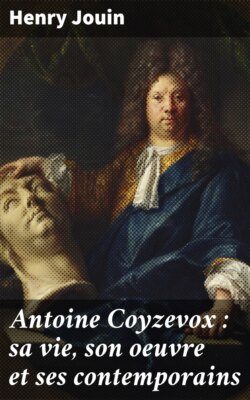Читать книгу Antoine Coyzevox : sa vie, son oeuvre et ses contemporains - Henry 1841-1913 Jouin - Страница 5
L’ÉCOLE FRANÇAISE DE SCULPTURE AVANT LE XVIIe SIÈCLE
ОглавлениеL’ÉCOLE DE SCULPTURE FRANÇAISE
AVANT LE XVIIe SIÈCLE
SOMMAIRE
Nécessité de parler des devanciers d’un homme supérieur. — Nul n’est indépendant de sa race ou de son époque. — Services rendus à l’histoire de l’art par Sauvai, Martenne, Duchesne, Félibien — Airard, sculpteur de l’Ile de France, au VIIIe siècle. — Tutilon, Theudon de Chartres, Guillaume de Dijon, Odoranne, Guillaume de Sens, Sigon de Fougères, sculpteurs français, du IXe au XIIe siècle. — Ecoles bourguignonne, champenoise, rhénane, poitevine, languedocienne, provençale, angevine, normande, et de l’Ile de France. — Millin, Emeric David et Alexandre Lenoir ont été les vrais créateurs de l’histoire de l’art en France. — Les maîtres de la sculpture au XIIe siècle: Jean de Chelles. Eudes de Montreuil, Sabine de Steinbach, Ravy, Le Bouteiller, de Saint-Romain. — L’étude de la nature caractérise la sculpture française au XIIIe siècle. — Floraison de la sculpture française avec Michel Colombe et Texier. — Souplesse du génie national. — Atteinte portée à la sculpture par le groupe gallo-florentin. — Primatice, Rosso, Cellini. — L’école de Fontainebleau. — Son style. — Le suicide de Rosso. — Les fontes de Primatice défendues par la duchesse d’Etampes. — Cellini et François Ier. — Influence de l’art antique sur le génie français. — Jean Goujon — Germain Pilon. — Nicolas Bachelier, Boudon. Richier, Gentil. — Retour à la tradition nationale. — Simon Guillain et Jacques Sarazin. — Anguier, élève de Guillain, forme Girardon. — Lerambert, disciple de est le maître de Coyzevox. — Louis XIV et Versailles. — Colbert. — Charles Le Brun. — Son talent, sa fécondité, son influence. — Le mérite de ses collaborateurs est la preuve que la postérité s’est montrée trop sévère envers Le Brun. — La discipline n’exclut pas l’indépendance du génie. — Nicolas Loir, Noël Coypel, les frères Marsy, Girardon, Coyzevox.
Je voudrais raconter la vie d’un sculpteur du dix-septième siècle, Antoine Coyzevox.
Avant de peindre l’homme dont je vais parler, peut-être n’est-il pas sans intérêt de rappeler ce qu’était l’école de sculpture en France au début du règne de Louis XIV. Nommer les devanciers d’un homme illustre dans l’ordre de la pensée, observer le caractère de ses contemporains, c’est établir la part d’influence à laquelle il n’a pu se soustraire. En même temps, c’est mettre en lumière la personnalité de cet homme. Tout portrait a besoin d’un cadre. Nul n’est indépendant de sa race ou de son époque. Nous recevons du milieu social dans lequel nous sommes nés quelque empreinte du génie national. En retour, quiconque porte une âme supérieure imprime à sa génération et à celles qui le suivent le sceau de son propre génie.
L’histoire de l’art dans notre pays s’est éclairée depuis quatre-vingts ans d’une lumière que n’avaient pas connue les siècles précédents. A la vérité, Sauval, Martenne, Duchesne, Félibien, avaient recueilli les éléments des tableaux d’ensemble que nos contemporains ont signés. Mais, à ces derniers revient l’honneur d’avoir réuni et mis en œuvre des documents épars, oubliés, perdus, d’où la vérité se dégage sur l’école française.
Il y a cent ans, les origines apparaissaient confuses. De bonne foi, personne ne se doutait guère que la sculpture sur le sol de France eût eu ses jours glorieux au temps de Charlemagne et de Philippe-Auguste. Airard, le sculpteur du portail septentrional de Saint-Denis, au VIIIe siècle; Tutilon qui travaillait à Metz en 880; Theudon, de Chartres; Guillaume, abbé de Saint-Benigne de Dijon; Odoranne et Guillaume, de Sens; Sigon, de Fougères, qui florirent du dixième au douzième siècle, étaient ignorés des critiques et des historiens d’art.
L’étude des styles n’avait pas obtenu des érudits une attention soutenue. Les écoles bourguignonne, champenoise, rhénane, poitevine, languedocienne, provençale, angevine, normande et de l’Ile-de-France qui, à l’aube du douzième siècle, luttent avec des aptitudes si diverses dans une égale activité, attendaient, il y a cent ans, qu’un savant, doublé d’un artiste, relevât leurs frontières et nommât leurs maîtres.
Cependant, plusieurs monuments remarquables, élevés par les artistes que nous venons de nommer, existaient encore au siècle dernier. Si Millin, Emeric David, Alexandre Lenoir avaient été devancés par des hommes de leur savoir ou de leur patriotisme, nous ne serions pas à jamais privés des trésors d’art détruits à l’époque de la Révolution. A défaut des œuvres de sculpture que le fanatisme a brisées ou fondues, il nous resterait le témoignage écrit de leur mérite.
Au treizième et au quatorzième siècle, l’école française élève des cathédrales qu’elle couvre de sculptures pendant que les mausolées des grands, habilement décorés par ses tailleurs d’images, prennent place sous les voûtes ogivales. Palais et châteaux se peuplent de statues. Bien que cette période soit éloignée de nous, il reste encore néanmoins de nombreux vestiges d’un art pratiqué par Jean de Chelles, Eudes de Montreuil, Sabine de Steinbach, Ravy, le Bouteiller, de Saint-Romain.
Le siècle suivant demeure éclipsé par l’éclat du nom de Ghiberti et de Donatello. Toutefois, pour ne citer qu’un maître, c’est l’heure où nous possédons Michel Colombe.
Jusqu’alors, notre école de sculpture avait vécu avec son tempérament, gardienne de sa doctrine. Aucun sang étranger depuis les premiers temps de la monarchie, ne s’était mêlé au sang de ses artistes. Ils étaient Français. Cédant à la pente logique de l’esprit national, c’est la nature qu’ils s’efforçaient de traduire. Etre naturel, imprégner un marbre de vérité, tel était le but de leur étude. Et cette poursuite du vrai dans l’interprétation naïve de la nature fut la passion si générale des maîtres d’œuvre de notre pays, dès le début du treizième siècle, qu’ils durent à cet effort continué d’atteindre à l’unité de style.
Au temps de Louis-le-Gros et de Philippe-Auguste, des écoles rivales luttaient d’ardeur et de puissance. Leurs caractères n’étaient pas exempts de contrastes. Sous Louis XII, en face des grandes œuvres de Michel Colombe, de Texier, il faut nommer une école non plus provençale, non plus rhénane, non plus poitevine, champenoise, bourguignonne, languedocienne ou normande, c’est l’école française. Aux contrastes qui, la veille, distinguaient chaque groupe, chaque province, ont succédé cette liberté de l’esprit et de la main, vertus natives de notre art national. Aucun genre, aucun mode d’expression ne seront étrangers à nos sculpteurs, parce que la sève intellectuelle dont ils vivent a des sources nombreuses et d’ordre différents. Mais cette richesse d’aptitudes, cette universalité dans le domaine plastique qui portent notre école à se mesurer avec la sculpture religieuse ou la sculpture d’histoire, l’allégorie ou le portrait, sont tempérées par une sorte de mesure, d’équilibre qui est comme la sauvegarde de l’art français. Alors que d’autres peuples cèdent invinciblement à l’emphase ou à l’afféterie, chez nous, la caractéristique de la sculpture est faite de simplicité, d’élévation, de bon sens.
Toutefois, l’école française n’a pas suivi une marche constamment progressive et ascensionnelle. Elle a eu ses temps d’arrêt. Au contact d’une école étrangère, sa sève s’est appauvrie, son courant a dévié.
Pour elle le seizième siècle fut l’écueil.
Primatice, Rosso, Cellini appelés par François Ier, ont été près de nos artistes de dangereux précepteurs. Ils étaient venus à nous escortés par la grande renommée de leurs compatriotes les Florentins. Comment ne pas subir l’ascendant des maîtres qui avaient sculpté la Madeleine pénitente et les Portes du Baptistère? Par malheur, Primatice et Rosso n’étaient eux-mêmes que des disciples. Ils n’avaient ni l’audace heureuse de Donatello, ni la puissance de Ghiberti. D’ailleurs, les grands Florentins étaient morts. Raphaël qui avait déplacé l’axe de toute gloire au profit de l’école romaine venait lui-même de disparaître. Son élève, Jules Romain, lui avait succédé ; mais Jules Romain demeuré sans tutelle ne sut pas grandir. Doué de pensée, ayant le sens de la richesse et de l’ampleur, prompt à l’exécution, original et savant, Jules Romain, malgré ses dons, est un maître fougueux et maniéré.
On sait dans quelles circonstances Rosso dût quitter Rome en 1530. L’année suivante, il était en France, intendant des bâtiments de Fontainebleau. Epris du renom de Jules Romain, il appela près de lui des Italiens qui travaillèrent sous ses ordres. Primatice, particulièrement désigné par son maître au choix de François Ier, s’était formé dans l’atelier de Jules Romain. Il vint en France en 1531. A la fois peintre, sculpteur et architecte, c’est lui qui dota Fontainebleau, s’il faut en croire Vasari, des premiers stucs que notre pays ait connus. Mais l’entente ne fut pas longue entre Rosso et Primatice. Celui-ci reçut l’ordre de se rendre en Italie pour surveiller la fonte ou le moulage des plus beaux antiques. Ce travail l’occupera neuf années. Pendant ce temps, Rosso est chef d’école sur la terre de France. Il est vrai, ses élèves sont de races très-diverses; leur style indécis et troublé, comme une musique balbutiée, n’a que de rares accents qui le rattachent à Michel Colombe. C’est un style gallo-florentin. Leur groupe ne fait pas illusion: ils ne s’appellent pas l’école française, mais l’école de Fontainebleau.
Ce qui sépare l’école de Rosso de celle qui avait prospéré au siècle précédent, c’est l’oubli de la nature. Les artistes de Fontainebleau sauront atteindre à la beauté des lignes, à l’harmonie de la couleur, à l’entente du clair-obscur, à la science myologique, mais je ne sais quoi de factice et de convenu dépare un très-grand nombre de leurs ouvrages. Je ne sais quoi de précieux, de cherché, d’élégamment incorrect blesse le regard dans les pages qu’ils ont laissées. En un mot leurs compositions manquent de cette simplicité lumineuse, de cette droiture que confère seule à l’œuvre d’art l’étude attentive de la vie, que nous appelons le naturel.
En ce temps-là, le génie de la France fut certainement en péril. Mais l’art, et principalement l’art plastique, reçoit la lumière de deux pôles. L’antique ne lui est pas d’un moindre secours que la nature. Le livre du sculpteur n’a que deux mots: création et tradition. Surprendre le secret de toute vérité tangible dans le chef-d’œuvre du monde créé qui est l’homme; parler la langue de ces maîtres divins, qui ont couvert la nature d’un manteau de splendeur, et dont les œuvres constituent la tradition de la sculpture, là se résume le double travail du statuaire vraiment digne de sa vocation.
Un jour de l’année 1541, quelques centaines de ducats disparurent de l’appartement de Rosso. L’impétueux artiste accusa de ce vol son ami, le peintre florentin Francesco Pellegrino. On soumit l’inculpé à la question. Peu après, son innocence fut reconnue, et Rosso s’empoisonna de désespoir, à quarante-cinq ans.
Nul obstacle ne s’opposait plus au retour de Primatice. Il revint en 1543. Un nouveau rival l’attendait: Benvenuto Cellini.
Tout le monde a lu le récit de cette scène fameuse qui eut pour théâtre la grande galerie de Fontainebleau, et pour témoins François Ier, la duchesse d’Etampes, le dauphin, Marguerite de Navarre, quelques seigneurs de la cour, Cellini, Ascanio et Primatice. Celui-ci avait rapporté d’Italie près de cent cinquante figures antiques. Des bronzes de l’Apollon du Belvédère, du Laocoon, de la nymphe dite Cléopâtre, de la Vénus de Médicis et de l’Hercule Commode, fondus à Fontainebleau sur les moulages obtenus à Rome, devaient être soumis à l’appréciation du Roi. En face de ces antiques fut placé le Jupiter en argent portant d’une main le globe, et dans l’autre un foudre. Cellini venait d’achever cet ouvrage.
Séduit par le talent de l’artiste, et sans doute aussi par divers artifices dont avait usé Benvenuto, le Roi donna la préférence à sa statue. Les courtisans firent de même. Vainement la duchesse d’Etampes voulut-elle en appeler d’un pareil verdict.
«— En vérité, dit-elle, on serait tenté de croire que vous n’avez point d’yeux. Ne voyez-vous donc pas ces figures antiques? C’est en elle que réside la perfection de l’art et non dans ces puérilités modernes.»
«— A ces mots, écrit Cellini, le Roi, suivi de son entourage, s’avança et jeta un coup d’œil sur les autres statues qui étaient éclairées d’en bas, ce qui leur était fort préjudiciable.
«— Celui qui a voulu nuire à Benvenuto, dit alors le Roi, lui a au contraire rendu un signalé service; car, de la comparaison de ces admirables figures avec la sienne, il ressort que cette dernière est infiniment plus belle et plus merveilleuse. Il faut donc tenir Benvenuto en haute estime, puisque ses ouvrages non-seulement égalent mais surpassent ceux des anciens .
Sans doute, nous pouvons croire que Benvemito Cellini, en consignant cette aventure, n’a pas dû atténuer les éloges que lui adressa le Roi. La nature vaniteuse del’artiste est connue. Mais le fait subsiste. Il montre quelle dut être la vogue de l’école de Fontainebleau, et en quel honneur était tenu sous François Ier le style gallo-florentin.
Cependant, un maître que n’avaient pas formé Rosso ou Primatice, Jean Goujon se chargea de répondre par ses ouvrages à l’engouement irréfléchi de la cour et des grands pour les Italiens. Non moins élégant que Primatice, Jean Goujon sut être naturel, expressif, et, dans les profils comme dans le méplat de ses bas-reliefs, ce merveilleux sculpteur fait songer aux Grecs. La nature et l’antique l’inspirent mutuellement. S’il cède, dans une certaine mesure, au goût de ses contemporains, lorsqu’il pose un personnage, il demeure supérieur aux artistes de sa génération par un modelé sobre, pur et vivant.
Germain Pilon le suivra de près. Les statues de François Ier et de Henri II révèlent l’habileté de ce maître, assez personnel pour secouer à ses heures le joug de Primatice.
Barthelémy Prieur, esprit moins original, appartient sans conteste à l’école de Fontainebleau dont il marque le déclin, mais en retour Nicolas Bachelier à Toulouse, Boudon à Orléans, Richier à Saint-Mihiel, Gentil à Troyes, et d’autres encore ont su préserver leur ciseau de tout contact avec Primatice. Plusieurs ont vu l’Italie, et le nom de Michel-Ange hante visiblement leur mémoire. N’importe, ces maîtres ont leur génie propre, ils relèvent l’art français dont ils sont les vrais représentants. La chaîne un instant rompue est renouée. Jean Texier, Michel Colombe ont des descendants à Toulouse, en Lorraine, en Champagne et sur les bords de la Loire.
La tradition nationale, ressaisie par des mains françaises, se transmit avec des alternative de progrès et de décadence jusqu’à Simon Guillain et à Jacques Sarazin.
Elèves du même maître, Guillain le père, surnommé Cambray, ces deux artistes se rendirent à Rome où Sarazin fut tellement frappé par les œuvres de Michel-Ange, que durant toute sa vie, dit Caylus, il se fit gloire du titre de disciple du Florentin. Mais pendant qu’ils séjournaient en Italie, Sarazin se lia avec le Dominiquin qui travaillait alors aux peintures de San-Andrea-Della-Valle. De son côté, Guillain, non moins admirateur que son compatriote du génie de Michel-Ange, gravait, entre deux statues, les compositions d’Annibal Carrache et de l’Albane.
De retour en France, les deux maîtres qui représentent la sculpture au début du dix-septième siècle firent preuve d’une science de composition, d’une puissance de modelé, d’une largeur de style vraiment remarquables.
Sarazin se plaisait à rappeler la forte nourriture qu’il devait aux maîtres italiens, mais ses Cariatides du Louvre, de même que les Captifs de Simon Guillain sont des oeuvres d’un caractère absolument original. La grâce des Cariatides de Sarazin permet de les comparer à certaines œuvres de Jean Goujon.
C’est à l’école de Sarazin que se forma Lerambert, le maître de Coyzevox. Girardon son émule, reçut les principes de Guillain par l’entremise d’Anguier.
Ainsi se résume, dans ses lignes essentielles, le tableau de la sculpture française antérieurement à Coyzevox. La filiation de nos statuaires peut être constatée. La race se perpétue avec honneur chez ses maîtres d’œuvre en quête de savoir, de talent, de prééminence et surtout d’individualité. Les sculpteurs français n’imitent pas volontiers. S’il advient qu’ils marchent pour un jour dans le sentier d’autrui, c’est qu’ils se sont pénétrés des procédés d’un maître étranger. Les ressources de leur génie, l’habileté qu’ils apportent dans le travail du marbre les poussent, à de certaines époques, à s’approprier, en se jouant, un style, une méthode qui ne sont pas les leurs. Mais le tempérament reparaît, la race n’a rien perdu de sa sève originelle, l’école de sa doctrine, et la sculpture française rentre dans son sillon qu’elle poursuit.
Coyzevox apparut à une heure solennelle dans l’histoire de l’art. Il atteignait à l’âge d’homme quand Louis XIV, au lendemain de la Fronde, ayant signé la paix des Pyrénées, inaugura dans le faste et le retentissement un règne que devaient rehausser toutes les gloires. Encore impressionné par des souvenirs de trouble et d’anarchie, le Roi méditait de rendre à la couronne tout le prestige dont la Fronde l’avait dépouillée. De là, cet appareil somptueux, l’étiquette, le luxe, les fêtes au milieu desquels voulut vivre Louis XIV. Bien qu’il eût passé son enfance au Palais-Royal, il n’avait pas d’attrait pour Paris. Or, jaloux de sa puissance, personnifiant en lui seul le pouvoir souverain, en s’éloignant de Paris il transférait le siège du gouvernement. Cette aversion pour la capitale décida de la construction de Versailles.
Un homme d’un rare mérite devait seconder Louis XIV dans ses somptueuses entreprises. Colbert, succédant à Fouquet avec le titre de contrôleur général des finances, devint bientôt ministre de la maison du Roi. Les Comptes des Bâtiments nous révèlent la sollicitude de Colbert pour les lettres et l’art. L’Académie de France à Rome, Versailles, Marly, le Louvre, les Tuileries, les Invalides, les Gobelins occupent tour à tour cet esprit ordonné, précis et désintéressé quand la gloire de la France est en cause. Mais, des créations de Colbert, celle dont nous aurons à parler davantage dans cet écrit, c’est Versailles.
Louis XIII avait élevé dès 1624, une maison de plaisance à Versailles. Le roi n’y résidait pas. Son château était à Saint-Germain. Lorsque Louis XIV eut résolu d’agrandir Versailles et d’en faire sa résidence, le domaine, aussi bien que le palais, durent être transformés. C’est en 1663, c’est-à-dire à l’avènement de Colbert au poste de contrôleur général, que les travaux commencèrent. On estime qu’ils coûtèrent au Trésor près de cinq cents millions.
L’art tient une large place dans ce monument, et de même que Colbert était l’instrument de la pensée royale, Le Brun fut l’intendant du ministre.
Le Brun n’était pas un inconnu. Guillain et Sarazin ayant eu la pensée de grouper quelques artistes en une sorte de conférence intime, dont le but était de mettre en commun les principes, les lumières de chacun dans la pratique de son art, Le Brun avait affermi cette création en obtenant des lettres-patentes qui la constituaient en Académie de peinture et de sculpture. L’un des Anciens de cette Académie, Le Brun, dut à la faveur de Colbert d’être nommé premier peintre du Roi, directeur de la manufacture des Gobelins, et d’exercer pendant près de vingt années une autorité directrice sur l’école française.
Encore que son action ne s’étendit qu’aux travaux commandés par Colbert, les projets aussi grandioses que nombreux du ministre de la maison du Roi suffirent pour occuper de 1661 à 1683 la plupart des artistes en renom. Le Brun fut l’ordonnateur de toutes choses. Peintres, sculpteurs, architectes, tapissiers, orfèvres, reçurent de lui les cartons ou les modèles de leurs compositions. D’une fécondité sans exemple, il concevait le plan d’un plafond, d’une tapisserie, d’un vase non moins aisément que celui d’une fontaine, d’un groupe, de trophées, de torchères ou de girandoles. Les bronzes, les mosaïques, les incrustations de toute nature, les candélabres, et jusqu’aux serrures élégamment ciselées des résidences royales, ont été dessinés par Le Brun. Il est pendant un temps le seul décorateur des demeures opulentes qui s’élèvent.
La postérité ne le lui a guère pardonné.
Cependant, nul artiste au dix-septième siècle n’était en mesure de subvenir à des obligations de cette importance. Son érudition, sa science du mouvement, l’entente de l’allégorie, du costume, des attributs qui le distinguaient, placent Le Brun au premier rang parmi ses contemporains. N’eût-il peint que la Clémence d’Alexandre envers la famille de Darius, il faudrait encore le proclamer un maître. D’autre part, nous devons à ses hautes fonctions sous Colbert cette unité surprenante qui frappe les moins attentifs dans la décoration de Versailles, des Tuileries ou du Louvre.
Au surplus, la part décisive qui lui revient dans la création de l’Académie de France à Rome, l’institution des conférences sur l’art au sein de l’Académie de peinture, dont il est resté en fait le directeur pendant vingt-huit ans, lui avaient concilié l’estime de ses pairs. La subordination consentie dans laquelle ils vécurent vis-à-vis de Le Brun ne fut pas pour le grand nombre un sacrifice. Pour aucun des vrais artistes de ce temps elle ne fut une sérieuse entrave. N’oublions pas, en effet, que les auxiliaires de Le Brun se sont appelés Nicolas Loir, Noël Coypel, Gaspard et Balthasar Marsy, Girardon, Coyzevox. Collaborateurs dociles, capables d’apprécier le bienfait d’une direction lorsqu’il s’agit de concourir à quelque œuvre commune, ces artistes n’ont rien perdu, que nous sachions, dans la discipline à laquelle les ont soumis Colbert et Le Brun. Coyzevox, notamment, dont nous allons retracer la vie, est une preuve de cette indépendance de la pensée sans laquelle l’homme d’art n’est qu’un praticien.