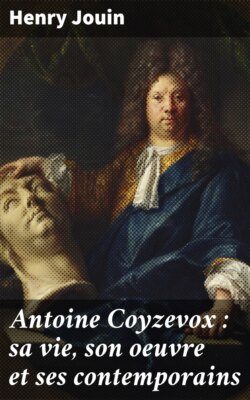Читать книгу Antoine Coyzevox : sa vie, son oeuvre et ses contemporains - Henry 1841-1913 Jouin - Страница 7
LES SCULPTURES DE SAVERNE
Оглавление1640-1677
SOMMAIRE
Antoine Coyzevox, fils d’un menuisier. — Origine espagnole des Coysevox. — Leur nom. — Enfance d’Antoine. — Le menuisier Coustou. — François Coustou, le fils, sculpteur habile. — Guillaume Coyzevox, frère d’Antoine, aussi sculpteur. — Antoine sculpte le bois. — «Vous faites un cheval? — Je ne le fais pas, je le découvre! » — Mariage de Claudine Coyzevox, sœur d’Antoine, avec François Coustou. — Antoine vient à Paris. — Le «fameux monsieur Lerambert.» — Quels furent les maîtres de Coyzevox outre Lerambert? — Les œuvres de Coyzevox exécutées à cette époque ne sont pas connues. — Mariage d’Antoine Coyzevox avec Marguerite Quillerier, nièce de Lerambert. — Coyzevox, sculpteur du roi. — Mort de Marguerite Quillerier. — Le maître sculpte un morceau de frise au palais du Louvre. — Il se rend à l’appel du cardinal François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg. — Un mot de Fermelhuis. — Le palais de Saverne. — Apollon et Les Muses. — Trophées et statues. — Les sculptures de Saverne détruites. — Retour de Coyzevox à Paris. — Il est reçu académicien. — Coyzevox veut se fixer à Lyon. — Le Brun le retient à Paris. — Mariage de Coyzevox avec Claude Bourdict. — Où a lieu son mariage? — Il loge aux Gobelins. — Les travaux de Versailles.
Antoine Coyzevox, fils d’un menuisier de Lyon, naquit dans cette ville le 29 septembre 1640. Son père habitait la paroisse de Saint-Nizier .
Le docteur Fermelhuis qui prononça l’éloge du statuaire en 1720, nous apprend que Pierre Coyzevox, le père d’Antoine, était originaire de Madrid, tandis que sa mère, Isabeau Morel, était lyonnaise. Il faut le croire, Fermelhuis ayant été l’ami du sculpteur. C’est d’ailleurs le seul témoignage autorisé que nous possédions de l’origine espagnole des Coyzevox.
Certains biographes, en effet, appuient cette origine sur la consonnance du nom et son orthographe peu commune dans notre langue. Des preuves de cet ordre seraient spécieuses, car c’est Antoine Coyzevox qui paraît avoir modifié l’orthographe de son nom. Pierre, le menuisier lyonnais, signait Quoyzeveau; en 1666, le statuaire écrit Quoyzeuaux. En 1679, le buste de Le Brun est signé Coyzevox. A dater de cette époque le nom du maître ne varie plus .
Nous savons peu de chose sur l’enfance d’Antoine. Toutefois, il est permis de penser que son père fut son premier maître. Au XVIIe siècle il n’était pas rare de rencontrer des marbriers sculpteurs et des menuisiers ornemanistes. Formelhuis a dit dans l’Éloge de l’artiste: «Ses jeux furent une étude si solide des principes de la sculpture, qu’à l’âge de dix-sept ans il fut en état de quitter le lieu de sa naissance et de venir travailler à Paris .
Si les yeux de l’enfant l’ont porté vers l’art du sculpteur, c’est sans doute que des modèles placés sous ses regards dans l’atelier paternel l’inclinaient à les reproduire. L’enfant copie naturellement ce qu’il voit.
D’ailleurs, Pierre Coyzevox n’était pas le seul artisan qui fût en mesure de seconder la vocation d’Antoine. Pierre avait pour émule un artiste industriel, menuisier comme lui, nommé Coustou. L’un des fils de ce Coustou, plus âgé qu’Antoine Coyzevox, demandera la main de sa sœur aînée, Claudine. Les deux familles étaient donc en relations. Or, le mari de Claudine, François Coustou, père des statuaires Nicolas et Guillaume, était lui-même un sculpteur sur bois d’un réel talent . On sait qu’il fut le premier maître de ses deux fils et qu’il travailla pour le Roi . Coyzevox lui dut peut-être quelques leçons lorsqu’il habitait encore sa ville natale.
Un frère d’Antoine, dont la date de naissance nous est inconnue, prend en 1677 la qualification de sculpteur . Il signe Guillaume Coizevaud. Antoine a donc vécu, dès son extrême jeunesse, dans un milieu propice à sa vocation. L’art plastique est l’occupation de ses proches et de ses amis. Ces artisans de goût donnent au bois qu’ils travaillent une forme capricieuse ou sévère; les figurines, les meubles, les boiseries se succèdent sous leurs ciseaux déliés, et l’âme de l’enfant qui doit devenir un maître ne reçoit du dehors selon toute apparence que des impressions heureuses , en harmonie avec ses propres dons. Sous ses yeux tout parle d’élégance, d’adresse, de parure. L’art décoratif est, pour ainsi dire, l’atmosphère dans laquelle il grandit.
Un jour, on le surprit lui-même taillant un morceau de bois. — «Vous faites un cheval, lui dit la personne qui l’observait» ? — «Je ne le fais pas, je le découvre», répondit l’enfant .
Si l’anecdote est vraie, cette parole de Coyzevox décèle un génie précoce. Tel mot qui sur d’autres lèvres serait vide ou subtil, a, dans la langue de l’artiste, un sens juste et profond. Il est l’expression d’une nuance que discernent seuls les hommes de pensée.
Promptement supérieur aux ornemanistes qui l’entouraient, se sentant poussé vers le grand art, Antoine Coyzevox quitta Lyon et vint à Paris. Il avait environ dix-sept ans. Son départ dut avoir lieu peu après le mariage de sa sœur Claudine avec François Coustou .
Lerambert, élève de Vouet et de Sarazin, jouissait alors d’un véritable renom. Sculpteur du Roi, garde des marbres de Sa Majesté, et garde du magasin des antiques, Louis Lerambert joignait à tous ces titres du savoir-vivre, de l’esprit, quelques aptitudes pour la poésie et la musique, et il était, en outre, un danseur consommé. Ses succès nombreux et variés appelaient sur lui l’attention des grands. Il avait fait les bustes de Mazarin et de Jabach, décoré l’hôtel du marquis de Dampierre; il excellait dans les figures d’enfants. Ami de Le Brun et de Le Nostre, il eut sa grande part dans les travaux de Versailles et du Louvre. Si, à l’époque où Coyzevox arrive à Paris, Lerambert n’est pas encore à l’Académie royale, c’est qu’il n’a pas pris le temps d’y songer. Artiste brillant, d’un caractère digne d’estime, sa réputation lui survit, et Guillet de Saint-Georges écrivant quelque vingt ans après la mort de son modèle, l’éloge de Lerambert, le suppose filleul de Louis XIII, tenu sur les fonts par Cinq-Mars. Cette fois, ce n’est plus de l’histoire mais de la légende . Quand Fermelhuis parlera de lui, nous l’entendrons dire: «le fameux M. Lerambert.»
Nous ignorons si Coyzevox reçut de prime-abord les enseignements de ce statuaire. Nous savons seulement qu’il eut plusieurs maîtres parmi «les plus célèbres» de l’époque.
Or, l’école de sculpture était alors florissante. Il est vrai, Simon Guillain allait s’éteindre et Coyzevox eut à peine le temps de l’entrevoir; son ami Jacques Sarazin n’avait plus que deux ans à vivre, mais François Anguier, Buyster, Girardon, Van Opstal, Guérin, Gaspard de Marsy, Jaillot, Buirette, Magnier, Le Hongre, Regnaudin formaient une pléiade d’artistes sérieux, convaincus, dans la force du talent. C’est assurément auprès d’eux que le sculpteur lyonnais chercha des maîtres, puis s’attachant à Lerambert, il suivit plus spécialement ses leçons.
Aucune trace ne subsiste des travaux que dut exécuter Coyzevox pendant les dix années qu’il passa près de Lerambert. Toutefois, deux faits semblent prouvés: le disciple se fit aimer du maître et il acquit de la réputation.
Le gage de l’entente cordiale et de l’attachement qui rapprochèrent ces deux hommes est dans le mariage que contracta Coyzevox à quelque temps de là.
Lerambert appartenait à une nombreuse famille: son père avait eu dix enfants. L’aînée de tous, Charlotte , était devenue la femme du peintre Quillerier, lorsqu’elle n’avait encore que seize ans . Noël Quillerier «peintre et valet de chambre ordinaire du Roy» fut, on le sait, le maître de Noël Coypel. C’est une des filles de Quillerier que demanda Coyzevox. Leur union fut célébrée le 18 janvier 1666. Le sculpteur avait alors vingt-six ans. La nièce de Lerambert, Marguerite Quillerier, comptait près de vingt-sept ans .
Comme on le pense bien, les proches de Coyzevox ne purent assister à son mariage. Lyon est éloigné de Paris. Le voyage eût coûté cher. Pierre Coyzevox et François Coustou n’étaient pas riches. Personne ne vint. Les signataires au registre de Saint-Germain-l’Auxerrois sont des Lerambert et des Quillerier
Quelque estime que méritât l’artiste lyonnais, nous pensons qu’il ne fût pas entré dans la famille de son maître si le talent n’avait été chez lui égal au caractère. Peut-être s’était-il déjà révélé par une œuvre de mérite. Le travail du marbre, dans lequel il excella toujours, lui valait sans doute dès cette époque de sérieux succès. Sur ce point, l’histoire n’a rien dit, et en face des bustes nombreux que le statuaire n’a pas datés, nous ne savons s’il serait juste d’en rattacher quelques-uns à l’année 1666. Il y a lieu de le croire, car malgré sa jeunesse, l’artiste reçut cette année même le titre de sculpteur du Roi. Une part lui était échue dans les travaux du Louvre. Or, Le Brun n’était pas à court de sculpteurs. L’Académie royale en comptait d’illustres. Avant d’appeler un jeune homme à lutter d’adresse avec eux, il fallait que ce nouveau venu se fût signalé.
La vie s’ouvrait radieuse devant notre artiste. La gloire l’avait marqué du doigt. Il se sentait honoré. L’or nécessaire à ce fils d’ouvrier lui était versé dans la mesure de son amour du beau. De plus, il avait un foyer.
Hélas! ses joies furent brèves. Dieu qui lui réservait de longs jours le grandit par l’épreuve. Il connut la douleur à l’âge de sa virilité. Assez fort pour en porter le poids sans fléchir, c’est à l’art qu’il demandera le calme de la pensée.
Il y avait moins d’une année que Marguerite Quillerier avait épousé Coyzevox quand elle mourut. Etrange coïncidence! Nous qui, après deux siècles, essayons de retracer une vie d’artiste, nous n’avons d’autres preuve de l’élévation du statuaire pendant l’année 1666 que l’acte de décès de sa femme. Cette pièce est le seul document où se trouve consigné Le titre de sculpteur du Roi à la suite du nom de Coyzevox . Ainsi la douleur qui est le fond de toute existence humaine laisse de son passage des signes plus durables que le succès, et souvent c’est à sa lumière que l’historien se guide dans le passé.
Le premier soin du statuaire, au lendemain de son deuil, fut de tenir parole à Le Brun. On était alors au début de l’année 1667. Coyzevox s’acquitta d’un «morceau de frise» qu’il avait à sculpter au palais du Louvre. Il fit encore, lisons-nous dans les Comptes des Bâtiments, divers autres ouvrages de sculpture qui lui furent payés cent-trente-cinq livres , puis, sa tâche remplie, l’artiste ne sollicita pas de nouvelles commandes. Il s’exila de France à l’appel du cardinal François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg.
Ce prélat faisait élever à Saverne, au pied des Vosges, un palais somptueux. Un parc, orné de grottes, de ruines, de pièces d’eau, entourait cette résidence et couvrait tout l’espace qui la séparait de la forêt de la Faisanderie, distante de deux kilomètres . A l’intérieur du château, le luxe le plus magnifique. De vastes salles, de riches galeries, un escalier d’honneur, des voûtes, des plafonds attendaient qu’un décorateur plein de hardiesse les revêtît de ces ornements sans lesquels l’architecture est froide et privée d’éclat.
Coyzevox fut l’un de ces décorateurs. Fermelhuis dit expressément que l’artiste n’avait que vingt-sept ans quand le cardinal de Furstenberg, «par une distinction honorable», l’appela au château de Saverne. «Ce fut là, dit le même historien, que produisant ses ouvrages en son propre nom, on commença d’en compter un nombre prodigieux, quoique peut-être ils n’égalassent point encore ceux qu’il avait faits à Paris, qui passaient pour l’œuvre de ses maîtres, qui n’auraient pas voulu les désavouer .» Paroles mystérieuses dont les réticences laissent entrevoir bien des luttes. Peut-être le sculpteur lyonnais s’en était-il allé emportant au cœur plus d’une blessure!
Affranchi de toute servitude, il se mit à l’œuvre. Il se sentait fier de créer librement des compositions savantes ou gracieuses, au gré de son imagination fertile. Bientôt ses ateliers furent peuplés de modèles et d’études. Une voix intérieure lui répétait cette devise du gentilhomme «Fac bene, nominaris, Fais bien, tu es en renom.» Et le cardinal de Furstenberg, loin d’entraver son sculpteur, applaudissait à son génie.
C’est dans ces conditions que Coyzevox exécuta pour la grande salle du palais une corniche circulaire richement ornée. Au-dessus, dans le plafond de cette même salle, l’artiste modela en stuc une figure de grandes proportions représentant Apollon Musagète. Le fils de Latone avait près de lui Clio, la muse de l’histoire, Euterpe qui joue de la double flûte, Thalie qui inspire Aristophane, Melpomène au front couronné de pampres, Terpsichore qui tient la lyre, Erato la muse d’Anacréon, Polymnie sérieuse et pensive, Calliope, mère de l’épopée, Uranie qui commande aux astres.
Autour de la salle d’honneur, Coyzevox disposa des Termes et des statues.
L’escalier principal reçut de l’artiste divers ornements et quatre Trophées gigantesques.
Dans le parc, huit statues colossales et vingt-quatre Termes en pierre de grès furent sculptés par Coyzevox .
De cet ensemble considérable, signé par un seul maître, rien n’est parvenu jusqu’à nous. Le palais de Saverne, achevé par le cardinal de Rohan pendant la première moitié du dix-huitième siècle devint la proie des flammes en 1780 . Les sculptures intérieures furent détruites. Treize ans plus tard, au moment où le palais se relevait de ses ruines avec l’or du cardinal de Rohan-Guémené, la Révolution fit disparaître les œuvres d’art accumulées depuis plus de cent ans dans ce domaine princier.
Coyzevux avait employé quatre années à la décoration du palais de Saverne. Il revint à Paris en 1671 . Une grande réputation l’y avait précédé. Le talent dont il venait de faire preuve à l’étranger lui était compté par ses compatriotes. Il entrait de plain-pied dans l’élite des sculpteurs. Désormais la considération, l’aisance lui étaient promises. Il marchait d’un pas assuré vers la gloire .
Son maître, Lerambert, était mort, mais Le Brun lui restait; Le Brun, l’ami de Colbert et de Louis XIV. Coyzevox ne tarda pas à modeler le buste de Le Brun. Cette attention délicate rendit plus étroite l’intimité des deux maîtres. D’autre part, la franchise de Coyzevox, la distinction de ses manières, un caractère égal et de grande douceur lui conciliaient naturellement l’estime ou l’affection de ses pairs. Miel assure que le roi lui-même honora le sculpteur de sa bienveillance. L’Académie ne pouvait exiger davantage de Coyzévox, Il y entra le 11 avril 1676.
Mais que s’est-il passé ? Avant d’être élu, le nouvel académicien a informé ses confrères qu’il abandonnait Paris. Le procès-verbal de la séance où il est admis nous révèle ce singulier dessein. C’est à Lyon que le statuaire veut se fixer,
Quelle hésitation le trouble? A-t-il peur des hasards? D’où lui viennent ses timidités? Comment expliquer ce refus de la renommée à l’heure où il peut s’en saisir? Cependant le registre de l’Académie ne permet aucun doute. Une école de dessin doit s’ouvrir à Lyon par les soins du peintre Blanchet. Cet artiste a placé sa fondation nouvelle sous le patronage de l’Académie royale de Paris. Sensibles à la déférence que leur marque Blanchet, les Académiciens se montrent favorables à son entreprise, et c’est Coysevox qui sera leur mandataire près de l’école de Lyon. «Le sieur Coysevaux, dit le texte officiel, qu’y a este resçeu en calité d’académicien, ayant desclaré qu’il estoit resolust de s’establir et faire sa résidance en la ville de Lion, l’Académie l’a reçeu et nomé adjoint-professeur, pour, en cette qualité, porter en laditte ville copie des lestres-patentes, statuts et règlement de ladite Académie et faire les fonctions qu’il appartiendra, promettant de luy aider de ses advis et conseilles en toute choses.»
Neuf mois s’écoulent et l’artiste n’a pas changé d’avis. Le procès-verbal du 2 janvier en fait foi. «Ce mesme jour, y est-il dit, a esté faict lecture de la commission pour l’establissement de l’escolle académique en la ville de Lion, commestant à cest esfect monsieur Blanchet et Coyzevaux pour faire tout ce qui sera nesessaire aud. établissement. L’Académie a admis mond. Sr Coysevaux en la qualité de proffesseur et a signé lad. commission .»
Le 13 février suivant, Coyzevox est désigné «desputéz pour l’establissement de l’Escolle académique de Lion» et il présente une lettre des Lyonnais que le secrétaire appelle «Messieurs ses collègues .»
Ainsi l’intention du sculpteur n’a pas varié. C’est Lyon qui l’attire et il va s’y rendre au premier jour. Sa carrière qui se dessinait à Paris avec tant d’éclat ne le retiendra pas. Peut-être est-il séduit par l’exemple de Puget, demeuré fidèle à la Provence. L’espoir d’être chef d’école et de compter des disciples au lieu même de ses débuts, le désir de se rapprocher de son père, entrèrent-ils pour une part décisive dans le plan du statuaire? Personne aujourd’hui ne le sait. Ce qu’il est permis de supposer, c’est qu’au dernier moment Le Brun, devenu l’ami de Coyzevox, lui marqua sa place à Paris. D’autre part, le voisinage de Girardon, Coypel, Tortebat, De La Fosse, ses collègues à l’Académie, dut être pour l’homme qui nous est connu la source d’une émulation sérieuse. Mais des motifs d’un autre ordre influèrent aussi sur la détermination de l’artiste.
Il y avait déjà onze années que Coyzevox était veuf. Il se lassa d’être seul et vers les derniers mois de 1677, il demanda la main d’une jeune fille nommée Claude Bourdict. On a lieu de penser qu’elle était lyonnaise . Leur mariage eut-il lieu à Paris ou à Lyon? Ne serait-ce pas le refus prolongé de Claude Bourdict de se séparer des siens, qui pendant si longtemps aurait tenu le statuaire dans l’hésitation sur sa résidence définitive? Aucune pièce authentique, relative à l’union de Coyzevox et de Claude Bourdict n’est connue. Quoiqu’il en soit, enlevé par son mariage à des perplexités qui n’avaient rien de raisonnable, le sculpteur ne songea plus à se fixer à Lyon. Le Brun lui fit obtenir un logement aux Gobelins. En même temps, Coyzevox était de la part de Colbert l’objet d’une attention distinguée. Les travaux considérables qui lui furent confiés à Versailles en cette même année 1677, attestent mieux que des discours l’estime du premier ministre pour le sculpteur.