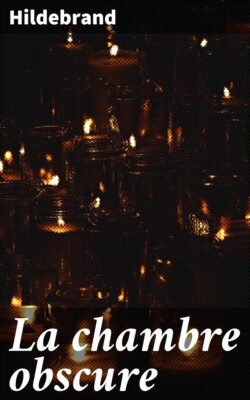Читать книгу La chambre obscure - Hildebrand - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II MALHEURS D'ENFANT
ОглавлениеJe reviens encore une fois aux beaux vers de Holtz:
Qu'on est heureux quand l'habit de l'enfance
Vous flotte encore sur les épaules!
Jamais le méchant temps ne le calomnie;
On est toujours gai et content.
Rien n'attriste, rien dans le monde entier,
Son visage serein et radieux,
Que quand son édifice tombe à l'eau
Ou que son sabre se brise.
Il ne manque certainement pas d'éloges de la jeunesse et des jeunes années. Je l'avoue de tout cœur; mais je prends la liberté de remarquer qu'ils sont uniquement écrits par des hommes d'âge, ou au moins par des jeunes gens au point de vue desquels le bonheur de l'enfant ne souffre presque pas d'exception. Et c'est assurément une triste preuve de la désolante situation de l'homme dans les jours plus avancés. Mais je ne sais s'il y a jamais eu de petits poëtes de sept, huit ou neuf ans, qui aient trouvé leur bonheur actuel aussi inestimable. Et cependant ceux-ci en étaient tout près. Lorsque j'allais à l'école hollandaise; nous faisions dans la classe supérieure, composée de messieurs de neuf à dix ans, tous les mercredis matin, une composition tantôt sur un sujet donné, tantôt sur un thème choisi et imaginé par nous. Mais, j'en appelle aux Jean, Pierre, Guillaume et Henri avec lesquels j'ai été assis sur les bancs de la rue des Jacobins, y a-t-il jamais eu quelqu'un parmi nous qui ait rempli son ardoise d'une dissertation ou d'une amplification sur les jouissances et sur le bonheur inaltérable de l'enfance? Non, nous écrivions des articles pleins de sens sur la vertu ou sur les quatre saisons; et Sanderre, dont le père était adjudant d'un général, a six fois écrit sur le cheval; et Pierre G., qui n'était jamais sur le tableau de punition, et ne voulait pas prendre part au noble exercice d'attraper des horions; il traitait toujours de l'obéissance et du zèle, idée à laquelle le ramenaient toujours les inscriptions de ses cartes de satisfaction. Enfin, je n'ai jamais vu mes collègues traiter des sujets joyeux. Moi-même, je n'ai jamais guère pu produire qu'une dissertation philosophique sur le contentement, un bonheur qui passe ordinairement devant le jeune homme, qui est vraiment ambitionné par l'homme fait, et qui viendrait parfaitement à point au vieillard si ses infirmités corporelles lui permettaient encore d'en jouir. C'est une très-jolie chose que le contentement, mais qui est renfermée dans l'ensemble du bonheur de l'enfant et n'a rien en soi de remarquable.
Mais, pour en revenir à notre sujet, cette plénitude de bonheur de l'enfant, nous n'en semblions pas, dans ce temps-là, tellement pleins, que nous dussions l'épancher. J'ai bien pensé un jour qu'un signe du vrai et authentique bonheur est qu'on a moins besoin de s'épancher, tandis qu'au malheur il faut des plaintes et des lamentations pour ne pas verser de larmes. Car les hommes qui ont toujours la bouche pleine de leur bonheur, je les ai vus souvent chercher une autorité qui, après avoir entendu leur rapport, pouvait déclarer qu'ils sont heureux, ce dont eux-mêmes n'étaient pas de sûrs appréciateurs. Ils s'estiment ainsi, non pas précisément heureux, mais malheureux avec excès; mais ils réunissent ce qu'il y a de bon dans leur sort, et l'accumulent dans les discours qu'ils vous font à la promenade, ou si vous dormez dans la même chambre qu'eux, surtout après un bon souper, ils vous adressent la parole de leur lit, de façon à vous faire envier leur position; cela élève incontinent leur froid bonheur à une haute température. Vous appliquez une main chaude sur leur thermomètre.
C'est là une belle remarque que j'ai faite et que je clos par cette jolie image physique; mais, en réfléchissant davantage sur le sujet, je me suis souvent demandé si l'école est bien le lieu où l'on peut sentir profondément le bonheur de l'enfance. Je sais bien que le maître n'est plus assis en bonnet de nuit et en robe de chambre, et armé d'une effrayante férule, dans la chaire, et ne nous porte plus par l'expression terrible de ses yeux et de ses gestes à une telle fayeur que, à l'exemple des jeunes gens d'autrefois, nous eussions avoué que c'est bien nous qui avons créé le monde, mais que nous ne le ferons plus, plutôt que de rester sans réponse à la première question du catéchisme, et aussi nous ne lisons plus, à notre formidable ennemi le Journal de Harlem, depuis a jusqu'à z. (En sommes-nous moins bons politiques)? Nous sommes aussi dans un bon et vaste local, si haut et si aéré, que parfois nous avons des courants d'air dans les jambes; il n'est pas rare que nous ayons vue sur une blanchisserie avec un pommier ou sur une cour intérieure. Mais le maître est si gros et les sous-maîtres sont si longs, leurs lunettes et leurs favoris ont un air si impitoyable, et les tableaux sont si noirs, et les tables si insociables, et la carte des Pays-Bas est pendue depuis si longtemps à la même place, que nous savons mieux y indiquer de petites déchirures et taches d'encre que les villes... C'était encore alors les dix-sept provinces[1]. Ajoutez à tout cela, le cœur m'en saigne encore, la table des occupations terribles, occupations dont l'addition fait penser aux livres d'arithmétique et de géographie, et à tant d'autres livres dont les feuillets vacillent dans les volumes, à cause des attouchements convulsifs des doigts désespérés de jeunes messieurs qui ne peuvent retenir combien de vaches viennent par an au marché au bétail, combien d'habitants et d'imprimeries il y a à Enschedé, et combien il y a à Harlem de sacristies et d'instituts pour les maîtres d'école, et qui ne peuvent saisir comment ils doivent s'y prendre pour établir la somme des règles précédentes! Oh! les livres d'arithmétique, c'était le côté faible de beaucoup d'entre nous. À mes yeux, il n'y avait pas de livres plus odieux. D'abord, ils étaient trop pleins de lettres et puis trop pleins de chiffres. Il y a parfois une profusion de fautes dans l'indication des résultats; mais si ces fautes n'y sont pas, en revanche, les éditions sont détestables. Voyez un peu, vous avez votre ardoise couverte d'une addition importante; trois fois déjà vous en avez effacé la moitié, parce que vous avez remarqué que vous n'aviez pas compris la question; mais enfin la somme y est, et vous avez comme résultat: 12 lastes[2], 7 muids, 5 boisseaux, 3 litrons, 8 mesures d'orge. La conscience tranquille et avec le bienheureux sentiment d'avoir fait votre devoir comme membre zélé de la société, vous devriez donner votre ardoise au sous-maître. Mais non! l'odieux livre donne, sous ce titre présomptueux: Résultat,—95 lastes, 2 muids, 1 boisseau d'orge et pas une seule mesure. Il est évident qu'il y a une erreur; vous avez fait trois fois toutes les multiplications et toutes les divisions: enfin vous prenez la résolution d'effacer tout, et vous avez encore votre manche sur l'ardoise, lorsque le sous-maître vient et croit que vous n'avez rien fait. Voilà ce que j'avais contre les livres d'arithmétique. Mais le pire et le plus absurde de cette invention, c'est qu'elle vous tient captif de toutes les manières. Vous êtes là depuis neuf heures et demie à l'école par le beau temps, dans le mois de mai, lorsque la verdure est jeune comme vous, et, ce qui est plus, lorsque les mares et la boue sont desséchées, et que le magnifique temps est on ne peut plus favorable au jeu de chiques. Vous êtes depuis neuf heures et demie à l'école où vous avez mis le pied en jetant un regard d'envie sur les enfants des pauvres, qui ne reçoivent pas d'instruction et jouent aux dutes[3] dans la rue. On vous a d'abord forcé de chanter avec vos compagnons de jeu le cantique:
Quelle joie! l'heure de l'école a sonné
Que chaque enfant désire tant!
—Après cela, vous avez lu pendant une heure sur un modèle de bon petit garçon, si bon, si doux, si obéissant, si habile et si studieux, que vous lui donneriez volontiers un regard de vos yeux bleus si vous le rencontriez dans la rue; ou si vous êtes un peu plus avancé, l'esquisse de la vie d'un très-grand homme qu'il vous semble pédant et désespéré d'imiter; et cette esquisse est entremêlée artistement d'un entretien entre des petits garçons et des petites filles avec lesquels vous n'avez pas la moindre sympathie, quoiqu'ils soient «vraiment étonnés des effrayantes connaissances de ce grand homme» dont le père Telhart et Braelmoed leur racontent l'histoire. Pendant l'heure suivante, vous avez écrit un bel exemple; c'est à savoir si vous écrivez en grand le mot wederwaardigkeit[4], remarquable par deux difficiles w; vous le tracez sept fois sans pouvoir le réussir, ou, si vous écrivez en petit, vous le tracez quinze fois, huit fois au-dessus et sept fois sur la ligne Voorzigtigkeid is de moeder der wysheid[5], dans laquelle circonstance vous avez omis deux fois le mot der, ce qui peut arriver très-facilement à la suite de la dernière syllabe du mot moeder, et vous avez mis une fois voorzwyzigkeid au lieu de voorzigtigkeid; ces erreurs vous font penser avec un peu d'anxiété à l'heure où la critique du maître viendra prononcer son arrêt. Pour ne pas parler de ce que vous avez été tourmenté par une mauvaise plume, par d'innombrables cheveux dans l'encre, par un tache ou deux jetées avec la nonchalance d'un artiste sur votre cahier d'écriture, et l'inflexible loi qui vous a obligé de donner votre plume deux fois pour la faire tailler à un sous-maître qui s'y entend autant qu'à écrire. Puis vient l'arithmétique. Je l'ai laissée longtemps attendre, chers lecteurs, mais c'est parce que pour moi elle est arrivée si souvent trop tôt! Voici l'arithmétique! Remarquez que, dans le cours de la matinée, vous êtes inscrit deux fois au tableau des punitions: une fois parce que vous avez murmuré à l'oreille de votre voisin de droite d'une façon suspecte, bien que ce que vous lui avez dit ait traité des balles à bon marché dans la large ruelle du Pommier, et une fois parce que vous avez laissé voir à votre voisin de gauche une chique en albâtre, sur quoi le corps du délit vous a été enlevé, et vous êtes dans la pénible incertitude de savoir si vous le reverrez jamais. Réunissez tout cela et ouvrez votre arithmétique, qui vous agace avec la treizième somme et où, comme pour vous faire subir le supplice de Tantale, elle vous présente avec le plus grand sang-froid un bel exemple de cinq petits garçons, je dis cinq, qui doivent jouer ensemble aux chiques et dont l'un a, au commencement du jeu vingt chiques, le second trente, le troisième cinquante, le quatrième... Il n'y a pas à y tenir, les larmes vous viennent aux yeux; mais vous êtes encore là pour une heure entière et à chiffrer encore! Oh! je tiens pour certain que la plupart des faiseurs d'arithmétique sont des descendants du roi Hérode.
De tout ce que j'ai avancé jusqu'à présent, il ressort clairement que l'école n'est pas précisément un lieu de nature à faire déborder de jouissance et de bonheur l'âme de l'enfant. Je ne crois pas que jamais cette idée soit venue à aucune petite tête blonde ou brune. Non, non, l'école est aussi bonne qu'elle peut l'être. L'école, par les nouvelles mesures prises, a été rendue aussi agréable et aussi supportable que possible; mais ses plaisirs sont éminemment négatifs. L'école garde toujours quelque chose de la prison, et le maître, aussi bien que les sous-maîtres, conservent quelque chose de l'épouvantail. Le mot de Van Alphen:
Apprendre est un jeu,
ne sera rectifié par aucun enfant, pas même par les plus studieux. Je m'imagine avoir appartenu à cette catégorie; mais, quand mon père ou ma mère me faisaient l'honneur de raconter à mes oncles et tantes que j'étais content quand les vacances étaient finies, toute mon âme se soulevait contre cette noble idée (qui me semblait très-fanatique), et il m'a fallu des années pour vaincre l'anxieuse répulsion que m'inspiraient mes maîtres respectifs. Il y en a aussi qui, malgré la méthode perfectionnée, électrisent un enfant s'il n'est pas des plus peureux.
Oui, mes chers amis, cachons ces pages à tous les chasseurs de papillons et à tous les joueurs au soldat; mais avouons que ce sont des malheurs de l'enfance: petits et insignifiants s'ils sont considérés de notre hauteur de pédants, mais grands et lourds dans les petites proportions du monde des enfants; malheurs qui inquiètent, tourmentent et secouent, et qui exercent souvent une grande et vive influence sur la formation du caractère.
Nous avons éprouvé tous, les premiers et les plus grands, c'est-à-dire avec la permission de Pestalozzi et de Prinsen, l'école. C'est un chancre, et tous les jours un chagrin nouveau. Un homme poursuivi par ses créanciers éprouve quelque chose des douleurs que souffre l'enfant en puissance de maître. Notre bon Holty, lui-même, ne peut s'empêcher de le menacer de ses vers. C'est pourquoi je voulais vous prier d'avoir pitié du sort de vos rejetons. Ils doivent tous aller à l'école; c'est une loi de la nature aussi certaine que celle par laquelle nous devons tous mourir; mais de ce que, d'après le cours des choses, nous ne devons pas mourir à notre dix-huitième année, je voudrais que l'école ne commençât pas pour eux avant leur huitième. C'est bien gentil que nous devions à la prononciation changée des consonnes que, dès l'âge de cinq ans, le petit Pierre puisse dire: «Je sais lire!» mais je ne sais pas si, à dix ans, le petit Pierre, en somme, aura autant profité que tel autre qui aura commencé à épeler à sept ou huit ans. J'offre ceci aux méditations de tous les cœurs philopédiques et n'ose pas, avec aussi peu d'expérience qu'Hildebrand (Hildebrand sans barbe, disent les critiques de journaux), pouvoir espérer de faire prévaloir mon opinion en si peu d'années.
Pour donner une autre tournure au sujet, et parler d'un autre malheur de la vallée des larmes de l'enfance, vraiment, chère dame, vous qui trouvez le monde si déloyal et les hommes si inconstants, la perte des illusions peut à peine peser aussi lourdement sur vous que la perte des dents sur les enfants. Vous souvenez-vous encore bien? Vous sentiez,—non, vous ne sentiez pas,—oui, hélas!—vous sentiez, trop certainement,—que vous aviez une double dent. Et la première était solide comme un mur. Six jours durant, vous cachez votre douleur: parfois vous l'oubliez; mais six fois par jour, au milieu de vos jeux, en savourant le plus friand craquelin, en faisant la plus douce chose, vous sentez toujours cette affreuse double dent. Votre seule consolation était que la première se détacherait facilement. En effet, la raison et la nature autorisaient cet espoir. L'expérience pourtant apprend qu'il en est autrement. Le septième jour, c'était un dimanche, votre petit service à thé est prêt sur votre petite table, et vos petites choses sont avec les deux poupées; la nouvelle est pour vous, et la vieille pour votre petite cousine Catherine, qui vient jouer avec vous; et le soir vous cuirez une brioche de biscuit pilé et de lait, et une tartine avec des fraises couronneront le tout. Vous témoignez votre joie par un grand cri, en apprenant ce dernier article. «Laissez-moi voir votre bouche, dit maman. Comment! une double dent?» Et votre joie est perdue. Vous vous esquivez comme si vous aviez commis un grand crime: probablement, grâce à votre souffrance, vous serez de mauvaise humeur et hargneuse contre Catherine; la brioche n'aura pas de charmes pour vous, les fraises pas de; goût, et vous irez au lit en rêvant du mal de dents. En vain mettez-vous à l'épreuve tous les remèdes domestiques les uns après les autres: secouer la dent avec la main, mordre sur une croûte dure, que, pour éviter la douleur éventuelle, vous mettez dans l'autre coin de votre bouche; vous appliquez un fil auquel vous n'osez pas tirer. Le dentiste doit venir. Il est venu, n'est-ce pas, l'affreux homme? Il avait, à vos yeux, l'aspect horrible d'un bourreau. Il feignait de ne vouloir que toucher à votre dent et il l'a traîtreusement tirée. Sur ces entrefaites, ce méchant tour est pour vous un bienfait qui compte pour toutes les autres fois. Ne me parlez pas des chagrins des grandes personnes. Elles ne se comparent pas à celle-ci. Il n'y a pas de marchand sur le point de sauter qui voie approcher avec plus d'angoisse le jour où il sera renversé, qu'un petit garçon ou une petite fille ne voient arriver avec terreur le jour où l'on doit arracher la double dent.
Nous sommes aux malheurs physiques. Eh bien, il y en a encore plus qu'on ne pense. Devenir grand, quelque belle et excellente invention que ce soit, est la cause de beaucoup de douleurs. Car d'abord, on passe de grands bras nus hors des manches, de grands bas hors du pantalon. Avec cela, on est honteux d'ordinaire d'avoir des bottes lacées ou des souliers à boucle, parce qu'il y a toujours quelques petits garçons précoces qui ont des demi-bottes, et des jeunes filles avancées qui s'élèvent sur des souliers à longs rubans. Beaucoup de mères ne comptent pas, à ce qu'il paraît, que non-seulement les jambes grandissent, mais que tout le corps croît, et que par conséquent la bonne nature et de sages raisons prouvent que, si les jambes de pantalon peuvent être allongées, le reste du vêtement demeurant le même, on se trouve condamné, par une très-désagréable compression, à la circonférence du corps, autre cause de maintes nouvelles croix dans plus d'un sens, et de maintes déchirures. Mais c'est aussi un mauvais côté de l'avantage qu'il y a à devenir grand, qui diffère chez les individus, si bien que rester petit s'oppose à devenir grand, qui est tant prisé. Maintenant, ce n'est pas un plaisir, chaque fois qu'on vient faire une commission de papa ou de maman, et qu'on va jouer avec Louis ou Théodore, de se voir tourner le dos par monsieur, madame, mademoiselle, et parfois la servante, pour retourner à la maison avec la conviction rafraîchie qu'on est d'une tête ou d'une demi-tête plus petit, et une vraie cosse de pois. On nomme cela vivre dans la société, quand on l'applique au moral; et cette taxation du physique est la seule pour laquelle le temps de l'enfance soit sensible, et très-sensible. Non, il n'est pas beau de la part des grandes personnes de saluer les petits de cette continuelle apostrophe: «Comme vous êtes devenu grand!» À la longue, cela ne peut pas plaire.
Mais il y a aussi une taxation morale qui, si elle ne blesse, pas précisément les enfants, ne leur fait cependant pas plaisir. Elle résulte de la circonstance que l'homme de trente-cinq à quarante ans, et de quarante à quarante-cinq, est déjà bien éloigné de sa cinquième année et a beaucoup oublié, et tant, qu'il ne sait plus rien de ce qu'il sentait, comprenait, goûtait lorsqu'il était enfant. De là vient que la mesure par laquelle il apprécie les enfants est trop petite et trop resserrée, et que mainte joie qu'il donne à de jeunes cœurs est retenue par lui, parce que, dans sa sagesse d'homme, il estime «qu'ils sont encore trop jeunes pour cela,» et puis, «qu'ils ne puissent y arriver» comme si on était venu sans mains au monde et avec un instinct seulement pour mettre tout en pièces. Et par suite, les divers affronts qu'il subit, parce que chacun pense qu'un enfant ne sent pas mainte chose qui le frappe pourtant profondément. Et puis, la passion des douceurs qu'on commence juste à retrouver grande de la veille, pour les petits gâteaux en prix d'autre chose. Vraiment, vraiment, on a vu croître dans la société maint accès misanthropique et lâche, parce qu'étant enfant on était trop petit pour avoir le sentiment de sa dignité.
Je ne parle pas de courir avec des chapeaux et des casquettes, ni de la différence de sentiments, selon le temps, qui, entre les parents et les enfants, peut s'établir d'une manière sensible. Je ne parle pas de certaines institutions barbares où les jeunes sont condamnés à porter la défroque des vieux; de sorte que le quatrième fils porte une blouse tirée de la veste de son frère aîné; de laquelle veste, les deux frères situés entre eux avaient un pourpoint sans col et un avec col;—ni des misérables proverbes considérés comme des oracles par les parents, et maudits par la postérité comme de méprisables paradoxes et sophismes, comme, par exemple, que les vieux doivent être les plus sages. Je ne parle pas de tous ces malheurs, car mon morceau est déjà trop long. S'il peut seulement engager quelques-uns de mes lecteurs à être plus délicats avec les jeunes erreurs des petits, et plus attentifs à ménager leurs petits chagrins pour les laisser jouir sans trouble de leurs grands plaisirs. La jeunesse est sacrée; elle doit être traitée avec prudence et respect; la jeunesse est heureuse, on doit veiller à ce qu'elle prenne le moins de part possible au malheur de la société, dans la mesure où elle le puisse subir, à son âge; on doit parfois la tourmenter et lui tomber à charge,—pour son bien,—mais il faut prendre garde d'exagérer. Toute une vie qui suit ne peut compenser une jeunesse opprimée; car quelle félicité les années postérieures pourront-elles donner pour le bonheur gaspillé d'une jeunesse innocente?
[1] Quelle simplification le traité des vingt-quatre articles a amenée dans l'instruction primaire! La Belgique de moins à étudier! Toute la jeune Hollande profita de la Révolution de 1830. (Note de l'auteur.)
[2] Poids de 4,000 livres.
[3] Petite monnaie qui équivaut à l'ancien liard.
[4] Adversité.
[5] La prudence est la mère de la sagesse.