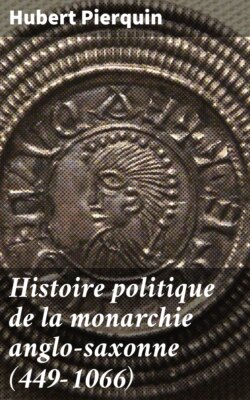Читать книгу Histoire politique de la monarchie anglo-saxonne (449-1066) - Hubert Pierquin - Страница 6
CHAPITRE II
ОглавлениеL’origine des Saxons. — Les régions occupées par les Saxons près de l’Elbe, avant leur invasion de la Bretagne. — Les expéditions sur mer, des Saxons; leur ligue avec les autres peuples, et leurs agrandissements sur le continent; — leur histoire, jusqu’à leur première tentative contre la Bretagne. — Les mœurs des anciens Saxons.
Au ve et au VIIe siècles, les Anglo-Saxons vinrent s’établir en Angleterre, après avoir quitté la péninsule des Cimbres qu’ils occupaient. Les Anglo-Saxons constituaient une branche distincte de la grande famille saxonne, qui de l’Elbe, s’était étendue jusqu’au Rhin. Les attaques de cette race formidable avaient longtemps désolé les régions occidentales de l’Europe, et quand les Goths s’emparèrent des plus riches provinces romaines, les Anglo-Saxons, du même coup, vinrent envahir la Bretagne, après que les Romains eurent définitivement quitté celle-ci. Les vaincus reculèrent devant l’ennemi, ou subirent son joug, et les institutions des Saxons, leurs lois, leurs langues, et leurs mœurs prévalurent, bientôt, par toute l’Angleterre, et même sur celles des autres peuples qui s’y étaient précédemment établis.
Au début le qualificatif saxon, impliquait un seul Etat, et non la confédération qu’il devait plus tard, désigner. Si les Romains ne s’inquiétèrent des Saxons qu’au second siècle de l’ère chrétienne, du moins Ptolémée, les mentionna-t-il, le premier, dans sa Géographie. Selon cet auteur , l’an 141, après J.-C., un peuple, appelé Saxones, était établi au nord de l’Elbe, et occupait trois petites îles, à l’embouchure de ce fleuve. La population saxonne était alors peu importante, puisque six autres nations occupaient, avec elle, ces territoires.
On peut remarquer avec quelque surprise, que Tacite, en écrivant une description particulière de la Germanie, bien des années avant Ptolémée, ait omis de nommer les Saxons. Quelques auteurs ont pensé que la nation à laquelle Tacite donne la dénomination de Fosi était composée de ces guerriers qui devaient s’illustrer, par la suite, sous le nom de Saxons. Mais il ne saurait y avoir plus de raison d’attribuer ce nom aux Saxons eux-mêmes qu’aux autres peuples omis par Tacite, dans la Germanie: aux Sigulones, aux Sabalingii, aux Cobandi, aux Chali, ou aux Phundisii . Le manque de renommée et de gloire des Saxons, suffit à expliquer le silence de Tacite, à leur endroit, car les Saxons n’avaient point, alors, attaqué Rome, ou quelque autre peuple puissant du continent.
Après la première occupation de l’Europe, par les Cimmériens et les Celtes, se forme un nouveau courant de tribus barbares, composées de Scythes, de Germains et de Goths: toutes étaient venues d’Asie. Les Celtes et les Cimmériens, pressés par ces nouveaux envahisseurs, se replièrent sur les parties occidentales et méridionales de l’Europe, où les Scythes les poursuivirent encore. Dans l’intervalle, ce dernier flot de peuples se répandait progressivement, sur les vastes espaces de l’Europe, jusqu’à ce que Tacite vint à comprendre tous ces barbares sous le nom de Germains, reconnaissant ainsi un état de fait. puisqu’à cette date, les Germains avaient non seulement, atteint le Rhin, mais avaient encore pénétré en France.
La première apparition des tribus des Scythes, en France, peut être placée, suivant Strabon au VIIIe siècle, ou d’après Hérodote, au VIIe siècle, avant l’ère chrétienne . Ce dernier établit que les Scythes étaient le peuple le plus jeune de ceux qu’il étudiait, puisqu’il ne comptait que mille ans entre le règne de leur premier roi, Targitaos, et les guerres que leur fit Darius. Le premier théâtre de l’action guerrière des Scythes, et du développement progressif de leur puissance; fut en Asie, le sud de l’Araxe. Pendant des siècles, ils y étendirent leurs territoires, qui demeuraient inconnus des peuples de l’Europe. Ils se nommaient entre eux, Scoloti, mais les Grecs leur donnaient la dénomination de Scuthoi, ou Nomades.
Avec les succès militaires d’un de leurs rois, les Scythes, selon Diodore de Sicile, ajoutèrent à leurs possessions, les régions montagneuses à l’entour du Caucase, avec les autres territoires, près du Tanaïs. De ces Scythes primitifs, les Sakai, les Massagètes, et les Arimaspoi tirèrent leur origine.
Les Massagètes semblent avoir formé la branche orientale de la race scythe. Des guerres éclatèrent entre eux et les autres tribus, comme le rapporte Hérodote, et ces circonstances déterminèrent leur émigration en Europe . Ce fut donc au VIIe siècle, que ces Seythes, passant l’Araxe, apparurent dans l’ancien monde. Ils s’y répandirent progressivement, et sous le règne de Darius, leurs colonies européennes se trouvaient assez nombreuses et prospères pour exciter la convoitise du roi des Perses, après sa conquête de la Babylonie. Mais ses attaques furent repoussées par les Scythes, et au temps d’Hérodote, ceux-ci occupaient en Europe, une situation que leurs succès militaires avaient définitivement fortifiée. Il semble qu’ils aient alors occupé les territoires du Tanaïs au Danube, et dans leurs migrations ultérieures, ils se dirigèrent vers l’occident; alors que leurs colonies, en Thrace, se développaient, d’un mouvement continu, vers le sud. Leur établissement le plus avancé, au nord de l’Europe, était représenté par les Roxolanes, qui s’étaient fixés au-dessus du Borysthène, ou moderne Dniéper.
En s’étendant à travers l’Europe, les Celtes et les Cimmériens se repliaient sur l’ouest et sur le sud, et les différentes tribus des Scythes, comme celles des Cimmériens et des Gaulois; avaient chacune, leur dénomination particulière.
Parmi les tribus des Scythes, les Sakai ou Sacae, paraissent avoir donné aux Saxons, leur descendance. Cette assertion n’a, ici, que la valeur d’une simple hypothèse, mais étymologiquement, Sakai-suna, ou fils des Sakai, a pu être abrégé en Saksun, qui donne le même son phonétique que Saxon: Les Sakai, appelés en latin, Sacae, constituaient une tribu importante, issue de la race des Scythes. Leur renom était tel, que les Perses qualifiaient tous les Scythes, de Sacae, et Pline parle d’eux, comme étant l’élite guerrière de ce peuple . Strabon situe les régions qu’ils occupaient, à l’ouest de la mer Caspienne, et il rapporte que les Sakai se livrèrent à de fréquentes attaques contre les Cimmériens et les Trères. Ils s’emparèrent, également, de la Bactriane et de la partie la plus fertile de l’Arménie, qui s’appela Sakasina, sous leur domination. Les Sakai sont nommés Sacassani, par Pline ; et ainsi connus des Romains, on peut supposer qu’ils purent traverser l’Europe, sous cette appellation qui leur demeurait, tout en subissant des contractions et des variations diverses, dans sa forme.
Il est admissible que les Sakai nomades, durent émigrer, insensiblement, vers les parties occidentales de l’Europe, où Ptolémée signale leur présence, et d’où ils harcelaient les provinces extrêmes de l’empire romain, au IIIe siècle de l’ère chrétienne. Ces Saxoi qu’Etienne de Byzance mentionne, comme établis sur le Pont-Euxin, semblent avoir tiré leur descendance d’Odin, à qui la tradition de l’Ynglinga Saga fait abandonner, une cité au sud du Tanaïs, du nom d’Asgard, et une région appelée Asaland, ou terre des Asae. Cette retraite avait été causée par les progrès des Romains, et Odin passe dans la fable, pour s’être retiré d’abord en Russie, et puis chez les Saxons, repoussé par les barbares eux-mêmes, que refoulaient nécessairement vers l’Europe, les guerres des Romains et de Mithridate.
Mais en laissant de côté les détails d’une tradition souvent fabuleuse, et les hypothèses quelque peu vaines qu’elle a pu suggérer, on remarque que certains mots de l’ancienne langue scythe, nous ont été conservés par l’histoire :
On apprend, d’après les mêmes sources historiques, que leurs dieux étaient au nombre de sept. Leurs caractères, et leur ressemblance avec les divinités de la mythologie grecque, ont été marqués par Hérodote:
Tabiti, divinité essentielle = Vesta.
Papaios = Jupiter.
Oitosuros = Apollon.
Artimpasa, ou Arippasa = Vénus.
Thamimasadas = Neptune.
Apia, femme de Papaios = La Terre.
Les Scythes avaient aussi une divinité guerrière dont le nom n’a pas survécu, et à laquelle ils élevaient des temples , et sacrifiaient annuellement, des chevaux, des moutons et des prisonniers. A la bataille, ils buvaient le sang du premier ennemi qu’ils renversaient, et ils faisaient des coupes, avec les crânes de leurs plus redoutables adversaires. Mais Homère et Eschyle ont rendu témoignagne à leur esprit de justice, et Strabon rappelle, non sans étonnement, leur détachement absolu des richesses.
Les Saxons, au temps de Ptolémée, étaient donc établis à l’ouest de l’Elbe, et leur situation même indiquait qu’ils l’avaient conquise, pendant la seconde grande émigration des tribus barbares, en Europe.
Quand les Saxons attirèrent l’attention des Romains, ils occupaient l’extrémité de la Chersonèse des Cimbres, avec trois îles inhabitées au temps de Ptolémée, et dénommées par la suite, Nord-Strand, Busen et Heiligland .
La première de ces îles qui fut sans doute détachée du sud du Jutland, par la violence des vagues, est située en face Hesum, et au-dessus de l’Eiderstede, dont elle est séparée par des bras de mer. L’Hever qui coule sur ses rives. est favorable à la navigation commerciale. Cette île, dont la population vivait d’agriculture et de pêche, était longue, au début de vingt lieues, et large de sept. Des inondations, au cours des années 1300, 1483, 1532 et 1615, en ont diminué de beaucoup, la superficie .
L’île de Busen est située au nord de l’embouchure de l’Elbe, à l’ouest de Ditmarsia: elle n’a guère que deux lieues de longueur, et trois de largeur . Mais l’île saxonne la plus célèbre, et la plus peuplée fut celle d’Heiligisland, littéralement, l’île sacrée. Au VIIIe et au XIe siècles, elle était désignées par deux autres noms, Fossetis-land et Farria, — dont l’orthographe a souvent varié.
Cette dernière île fut, sans doute, le centre des expéditions navales des Saxons. Au VIIIe siècle, un auteur la mentionne, comme étant le lieu, où l’idole Fosete était adorée . Au XIe siècle, elle est décrite en ces termes, par Adam de Bremen, sous le nom de Farria «... C’est la première île, écrit-il, que l’on rencontre dans l’océan. Elle possède un monastère, et est inhabitée. Sa terre est très fertile: riche en blé, elle nourrit les troupeaux et les oiseaux. Il y a là, une colline, et point d’arbres: l’île est entourée des rochers les plus abrupts, avec un seul défilé, où l’eau fraîche jaillit en cascade. C’est un lieu vénéré de tous les marins, et surtout, des pirates. D’où, son nom d’Heiligeland» .
L’île souffrit d’inondations, en 800, 1300 et 1500: celle de 1649, fut la plus destructive; mais toujours, Heiligisland, reçut dans son port, le pilote en détresse, ou le pirate, poursuivi sur les mers.
Le territoire que les Saxons occupaient, à l’origine, sur le continent, était situé sur la rive occidentale de la péninsule Cimbrique, entre l’Elbe et l’Eyder. Ce dernier fleuve est regardé comme la frontière du Danemark, et comme le point extrême des possessions germaniques . La région entre l’Eyder et l’Elbe, était nommée Nordalbingia, ou Eald Saexen, et divisée en trois districts, Ditmarsia, Stormaria et Holsatia . Les progrès des Slaves contribuèrent à former une quatrième division de ces territoires, dans la province de Wagria.
Le district de Ditmarsia est séparé, au nord, du Sleswig par l’Eyder, et du district de Stormaria, au sud, par la Stoer. Il fait face aux îles d’Heiligland et de Busen, et a une étendue de trente-sept lieues, avec une largeur de vingt-trois lieues. L’aspect général du sol est bas, et marécageux, et de fortes digues défendent l’île, contre l’assaut furieux des vagues. Les plaines du rivage sont propices à la culture, et à l’élevage, mais à l’intérieur des terres, on ne rencontre guère que des landes stériles, et des marais sauvages. Les habitants de l’île montrèrent, toujours, un instinct belliqueux très prononcé, avec des mœurs presque sauvages, et un désir constant d’indépendance qu’ils assuraient par les armes,
Au-dessous de Ditmarsia, s’étendait jusqu’à l’Elbe, le district de Stormaria, borné au Nord, par la Stoer. La province entière, ne présentait guère que l’aspect d’un vaste et sombre marais, d’une étendue de trente-trois lieues. Ces détails confirment bien les descriptions faites par les Romains, des régions inaccessibles, occupées par les Saxons .
Séparé du Sleswig par le Levesou, au nord, et borné, au sud, par la province de Wagria, le district d’Holsatia , étendait vers Ditmarsia ses régions forestières, et ses plaines susceptibles de culture.
Le travail et le courage, furent les conditions nécessaires à la subsistance et à la défense de ces peuples primitifs. Bien que ces derniers fussent encore dans un état de civilisation peu avancé, les chroniqueurs rapportent leur fidélité au serment, devenue proverbiale; et en dépit de leur goût du pillage, ils passaient pour hospitaliers, généreux à la guerre, et magnanimes envers leur ennemi, brave et vaincu . C’étaient ces peuples, perdus sur leurs territoires lointains, qui menaçaient, déjà, l’empire de César, et qui, en se répandant par les Gaules, la Germanie, et la Bretagne, devaient réaliser, en fait, la formidable unité barbare, bientôt victorieuse du nom romain.
Les Saxons, ainsi établis sur les côtes d’une partie de l’Europe, voisine de quelques riches provinces de l’empire et assez éloignée pour défier les poursuites des Romains, devaient s’efforcer de développer leur puissance maritime: les tribus, établies sur les bords de la mer, des embouchures du Rhin à la Baltique, s’étaient formées, depuis le siècle de César, aux expéditions maritimes. Les Romains avaient contribué à ces progrès, sans en mesurer les conséquences lointaines. Drusus avait équipé une flotte sur le Rhin, pour faire remonter l’Ems à son armée, et il avait donné l’ordre qu’on creusât un canal, pour permettre à ses troupes, de passer dans le Zuyderzée. A cette même époque, les Bructères, établis sur la rive gauche de l’Ems, étaient capables sur mer, de livrer bataille aux Romains. Sous le règne de Tibère, Germanicus fit construire et équiper mille vaisseaux sur le Rhin: il eut, alors, l’imprudence d’enseigner aux barbares attentifs, l’art et les secrets de la navigation , .
Après trente ans, les progrès maritimes de ces peuples, furent arrêtés par Germascus qui, à la tête des Chauques, et sur des bâtiments légers, se livrait à la piraterie, et désolait les côtes des provinces romaines. Comme la population entre le Rhin et l’Ems, s’accoutumait aux expéditions aventureuses sur mer, les Saxons se rapprochèrent d’elle, et se multiplièrent dans les îles, dont il a été précédemment question. Là, les Saxons vécurent entre la sombre horreur de leurs marais, et les rocs inaccessibles qui les entouraient, demandant leur subsistance à la pêche, sur la mer inclémente. Mais leur audace sur les flots s’étant fortifiée, avec de nouveaux progrès dans l’art de la navigation, ils se prirent à songer que les Romains invincibles sur terre ne l’étaient plus sur les flots, et ils voyaient dans le pillage des provinces lointaines, avec l’appât du butin, la satisfaction de leur goût naissant des aventures.
Dans les quelques années qui suivirent, les Saxons joints aux Francs, désolèrent à ce point les côtes, de la Belgique, de la Gaule, et de la Bretagne, que les Romains durent envoyer une flotte puissante, commandée par Carausius, Ce dernier, accusé de corruption, se révolta contre Rome, prit la pourpre et se fit reconnaître empereur, par les légions de Bretagne, l’an 287. Les guerres, sans cesse renaissantes aux confins de l’empire, favorisèrent son usurpation. Carausius se comporta en politique assez habile: il fit alliance avec les Germains, les Saxons, et les Francs, adoptant même, pour répondre aux besoins de sa cause, les coutumes et les mœurs de ces peuples. Afin de les rendre utiles à ses projets, il les dirigea vers les expéditions maritimes, leur donna des vaisseaux et de hardis pilotes. Tout peuple des côtes qui ne reconnaissait pas l’autorité de Carausius, était envahi, et dévasté par les barbares. Durant les sept années de l’usurpation de Caurausius, les Saxons purent se livrer, à l’envi, au pillage, avec des procédés de navigation plus sûrs, et avec la confiance que leur donnaient de constantes victoires .
Soixante ans après ces événements, Magnence ayantusurpé le trône de Constance qu’il avait assassiné, résolut d’affermir sa dignité précaire, par l’alliance défensive des Francs et des Saxons auxquels, il promettait, en retour, une protection dont ceux-ci n’avaient nul besoin. Ce fait consacrait l’importance déjà prise, par ces peuples indomptés que Tacite ignorait, et que Ptolémée nommait à peine: ils s’apprêtaient à s’emparer de la Bretagne romaine, et à y fonder des colonies nouvelles.
Au début du IVe siècle, les Saxons n’étaient pas seuls établis, sur les rivages de la mer: d’autres nations, au nord et au sud des propres territoires de ces derniers, étaient prêtes à agir de concert avec eux, animées du même esprit d’indépendance et de conquête. Grâce à ces appoints naturels, et avec l’accroissement constant d’une forte population, les Saxons multipliaient leurs flottes, et réparaient, sans cesse, les pertes qu’ils subissaient dans les combats. La ligue de tous les Saxons était réalisée; en fait, et ceux-ci imposant leur alliance, même par la force, aux autres peuples, on vit bientôt la plupart des nations établies au nord du Rhin, prendre le nom. saxon, et vouloir en assurer la prédominance. Au sud, les Chauques, entre l’Elbe et le Rhin, semblent s’être joints, les premiers, aux Saxons. L’appât du pillage fit suivre aux Frisons leur exemple, et l’alliance saxonne paraît avoir encore compris les Chamaves, et en dernier lieu, les Bataves, les Toxandres, et les Morins. Cette ligne formidable qui devait demeurer, entière, jusqu’à l’expédition Saxonne en Bretagne, et fut ensuite dissoute, s’accrut encore concours des Cimbres, des Jutes, des Angles, et de peuplades nombreuses dont les noms n’ont point été rapportés .
Ainsi unis, les états Saxons s’étendirent progressivement, de l’Elbe au Weser; du Weser, à l’Ems, et se répandirent, finalement, sur lesbords du Rhin, alors que les Francs; quittant ces régions, et la mer, marchaient sur les Gaules. Les Francs, étant, par leur situation géographique, les premiers exposés aux répressions des Romains, devaient nécessairement concentrer leur effort, et consolider leur force sur le continent, et abandonner ainsi, les expéditions maritimes, pour s’assurer contre un péril imminent. Ces circonstances influèrent singulièrement, sur l’extension maritime des Saxons, et plus on approche de l’invasion de la Bretagne par ces derniers, et moins on voit leur alliance étroite, avec les Francs. Des conflits armés éclatent même entre les deux nations, et quand les Francs se portent à la conquête de la Belgique et de la Gaule, les Saxons demeurent le seul peuple combattant avec succès sur mer, et s’y livrant avec impunité, à la piraterie. D’anciens alliés des Francs se joignirent à eux, par la suite, pour partager leur vie facile et aventureuse, et l’abondance de leur butin. Les Saxons, successivement vainqueurs, se répandirent en Germanie, où ils rangeaient sous leur domination, avec leurs anciennes possessions de l’Elbe à l’Eyder, les vastes territoires baignés par l’Elbe et le Rhin .
Mais les alliés immédiats des Saxons, dans leur invasion de la Bretagne, furent les Jutes et les Angles. Les Jutes étaient fixés, dans la partie sud du Jutland, et la première armée qui devait s’introduire en Angleterre, sous la conduite d’Hengist et d’Horsa, était composée de Jutes . Les Angles venaient des différentes parties du Nord de la Germanie. On a cru reconnaître leur capitale, par la similitude des noms, successivement, dans Engern, en Westphalie, et dans Angloen, en Poméranie. Mais l’opinion de Bède et du roi Alfred, adoptée par Camden, a prévalu: au temps de Tacite et de Ptolémée, les Angles ont pu être établis en Westplialie, mais au moment de l’invasion Saxonne, il semble bien qu’ils étaient fixés, dans le district d’Anglen, dépendant du moderne duché de Sleswig .
Quand au IVe siècle, les Saxons furent parvenus à l’apogée de leur puissance militaire, le voisinage de la Bretagne facile d’accès, et prospère, ne fut pas sans exciter leur convoitise. Ils associèrent à leur projet de conquêtes, les Pictes, les Scotes, et les Attacottes: l’an 368, après J.-C., ils massacrèrent, dans une invasion de la Bretagne, le gouverneur romain, Nectaridus. Les Romains ne purent se rendre maîtres des assaillants, qu’à l’arrivée de Théodose, désigné par l’empereur Valentinien, pour pacifier la Bretagne. Les Pictes et les tribus alliées dirigeaient leur attaque par le nord, alors que les Saxons et leurs auxiliaires investissaient les côtes de la mer. Parti de Bichborough, Théodose marcha sur Londres, et divisant son armée en deux corps, il opposa chacun de ceux-ci aux ennemis, qu’encombraient les nombreux bagages de l’armée. Le butin, repris aux barbares, fut restitué à ses possesseurs primitifs, et Théodose voulut achever les. succès qu’il avait remportés à la guerre, en divisant ses ennemis. Il proclama une amnistie pour les vaincus ; tout en poussant la guerre avec énergie, dans le nord de la Bretagne, encore insoumis. Les Saxons, après une vaine résistance sur mer , firent aux Romains leur soumission, et Théodose reçut le surnom de Saxonicus .
A la Bretagne romaine, il ajouta la province de Valentia, et rétablit des garnisons par toute l’île.
Tour à tour, vaincus et vainqueurs des Romains, les Saxons défirent Maxime, et arrêtèrent momentanément Stilichon, à là fin du IVe siècle . Après la mort de ce général, ils aidèrent les Armoricains révoltés, ouvrirent des hostilités contre les Francs, et étendant le champ de leurs conquêtes, ils menacèrent la Belgique, la Gaule, l’Italie et la Germanie. Mais la puissance des Savons du continent fut définitivement abaissée par Charlemagne, et ce peuple dut se contenter de jouer un rôle obscur, dans les événements qui se précipitèrent en Germanie.
Mais quels furent les caractères généraux, et les mœurs des premiers Saxons? Pirates férocement braves, guerriers aventureux, Orose parle de leur terrible courage, et l’empereur Julien qui s’était mesuré en mainte rencontre avec les tribus barbares, cite les Saxons, comme l’emportant sur leurs voisins, par leur ardeur à la guerre. Zosime porte sur eux le même jugement, en plaçant leur bravoure au-dessus de celle des peuples contemporains, même les plus belliqueux.
Cet instinct guerrier se développait sans cesse, chez les Saxons, par dé continuelles expéditions, qui n’avaient pour but, que le pillage. Les autres peuples redoutaient ces barbares comme un fléau, pour leurs agressions soudaines, pour leurs cruautés inutiles, et pour les ruines qu’ils laissaient derrière eux, sur ces rives qu’ils avaient pillées .
Insouciants dé la résistance possible des assaillants, les Saxons s’abandonnaient aux flots, pour aborder stir quelque rivage, même inconnu, qu’ils pussent dévaster, après l’avoir atteint . Ils bravaient les naufrages, en s’embarquant par les tempêtes, pour mieux surprendre leurs victimes par une attaque, que celles-ci pouvaient croire impossible, devant les éléments déchaînés. Les régions, à l’intériéur des terres, n’étaient pas à l’abri des invasions des Saxons. Ceux-ci remontaient le cours des fleuves, sur des barques de bois, recouvertes de peaux cousues les unes aux autres: et telles étaient l’habileté et l’audace des navigateurs saxons, qu’ils se hasardaient sur de pareils esquifs, même sur l’océan germanique . Les Romains leur avaient enseigné contre eux-mêmes, l’art de la navigation, et les Saxons avaient construit des flottes entières, grâce aux ressources inépuisables de bois, que leur gardaient les immenses forêts de la Germanie.
Au ve siècle, Sidoine Apollinaire , écrivait ainsi, des Saxons: «Vous voyez, parmi eux, autant de pirates que de rameurs, car tous apprennent et enseignent l’art du pillage; ils ne commandent, et n’obéissent que dans ce dessein... Ces ennemis sont plus redoutables qu’aucun autre: êtes-vous sans défense? ils vous attaquent; êtes-vous prêts? ils vous échappent. Ils craignent la défensive, et n’attaquent qu’inopinément.. S’ils poursuivent l’ennemi, c’est qu’ils doivent l’écraser; s’ils s’enfuient, ils échappent sûrement à qui les poursuit! Les naufrages les fortifient, sans les abattre,... et tous les dangers de la mer, leur sont familiers;...une tempête les favorise, car elle enlève toute appréhension à ceux qu’ils doivent assaillir... Parmi les vagues et les écueils, ils se réjouissent dans le péril, parce qu’ils espèrent surprendre leur ennemi...»
Et Zosime ajoute encore, en parlant des Saxons et de leurs alliés: «...ils se dispersaient en corps, pillaient la nuit, et le jour venu, ils se cachaient dans les bois, pour compter leur butin...»
Les Saxons ne pouvaient supporter la honte, ni l’esclavage, et Symmaque rapporte, que dans leur orgueil, vingt-neuf Saxons s’étranglèrent, plutôt que de figurer, à Rome, dans les jeux du cirque .
La taille des Saxons, était, généralement haute, et fiers de la beauté de leur race, ces barbares n’acceptaient point d’alliances avec d’autres tribus. Au IVe siècle, les Saxons se rasaient la tête , mais par la suite, ils portèrent des cheveux flottants sur les épaules , et une ancienne loi saxonne punissait l’homme qui en saisissait un autre par les cheveux .
Comme costume, les Saxons portaient une sorte de veste de toile, ornée de bordures aux nuances bigarrées . Sur celle-ci, était jeté le sagum ou manteau. Les Saxons portaient des sandales. Leurs femmes avaient d’amples tuniques, et des bijoux à la tête, aux bras, et au cou .
D’après Wittichind , les Saxons qui envahirent la Thuringe, au VIe siècle, étaient armés de petits boucliers, de longues lances, et de larges coutelas.
Un auteur du XVIe siècle, Fabricius, ajoute, en s’appuyant sur la seule tradition parvenue jusqu’à lui, que les Saxons avaient leurs boucliers suspendus à des chaînes; que leurs cavaliers brandissaient de lourds marteaux de forgeron, et qu’enfin, leur armure était très pesante... .
Chez les Saxons, comme chez tous les peuples primitifs, la première autorité dut être celle du père de famille; et par la suite, l’âge devint le titre essentiel à toute charge, ou fonction publique. Dans la langue saxonne, les mots désignant l’autorité, impliquent, aussi, la notion d’âge.
Dans la version saxonne des écritures, Joseph est cité, comme ayant été choisi pour gouverner l’Egypte, de préférence aux plus âgés. Le nom de César, y est accompagné de l’adjectif yldest, le plus âgé, le plus grand . Le chef militaire des Saxons était, en général, appelé ealdorman, l’homme âgé . Et le terme latin, satrapa, qu’emploie Bède, pour désigner le chef du district saxon, est rendu par ealdorman, dans la traduction d’Alfred . Dans la controverse des disciples du Christ, cherchant à savoir lequel d’entre eux serait le plus grand, ce dernier adjectif est exprimé en saxon, par yldest, le plus âgé . Les chefs primitifs des Saxons furent donc les hommes âgés; les termes rendant l’idée d’âge ou de vieillesse, sont synonymes d’âge ou de dignité, et gardent ce même sens, quand les charges publiques; par la suite, ne sont plus dévolues à la seule ancienneté.
La plus ancienne relation du gouvernement Saxon, sur le continent, est renfermée dans ce passage de Bède: «Les anciens Saxons n’ont pas de roi, écrit-il, mais plusieurs chefs qui, en présence des nécessités de la guêtre, tirent entre eux, au sort: ils obéissent, alors, à celui que la chance désigne; pendant toute la durée de la guerre. Quand celle-ci est terminée; tous les chefs reprennent un égal pouvoir ...» Ces données ont été confirmées; par d’autres autorités , et on les rencontre, déjà, avec les mêmes détails, dans César , parlant des chefs germains. On peut donc avancer, que quand les Anglo-Saxons pénétrèrent en Angleterre, ils y vinrent sous la conduite de rois, élus pour la guerre: ainsi s’expliquent le règne d’Hengist, et les dynasties de l’Octarchie. En fait, les Anglo-Saxons, par les guerres perpétuelles dont ils étaient menacés, durent maintenir au pouvoir ces rois temporaires, jusqu’à ce qu’un état de paix relatif, leur permît l’établissement d’une monarchie tempérée, et permanente. Dans ce système de gouvernement, les chefs, ou witena, conservèrent leur influence et leur pouvoir. Ils élisaient le roi, tout en le choisissant dans la famille même du monarque défunt, et leur consentement était nécessaire à tous les actes publics du royaume.
Sous les anciens Saxons, les hommes étaient divisés en trois classes: l’étheling, ou noble; l’homme libre, l’affranchi, et l’esclave. Les nobles se montraient jaloux de leur race et de leur rang. Ces ordres avaient, chacun, une existence distincte, sociale et juridique, et leurs membres ne s’alliaient qu’entre eux.
La législation des Saxons, à l’état païen, est imparfaitement connue: elle paraît avoir eu pour base, la compensation pécuniaire, comme mode général de punir les injures personnelles, et les crimes. La sévérité de la loi, dans la répression de l’adultère, fut extrême: si une femme manquait à son devoir d’épouse, on l’obligeait à se pendre; puis, son corps était brûlé, et sur ses cendres, on égorgeait le complice de l’adultère. D’autres fois, une troupe de femmes frappait la coupable, en la chassant de district en district; et la découvrant jusqu’à la ceinture, elles lui lacéraient les seins, à coups de stylet, jusqu’à ce que la mort s’en suivît .
Le mariage était permis, chez les Saxons, entre le fils, et sa belle-mère, et le frère pouvait épouser sa belle-sœur .
Les sanctuaires des Saxons étaient protégés par des pénalités, aussi terribles que celles qui frappaient la femme adultère. Une loi des Frisons renferme, à ce sujet, la disposition suivante: «Quiconque fait irruption dans un temple, et y vole des objets consacrés, sera conduit sur le rivage de la mer, et enfoncé dans le sable que doit recouvrir la marée montante... Là, on lui coupera les oreilles, on le mutilera, et il sera finalement immolé, aux dieux dont il aura violé les temples...» .
Il est difficile de donner une exacte notion de la religion des Saxons, trop imparfaitement connue. Seule, l’autorité de Bède permet d’avancer, que les Saxons, à leur arrivée en Bretagne, avaient des idoles, des autels, des temples, et des prêtres; que les temples étaient protégés par des enceintes, et qu’ils étaient profanés, si l’on jetait des lances dans celles-ci; qu’enfin, les prêtres ne pouvaient porter les armes, et qu’il ne leur était permis de monter que sur une cavale.
On peut retrouver, dans les jours de la semaine, les noms de quelques-unes des divinités saxonnes:
Sunday, ou Sunnan daey, — le jour du Soleil.
Monday, ou Monnan daey, — le jour de la Lune.
Tuesday, ou Tithes daey, — le jour de Tiw.
Wednesday, ou Wodnes daey, — le jour de Woden.
Thursday, ou Thunres daey, — le jour de Thunre.
Friday, ou Frige daey, — le jour de Friga.
Saturday, ou Seternes daey, — le jour de Saturne.
Le soleil, chez les Saxons, était regardé comme une divinité féminine; la lune était du sexe masculin ; on ne connaît guère du dieu Tiw, que le nom. Woden était l’ancêtre national, à la descendance duquel prétendaient les Saxons, qui la faisaient remonter au IIIe siècle. Les autres divinités sont demeurées inconnues. Bède a rapporté les noms de deux déesses saxonnes: Rheda, à qui l’on sacrifiait au mois de mars, et qu’on appelait Rhed-monath, pour cette raison; et Eostre, dont les fêtes étaient célébrées au mois d’avril, et qu’on nommait, par suite, Eostne-monath .
L’idole adorée dans l’île d’Heiligland, occupée, à l’origine,; par les Saxons, avait nom Fosete, et devint si célèbre que les lieux mêmes où se célébrait son culte, furent désignés par son nom, sous la forme, Fosetesland. Des temples furent élevés à Fosete, et la vénération qui l’entourait, était telle qu’on ne poursuivait point un animal, réfugié sur les, terres qui lui étaient consacrées, et qu’on ne puisait point d’eau à la source, qui coulait près des temples de ce dieu. Au VIIIe siècle, Willebrord, anglo-saxon converti au christianisme, et devenu missionnaire chez les Frisons, tenta de détruire chez ceux-ci, le culte de Fosete. Il y réussit, en dépit d’une résistance violente de Radbod, roi de l’île. Willebrord baptisa trois hommes dans la fontaine du temple, et tua, pour nourrir ses compagnons, un troupeau qui paissait sur le champ sacré, à l’étonnement des barbares, qui croyaient le voir frappé de mort, ou de folie .
On apprend dans Tacite , que les Angles avaient une déesse, nommée Hertha, Earth (la Terre), dont les fêtes joyeuses couvraient dans la paix. Les Saxons redoutaient un esprit du mal, nommé Faul .
Les elfes faisaient partie de leurs superstitions, et il est dit de Judith , dans le poème anglo-saxon qui porte ce nom, qu’elle «brillait comme un elfe». Les Saxons vénéraient encore les pierres, les grottes mystérieuses, et les fontaines qu’ils peuplaient de divinités douces et tutélaires; ils adoraient aussi Héra, génie de l’air, qui venait répandre l’abondance, en été .
Les idoles des Saxons semblent avoir été très nombreuses. Grégoire, au VIIIe siècle, exhorte les barbares à abandonner leurs idoles, d’or, d’argent, de bronze, ou de pierre .
Les sacrifices humains furent en vigueur chez les Saxons; ce fait est, déjà, rapporté par Tacite, et Sidoine Apollinaire atteste qu’à leur retour victorieux d’une guerre de pillage, les Saxons immolèrent à leurs dieux, la dixième partie de leurs prisonniers, après les avoir tirés au sort . Enfin, Ennodius confirme que les Saxons et les Francs apaisaient leurs divinités, par l’effusion du sang humain . Mais il est difficile d’établir, si ces sacrifices étaient occasionnels, ou périodiques.
L’idole la plus renommée des Saxons, fut Irminsula. Elle se dressait à Eresberg, sur une colonne de marbre. Le dieu tenait de la main droite, une rose rouge, et de la gauche, présentait une balance. Le cimier du casque était formé d’une figure de coq; sur sa poitrine, un ours était gravé, et sur un bouclier, pendant à ses épaules, était figuré un lion dans un champ semé de fleurs .
Selon Rolwinck, chroniqueur du XVe siècle, les prêtres d’Irminsula, avaient des attributions politiques et judiciaires, d’ailleurs incertaines. Aux jours de combat, ils sortaient l’idole, qu’ils promenaient sur le champ de bataille. A l’issue du conflit armé, les Saxons immolaient à l’effigie du dieu, et les captifs, et les lâches de leur propre armée. Meibomius ajoute à ces détails qu’à de certains jours solennels, les guerriers saxons s’avançaient en armes vers la statue du dieu, et qu’ils dansaient autour d’elle, en agitant des cestes d’airain, pour lui demander aide, et victoire .
En 772, cet objet de la superstition saxonne, fut détruit par Charlemagne. Pendant trois jours, une partie de l’armée impériale, procéda à la démolition du temple, tandis que l’autre, demeurait sous les armes. Les soldats de Charlemagne se partagèrent les dépouilles du temple, dont une partie fut attribuée à des œuvres de piété .
Mais la conception religieuse des Saxons, parut prendre, parfois, un caractère plus élevé. La notion abstraite de la divinité, n’échappa point à ces êtres primitifs, et le mot God, pris dans la double acception de bien et de dieu, sortit de leurs premières méditations, sur la nature divine. Ces derniers détails indiquent assez que les Saxons étaient prêts à subir l’influence nouvelle du christianisme, après avoir adoré les dieux sanglants de la victoire et de la mort.