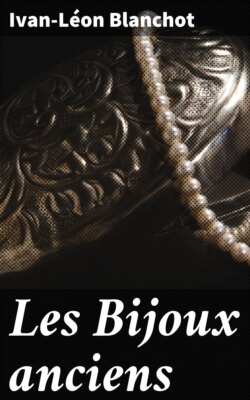Читать книгу Les Bijoux anciens - Ivan-Léon Blanchot - Страница 6
VOCABULAIRE DES TERMES TECHNIQUES
ОглавлениеAffiquets. — Bijou quia commencé par servir de plaque d’identité à certains émissaires chargés de missions importantes. Il en reste un souvenir dans les plaques d’habit de nos garçons de banque. Vers le XVIe siècle, les femmes s’en emparèrent et en firent un ornement. On ne le portait plus au XVIIe siècle.
Agate (gr. Achates). — Nom du fleuve sur les bords duquel on recueillait celle que connurent les Grecs. C’est une pierre dure diaprée dans sa masse. On distingue les agates en ocellées, arborescentes, figurées.
Aggema. — Nom donné au XVIIIe siècle à un genre de travail d’incrustation de traits d’or — sur écaille, par exemple — obtenu par stries irrégulières et rapprochées (travail de la ville d’Adjem, en Arabie).
Agrafe. — C’est le nom donné à des ornements qui tiennent à la fois de la fibule et du fermail. Il s’applique surtout à des bijoux du moyen âge.
Aigrette. — Parure de tête, qui n’a pas été exclusivement féminine, jusqu’au XVIIe siècle. Les princes orientaux en ornent leur turban. Elle se compose de deux parties: l’une fixe qui est toujours en joaillerie, l’autre tantôt en joaillerie sur tiges tremblantes, tantôt en plumes.
Aigue- marine. — L’aigue-marine orientale est un corindon très dur de couleur bleu-vert très franche. C’est elle que l’antiquité et le moyen âge nommaient: béryl.
Ambre. — Matière fossile transparente d’aspect résineux. Sa couleur varie du jaune pâle au brun roux. Plongé dans l’huile chaude, il devient malléable, et fond aux environs de 400°.
Améthyste. — Corindon hyalin de couleur violette. Raye le cristal de roche.
Ardillon. — Pointe mobile sur la traverse d’une boucle. Passée dans le tissu à fixer et rabattue sur le corps de la boucle, elle empêche le lien de glisser.
Aventurine. — Un grand nombre de pierres sont encore désignées sous ce nom, — bien que n’étant pas des aventurines, — dès qu’elles présentent les maculations dorées du quartz opaque aventurin, qui, lui, raye le cristal de roche.
Bâte. — Languette métallique soudée à angle droit sur un fond de bijou, et formant ainsi une alvéole où est sertie la pierre précieuse.
Béquille. — Bijou destiné à l’ornementation des cannes. C’est une variété de poignée courbée à angle droit, comme le «bec-de-corbin», mais dans celui-ci la branche horizontale est courbe au lieu d’être rectiligne.
Boucle. — Anneau de métal, rond ou rectangulaire, muni d’une traverse et d’un ou plusieurs ardillons, qui sert à réunir les deux extrémités d’une courroie, d’un ruban. — A l’âge du bronze, on en rencontre dépourvues d’ardillon, mais armées d’un crochet ou bouton.
Brodé. — Travail d’or incrusté par tailles légères et assez libres sur l’écaille, la nacre ou même l’ivoire. Il rappelle, en effet, un peu le travail de broderie d’or sur étoffe.
Breloques. — En Grèce déjà, les femmes portaient parfois suspendues à leurs bracelets de petites figures d’or, ou de pierreries qui étaient moins que des talismans, mais plus que de simples ornements. C’est le bijou du moment, le souvenir, la fantaisie d’une heure.
Cabochon. — Pierre précieuse polie dans une forme arrondie, au lieu d’être taillée à facettes.
Carat. — Quand il s’agit de l’or, ce mot signifie la 24e partie du poids total d’un alliage; ex.: de l’or à 18 carats contient 18 parties d’or fin sur 24.
Pour les perles, les diamants, le carat est un poids de 20 centigrammes qui leur sert d’unité légale.
Chapel. — Bijou, qui se portait d’ordinaire sur le chaperon, au moyen âge. On nommait également chapel d’orfroi la résille d’or enrichie de perles que les femmes nobles ont portée souvent du XIIe au XVe siècle.
Chalcédoine. — Quartz-agate; pierre dure semi-transparente d’un blanc laiteux, parfois légèrement bleuté. Cette dernière couleur est la plus estimée.
Châtelaines. — Chaînes par lesquelles les dames suspendaient à leur ceinture certains bijoux ou bibelots précieux: flacons, couteaux, clefs de coffret, etc.
Chaton. — Partie de la bague qui se trouve à la partie supérieure du doigt. C’est elle qui porte tantôt une inscription, tantôt une gravure ou encore un motif de joaillerie.
Clivage. — Polissage d’une pierre précieuse sur ses faces naturelles de cristallisation.
Colliers-carcans. — Fantaisie inventée ainsi que le nom au XVIIe siècle. Colliers en joaillerie à plusieurs rangs de pierres égaux entre eux. On en fait encore aujourd’hui.
Corail. — Test calcaire sécrété par certains polypiers des mers chaudes, agglomérés en masses considérables: rouge, rose ou blanc.
Corindons. — Toutes les pierres dures dites orientales sont des corindons diversement colorés par des oxydes naturels. Ce sont les plus durs des minéraux.
Cornaline. — Sorte de chalcédoine colorée en rouge par l’oxyde de fer.
Cristal de roche. — Quartz hyalin transparent, blanc. Assez dur pour rayer la plupart des agates.
Culbutes. — Nom donné, au XVIIe siècle, à des joyaux montés en «chutes», c’est-à-dire en groupes de pierreries serties, à articulations mobiles.
Diamant (grec: άδαμας, indomptable). — Carbone pur cristallisé en octaèdres ou dodécaèdres et leurs dérives. Inattaquable par les acides et ne pouvant être rayé que par lui-même. Brûle comme le charbon. Son pouvoir de réfraction est: 1.396 (eau — o, 785).
Fibule. — Sous des apparences plus ou moins modifiées par les modes successives, la fibule est cette sorte d’épingle, qu’on utilise encore aujourd’hui sous le nom d’épingle de nourrice. Le système de ressort obtenu par enroulement de l’épingle sur elle-même à sa base, semble commun dès l’âge du bronze.
Filigrané. — Le filigrané vient del’Orient où la tradition technique s’est d’ailleurs conservée. C’est une sorte de tressage de fils métalliques, or ou argent, soudés entre eux par endroits, et tantôt produisant une forme ajourée, tantôt s’appuyant à un fond. On dit communément: filigrane.
Frassinelle. — Pierre dure qui sert à polir le métal.
Glacis. — Teinte transparente appliquée sur un fond d’autre couleur et qui lui donne de l’éclat.
Girandoles. — Diamants ou pierreries assemblés à articulations mobiles et servant de pendants d’oreilles. La mode en a commencé en France au XVIIe siècle.
Grain. — Ancien poids très petit valant environ 5 centigrammes, que les lapidaires emploient encore pour décrire une pierre; ex.: une perle de 4 grains et demi. — Cellini écrit couramment: grain de blé, terme encore usité en Italie, de son temps.
Granulé. — Travail de fonds sur les bijoux étrusques et parfois égyptiens obtenu par l’effet d’une poussière d’or soudée. On l’a cru longtemps irréalisable par des mains modernes: c’est un procédé long, minutieux, mais sans aucun mystère technique.
Émail de basse taille. — Décoration obtenue par l’émail sur un fond de métal, à peine entaillé en creux et surtout strié de points de rétention. On sait que dans les émaux limousins la place réservée à l’émail était préparée par cloisonnemment ou par champ-levé.
Émeraude (sanscrit: smarakata = vert?) L’émeraude orientale est un quartz hyalin d’un vert intense. Toutes les pierres dures de couleur verte employées par les bijoutiers ne sont pas de vraies émeraudes.
Enseignes. — Genre de bijou porté au chaperon, par les hommes et même par les femmes pendant le XVIe siècle. — On en fit alors de très riches ornés d’émaux et de pierreries.
Fermail. — Bijou du moyen âge. Créé d’abord pour les lourdes chapes religieuses, il est resté usité, mais allégé, dans tous les pays où les femmes portent des capes.
Ferrets. — Ornements métalliques qui enserrent les extrémités d’un lacet ou d’un ruban: ils ont été à la mode chez nous au XVIe et au XVIIe siècle pour les hommes comme pour les femmes. Aujourd’hui, ils ne servent plus de bijoux. On les emploie encore à l’extrémité des aiguillettes et des fourragères militaires.
Ferronnière. — Bijou qui, à l’époque de la Renaissance, fut à la mode, pour les femmes. Il consistait en un joyau retenu au milieu du front par une chaînette ou un cordonnet qui ceignait la tête. — Le portrait de Lucrezia Crivelli par Léonard de Vinci (au Louvre) la montre parée d’une ferronnière.
Fonte à cire perdue. — C’est la seule qui puisse produire les objets délicats que sont les bijoux. Elle sert uniquement d’ailleurs aux joyaux de grande dimension. Aujourd’hui, que l’emploi des pierres s’est généralisé, elle est délaissée en bijouterie.
Grenat. — Silicate d’alumine ferrugineux assez commun, d’une belle couleur rouge qui rappelle celle de la grenade (latin: punicum granatum).
Guillochage. — Travail de fond qui consiste en un réseau plus ou moins serré de traits ondulés gravés en creux dans le métal.
Le résultat de ce travail se dit: guilloché, et aussi: guillochis.
Jaspe. — Quartz opaque susceptible d’un beau poli. On en trouve de vert, — le plus commun, — de brun, de noir et de blanc; ces derniers sont rares.
Jeannettes. — Le nom est contemporain de J.-J. Rousseau et de Greuze et témoigne de la vogue qu’eut alors la simplicité des champs. C’est une chaîne à maillons unis, ornée d’une modeste croix, en or également.
Lapis-lazuli (latin: lapis; arabe: azul, bleu). — Silicate d’alumine et de chaux, opaque, de couleur bleue plus ou moins intense. Assez dur pour rayer le verre. Se polit bien.
Malachite. — Pierre opaque, assez dure, d’une couleur vert intense. Ce n’est évidemment pas celle que les Grecs appelaient du même nom: μαλάχη = mauve.
Manicles. — Bracelets larges pour le poignet.
Marquises. — Bagues créées au XVIIIe siècle. Monté sur un jonc assez simple, un chaton émaillé de forme ogivale allongée, le tout entouré de petits diamants.
Martelé. — Genre de travail dans lequel le marteau frappe directement le métal, et le façonne un peu comme le forgeron modèle le fer. L’or et l’argent s’écrouissent par ce travail et deviennent plus durs, plus résistants.
Médaillon. — Bijou ouvrant à charnière, et pouvant contenir soit un portrait en miniature, soit un souvenir. La vogue en a été grande surtout au XVIIIe siècle et à la Restauration. La bulle romaine était un médaillon.
Nielle. — Décoration obtenue sur l’argent par une gravure au burin, dans laquelle on fixe ensuite une pâte de couleur noire. L’effet obtenu est un peu celui d’une gravure sur papier, mais avec un fond brillant. — Le procédé a été découvert par Maso Finiguerra, Florentin, au XVe siècle.
Noeuds à l’égaré. — Nœuds en joaillerie créés par le célèbre orfèvre Gilles Ligari. — Il se portait sur le sein; d’où le calembour aussitôt répandu qui lui valut désormais son nom.
Œil-de-chat. — Silicate d’alumine ocellé dont l’éclat et la couleur rappellent, en effet, la lueur des yeux de félins.
Opale. — Silicate hydraté insoluble, de dureté et de coloration variées. Très fragile,, elle se laisse généralement attaquer par la lime.
Patenôtres. — Jusqu’à la fin du moyen âge et depuis le XIVe siècle, les chapelets et rosaires furent souvent des ornements luxueux en même temps que des objets de piété. On les portait ostensiblement, comme font encore les Arabes aujourd’hui.
Pectoral. — Bijou rituel porté sur la poitrine par des souverains, des pontifes, les pharaons d’Égypte par exemple ou les grands prêtres juifs.
Pend-à-col. — Nom donné à l’époque de la Renaissance aux nombreux bijoux, souvent fort beaux, dont la mode se développa en même temps que celle des justaucorps échancrés pour les hommes et des guimpes décolletées pour les femmes.
Pendentif. — Désigne le même genre de bijou que le pend-à-col. Il est en général suspendu à une chaîne beaucoup plus longue que celui-là.
Perle. — Sécrétion à base de carbonate de chaux et substance organique produite par quelques mollusques, et en particulier par l’huître perlière: meleagrina margaritifera.
Pierre de lune. — Dure, à reflets opalescents; les anciens l’ont peut-être voulu désigner sous le nom d’Astrios et de Sélénites.
Reliquaire. — Comme son nom l’indique, ce bijou devait contenir des reliques. Sa forme ni son emploi n’ont été rigoureusement fixés. On le portait généralement au cou.
Recuit. — Opération de remise au feu qui redonne au métal martelé sa malléabilité première.
Repercé. — Travail par lequel l’ouvrier reprend à l’outil, à la lime généralement, les contours d’un bijou obtenu par la fonte ou l’estampé.
Repoussé. — Ornementation d’une feuille de métal par des reliefs obtenus au marteau, et à froid. Une partie du travail, le repoussage proprement dit, s’effectue à l’envers de la pièce.
Rivière. — Long collier en diamants exclusivement.
Rubis. — On confond ordinairement sous ce nom trois pierres très diverses de constitution mais d’apparence analogue: le rubis corindon rouge ou rubis oriental, le spinelle et le rubis balais. Le rubis corindon est l’escarboucle.
Saphir. — Cristal d’alumine presque pure coloré en bleu plus ou moins foncé par l’oxyde de fer. — Les anciens n’ont pas très bien su l’identifier.
Sardoines, sardonyx. — Pierres dures semi-transparentes, veinées, parfois à plusieurs couches de coloration différente. Se gravent aisément.
Sautoir. — Terme qui désigne actuellement un long collier, — de perles, en général, — dont une partie s’enroule autour du cou et l’autre reste pendante sur la poitrine.
Serti. — Entourage métallique, soudé sur le fond et rabattu sur les flancs de la pierre à monter, afin de la fixer solidement.
Soudure. — Opération par laquelle on fixe à chaud une partie métallique sur une autre partie, tantôt avec de l’étain, tantôt avec le métal lui-même auquel on ajoute du borax comme «fondant».
Taille. — Opération par laquelle, grâce à des clivages successifs, on donne une forme régulière, et presque toujours à facettes, aux pierres dures, diamant, rubis, émeraudes, etc.
Topaze. — La topaze orientale est un corindon hyalin jaune brillant. Il raye assez profondément le cristal de roche, et sa couleur tourne au rose sous l’influence d’une certaine température.
Tourets. — Coiffure de femme usitée au XVIe siècle. — Elle consistait en une sorte de diadème en bourrelets, rehaussé de bijoux spécialement créé pour cet usage.
Trousses. — Bijou analogue aux châtelaines; on l’accrochait aussi à la ceinture. Il contenait mille objets utiles, couteaux, ciseaux, miroirs, cure-oreilles, flacons, etc. C’était plutôt une parure de bonne ménagère.
Turquoise. — Le même nom sert à désigner la turquoise alumine, pierre qui ne s’altère pas à l’air, la turquoise phosphoreuse fossile dont la surface se détruit peu à peu, enfin la turquoise occidentale qui s’altère profondément et qui est sans valeur.
(FIG. 1).