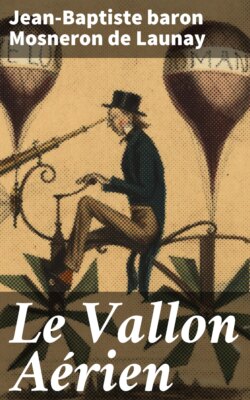Читать книгу Le Vallon Aérien - Jean-Baptiste baron Mosneron de Launay - Страница 5
LE VALLON AÉRIEN.
ОглавлениеRelation de mon Voyage (celui de M. de Montagnac) dans le Vallon Aérien.
J'avois apperçu dans une de mes dernières ascensions un groupe de montagnes rangées dans une forme circulaire, au milieu desquelles je soupçonnois qu'étoit une plaine d'une grande étendue; avant de m'élever au-dessus de cette partie de la chaîne des Pyrénées, je désirai savoir le nom qu'on lui avoit donné dans le pays, et si elle étoit habitée. Je m'acheminai donc au pied de ces montagnes, et je cherchai des éclaircissemens parmi des bergers qui étoient venus s'y établir pendant l'été avec leurs troupeaux. Ils me dirent que l'intérieur de l'enceinte étoit aussi profond que les montagnes étoient élevées, qu'on n'avoit jamais pu y pénétrer, attendu que tout autour l'extérieur étoit un rempart perpendiculaire, uni comme une glace; mais que l'on savoit cependant que cette enceinte servoit de demeure à une troupe de sorciers qui, s'ils n'étoient pas de vrais diables, avoient du moins de grandes relations avec l'enfer; qu'il étoit constaté que toutes les fois qu'il tomboit une grêle, une gelée ou quelqu'autre accident funeste, on voyoit quelques-uns de ces sorciers rire aux éclats sur les remparts de l'enceinte; d'où il étoit évident que c'étoient eux qui avoient envoyé le fléau.
Voilà les seuls renseignemens que je pus tirer de ces pauvres pâtres. Il eût été inutile de chercher à les désabuser.
"L'homme est de glace aux vérités,
Il est de feu pour le mensonge.
Ces vers ont une application universelle, et il semble à l'intérêt qu'inspirent les fictions à toutes les classes de la société, qu'elles sont nécessaires à l'esprit de l'homme; ce n'est le plus souvent que par-là qu'il prouve l'existence de sa pensée; et la plus grande partie du genre humain seroit réduite à l'état d'imbécillité, si la vérité étoit la seule source où elle pût puiser ses idées.
Je conclus de l'opinion de mes pâtres, partagée par tous les habitans des environs, que l'intérieur de ce groupe de montagnes méritoit d'être examiné. Je profitai, le 10 de juillet, d'un calme presqu'absolu pour m'élever à leur hauteur. En planant à la distance de quelques centaines de toises au-dessus de ce bassin, il me fut aisé d'y appercevoir des hommes à la simple vue; mais aussitôt qu'ils m'eurent découvert, ils s'enfuirent et disparurent: ce qui auroit bien suffi, si j'avois eu quelques doutes à cet égard, pour me persuader que ces gens-là n'étoient pas en relation avec l'empire infernal. Cependant, lorsqu'après avoir ouvert la soupape pour faire écouler une partie du gaz de mon ballon, je fus descendu à terre, je m'armai à tout évènement, avant de sortir de ma nacelle, de mes deux pistolets et de mon sabre. Tous les objets qui m'environnoient, présentoient l'image de la civilisation; à mes pieds, des champs cultivés et plantés en diverses espèces de grains; sur les coteaux, des troupeaux de différens animaux, des bosquets, des fleurs, un jardin; et vers le milieu, un amas de cabanes alignées dans un ordre régulier; mais parmi cette apparente population, la plus profonde solitude; les pâtres même qui gardoient les troupeaux, avoient disparu, et il ne restoit dans les champs en culture que quelques instrumens aratoires qui attestassent la présence de l'homme.
En suivant le sentier qui conduisoit aux cabanes, je me sentis frappé d'un violent saisissement. Quels étoient les habitans de ce lieu inconnus au reste de la terre? des brigands, peut-être, des assassins qui n'ont pu trouver que cet asile pour se dérober à la justice. Que vais-je devenir au milieu d'eux, seul, sans secours, sans protection! Cependant, ces paisibles troupeaux, cette innocente culture annonçoient des mœurs douces; les peuples agriculteurs sont sociables et bons; il n'y a de féroces que ces hommes de sang qui vivent de chasse et de carnage. En m'entretenant de ces diverses pensées, j'arrivai au village; toutes les portes étoient fermées et je n'entendois pas le moindre bruit. Parmi ces cabanes, j'en distinguai une plus grande et plus ornée que les autres. Je pensai que s'il y avoit quelque humanité dans ce lieu, elle se trouveroit de préférence chez l'individu qui annonçoit le plus d'aisance, et conséquemment le plus de lumières. J'allai donc frapper à cette porte, qui, ainsi que toutes les autres, n'étoit fermée que par un simple loquet de bois. Elle s'ouvre, et je me sens pénétré de confiance et de vénération à l'aspect d'un grand et bel homme portant une longue barbe, qui me dit avec un sourire affectueux: «Mon frère, vous avez couru un grand danger, et nous avons eu bien peur nous-mêmes de ce gros vilain animal qui vous tenoit dans ses pattes. Il est mort, sans doute, puisque vous voilà en vie.» Après ces paroles, et sans attendre ma réponse, le patriarche me prend par la main et m'entraîne hors de la maison. Sa femme et ses deux enfans le suivent. Lorsqu'il fut sur le perron qui étoit au-devant de sa demeure, il sonna trois fois d'une trompe qu'il portoit suspendue à son côté. A ce signal, tous les habitans sortirent de leurs cabanes et se rangèrent en demi-cercle devant le perron. Cependant, ils tournoient souvent la tête du côté où étoit le ballon, en donnant de grandes marques de frayeur. Parlez maintenant, me dit mon guide qui paroissoit être le chef de la peuplade; apprenez à nos frères si vous êtes bien sûr d'avoir tué le monstre qui vous a porté jusqu'ici, et s'il n'y a plus rien à en craindre. Je m'efforçois de leur faire comprendre que mon ballon n'étoit qu'une machine insensible, absolument incapable de faire ni bien ni mal à personne; mais, m'appercevant qu'il restoit toujours beaucoup d'inquiétude, je les conjurai de me suivre pour se rassurer par leurs propres yeux. Lorsque je fus rendu au ballon, et que je l'eus touché et fait toucher de tous côtés à quelques-uns des plus hardis, ils passèrent aussitôt de l'excès de la peur à l'excès de la licence. Chacun s'efforçoit à l'envi de monter dessus pour le fouler aux pieds. Je me hâtai de prévenir les suites de ces bravades, en faisant concevoir au chef de quelle importance il étoit pour moi que cette machine ne fût pas endommagée. Alors, il décrivit à trois pas de distance un grand cercle tout autour, et défendit à tout le monde de l'outre-passer, en recommandant aux mères de surveiller leurs enfans.
Lorsque de part et d'autre on eut fait disparoître tout sujet de craintes et d'inquiétudes, je me livrai à l'examen de mes nouveaux hôtes. Tous les hommes sembloient des Apollon, et toutes les femmes des Vénus par leurs belles formes et leur noble stature; mais la bonté peinte sur la figure des premiers, remplaçoit la fierté du Dieu vainqueur du serpent, et tous les traits des autres exprimoient l'innocence et la candeur, au lieu des ruses et de la coquetterie de la déesse amante de Mars.
Cette beauté extérieure, si générale parmi les deux sexes, devoit avoir une cause commune; et la suite de mes observations me convainquit qu'elle étoit principalement l'effet de la perfection intérieure. On a pu remarquer comme moi que ces familles de bonne race, distinguées par une longue filiation de vertus héréditaires, sont la plupart caractérisées par une belle figure, et toutes du moins par une bonne figure. S'il y a des exceptions à la règle, elles ne portent que sur quelques individus, et non pas sur les races qui conservent, tant qu'elles ne dégénèrent pas, cette influence marquée du moral sur le physique, cette harmonie entre l'ame et le corps.
La peuplade que j'avois sous les yeux respiroit je ne sais quoi d'antique et de patriarchal. Il me sembloit voir les premiers descendans d'Adam rassemblés autour de leur chef, avant sa chute, avant que Caïn eût troublé l'innocence et la paix de la terre. Ils ne composent qu'une seule famille; ils s'appellent entr'eux comme aux premiers tems du doux nom de frère et de sœur; le chef a sur eux cette autorité de la vertu qui, ne se déployant que pour le bonheur des hommes qui lui sont soumis, tire tant de force de l'amour qu'elle inspire. Aussi est-il leur père commun. Toutes ses volontés sont des lois sacrées, parce qu'il ne veut jamais que faire des heureux.
La puissance du chef est sanctionnée par Dieu même. Il est son représentant sur la terre; c'est au nom de cet Etre-Suprême qu'il annonce ses volontés. Ainsi, c'est de Dieu même qu'émanent toutes les loix; il est présent à toutes les pensées et à toutes les actions. En un mot, c'est le gouvernement théocratique, mais bien différent de celui de Moïse; car il ne commande ni les sacrifices d'animaux, ni le massacre des hommes, et il est aussi doux que l'autre étoit terrible.
Une chose plus étonnante encore que la pureté des mœurs dans ce coin des Pyrénées, c'est l'instruction, la justesse d'esprit, la correction du langage commune à tous ses habitans. Quel incroyable phénomène! au milieu d'un pays qui semble de trois siècles en arrière de la civilisation du reste de la France, où l'homme encore sauvage ne parle qu'un patois grossier, borné, comme ses idées, à l'expression des seuls besoins physiques;[1] dans le lieu le plus agreste de ce pays, qu'à l'aspect de son enceinte on n'auroit jugé propre qu'à servir de retraite aux aigles et aux ours, habite un peuple doux, bon, aimable, tel qu'on n'en trouve plus de semblable sur la terre, et que, pour s'en former une idée, il faille recourir à ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'histoire et dans la fable. Qu'on se représente une société choisie du beau siècle de Louis XIV, échappée à la contagion du siècle suivant, dont la raison mûrie a remplacé la politesse des lèvres par celle du cœur, et les éclairs du bel esprit par la lumière toujours égale du bon sens. Tel est le peuple du Vallon aérien.
Quoiqu'il soit difficile de se défendre d'un peu d'enthousiasme en faisant la description d'un pareil peuple, elle est cependant fidellement tracée d'après la nature même. L'imagination peut bien chercher à embellir quelques traits d'un tableau lorsqu'on le copie; mais elle n'en ajoute aucun qui ne soit pas dans le modèle. On ne pourra m'accuser d'exagération quand je me renfermerai dans l'expression littérale de ce que j'ai vu, et c'est ce que je fais religieusement; et je consens qu'on m'applique le mentiris impudentissime, si mes confrères les aéronautes qui seront tentés de faire le même voyage, ne confirment pas cette relation[2].
Après ce que je viens de dire du degré de civilisation de ce peuple, ce n'est pas une grande merveille que tous ses individus sachent lire et écrire. Si je faisois un roman, j'ajouterois qu'il y a dans le pays une fabrique de papiers, une imprimerie et des auteurs; mais, fidèle organe de la simple vérité, je dirai qu'au défaut de papier dont on ne fait point usage, attendu qu'on n'en fabrique pas, on se sert de parchemin pour écrire; que toute la bibliothèque du pays est composée d'une centaine de volumes imprimés à Paris il y a cent trente ou cent cinquante ans; qu'on ne connoît aucun de ceux du XVIIIe siècle, et que les seuls livres nouveaux sont manuscrits, et ont été composés dans ce lieu. Ces livres sont un catéchisme politique et moral dont il y a autant d'exemplaires que d'habitans âgés de plus de vingt ans; car chacun est obligé d'en tirer une copie dès qu'il est parvenu à l'âge de raison. Ce catéchisme contient des règles de conduite pour tout ce qui, n'étant pas inspiré par la nature, tient aux conventions ou aux convenances de la société. Ainsi, les obligations réciproques entre les pères et les enfans n'y sont pas comprises, parce qu'elles émanent du sentiment, et que ce seroit méconnoître le sentiment que d'en faire un devoir.
La religion fournit le texte du premier et principal chapitre de ce catéchisme. Cette religion est, comme je l'ai dit, essentiellement théocratique. Le chef, étant le représentant de Dieu, réunit les deux pouvoirs temporel et spirituel. C'est lui qui, chaque matin, entonne le cantique de louanges et d'hommages à l'Etre-Suprême, que tout le peuple répète après lui. Il prescrit ensuite les différens travaux auxquels chacun doit se livrer dans le cours de la journée. En quelque lieu que soit l'homme, et quelles que soient ses pensées et ses actions, il est continuellement sous les regards de Dieu. Le chef fait, quand il lui plaît, résonner la trompe que lui seul a droit de porter; à ce signal, tous les individus, sans exception, quittent leurs travaux, et adressent en commun leur hommage au ciel; cet hommage est renouvelé avant le commencement et après la fin de chaque repas, ainsi qu'après la fin des travaux de la journée. Les dimanches, les fêtes annuelles instituées pour différentes causes, les naissances, les mariages et les funérailles, sont également célébrés par des hymnes, par des chants religieux, analogues au sujet de la cérémonie. Voilà le seul culte, les seuls actes extérieurs de la religion de ce peuple; et j'ajoute que jamais sur la terre il n'en a paru d'aussi pieux. L'Eglise Romaine n'a pas de saints plus purs, et leurs vertus semblent, comme leur demeure, située entre le ciel et la terre, les placer dès cette vie au rang des anges.
Tel est le sommaire du premier chapitre.
Le second chapitre traite de la puissance du chef, de l'obéissance du peuple et des obligations réciproques de l'un et de l'autre.
Dans les autres chapitres on fixe le mode d'élévation à la place de chef. Elle est héréditaire pour les hommes seuls et par ordre de primogéniture.
Il y a un conseil de vieillards qui s'assemble deux fois par semaine, et sans l'avis duquel le chef ne peut rien ordonner de nouveau ou qui s'écarte de la règle habituelle. Ce même conseil est chargé de faire l'examen de la vie de l'individu qui vient de mourir, et de rédiger, conformément au résultat de cet examen, l'inscription qui est gravée sur sa tombe. C'est ce conseil qui, conjointement avec le chef, fixe tous les ans l'étendue des terres à cultiver, et l'espèce de grains à y semer; car il n'y a aucune propriété distincte; tout est commun, à l'exception seulement des personnes, du logement et des vêtemens.
Mais le peuple n'est pas le seul dont la conduite soit dirigée; une loi sévère surveille également celle du chef. Depuis l'archange Satan qui abusa de sa puissance, tout démontre qu'il n'est aucune créature, telle parfaite qu'elle soit, qui ne soit portée à excéder la mesure de son pouvoir, si ce pouvoir n'a des limites et des surveillans qui les fassent respecter. Tous les cas d'usurpation d'autorité et de despotisme sont prévus dans le catéchisme, et la repréhension en est confiée au conseil des vieillards.
Au reste, on peut dire de cette peuplade, avec bien plus de raison que Tacite n'a dit des Germains: Que les mœurs y tiennent la place des lois. L'isolement de cet heureux asile de la vertu le garantit de la contagion du vice: et s'il s'y est glissé quelques fautes inséparables de l'humanité, de légères corrections suffisent pour les réprimer[3].
Je me borne à cet exposé, parce que j'ai apporté une copie de ce singulier catéchisme que je ferai imprimer séparément en entier, si on le désire[4].
L'autre livre, également manuscrit, contient les annales de cette peuplade, depuis l'origine de son établissement jusqu'à ce jour. Celui-là n'est pas aussi répandu que le premier; le chef et les membres du conseil sont les seules personnes qui en ayent une copie. On a bien voulu m'en donner une que je transcrirai à la suite de cette relation[5].
Je reprends la description de ma nouvelle découverte. Ce canton des Pyrénées étoit autrefois connu sous le nom de vallon de Mambré, c'est maintenant le Vallon aérien. La population qui l'habite est presque doublée depuis environ cent trente ans qu'elle y est fixée et qu'elle y vit entièrement ignorée du reste de la terre. Les hommes portent la barbe dans toute sa longueur; leurs cheveux également longs sont rassemblés et attachés derrière. Leurs vêtemens consistent en un bonnet ou un chapeau de paille, des guêtres, une culotte et un gilet, et dans l'hiver, un manteau pardessus: ces vêtemens sont en laine tissue dans le vallon. L'habillement des femmes est composé d'une jupe, d'un corset, et d'une mantille l'hiver. Leurs longs cheveux sont nattés en tresses et relevés sous un chapeau de paille semblable à celui des hommes. Les souliers des deux sexes sont des spartaines de cordes comme on en porte dans toutes les hautes montagnes.
Ils font deux repas par jour, l'un à onze heures du matin, l'autre à sept heures du soir. Ils ont pour alimens d'excellent pain très-bien fabriqué, des truites, des œufs, des légumes et de la viande, seulement deux fois par semaine; mais leur mets favori, et dont ils font leur principale nourriture, est le laitage si délicieux dans les montagnes. La boisson est à leur choix, de l'eau ou une petite bierre qu'ils sont parvenus à faire très-bonne. La framboise, la fraise si parfumée des Pyrénées, croissent abondamment dans ce vallon; mais nos autres fruits n'y viennent pas aussi bien, entr'autres, le raisin que je n'ai vu qu'en petite quantité, soit qu'ils n'ayent pas pu, soit que par crainte des suites ils n'ayent pas voulu multiplier assez les plans de vignes pour faire du vin leur boisson habituelle.
Ils prennent ces repas réunis en commun au nombre de douze personnes, entremêlées, sans distinction de parens ou d'étrangers. Une pareille confusion avoit également lieu chez les Spartiates, dans leurs tables publiques; mais le but n'étoit pas le même. Lycurgue avoit voulu par ce moyen affoiblir l'amour des pères pour leurs enfans et des enfans pour leurs pères, afin d'endurcir le cœur des uns et des autres, de les rendre impassibles, et conséquemment plus propres au dur métier de la guerre. Le législateur du Vallon aérien s'étoit proposé, au contraire, dans cette réunion, d'étendre à toute la peuplade l'attachement des membres de chaque famille entr'eux, de manière à n'en faire réellement qu'une seule grande famille; et, si j'en juge par l'apparence, il a parfaitement réussi; car il m'a semblé que tous les habitans étoient frères et sœurs de sentiment comme ils le sont de nom.
Tous ces montagnards me parurent réunir à leurs belles formes une constitution saine et robuste. Je vis plusieurs octogénaires en état de supporter journellement les fatigues de l'agriculture. La seule maladie que je jugeai devoir faire de grands ravages dans la nouvelle colonie, est la petite vérole. La plupart des figures en étoient gravées; et j'appris qu'il y avoit eu des tems de malignité où ce fléau avoit moissonné le quart de la population. J'instruisis alors le gouverneur de la découverte récente de la vaccine; je lui en exposai les nombreux avantages, et comme je portois toujours avec moi du vaccin frais, je lui offris d'en faire l'emploi sur quelques enfans de la colonie, en lui enseignant en même tems le moyen de multiplier ce remède et de l'étendre à toute la jeunesse; mais je tâchois en vain de le persuader de la bonté de ce préservatif; je n'aurois pu obtenir d'en faire l'application, si plusieurs pères de famille qui avoient perdu une partie de leurs enfans par la petite vérole, craignant encore pour ceux qui leur restoient, n'avoient fortement appuyé ma demande. Je suis loin de blâmer cette obstination du gouverneur à rejetter la vaccine, quand je songe aux longues difficultés qu'éprouva l'inoculation à s'établir en Europe. Le premier mouvement de la nature est de repousser un mal certain, quel que soit l'espoir que ce mal procurera du bien. L'expérience seule peut instruire à cet égard; mais il faut mille faits pour détruire un préjugé accrédité. Le remède que j'ai introduit se fera bientôt connoître; ses bons effets seront trop évidens pour ne pas assurer son triomphe, et je jouis d'avance de la vive satisfaction d'avoir extirpé le principal fléau de ce beau séjour.
Quoique ma curiosité fût très-pressante, et que je fisse une foule de questions, ces bons montagnards n'en parurent pas importunés; ils y répondoient avec beaucoup de douceur et de clarté; mais, à mon grand étonnement, cette curiosité n'a pas été réciproque; non-seulement, contre mon attente, ils ont été fort insoucians sur tout ce qui concerne le pays d'où je venois, mais même ils évitoient d'en parler. J'ai attribué cette indifférence pour le monde inférieur qui alloit quelquefois jusqu'à l'aversion, au souvenir des malheurs qu'y ont essuyés leurs aïeux. Il y avoit encore dans le Vallon aérien plusieurs individus dont les pères avoient vécu dans ce monde-là. Ils l'avoient peint avec des couleurs si noires qu'ils en avoient fait une espèce d'enfer. Telle étoit la tradition du Vallon qui se fortifiera encore en vieillissant, de sorte que, dans un ou deux siècles, la terre entière ne sera habitée, selon eux, que par des diables; le Vallon aérien sera le seul asile préservé des flammes infernales, où vivront paisiblement quelques élus en attendant leur passage à la vie immortelle de l'empire céleste.
Toutes les facultés intellectuelles, portées au haut degré d'élévation où je les voyois chez ce peuple, supposoient cependant un grand fonds de curiosité; car la science ne peut naître que du désir de savoir; mais ce qu'il m'eût été difficile de deviner, c'est que le principal objet de la curiosité des habitans du Vallon étoit la connoissance des astres. Indifférens pour tout ce qui se passe sur la terre, ils étoient avides de lire ce qui arrive dans le ciel; ils en connoissoient assez bien la carte; ils distinguoient les planètes; ils suivoient leurs mouvemens; ils avoient calculé avec la plus grande précision la révolution apparente du soleil, et leur année correspondoit exactement à la nôtre.
La même étude étoit commune à ces anciens peuples Nomades, tels que les Chaldéens, qui, vivant en paix avec toute la terre, ne cherchoient à faire de conquêtes que dans le vaste champ des étoiles.
On peut remarquer aussi que tous les grands astronomes ont eu le même esprit de douceur et de paix, Copernic, Galilée, Newton et notre Lalande. Ce dernier, malgré son opinion sur la création, assurément très-immorale, étoit le meilleur des hommes.
La lunette dont ils se servoient pour observer étoit très-imparfaite. Depuis le tems de sa construction, l'optique avoit fait de grands progrès. Je leur offris un excellent télescope que je portois dans tous mes voyages aériens. Ils l'acceptèrent avec grand plaisir; ils furent émerveillés des nouvelles découvertes astronomiques dont je les instruisis.
Ils s'occupent aussi de l'étude de l'agriculture, et de cette partie de la botanique qui a pour objet la connoissance des plantes salutaires dans différentes maladies. Cette branche de la matière médicale, la seule que la nature ait indiquée aux animaux et qui leur suffit pour prévenir ou guérir leurs maux, suffisoit également à ces hommes qui, menant une vie simple et frugale, exempte de toute espèce de passions, n'étoient assujétis qu'aux maladies communes à tous les êtres qui ont reçu l'existence, et avec elle le germe de la mort.
Les arts auroient été seuls capables de réconcilier les habitans du Vallon aérien avec la terre. Les ouvrages d'art qui leur avoient été transmis par leurs ancêtres, étoient la plupart comme dans le tems de leur invention. Plusieurs autres avoient été découverts depuis. La perfection des premiers, l'invention des autres excitoient leur admiration. Ils me firent voir les montres des fondateurs de la colonie qui étoient suspendues depuis cent quarante ans, entièrement détraquées et sans mouvement, et me demandèrent si nous avions maintenant quelque chose de mieux. Je leur présentai pour réponse les deux que je portois; l'une étoit une montre marine de Berthould; l'autre étoit de Breguier, à répétition, quantième, seconde, etc. Le gouverneur ne put contenir sa joie à la vue de ces effets précieux; il les prit aussitôt de mes mains et les suspendit dans sa chambre. Il s'appropria également mon baromètre, mon thermomètre, ma boussole et quelques autres instrumens utiles à mes voyages. Il ne faisoit, en agissant ainsi, que suivre l'usage reçu dans le Vallon aérien, où tout en général est commun, sans qu'il soit reconnu aucune propriété distincte. Cependant, mes regards fixés avec étonnement sur les siens, rappelèrent à son esprit que notre usage étoit bien différent du sien; alors, il voulut tout me rendre, un peu confus de son action; mais je me hâtai de le tranquilliser en lui en faisant présent.
L'heure du repas du soir étant arrivée, je me mis à table avec le gouverneur, sa famille, et quelques habitans du Vallon qui sont tous invités successivement chacun à leur tour, à moins de quelque faute qui les exclue pour un tems de la table du chef, et cette punition est la plus sensible qu'on puisse infliger. Du poisson, des légumes, du laitage, des fraises, composoient le souper; les plats et tous les autres ustenciles de cette nature étoient faits d'une terre très-convenable à cet usage, qu'on trouvoit dans la gorge d'une des montagnes. La boisson étoit une petite bierre assez agréable. J'avois dans ma nacelle quelques liqueurs; mais je me gardai bien de leur en offrir; c'est la seule richesse de notre monde dont la connoissance eût été un malheur pour celui-ci. Si leur raison n'en eût pas été troublée pour le moment, la privation de ce doux breuvage leur eût tout au moins préparé pour l'avenir d'impuissans regrets.
Quelque tems après la fin du souper, les airs furent remplis du plus beau concert que j'aie entendu de ma vie. C'étoit le cantique du soir, chanté en chœur par tous les habitans réunis. Une modulation céleste marioit la voix des hommes de la montagne, naturellement forte et harmonieuse, à la voix douce et fraîche de leurs compagnes; un accident vint encore augmenter la solemnité de ce chant religieux. La soirée avoit été orageuse, et le tonnerre qui grondoit dans le lointain, s'approcha par degrés; il sembloit être l'organe de la Divinité qui applaudissoit à l'hommage de ses enfans bien-aimés.
Rien ne dispose mieux qu'une belle musique à un paisible sommeil. Avant de nous séparer pour en jouir, nous nous entretînmes pendant quelque tems du majestueux orage qui avoit produit une si belle basse à leur concert. Je leur appris que, graces aux nouvelles découvertes, ce météore n'étoit plus redoutable sur notre terre. Ils entendirent avec beaucoup d'intérêt l'historique des paratonnerres du célèbre Franklin. Cet instrument auroit été absolument inutile dans leur Vallon; car il est inoui que la foudre y ait jamais causé le moindre ravage. Tous les phénomènes de l'électricité, du galvanisme, en général, de la physique, que je leur racontai, ne captivèrent pas moins vivement leur curiosité et leur admiration.
Mon lit avoit été préparé dans une chambre voisine de celle du gouverneur. Une musique et des chants appropriés à la naissance du jour, comme ceux de la veille l'étoient à sa fin, vinrent terminer agréablement mon sommeil. Après avoir salué le gouverneur, je lui proposai une promenade. La pureté de l'air, le calme du ciel, le parfum des montagnes inspiroient dans tous les sens une douce sérénité. Il me sembloit être transporté à la création du monde, et dans ce lieu de délices où la course du tems n'étoit marquée que par la variété des plaisirs. Ah! m'écriai-je, voilà le paradis.
LE GOUVERNEUR.
Vous avez raison, mon ami; mais la différence de notre paradis à celui d'Adam, c'est que la vanité a fait sortir le premier homme du sien, et que c'est à la méchanceté de vos pères que nous devons l'heureuse rencontre du nôtre. Ici, notre espèce s'est relevée de sa chute originelle; ici, elle a recouvré les avantages qu'elle avoit perdus et dont vous êtes encore privés. Nous sommes au premier rang des êtres par notre bonheur comme par notre intelligence, tandis que dans votre monde dégénéré, vous n'êtes au-dessus des animaux que par vos connoissances; ils sont moins intelligens, mais ils sont plus heureux que vous. Etrange renversement produit par vos passions! la plus noble des créatures en est la plus infortunée.
M. DE MONTAGNAC.
Oui; c'est un fait certain; notre monde est resté sous le coup de la malédiction. La faculté de se rappeler le passé et de voir dans l'avenir qui augmente le bonheur de l'homme vertueux, fait le supplice du coupable; il vaudroit bien mieux pour lui qu'il fût borné comme l'animal à la jouissance du présent. J'ai pensé autrefois que les progrès de la civilisation et des lumières contribueroient à l'amélioration ainsi qu'au perfectionnement du genre humain. L'expérience et la réflexion m'ont détrompé.
LE GOUVERNEUR.
Mon ami, votre opinion étoit juste, et vous avez eu tort d'en changer. Les lumières élèvent l'homme et l'ignorance le dégrade; mais il faut pour cet effet que ces lumières soient permanentes, et que la masse entière en soit pénétrée. L'inconstance de vos gouvernemens ne permet pas cette stabilité. Vous avez aujourd'hui un roi qui protège la littérature et les sciences; il est remplacé par un autre qui n'a que la passion des conquêtes; un troisième succède sans caractère, sans goût et sans idée. De ce changement continuel résulte une légèreté d'esprit incapable de percer jusqu'à la vérité. On prend au lieu d'elle quelques prestiges séduisans, quelques lueurs mensongères que l'on suit et qui égarent. Mieux vaudroit l'ignorance et rester à la même place; mais que l'étude soit constamment suivie, que le flambeau des sciences brille toujours de la même lumière, et vous verrez l'espèce humaine marcher d'un pas lent, mais sûr, vers la perfectibilité. C'est à ce seul avantage que nous devons celle dont vous êtes étonné. Toutes les facultés intellectuelles dont nous sommes doués ont été constamment dirigées vers notre bonheur. C'est à ce seul but qu'elles doivent tendre; telle est l'intention de la nature en nous les accordant. Et c'est se rendre indigne de ses faveurs que d'occuper son tems d'études spéculatives qui ne produiroient aucun fruit utile, quand même on seroit assuré d'y avoir le plus grand succès.
Tout ce que je voyois m'annonçoit qu'en effet le bonheur de ce peuple n'étoit point comme le nôtre, un éclair rapide qui brille et s'éteint presqu'aussitôt au milieu d'épaisses et longues ténèbres; ici, il commence avec la vie et ne finit qu'avec elle. Le travail, loin de l'interrompre, est un nouveau plaisir. Ce travail, entremêlé de sourires, de propos agréables, de chants joyeux, est une image vivante de celui dont s'occupoient nos premiers pères dans leur magnifique jardin, suivant la belle description de Milton. Il contribue pareillement à faire mieux goûter la volupté du repos, les délices d'un salubre repas. Durant tout l'été, ce repas est pris en plein air, sur un tapis de fleurs au bord du ruisseau, à l'ombre de l'avenue de tilleuls qui serpente comme lui dans la prairie, et qui forme un lit de verdure parallèle à celui des eaux. Les vieillards, chancelans sous le poids des années, sont portés par leurs enfans à la salle du banquet champêtre. Ils arrivent en triomphe, et tout le monde se lève à leur approche. La petite quantité de vin qui est recueillie dans le Vallon est réservée pour cette dernière période de la vie où le sang glacé a besoin d'une chaleur auxiliaire. Les bons vieillards retrouvent dans la liqueur bienfaisante quelques souvenirs de leur jeune âge; ils se rappellent la vieille chanson qui accompagnoit la danse de leur tems.
Lorsque le repas est fini, d'autres plaisirs succèdent à celui du festin. Chacun se livre à l'amusement qui est le plus de son goût: les uns forment des danses dont la joie marque tous les pas; les autres s'occupent à différens jeux, soit d'exercice, soit d'adresse. Dans tous ces ébats règne la décence sans étude et sans art. Les vertus sont si naturelles chez ce peuple, qu'il lui en coûteroit plus pour s'en détacher qu'à tel peuple corrompu pour les pratiquer.
C'est ainsi que s'écoulent tous les jours des habitans du Vallon aérien. Jouissant d'un travail sans fatigue, et d'un repos sans oisiveté, leur félicité est bien supérieure à celle du célèbre vallon de Tempé dont la monotone bergerie devoit cacher bien des momens d'ennui.
J'ai dit qu'il ne manquoit à ce bon peuple que d'avoir la connoissance des sciences et des arts de l'Europe. Lorsque l'entretien vint à rouler sur cette matière, le gouverneur me fit observer qu'aucune nouveauté ne pouvoit être communiquée à ses frères qu'après avoir été soumise à l'examen et obtenu l'approbation du conseil. En parcourant les annales qu'il m'a communiquées, j'ai vu que cette loi étoit motivée sur l'extrême danger que courut la société en recevant dans son sein un étranger nommé Renou, et en adoptant quelques-unes de ses opinions. Le gouverneur n'étoit animé que du désir de faire le bonheur de ses frères; mais, rendu circonspect par l'exemple du passé, il me pria de lui dire franchement ce que je pensois moi-même sur le résultat de nos doctes acquisitions. «Vos savans, me dit-il, ont-ils perfectionné quelqu'un des cinq sens de l'homme? ont-ils découvert quelque nouvelle jouissance? en un mot, leurs travaux ont ils augmenté la portion de bonheur mesurée pour notre espèce?»
«Hélas, lui répondis-je, des trois grandes découvertes faites depuis environ deux mille ans, savoir, la boussole, la poudre à canon et l'imprimerie, les deux premières n'ont servi qu'à dépeupler la terre, la troisième est la seule qui l'ait éclairée.
Toute la science de nos astronomes n'est encore parvenue qu'à faire un bon almanach, celle de nos physiciens qu'à connoître la pesanteur relative des corps, celle des chymistes qu'à les décomposer. Au-delà, tout est doute et incertitude.
Ainsi, ces arts et ces sciences si vantés attestent un très-haut degré d'intelligence, mais ont été en général plus funestes qu'utiles. Il n'en est pas ainsi de la littérature. La belle éloquence, la sublime poésie, les fidèles tableaux de l'histoire, les touchantes rêveries de l'imagination, les grandes pensées de la philosophie, consolent au moins de nos maux, si elles ne les préviennent pas. Notre vie est le plus souvent un sentier entre deux précipices; au lieu de perdre son tems à combler les abîmes, ne vaut-il pas mieux en cacher la vue par des tapis de fleurs étendus de chaque côté?»
«Dans tous les tems et dans tous les pays, reprit le gouverneur, la culture des sciences a précédé celle de la littérature. Les choses vont avant les mots; et ce n'est qu'après avoir pensé, qu'on peut perfectionner l'art d'expliquer sa pensée. Il me paroîtroit donc bien étonnant que le siècle qui a suivi celui de Louis XIV n'eût pas produit de grands littérateurs. Je serois charmé de les connoître.»
«Le siècle de Louis XIV, lui répondis-je, a été suivi, non pas du siècle de Louis XV, mais du XVIIIe siècle; car il n'y a que les grands rois qui donnent leur nom à leur siècle; et ce siècle-là sera en effet éternellement célèbre par ses littérateurs. Ceux qui l'ont principalement honoré sont au nombre de quatre: Voltaire, Buffon, Montesquieu et J.-J. Rousseau.»
Le premier a été poète tragique et épique, historien, moraliste, romancier; en un mot, il s'est exercé sur toutes les cordes de la lyre, et sur toutes d'une manière originale et intéressante. Cependant, il ne paroît qu'au second rang des poètes épiques quand on le compare à Homère, Le Tasse ou Milton; des tragiques, si on le rapproche de Racine; des historiens, si on le lit après Robertson; des moralistes, quand on se rappelle Montague ou Labruyère; et il n'occupe sans contestation le premier rang que lorsqu'il s'agit de régler ceux des poètes légers. Mais une chose qui lui conciliera toujours un grand nombre de suffrages, c'est le talent d'observer, de peindre les mœurs, de saisir dans l'histoire les résultats des évènemens, et d'y répandre une philosophie aimable et instructive. Dans tous ses écrits, et jusques dans les plus frivoles, il intéresse par cet art de fournir un texte au babil des gens du monde et à la méditation des penseurs. Il semble par-là l'auteur de tous les âges et de tous les goûts.
Un autre écrivain a enrichi du style le plus brillant l'histoire qu'il a faite de tous les êtres organisés. L'homme est le premier anneau de la chaîne de ces êtres. L'historien de la nature parcourt toutes les espèces; il saisit d'une main sûre, dans la physionomie de chacune, les traits qu'elles ont de commun et ceux qui leur sont particuliers. Quel admirable enchaînement depuis l'animal le plus intelligent jusqu'à celui qui ne paroît que comme une plante insensible. Le génie du grand naturaliste s'est surtout déployé dans les hautes stations d'où il a contemplé la nature. C'est là que, planant sur la création, il en déroule à nos yeux le magnifique tableau. Ainsi, le savant géographe, en s'élevant par la pensée au-dessus du globe terrestre, cesse d'appercevoir les petites divisions de provinces, et d'états tracés par la main des hommes; ne voit plus que les grandes masses de la nature, les mers, les continens, les îles, les principaux fleuves; dessine avec exactitude leurs linéamens et leurs contours, et renferme la terre entière dans la circonférence de son compas.
Ce que Buffon fit pour l'histoire naturelle, un autre auteur l'a exécuté pour l'histoire civile. Nouvel Œdipe, il a deviné l'énigme des lois obscures et barbares qui gouvernèrent autrefois plusieurs grands peuples. Quelle patience pour compulser leur code enseveli sous la poussière des siècles! quelle sagacité pour pénétrer au travers de ces décombres, pour découvrir la disposition primitive des matériaux et le motif qui la dirigea, pour discerner les parties de l'édifice qui étoient sagement ordonnées et celles qui péchoient par quelque vice caché, pour rendre les fautes des pères utiles aux enfans, tirer les leçons de l'expérience et instruire les hommes dans la science qui les touche de plus près, celle de vivre en société de la manière la plus convenable pour qu'ils soient heureux!
Ce travail, sur les principes qui ont gouverné les différentes nations, avoit été préparé par un autre sur ceux qui ont porté au plus haut degré d'élévation le peuple-roi, et sur les causes de sa décadence. L'histoire est remplie d'individus nés sur le trône ou dans un rang vulgaire, qui ont fait de grandes conquêtes; mais où trouver ailleurs que chez les Romains un peuple entier conquérant par un systême politique, suivi constamment pendant plus de dix siècles? L'évènement? tenoit presque du prodige, et depuis près de deux mille ans on ne savoit que l'admirer. Montesquieu a jeté un coup-d'œil sur ce phénomène unique sur la terre; aussitôt le prestige s'est évanoui; mais l'admiration n'en a peut-être été que plus grande, en se reportant des effets sur les causes simples et naturelles que son livre a révélées. Ainsi, la construction de l'église de St.-Pierre à Rome est moins étonnante que l'imagination de l'architecte, qui, en traçant le plan de cet édifice, a prévu ce qu'il paroîtroit quand il seroit achevé.
A côté de ces maîtres marche un homme qui réunissoit à la plus profonde connoissance du cœur humain le plus grand talent pour en exprimer les passions. Personne ne l'a égalé dans la peinture de l'amour, de sa volupté, de ses orages, de la succession de ses peines et de ses plaisirs. Doué à la fois d'une exquise sensibilité, d'une forte conception, d'une heureuse facilité à embrasser plusieurs sujets différens, des plus minces détails de la vie domestique il s'est élevé aux plus hautes questions de la politique et de la morale. Tout s'embellissoit sous sa plume. Son éloquence l'a séduit lui-même; elle l'entraîna quelquefois à soutenir les plus absurdes paradoxes; il s'égaroit sans s'en douter, et croyoit de bonne foi tout le monde, excepté lui, hors du sentier de la vérité. Cette prodigieuse magie de style lui a fait d'abord une foule de chauds partisans, surtout parmi les femmes et les jeunes gens; mais peu-à-peu les gens sages ont dissipé une partie du charme. Cependant, il reste encore à J.-J. Rousseau une assez belle portion de gloire. L'éducation lui doit d'importantes réformes; et si personne ne fut, avec autant d'esprit, plus malheureux pendant sa vie et plus déchiré après sa mort, les tendres épouses, les bonnes mères s'empresseront de consoler la cendre de leur ami, et couvriront de fleurs la tombe de celui qui s'occupa avec tant de soin d'en semer sous les pas de leurs enfans.
LE GOUVERNEUR.
D'après le tableau que vous me tracez des grands hommes du XVIIIe siècle, je vois qu'ils ont eu un grand avantage sur ceux du XVIIe. Le style étoit formé quand ils ont écrit; ils s'en sont servi pour orner la science et rendre l'instruction agréable; sans doute, ils n'ont que des admirateurs parmi vous.
M. DE MONTAGNAC.
Les Pradon et les Cottin n'ont pas eu de critiques plus amers. Un tems viendra où le mérite sera mis à sa place, et où les gens sensés lui rendront un hommage éclatant; mais dans ce moment les sages se taisent; il n'y a que la sottise qui fasse du bruit.
LE GOUVERNEUR.
Quelle lâcheté!
M. DE MONTAGNAC.
Vous êtes trop sévère. Songez donc que nous sortons à peine d'une révolution qui a frappé toutes les colonnes de la société; tout a été brisé ou bouleversé en même tems. En politique, c'est l'anarchie qui avoit pris l'empire; en morale, le crime; en littérature, le mauvais goût. Depuis l'apparition de l'homme de la Providence, tout rentre peu-à-peu dans l'ordre; un gouvernement juste a remplacé l'absence des lois, des principes d'honneur ont distingué le citoyen; le sens commun aura son tour, il fera rentrer dans la poussière la déraison et l'impudence.
LE GOUVERNEUR.
Que disent, que font donc vos honnêtes gens en attendant que leur jour revienne? quel est enfin chez vous l'esprit public?
M. DE MONTAGNAC.
Il n'y en a plus, et c'est fort naturel. Les habitans d'un pays où vient d'éclater le plus violent tremblement de terre, restent long-tems interdits et immobiles d'épouvante et de terreur sur le bord de l'abîme qui a englouti plusieurs milliers de leurs concitoyens.
LE GOUVERNEUR.
J'entends; votre nation étoit caduque; la révolution a accéléré son dernier terme, et maintenant tout est épuisé chez elle.
M. DE MONTAGNAC.
Tout, hors l'esprit militaire.
LE GOUVERNEUR.
Voilà une chose admirable. La fin des empires s'annonce généralement par la mollesse et la lâcheté. Le vôtre, au contraire, après plus de douze siècles d'existence, revient au point d'où il est parti. Si cela se soutient, la France deviendra un second empire romain; la terre entière lui sera soumise. Puissent les sciences et la littérature se régénérer également dans son sein! sans cela, sa gloire seroit bien triste et bien funeste.
M. DE MONTAGNAC.
Rassurez-vous. Celui qui renouvelle les bases politiques de l'Europe, saura bien rallumer la lumière du génie. Déjà des couronnes de gloire sont suspendues dans l'arêne, et sollicitent de toutes parts l'émulation des athlètes. Sans doute, les premiers combats ne seront pas signalés par une grande célébrité, mais bientôt les favoris de Mars deviendront ceux de Minerve; et la littérature, après de longs jours de tristesse et de deuil, reparoîtra plus brillante que jamais.
Tandis que je parlois, le gouverneur observoit la hauteur du soleil. «Voici, me dit-il, l'heure du conseil qui s'assemble aujourd'hui. Je vous quitte pour m'y rendre; continuez votre promenade, je viendrai vous rejoindre aussitôt que je serai libre.» En montant le coteau, je vis plusieurs groupes d'enfans qui paroissoient chercher des fraises, et qui accoururent à moi aussitôt qu'ils m'eurent apperçu. Dès qu'ils m'eurent approché, ils me tendirent la main d'un air suppliant. Je crus d'abord qu'ils me demandoient l'aumône; et, quoiqu'un peu surpris de trouver ici des mendians, je leur donnai quelques pièces de monnoie; mais en les voyant sourire et jeter cet argent, je réfléchis qu'ils n'avoient aucune idée de sa valeur, et que par conséquent ce ne pouvoit être de l'argent, mais des sucreries dont je leur avois déjà fait connoître le prix, qu'ils me demandoient.
Tous ces enfans joignoient aux graces de leur âge une bonté qui ne l'accompagne pas toujours. Plusieurs d'entr'eux pouvoient à peine marcher; quelques-uns avoient été enlevés de leurs berceaux. Les plus forts se relayoient pour porter ceux-ci, les autres étoient conduits par la main. La plus aimable bienveillance animoit toute cette charmante jeunesse. C'étoit le printems d'une année de l'âge d'or.
Les corbeilles remplies de fraises parfumées me furent présentées par les jeunes garçons; les filles étoient derrière et osoient à peine se faire voir. Peu-à-peu leur pudeur enfantine s'évanouit, et ces timides Galatées, après s'être cachées derrière les saules, s'enhardirent par degrés, et finirent par donner des leçons de hardiesse à leurs petits compagnons.
Lorsque ces enfans se furent un peu familiarisés avec moi, je des rai recevoir de leur ingénuité quelques éclaircissemens sur les mœurs domestiques. A peine m'eurent-ils compris qu'ils s'empressèrent à l'envi de me satisfaire. Le babil, souvent coupé, mais jamais disputé, passoit en riant d'une bouche à l'autre. Il ne tarissoit pas sur l'amour qu'ils avoient pour leurs parens, sur les témoignages de tendresse qu'ils en recevoient chaque jour, sur leur vénération pour l'Etre-Suprême qu'ils commençoient déjà à appercevoir au-dessus d'eux, et sur leur profonde soumission à ses sages lois. J'étois touché jusqu'aux larmes de l'expression naïve de ces sentimens. Au milieu de cette scène attendrissante arrive le gouverneur. Il changea de figure en voyant ces enfans auprès de moi, et d'une voix sévère, il leur ordonna de se retirer. Etonné d'une altération aussi subite, je crus en entrevoir le motif, et je ne dus pas le dissimuler. «Vous sortez du conseil, lui dis-je, ma présence ici commenceroit-elle à lui donner de l'inquiétude?»
LE GOUVERNEUR.
Non pas, précisément.
MOI.
Il peut se rassurer, je pars dès aujourd'hui.
LE GOUVERNEUR.
J'espère, monsieur, que vous ne nous refuserez pas une grace pour prix de l'hospitalité que nous vous ayons accordée.
MOI.
Quelle est-elle?
LE GOUVERNEUR.
C'est de ne pas dire, lorsque vous serez de retour dans votre pays, que vous nous ayez connus, ou tout au moins de vous taire sur la position géographique de notre asile.
MOI.
De crainte apparemment que nous ne venions en faire la conquête. Je ne puis m'empêcher de rire de votre terreur.
LE GOUVERNEUR.
Je vous préviens en tout cas que le premier ballon qui paroîtra au-dessus de nos têtes, sera reçu à grands coups de flèches.
MOI.
Voulez-vous que je dénonce à la France votre déclaration de guerre?
LE GOUVERNEUR.
Tout comme il vous plaira, si vous êtes indiscret. Observez cependant que nous ne songeons point à attaquer, mais seulement à nous bien défendre si l'on nous attaque.
Nous étions au bas du coteau lorsqu'il acheva ces mots. Je reprimai l'émotion qu'ils excitèrent en moi en songeant que la conduite de M. Renou justifioit celle du conseil. On m'avoit d'abord reçu à bras ouverts, et j'aurois sans doute toujours joui de la même confiance, si mes hôtes ne s'étoient pas rappelé la leçon de l'expérience. Cette leçon avoit été terrible, et ils auroient été inexcusables de n'en pas profiter. Quelque injurieuse que me fût la décision du conseil, je ne pus donc que l'approuver, et je me hâtai de m'y soumettre en allant travailler aux préparatifs de mon départ.
Il restoit encore beaucoup de gaz dans le ballon; j'en augmentai facilement le volume avec l'air raréfié par le feu. Lorsqu'au moyen de ce procédé il sollicita son ascension, je mis dans la nacelle les plantes que j'avois découvertes dans le Vallon avec les manuscrits, et quelques objets curieux qui m'avoient été donnés.
Je ne pus prendre congé de mes hôtes sans verser des larmes. Ils étoient également émus, et me témoignèrent plusieurs fois combien ils étoient affligés de la dure loi que leur imposoit l'expérience. Sans cette terrible leçon du malheur, je me serois peut-être fixé parmi eux. Eh! comment avec des goûts simples et paisibles, n'aurois-je pas chéri le seul lieu sur la terre où l'homme n'a pas besoin de fortune pour être estimé, où tous les cœurs étrangers à la haine ne sont pleins que de bienveillance et d'amour? Ah! sans doute, je le garderai ce secret qui m'a été imposé sur la situation de ce dernier asile de l'innocence. Ce n'est plus pour le convertir à la foi du christianisme qu'on entreprendroit sa conquête; car il ne possède que des vertus sans aucune parcelle d'or ou d'argent; mais en s'annonçant pour étudier les mœurs de ses habitans, nos doctes missionnaires les infecteroient des leurs; ils répandroient dans la source des générations de cet Elysée, le poison terrible qui dévore la population de nos modernes Babylones.
Ces réflexions s'accumulèrent dans mon sein au moment de quitter mes hôtes, et je m'écriai: «Adieu, dignes habitans d'une terre céleste; adieu, peuple vraiment chéri de Dieu: persistez dans votre sage sévérité, repoussez sans pitié le téméraire qui prétendroit violer votre asile. Vous vous livrez maintenant sans crainte aux désirs de la nature, réglés par la raison; vos chastes épouses ne connoissent d'autres plaisirs que leurs devoirs; vos filles modestes n'écoutent d'autre amant que celui qui doit être leur mari; vous n'avez ni maîtres, ni esclaves, et vous êtes exempts d'orgueil comme de bassesse. Tout seroit bouleversé si vous permettiez à l'étranger de s'établir parmi vous. Plus de mœurs, plus d'innocence, plus de bonheur; un vain babil, un stérile étalage, des dehors imposteurs remplaceroient ce qu'il y a de plus précieux au monde, la probité chez les hommes, la pudeur parmi les femmes.»
Je m'élevai dans les airs aux yeux étonnés des habitans du vallon. Des cris d'admiration se mêlèrent aux vœux pour mon heureux voyage, exprimés en chants harmonieux. J'avois cessé de paroître à leurs regards, que la ravissante mélodie retentissoit encore à mon oreille. Je suis descendu, toujours poursuivi par les accens célestes. Toutes les choses merveilleuses que je venois de voir et d'entendre m'avoient tellement ravi, qu'en touchant la terre, je crus me réveiller et sortir d'un rêve qui m'avoit transporté dans les cieux. Lorsque l'illusion fut dissipée, et que je fus bien convaincu de la réalité de mon voyage, mon premier soin fut d'en rédiger la relation; c'est celle qu'on vient de lire. Elle est très-imparfaite sous plusieurs rapports, et l'eût été moins si j'avois eu la liberté de faire un second voyage dans ce paradis terrestre. J'avoue que l'amour de la science n'eût pas été mon principal motif pour l'entreprendre. Lorsque le cœur est pleinement satisfait, l'esprit n'a pas de désirs; et il n'est aucun moment de ma vie où j'aie été aussi complètement heureux que dans le Vallon aérien. Puisque je ne puis prétendre à le revoir, je vais du moins m'entretenir des souvenirs que m'a laissés ce séjour enchanteur, en relisant ses annales que je copie à la suite de cet écrit.