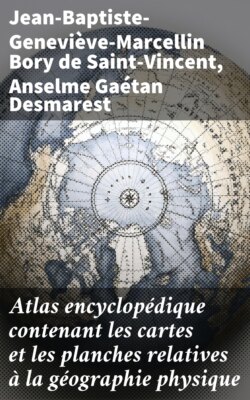Читать книгу Atlas encyclopédique contenant les cartes et les planches relatives à la géographie physique - Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
COUP-D’ŒIL SUR L’ÉTAT PRIMITIF DE LA SURFACE DU GLOBE, ET DANS QUEL ORDRE LES CORPS ORGANISÉS Y DURENT APPAROÎTRE.
ОглавлениеPOUR donner, d’un premier coup-d’œil, une idée de la surface du Globe considéré physiquement, nous soumettrons au lecteur l’esquisse d’une mappemonde (voyez Pl. I ), où l’on ne trouvera point de ces frontières arbitrairement coloriées, d’empires éphémères, ni de ces capitales destinées à décheoir, avec des villages qui peuvent, à leur tour, s’élever au rang de capitales. Dans cette carre, sur laquelle nous avons, dans sa séance du 26 mars 1817, appelé l’attention de l’Académie des sciences, les montagnes ne sont point jetées au hasard, ainsi qu’on le fait toujours dans le plus grand nombre de cartes modernes; mais elles sont soigneusement réparties selon le système qu’on trouvera exposé au chapitre cinquième: il résulte de l’attention que nous avons apportée à n’en pas faire buriner, où l’existence n’en fût pas constatée, que des espaces de terrain sur lesquels les historiens placent le berceau de grandes nations, se trouvoient encore couverts par les vagues aux époques où ces nations commencèrent à se faire connoître. En remontant au temps où quatre cents mètres d’eau seulement grossissoient la masse de celles qui baignent aujourd’hui le Globe terrestre, la surface de celui-ci se composoit d’une douzaine de grandes îles, ou principaux archipels, sur lesquels nous engageons les zoologistes et les botanistes à chercher les points de dispersion et de dissémination des espèces soit animales, soit végétales. Nous osons assurer les plus étonnans résultats de ce genre d’investigation; il fournira les moyens de démontrer que la plupart des types de familles et des genres naturels sont encore généralement comme cantonnés dans les grandes îles primitives, tandis que les espèces ambiguës ne se trouvent guère que sur les espaces par lesquels ces îles se mirent en contact, à mesure que les eaux diminuoient pour laisser voir les continens actuels. Sous ce point de vue, la mesure des hauteurs des montagnes acquiert une nouvelle importance.
Nous avons en outre, dans cette mappemonde nouvelle, adopté la nomenclature hydrographique qu’on trouvera établie quand il sera question des mers, et indiqué la répartition des espèces qu’il devient indispensable d’admettre dans le genre Homme. Des teintes diverses mettent encore notre carte en rapport avec notre article RACES HUMAINES, qu’on trouvera dans la partie de l’Encyclopédie confiée à la plume de M. Huot, l’un des plus zélés géologistes de l’époque. Nous avons surtout tenu compte des grands bassins, qui sont les véritables régions en Géographie physique, où ce qu’on entend par climats dans la Géographie astronomique, n’est absolument d’aucune importance. L’influence de ces derniers sur quoi que ce soit, est l’une des erreurs radicales introduites dans le monde savant par le président de Montesquieu. C’est avec surprise qu’on la trouve encore reproduire dans certains ouvrages modernes que leur titre feroit supposer être, dans toutes leurs parties, élevées au niveau des connoissances de l’époque. On doit reléguer de telles chimères avec les barbares du Nord et les trois principes des trois gouvernemens, qui sont les bases sur lesquelles édifia l’illustre écrivain; et nous profiterons de l’occasion pour faire remarquer combien sont importantes des notions approfondies en Géographie pour quiconque entreprend d’écrire sur les sujets même qui en paroissent être les plus éloignés
Dans ces bassins généraux, ou régions, qui soient les seules physiquement climatériques, et conséquemment influentes sur la distribution des corps organisés, ont dû s’opérer divers modes de création, et ces modes de création s’y doivent perpétuer tant que de grands changemens physiques ne viendront pas interrompre ou déranger le cours actuel des choses: par diverses causes constamment agissantes, leurs résultats doivent se rapprocher, se mêler, se confondre même, et passer parfois de l’une à l’autre pour devenir subordonnés à des modifications successives et continuelles qui changent insensiblement l’aspect de l’Univers.
Il est deux manières de rechercher l’histoire de ces modes de création dont les résultats apparoissent au premier plan sur le vaste théâtre du Globe terrestre. L’une, en consultant ce qu’en rapporte une RÉVÉLATION que nous adopterons sur ce point comme inattaquable, et au sens de laquelle les sciences physiques prêtent l’appui des vérités qu’elles enseignent; l’autre, en étudiant dans la nature même l’ordre de succession qui paroît avoir présidé dans sa majestueuse immensité.
Six espaces de temps, qu’on peut supposer avoir été arbitrairement appelés jours, sans que nulle conscience s’en puisse alarmer (et puisqu’un prélat éloquent fit cette concession à la philosophie du dix-huitième siècle ); six espaces de temps, disons-nous, sont nécessaires dans les écrits inspirés pour l’exécution du vaste plan dont une espèce du genre humain complète l’ensemble.
Le verbe ou la voix de Dieu retentit dans les ténèbres qui couvrent l’abîme; la matière est émue, le mouvement commence, la lumière brille, et le premier jour a lui. L’origine du temps date de ce jour solennel; car il est aussitôt marqué par la révolution des corps célestes lancés dans les vastes orbites assignés à leur masse roulante; les eaux sont repoussées dans leurs bassins profonds, et devenant des mers, commencent à mugir autour de l’aride; les plantes parent cet aride devenu bientôt la terre, avec son jet d’herbe qui la doit fertiliser de ses débris, après l’avoir parée de sa verdure; les poissons animent les vagues; les oiseaux, succédant aux plantes et aux poissons, volent vers l’étendue des deux. Les animaux des champs et des forêts naissent à leur tour; Adam apparoît le dernier, mais pourtant le premier en tête de la création pour glorifier son auteur.
Si l’on interroge l’histoire naturelle, l’apparition du cortège des êtres à la surface du Gobe ne diffère en rien du tableau que nous venons de tracer d’après la Genèse. Les eaux couvrirent évidemment le monde primitif, abîme silencieux, où les élémens demeuroient tenus en réserve pour produire la vie. Tout raisonnement par lequel on voudroit attaquer cette vérité, ne pourroit tenir contre le simple énoncé d’une loi physique, en vertu de laquelle les fluides sont contraints à chercher le niveau, et qui commandoit dès-lors aux flots de submerger les plaines, puisqu’ils se balançaient au-dessus des monts où nous retrouvons encore les traces de leur antique séjour. Des restes d’animaux océaniens, contemporains de ces premiers âges où la Mer battoit nos plus hautes alpes, et auxquels n’ont pu que succéder d’autres fossiles plus modernes, sont en même semps la preuve irrécusable que l’Océan, vieux père du Monde, comme l’appeloient les Anciens, fut aussi le berceau de l’existence. Lorsque nul des êtres qui respirent dans l’atmosphère n’y eût trouvé de patrie, des petits Crustacés dont on ne connoît plus d’analogues vivans, des Céphalopodes, dont on n’a retrouvé que les parties solides, et jusqu’à de fragiles Polypiers, préparoient lentement, par l’accumulation de leurs restes, nos demeures sous les eaux; et, comme si la formation de tout ce qui pare l’Univers eût été le résultat des conceptions d’une puissance à l’expérience de laquelle, cependant, ses propres œuvres donnoient chaque fois une nouvelle confiance en elle-même, il n’est pas un être dans la nature qui ne semble résulter d’une combinaison plus simple, antérieurement essayée. Et sans doute, aujourd’hui, où le vulgaire croit l’Univers fixé, beaucoup de créatures des eaux, sans organes bien arrêtés, ou du moins visibles, fragiles, pénétrables par la lumière, douées tout au plus du sens du tact, ne paroissent être que des ébauches, chez qui la vie n’est guère qu’un essai non susceptible du degré de développement qui en fait un bien si précieux pour les créatures plus parfaites, c’est-à-dire qui furent conçues en vertu de complications capables de multiplier en elles les élémens de l’intelligence; et qu’on ne dise point qu’un pareil aperçu rabaisse la puissance organisatrice, en la supposant astreinte aux mêmes voies d’essai que l’homme, condamné dans ses conceptions à s’élever du simple au compliqué : nous pourrions répondre victorieusement à cette objection par le texte même de la Bible. Quoi qu’il en soir, lorsque les eaux couvroient la totalité du Globe, les végétaux, que nous voyons aujourd’hui tapisser sa verdoyante surface, n’y pouvoient exister. Ils apparurent successivement quand la terre exondée, se desséchant, cessa d’être entièrement fangeuse. Les plantes littorales, ou propres aux sols humides, durent être les premières, et les oiseaux des rivages ne commencèrent à planer au-dessus des mers que lorsqu’il y eut des côtes ou des rochers autour desquels se venoit jouer leur proie, et sur lesquels, se pouvant reposer, l’amour leur apprit qu’ils pouvoient aussi déposer leur progéniture.
Ainsi, dès qu’une série d’êtres étoit constituée, il devoit en naître une autre, que son organisation subordonnoit à quelque série préalable. L’arbre, par exemple, ne pouvoit précéder la mousse, le lichen, la fougère ou le gravier, destinés à préparer le sol propre à supporter ses racines. L’arbre se trouvant ainsi, par l’ordre de son apparition, subordonné à l’apparition de l’herbe; l’oiseau granivore ne pouvoir naître avant le végétal qui le devoir nourrir de ses semences. Le mammifère broutant devoir attendre, pour paroître, que le jet de la terre assurât son existence; et l’animal sanguinaire ne put tyranniser les campagnes que lorsque la vie s’y fut répandue parmi les séries qui lui ménageoient ses alimens. Enfin, les omnivores, entre lesquels s’élève l’homme, ne pouvoient venir que les derniers. Telle fut la marche de la nature, à laquelle s’est exactement et minutieusement conformé l’auteur du Bérésith, marche toujours conséquente du premier pas, où chaque chose se contrebalance, en déterminant la production de celle qui, vivant à ses dépens, devint l’un des moyens coërcitifs employés pour empêcher que telle ou telle cohorte de la création ne finisse par dominer exclusivement dans l’Univers.
Ainsi l’homme est le dernier venu, dans ce que les Livres sacrés nomment les Cieux avec toute leur armée; il y apparoît pour y commander, et comme la plus haute conception d’une sagesse qui voulut que cet anneau d’une grande chaîne la rattachât à l’ensemble général émané de sa puissance législative; mais lorsqu’en reconnoissant un plan de conceptions successives dans l’ensemble de la nature, on en suit la progression selon le sens que nous venons d’indiquer, doit-on conclure de ce que les traditions restent muettes après la formation du genre humain, que l’impulsion productive ait été à jamais suspendue quand elle eut enfanté nos premiers pères? Qui oseroit tenter de déterminer le point où le mouvement imprimé aux élémens exhumés du chaos à la voix du législateur souverain, auroit dû suspendre le cours de ses merveilles? Outre que le mode de développement propre à chaque être organique amène en lui des modifications individuelles qui le font paroître, selon, les phases de son existence, comme des êtres fort différens du type spécifique, et que les variétés ou que les hybrides qui se perpétuent soient encore comme des créations de tous les jours, des créations plus décidées et complètes d’espèces, de genres et de familles entières de plantes ou d’animaux, ne pourroient-elles pas avoir lieu incessamment? Et n’est-ce pas restreindre injurieusement la puissance créatrice, qu’imaginer qu’ayant en quelque sorte brisé ses moules, et fatiguée de produire, elle ne se soit pas réservé la faculté de modifier, d’augmenter ou de recommencer ses ouvrages sur des plans nouveaux? L’homme auroit le rare privilége d’avancer dans la carrière du développement en perfectionnant ses fragiles œuvres, et le Tout-Puissant qui le doua du plus noble attribut, condamné par l’orgueil humain à demeurer stationnaire, seroit captif dans le résultat impérieusement fixé de ses premiers enfantemens? Contraint à voir les défectuosités de ceux-ci, sans y pouvoir porter remède, il ne posséderoit plus la disposition des moyens dont il nous accorda l’usage? Et parce qu’il auroit plu à l’ignorance présomptueuse d’attribuer à l’auteur de la nature une prévision qu’il ne voulut probablement pas s’attribuer, sa souveraine sagesse, désormais enchaînée, pourroit à la fin se trouver égalée par la sagesse des créatures perfectibles, c’est-à-dire que Dieu seroit sans cesse menacé par des Titans nouveaux!
Non, la Toute-Puissance créatrice, éternellement agissante, n’a jamais interrompu la pompe de sa marche; elle a pu modifier plusieurs fois, non-seulement une partie de ses chefs-d’œuvre, mais encore l’immensité de plusieurs de ses plans généraux de créations qui ont disparu pour faire place à d’autres. Et celui qui dit le premier proverblalement, tout change dans la nature, énonça une grande vérité manifestée, non-seulement dans l’ensemble de l’Univers, mais encore dans chacune de ses parcelles; car l’homme n’est pas au berceau ce qu’il doit être dans sa virilité, ou ce qu’il deviendra vers sa décrépitude. Et lorsqu’il se dressa vierge et nouveau à la face de la Terre, d’autres séries animées devoient encore y venir après lui, puisqu’il en est qui, vivant de sa propre substance, ne pouvoient s’y montrer avant qu’il n’y fût introduit. N’est-il pas clair que ces insectes incommodes qui souillent sa chevelure, que les vers dévorans nés des mucosités de ses intestins, ne sauroient être antérieurs aux intestins non plus qu’aux cheveux? Il en est de même pour une multitude d’êtres qui vivent, parce que d’autres vivoient auparavant. Ainsi, lorsque des lichens, des mousses et des fougères terrestres, préparoient l’humus dans lequel un arbre à venir pourroit trouver un appui; les lichens, les mousses et les fougères qui croissent exclusivement parasites sur l’écorce des arbres, ne faisoient point encore partie d’une création où de tels végétaux n’eussent pas trouvé le support convenable à leur espèce; enfin, lorsque les grands animaux apparurent sur le Globe, il restoit à éclore d’innombrables légions de créatures organisées qui, se nourrissant aux dépens de ces grands animaux, et habitant leur propre substance, n’auroient pu se développer, si les corps qu’ils dévorent morts ou vivans, n’eussent d’abord existé pour leur fournir une curée.
Il y a plus: une multitude d’autres produits de la Toute-Puissance ne pouvoient se développer avant l’époque où l’homme, sorti de la première barbarie, n’avoit pas fait usage de ses mains, pour modifier les œuvres du Créateur, autant qu’il lui est donné de le faire; la mite du fromage pourvoit-elle vivre avant qu’on eût fait du fromage? Il est un lichen qui végète exclusivement sur la brique; où ce lichen eût-il trouvé son support avant que l’homme eût imaginé de durcir la terre par le secours du feu? Et les botanistes qu’on accuse trop souvent de s’occuper de puérilités, n’ont-ils pas découvert récemment qu’il existe des conserves végétant exclusivement dans le vin de Madère ou dans l’encre, et qui devoient conséquemment attendre, pour prendre leur rang dans l’ordre des choses créées, que nous eussions fait de l’encre et du vin de Madère? La création, passant conséquemment du simple au composé, en vertu des lois immuables qui l’ont de tout temps régie, s’étoit d’abord élevée par l’effet de celles qui la commandèrent, du genre monade au genre humain; elle est ensuite redescendue vers des séries non moins simples dans leur organisation que celles par où tout commença; dans la totalité de ce qui la compose, la nature semble donc s’être complue à se renfermer en un vaste cercle, symbole de l’éternité, limites du possible et conséquemment type de la suprême raison.
Pour rendre nos idées plus faciles à saisir sur l’évidence des créations successives et continuelles, il est nécessaire de reproduire ici certaines considérations où nous nous arrêtâmes autrefois avant aucun autre, et qui nous paroissent mériter toute l’attention des bons esprits.
Nous plaçant en un point terrestre évidemment moderne en comparaison du reste de notre planète, nous examinions de quelle manière la végétation et la vie avoient pu se développer sur ce point en couvrant sa face de plantes et en la peuplant d’animaux. Ce point terrestre fut l’île de Mascareigne, située à cent cinquante lieues de Madagascar, qui en est la contrée la moins distante, et d’où l’on pourroit d’abord supposer que lui vinrent ses plantes et ses animaux. Nous avons démontré dans la relation de notre voyage dans quatre îles des mers d’Afrique, que la masse entière de Mascareigne, excessivement élevée au sein des flots, par l’action des feux souterrains, fut origiginairement incandescente et liquéfiée en totalité. L’Océan rouloit encore ses vagues sur l’espace occupé maintenant par l’île dont il est question, que les continens et bien des archipels se trouvoient dès long-temps émergés. Déjà des torrens et des rivières dépouilloient, en les sillonnant, d’antiques montagnes et arrachoient de leurs cimes les attérissemens propres à augmenter l’Asie et l’Afrique, que nulle trace de Mascareigne ne se montroit encore. Tout y est neuf comparativement à la parure de l’ancien continent, tout s’y montre empreint d’un caractère de jeunesse, d’une teinte de fraîcheur qui rappelle ce que les poëtes ont chanté du monde naissant, et qu’on ne retrouve guère que sur d’autres îles pareilles, formées également dans les âges récens; elle n’en fut pas moins un soupirail brûlant au milieu des vagues, et tel qu’on en a vu s’élever de nos jours dans notre hémisphère entre les Açores ou bien à Santorin; des éruptions multipliées en exhaussèrent peu à peu la fournaise au moyen des courans de laves ardentes, qui, s’y surposant sans interruption, formèrent enfin une montagne, que des tremblemens de terre vinrent ensuite fracasser pour former de ses débris d’autres montagnes sur les flancs échauffés desquelles les eaux pluviales se réduisant aussitôt en vapeur, n’arrosoient aucun végétal possible. Les Salamandres de la Fable ou les Cyclopes de son Vulcain, eussent seuls pu devenir les hôtes de l’écueil fumant; comment une aimable verdure vint-elle ombrager un sol d’abord en feu? Comment des animaux attachés à la terre trouvèrent-ils ensuite un berceau sur des rochers naguère en fusion, et nécessairement inhabitables long-temps encore après leur apparition ou durant leur accroissement igné ?
Les vents, les courans de la mer, les oiseaux du ciel et l’homme ont suffi pour ensemencer et peupler Mascareigne, répondront hardiment certains savans qui, prêts à répondre à tout, pourront s’étayer de l’opinion de Buffon, lorsque cet écrivain nous dit dans ses supplémens (articles Chèvres et Brebis): «Tous les animaux ont été. transportés aux. îles de France et de Bourbon par des navigateurs, parce que nulle espèce terrestre ne leur étoit propre.» Pour répondre à Busson ainsi qu’à ses échos, il suffiroit d’opposer le Pline français à lui-même, en le renvoyant à ce qu’il disoit du dronte, gros oiseau bizarre et massif, qui ne pouvant voler, n’étoit point arrivé à Mascareigne par les routes de l’air; qui n’ayant jamais été retrouvé en nul autre point du Globe, étoit nécessairement le produit d’une création locale, et dont la race entière ayant, à cause de sa difformité et de sa stupidité, été proscrire par les premiers hommes qui l’aperçurent, n’avoit point été apporté par des exterminateurs, qui d’ailleurs n’eussent pu l’avoir pris en aucun autre endroit.
«Les vents, dira-t-on, enlevant d’un souffle impétueux les grains des végétaux, les transportent à de grandes distances au moyen des ailes et des aigrettes dont plusieurs sont munis. Des courans asservis à une marche régulière dans la zône torride entraînent avec eux des fruits qu’ils ramassent sur certains rivages, et qu’ils abandonnent sur des rivages opposés. Les oiseaux qui se nourrissent de baies, en rejettent les semences prêtes à germer sur le sol prompt à les reproduire. Les hommes enfin qui naviguent depuis bien plus long-temps peut-être qu’on ne l’imagine, ont pu, avant sa découverte par les Portugais, aborder à Mascareigne et naturaliser à sa surface tous les animaux que nous y retrouvons.»
Ces explications sont tous les jours reproduites par des auteurs habitués à répéter sans examen ce qu’ils ont lu quelque part ou imprimé une fois; elles paroissent, sans doute, suffisantes à ceux qui pensent être sortis d’embarras, quand ils ont répondu, ou qui, pour se dispenser de penser par eux-mêmes, se contentent de toutes les réponses; mais elles ne satisferont pas des hommes qui recherchent sérieusement la vérité, soit qu’ils répondent, soit qu’ils interrogent.
1°. Les vents emportent effectivement avec eux, et même fort loin, les semences légères d’un certain nombre de végétaux; mais il est douteux qu’ils les promènent jusqu’à cent cinquante lieues, pour les déposer précisément sur un point presqu’imperceptible, en comparaison de l’immense étendue des mers environnantes. Les végétaux à semences aigrettées et ailées, susceptibles de voyager par les airs, ne sont d’ailleurs pas en grand nombre, surtout dans l’île qui nous occupe, et dans laquelle conséquemment les vents n’ont pu porter que fort peu d’espèces de plantes, si toutefois ils en ont jamais porté.
2°. Les courans de la Mer entraînent à la vérité parmi les débris qu’ils enlèvent de certaines plages, quelques fruits capables de surnager; nous convenons que de temps en temps ces fruits roulés d’abord sur la terre, et roulés ensuite dans l’eau, abordent sur des rives lointaines. Les cocos de Praslin, qu’on nomme vulgairement cocos des Maldives, en fournissent une preuve. Mais l’eau salée frappe de mort les germes de tous les végétaux qu’on y plonge même durant peu de temps, ou du moins du plus grand nombre. Les botanistes qui essaient de transporter des plantes à bord des navires, savent que lorsque les bourgeons et même jusqu’aux semences sont touchés par l’onde amère, tout est perdu, les rejetons languissent et s’étiolent sans jamais prospérer ni se reproduire. Quels sont d’ailleurs les végétaux dont les vagues pourroient trouver les graines en bon état le long des côtes? Ce ne sont que des espèces littorales dont le nombre est très-restreint; quelques salicornes, des soudes, des soldanelles, des statices ou de maigres crucifères. Les plantes de telles familles sont les moins nombreuses ou inconnues à Mascareigne. Les fruits des arbres de l’intérieur des terres et des montagnes qui se rencontreroient au rivage, n’auroient pu y être entraînés que par les pluies ou par accident; ayant été alternativement exposés à l’humidité ou aux ardeurs du soleil, hors du sein de la terre, ils auroient perdu la faculté de végéter. Ces cocos venus par mer des Séchelles, enveloppés d’une coque et d’une bourre impénétrable, et abordés sur les plages de l’Inde ou de ses archipels, y ont-ils jamais donné des cocotiers? et l’arbre qui donne les fruits errans, connus par tout le monde à cause de leur forme bizarrement volumineuse, s’est-il jamais naturalisé ailleurs qu’à Praslin?
3°. On ne peur disconvenir que certains oiseaux frugivores ne sèment dans l’étendue des continens qu’ils habitent, et sur l’écorce des arbres où ils se reposent, les graines de plusieurs végétaux dont les fruits les nourrissent habituellement; le gui en fournit un exemple sur nos pommiers; mais ces oiseaux frugivores sont en général sédentaires; ils ne se déplacent jamais dans les régions où la variété des saisons ne les force pas d’en consacrer une aux émigrations. Rien n’attiroit de pareils hôtes sur un écueil nécessairement stérile pendant sa formation volcanique, très-éloignés de toute côte qu’ils aient pu habiter d’abord, et hors de la portée de leur vol généralement restreint; de tels oiseaux n’ont pas porté le petit nombre de pépins dont l’organisation peut supporter la chaleur de leur estomac pendant le très-court espace de temps nécessaire à la digestion. Les oiseaux à vol soutenu, habitués à se réfugier sur les rochers battus des vagues, ne se nourrissent que de poissons et de vers marins; ils ont été probablement les premiers habitans ailés de Mascareigne; mais ils n’y ont pas porté les semences pesantes des arequiers, ni des vaquois; ils n’y ont pas porté non plus le nasturs, sorte de bambou qu’on n’a jamais retrouvé autre part.
4°. Enfin, les hommes, quelle que soit l’époque où ils aient abordé dans l’île qui nous sert d’exemple, où ils en aient défriché et ensemencé le sol, où ils y aient répandu des animaux domestiques; les hommes, disons-nous, n’y auroient pas planté de lycopodes, de champignons ou de conferves, avec tant d’autres végétaux qu’on ne cultive nulle part, et dont on ne retire pas la moindre utilité. Ils eussent pu introduire des bœufs, des chèvres et quelques insectes qui les suivent partout en dépit d’eux-mêmes; ils ont évidemment naturalisé des oiseaux (les Martins), pour faire la guerre aux insectes indigènes, mais ils n’ont pas lâché ces singes, auxquels on fait une guerre active; ces grandes chauves-souris et ces tortues de terre, dont la délicatesse de la chair cause la destruction; ces sauriens dont les habitations sont remplies; ces rats musqués qui infectent chaque cabane; cette foule d’araignées qui salissent les encoignures des appartemens ou filent en liberté dans les campagnes; enfin ces papillons nombreux qui brillent sur les fleurs. Ils n’ont pas davantage peuplé les torrens et les mares d’eau douce de poissons particuliers, d’insectes, d’écrevisses et de navicelles propres à l’île. Ils n’ont pas surtout porté avec eux ce Dronte, oiseau monstrueux, qu’ils furent si étonnés d’y voir, et dont ils exterminèrent la race; ce Dronte, essai baroque d’une nature trop hâtée d’enfanter, et qui présentoit dans le ridicule de son ensemble le cachet de l’inexpérience organisatrice. Il est impossible de supposer qu’aucune de ces créatures ait été portée par l’homme, par la mer, par des oiseaux ou par les vents.
D’ailleurs, tous les êtres qu’on voit, non-seulement à Mascareigne et dans les îles voisines, mais encore sur toutes les autres îles de l’Univers, ne pourroient y être venus d’aucun autre lieu, quand on parviendroit à démontrer la possibilité du voyage; puisque, outre un certain nombre d’espèces qu’on retrouve dans les climats analogues, chaque archipel présente quelqu’espèce, quelque genre même qui lui sont exclusivement propres, qu’on ne revoit en aucun autre endroit, et qui, par conséquent, n’ont pu être créés que sur les lieux mêmes. Or, comme il ne peut être douteux que la plupart des îles volcaniques ne soient plus nouvelles que les continens, et que, par conséquent, tour ce qu’on y trouve ne soit aussi plus récent, il faux nécessairement admettre la possibilité de créations modernes, de créations actuelles, et même de créations futures qui ont ou auront lieu, lorsqu’un concours de circonstances déterminantes a ou aura lieu sur quelque point existant ou futur de notre Univers.