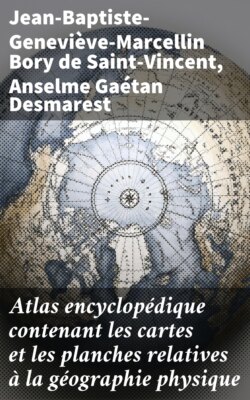Читать книгу Atlas encyclopédique contenant les cartes et les planches relatives à la géographie physique - Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
RAPPORTS DES CIEUX AVEC LA TERRE, ET DE L’INFLUENCE DES CLIMATS PHYSIQUES.
ОглавлениеAVANT de s’étendre sur l’histoire physique de la superficie du Globe, il devient nécessaire de donner une idée de sa forme générale, et des rapports où il se trouve avec ces corps célestes dont il fait lui-même partie, rapports qui influent si considérablement sur la distribution géographique des êtres organisés. Pour ne point nous égarer dans la Géographie astronomique, avec laquelle nous devons nous trouver en contact dans ce chapitre, nous nous bornerons à l’énoncé des notions qui sont indispensables pour comprendre la suite de notre Illustration.
Corps opaque à peu près sphérique, le Globe terrestre lancé dans le système solaire, n’y est guère qu’une planète du second ordre; sa distance à l’astre qui l’éclairé est de 34,505,422 lieues; il tourne autour de cet astre en 365 jours 5 heures 45 minutes 43 secondes, et cette révolution est l’année; tournant en outre sur lui-même dans vingt-quatre heures, cette révolution secondaire est le jour. Un axe sur lequel est censé s’exercer le dernier mouvement, traversant la Terre, y passe par deux points appelés pôles; l’un de ces pôles se nomme arctique il est celui du nord; l’autre s’appelle antarctique, c’est celui du sud. Vers ces deux points le Globe est légèrement aplati; le diamètre dont les pôles sont les deux extrémités, est de 2860 lieues; celui qui le coupant à angle droit se conçoit d’un point de l’équateur à un point opposé du même cercle, est de 10 lieues environ plus grand. L’équateur est le cercle qui, à une distance égale des deux pôles, environne le Globe précisément par le milieu, et dont la circonférence est d’environ 8580 lieues, qu’on porte à 9000 selon la mesure qu’on donne à ces lieues. Comme la rotation diurne ne s’exerce pas dans un plan parallèle à celui de la coupe de notre planète par l’équateur, mais que l’axe qui passe par les pôles est incliné de 23 deg. 28 min. sur ce plan, on a imaginé deux parallèles appelés Tropiques, limites apparentes pour nous de la marche du soleil; la septentrional est le tropique du Cancer, le méridional celui du Capricorne. Ces noms viennent de ce que, pour les hommes de l’hémisphère où fut inventée l’astronomie, le soleil, parvenu au solstice d’été, semble redescendre vers le sud, ou reculer par une marche imitative de celle d’un crustacé, vers le tropique opposé, d’où il remonte aussitôt qu’il y a touché, comme la chèvre sauvage, anciennement appelée capricorne, escalade d’un pied léger le sommet des monts escarpés qu’elle habite. La marche du soleil entre les tropiques détermine les saisons qui sont opposées pour les deux hémisphères, c’est-à-dire dont l’un se trouve en hiver quand l’autre est en été, et au printemps quand celui-ci est en automne. On appelle solstice le point de chacun des tropiques qu’atteint la plus grande élévation ou le plus grand abaissement du soleil dans l’écliptique, lequel est le cercle qui coupe obliquement l’équateur, et dans lequel le soleil paroît tourner autour de la Terre. Le solstice d’été est pour nous celui où le soleil, parvenu au tropique septentrional ou du Cancer, doit redescendre; il détermine le plus long jour de l’année pour notre hémisphère, et conséquemment le plus court pour l’hémisphère austral. Le solstice d’hiver, qui marque le jour le plus court de nos hivers, et conséquemment le plus long pour l’autre côté de la ligne, est celui où le soleil, arrivant au tropique du Capricorne, l’abandonne aussitôt pour remonter vers le nôtre. Les deux points opposés où l’écliptique coupe l’équateur, s’appellent équinoxes, parce que les nuits sont égales aux jours en durée, quand le soleil y passe dans sa révolution annuelle. Cette élévation et cet abaissement alternatif et régulier du soleil sur le plan de l’équateur terrestre, produisant les saisons, et conséquemment l’inégalité de la durée des jours et des nuits, a non-seulement servi de moyen pour mesurer le temps, mais encore pour déterminer sur le Globe une division de climats que les astronomes et les géographes ont évaluée en heures, mais que le physicien considère seulement sous le point de vue de l’influence qu’ils exercent dans la répartition des êtres organisés à la face du Globe. La circonscription de ces climats, considérés ainsi physiquement, ne dépend pas uniquement de leur distance à l’équateur; elle se modifie par une multitude de causes locales, ainsi que M. de Candolle l’a fort savamment expliqué quand il a porté la lumière dans la Géographie botanique, jusqu’à lui seulement indiquée, et déjà surchargée d’inventions qui, sans l’esprit judicieux du professeur genevois, eussent détourné cette science de la marche qu’elle doit tenir.
Les climats que nous appellerons généraux, sont ceux qui dès long-temps ont été indiqués sous le nom de Zônes. Ils sont au nombre de trois:
1°. La ZONE TORRIDE: unique, mitoyenne, contenue entre les deux tropiques, de plus 1100 lieues de largeur, coupée en deux parties presqu’égales par l’équateur; ainsi nommée de la chaleur perpétuelle qui ne cesse d’y régner: chaleur plus grande, à circonstances égales de localités, qu’elle ne l’est jamais en dehors des tropiques. Ici, quand le sol n’est point abandonné à l’ardeur dévorante d’un soleil dont les rayons sont rarement éloignés de la perpendiculaire, et que ses eaux fécondées par l’influence du grand foyer lumineux ne s’évaporent pas sans profit pour la végétation, la nature produit avec complaisance et même avec luxe, les plus pompeuses de ses merveilles et le plus de ces créatures auxquelles ses lois imposèrent des formes prodigieusement variées. La végétation n’y cesse point; la vie, dans toute son intensité, ne s’y use que par l’exercice continuel de ses propres forces; et quand une mort hâtive y vient atteindre des êtres qui vécurent trop vîte, ces êtres y sont aussitôt remplacés sans efforts par l’effet d’une puissance productrice infatigable.
2°. La ZONE TEMPÉRÉE: double, dont une moitié est au nord de la zône torride, et l’autre au sud, s’étendant des deux tropiques aux deux cercles polaires. La largeur de chacune de ses parties est de 1000 lieues au moins. Dans leurs limites tropicales, elles sont souvent plus chaudes que certaines parties contiguës de la torride, tandis que d’autres points de leur étendue éprouvent déjà les rigueurs de violens hivers.
3°. La ZONE GLACIALE: également double, dont les deux parties opposées, limitées d’un côté par leur cercle polaire respectif, ont les pôles pour centre et non pour extrémité : région déshéritée, où la nature vivante expire dans les longues alternatives de jours sans éclat, et de profondes ténèbres. Des neiges éternelles y réfléchissent une lumière égarée, au bruit confus du déchirement des montagnes de glace contre lesquelles se brisent en mugissant des flots qui deviennent aussitôt solides; lieux où nulle créature animée ne sauroit s’acclimater, où des rayons épars, dans une atmosphère brumeuse, donnent au sein de nuits de plusieurs mois une imparfaite image de nos aurores, tandis que des vapeurs épaisses et des nuages glacés, s’élevant de la surface des mers à l’aspect du soleil, frappent d’impuissance en le voilant cet astre qui, partout ailleurs, féconde l’Univers.
Ainsi, en partant de l’équateur pour nous élever ou pour nous abaisser vers les pôles, nous avons vu la zône torride durant trois cent soixante-cinq jours, et le même nombre de nuits, se montrer féconde quand l’ardeur du soleil n’en dessèche pas les innombrables productions; nous avons vu, au contraire, le centre de la zône glaciale plongé dans le deuil du seul jour et de la seule nuit dont l’année se compose pour les pôles. Eprouvant l’influence du voisinage de l’une et de l’autre zône vers ses extrémités, la tempérée a des saisons mieux déterminées, ou du moins plus manifestes. Par l’effet que ces saisons produisent sur les créatures qui l’habitent, la nature, toujours à circonstances égales de localité, ne s’y montre point aussi libéralement dispensatrice de ses trésors que dans la zone torride, mais n’y paroît jamais avare; ce n’est qu’en se rapprochant des cercles polaires qu’on la voit devenir parcimonieuse et finalement stérile.
Si, dans un point favorisé des zones fécondes, la nature étale au bord des eaux toutes ses richesses, le rivage, la plaine ou le vallon sont couverts de riantes prairies, et de majestueuses forêts: de nombreuses races d’animaux viendront en des sites fertiles chercher leur pâture, leur proie et des ombrages; que le sol s’élève, que la plaine, la rive ou le vallon se trouvent situés vers la base de quelque mont sourcilieux dont le faîte se perd dans les dernières régions de l’atmosphère, on observera, en gravissant sur les pentes alpines, que la température changeant de la base jusqu’aux sommets, et passant par les mêmes nuances qui la diversifient depuis l’équateur jusqu’aux pôles, les productions végétales et animales se modifieront successivement suivant le changement de température; de sorte que, parvenu au faîte des montagnes, on y trouvera des glaces et l’infécondité des pôles. Nous pourrions citer un grand nombre d’exemples de localités où de pareilles transitions s’opèrent dans un court espace de chemin. Ces exemples sont fréquens surtout dans les hautes crêtes des îles et sur les côtes montueuses des pays chauds: le pic de Ténériffe, entre l’ancien et le nouveau Monde, la Sierra-Névada, au sud de l’Espagne et vis-à-vis la Barbarie, nous ont paru les points du Globe où, sans aller trop loin, un naturaliste européen peut, dans le cours d’une seule journée, passer d’une nature torride à une nature polaire; il y observera, de toise en toise, de ces changemens de climats que, dans un voyage entrepris depuis la ligne jusqu’aux glaces arctiques, il ne reconnoîtroit guère que de cent lieues en cent lieues. Une excursion de cette nature donne plus d’idées exactes en Géographie naturelle, que la lecture de tant d’ouvrages où l’on croit avoir additionné les productions de la terre, quand on a compulsé des catalogues souvent informes, et composés par des auteurs qui tous n’attachoient pas aux noms de chaque chose une valeur rigoureusement déterminée.
Agrandissant le cerole des idées que firent naître de tels voyages dans notre esprit, nous imaginâmes, dès notre première ascension sur de hautes montagnes, qu’on pouvoir considérer les deux moitiés du Globe même comme deux montagnes immenses, opposées base à base, dont la ligne équatoréale étoit le vaste pourtour, et dont les deux pôles étoient les cimes avec leurs éternels glaciers; et, comme à mesure qu’on s’élève dans les Alpes on trouve sur leurs flancs des régions variées où, selon l’exposition, les abris, la nudité, la sécheresse, l’arrosement, et autres causes d’humidité et de chaleur, mille aberrations climatériques se peuvent observer; de même, à mesure qu’on s’élève sur les deux grandes montagnes terrestres, de leur base commune jusqu’à leurs sommets distincts, c’est-à-dire de l’équateur aux pôles, on est frappé des perturbations occasionnées dans la physionomie des lieux, par les mers, par les bassins, par les déserts dépouillés, ou par des ramifications des montagnes. C’est dans la partie de cette Illustration, qui doit être consacrée à la Géographie botanique, que l’influence de ces causes diverses sera plus particulièrement examinée; nous devons auparavant terminer les présentes généralités par un aperçu de la figure du Globe, dont les accidens superficiels n’ont pas moins d’influence sur la Géographie naturelle que l’élévation des lieux par rapport à l’équateur.
Outre les parallèles à cette grande ligne, par lesquels sont circonscrites les zônes, les astronomes imaginèrent d’autres cercles qui coupent perpendiculairement les parallèles, et qu’on nomme Méridiens. Ces cercles indiquent qu’il est simultanément midi ou minuit sous tous les points de leur étendue, qui va d’un pôle à l’autre. On leur avoit supposé quelqu’influence sur la répartition des productions naturelles, mais cette influence paroît être nulle ou à peu près nulle.
La surface du Globe se compose de terre et d’eaux; ces eaux, comme on le verra dans le chapitre suivant, doivent avoir couvert le Globe antérieurement à l’existence des créatures terrestres actuelles. Maintenant restreintes dans les bassins où les lois qui régissent les liquides enchaînent leurs flots, elles occupent au moins les trois quarts de la surface planétaire. Un mouvement de flux et de reflux leur est imprimé par l’action qu’exerce sur notre atmosphère la Lune, quarante-neuf fois plus petite que la planète, à la marche de laquelle ce satellite se trouve attaché, et que 85,000 lieues éloigent de nous; ce mouvement de flux et de reflux a son importance en Géographie physique, puisqu’il nous procure la facilité d’étudier les productions océaniques qui prospèrent ou décroissent en nombre, selon qu’elles vivent alternativement couvertes ou découvertes par les eaux de la mer, ou qu’elles demeurent éternellement plongées dans ses profondeurs. Il influe encore sur la science qui nous occupe, en ce que, imprimant par réaction des mouvemens dans l’atmosphère, il n’est pas étranger à l’action des vents dont le rôle est important à la surface de la Terre pour disséminer, favoriser ou contenir la végétation. La Mer influe encore sur les productions terrestres, en modifiant la température de ses rivages: ceux-ci n’étant, toutes circonstances de localité égales d’ailleurs, ni aussi froids en hiver, ni aussi chauds en été que l’intérieur des terres, jouissent d’une sorte d’égalité atmosphérique par l’effet de laquelle la propagation d’une quantité d’êtres de la zône torride s’étend dans les deux moitiés de la zône tempérée, et des créatures de cette dernière jusque dans quelques baies de la zône glaciale. Aussi les îles, d’autant plus assujetties à l’influence de cette égalité qu’elles sont moins considérables, présentent-elles souvent dans leur végétation, et dans les animaux qu’elles nourrissent, des particularités qui paroissent renverser l’idée qu’on se forme de l’influence des climats, jusqu’ici trop servilement considérés dans leur parallélisme.
Après l’influence du voisinage des mers, celle de l’élévation du sol a le plus d’empire sur la répartition des corps organisés à la surface du Globe. Nous avons déjà indiqué cette influence en comparant notre planète à deux montagnes opposées base à base; elle sera bientôt examinée sous d’autres rapports. Quant aux corps bruts, aux roches, aux substances minérales, charpentes de la Terre, élémens et supports de tous corps organisés, la Nature, en les prenant pour fondation de ses enfantemens, ne leur traça point de limites géographiques. Partout les mêmes, ces corps bruts ne sont sujets qu’à des circonstances de localité, qui peuvent partiellement bouleverser leurs rapports de juxta-position, mais non leur fournir les moyens de se propager de proche en proche sur le Globe, où leur rôle est essentiellement inerte.
Cependant, si ces corps inertes ne sont point soumis aux lois qui président à la distribution des plantes et des animaux à la surface des terres, ou dans les profondeurs des mers, ils exercent une grande action sur cette distribution. Les pluies abaissent les monts qu’elles dépouillent, et nivèlent à la longue le Globe où elles étendent insensiblement les plaines aux dépens des sommités; les volcans, à leur tour, soulevant des plaines pour les transformer en montagnes, semblent être, en Géographie physique, ce que les guerres et les conquêtes sont relativement à la Géographie politique: ces causes viennent bouleverser les limites dans lesquelles se renfermoient certaines créatures qu’elles contraignent à la dispersion lorsqu’elle s ne les détruisent pas. On pourroit citer d’autres exemples d’influences perturbatrices: ainsi l’arène mobile, par exemple, envahissant certains rivages, y vient déterminer une végétation, et conséquemment un mode d’animalité fort différent de ce qui dut exister d’abord. Les Salicornes, le Triglochin, les Glauces, disparoîtront pour faire place au Panicaut maritime, aux Soudes, à la Soldanelle, à l’Arénaire péploïde. Quelques Pimélies et plusieurs Curculionides, qui, s’abandonnant aux vents, se plaisent à se faire rouler avec les parcelles de sable, succéderont au Carabe maritime, ainsi qu’aux petits Crustacés de la plage. Que l’homme parvienne à fixer les dunes vagabondes que, se faisant un auxiliaire de quelques Graminées à racine agglomératrice, il contraigne l’éblouissante surface du sable à supporter de verdoyantes forêts, les modes de végétation et de vie doivent changer de nouveau. Les Soudes, les Panicauts, la Soldanelle, feront place aux Genêts, aux Cistes, aux Ronces, et bientôt même aux Mousses ainsi qu’aux fraîches Fougères, qui, dans d’autres expositions, eussent précédé toute autre forme d’existence: alors, l’insecte dont la larve se nourrit de bois, viendra remplacer, dans la forêt nouvelle, le Coléoptère des sables, et l’Oiseau, soit granivore, soit insectivore, succédant à la Mouette, ainsi qu’au Vanneau du rivage, viendra mêler au murmure des feuilles ses chants d’amour, qui, trahissant son existence, doivent attirer l’Epervier. L’Ecureuil et d’autres rongeurs, le Chevreuil, enfin le Cerf, appelleront la férocité des bêtes de proie et du chasseur.
L’homme apporte encore de nouveaux changemens dans la physionomie du Globe, soit qu’il en défriche les solitudes, qui, sous sa main, se peuplent d’êtres nouveaux, soit qu’au contraire il épuise un sol long-temps fertile pour le métamorphoser en aride désert. Son influence est puissante; s’il extermine des races, il en propage; il opprime les unes pour protéger les autres: enfin, cette influence, dans la distribution géographique des créatures, n’est pas moindre que celle des vents, des eaux et des révolutions volcaniques.
C’est donc au milieu de mille aberrations et de tant de causes de changement, que le géographe doit étudier les lois en vertu desquelles la dissémination des êtres a lieu sur la planète qu’il habite, et qu’il doit rechercher les lois qui présidèrent à l’établissement de ces êtres sur tel ou tel point de la Terre, ainsi qu’à leur colonisation hors des circonscriptions naturelles entre lesquelles ils avoient été originairement formés.