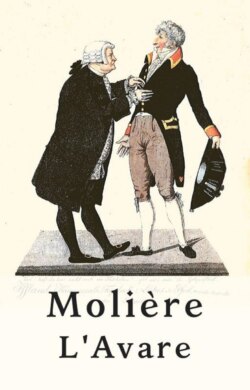Читать книгу L'Avare - Jean-Baptiste Moliere - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCÈNE II. — CLÉANTE, ÉLISE
ОглавлениеCLÉANTE
Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur ; je brûlois de vous parler, pour m’ouvrir à vous d’un secret.
ÉLISE
Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu’avez-vous à me dire ?
CLÉANTE
Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot : J’aime.
ÉLISE
Vous aimez ?
CLÉANTE
Oui, j’aime. Mais, avant que d’aller plus loin, je sais que je dépends d’un père, et que le nom de fils me soumet à ses volontés ; que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour ; que le ciel les a faits les maîtres de nos vœux, et qu’il nous est enjoint de n’en disposer que par leur conduite ; que, n’étant prévenus d’aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre ; qu’il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l’aveuglement de notre passion ; et que l’emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire ; car, enfin, mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrances.
ÉLISE
Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez ?
CLÉANTE
Non ; mais j’y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raisons pour m’en dissuader.
ÉLISE
Suis-je, mon frère, une si étrange personne ?
CLÉANTE
Non, ma sœur ; mais vous n’aimez pas ; vous ignorez la douce violence qu’un tendre amour fait sur nos cœurs ; et j’appréhende votre sagesse.
ÉLISE
Hélas ! mon frère, ne parlons point de ma sagesse ; il n’est personne qui n’en manque, du moins une fois en sa vie ; et, si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous.
CLÉANTE
Ah ! plût au ciel que votre âme, comme la mienne...
ÉLISE
Finissons auparavant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez.
CLÉANTE
Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers, et qui semble être faite pour donner de l’amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n’a rien formé de plus aimable, et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Mariane, et vit sous la conduite d’une bonne femme de mère qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable fille a des sentiments d’amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la sert, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucheroit l’âme. Elle se prend d’un air le plus charmant du monde aux choses qu’elle fait ; et l’on voit briller mille grâces en toutes ses actions, une douceur pleine d’attraits, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable, une... Ah ! ma sœur, je voudrois que vous l’eussiez vue.
ÉLISE
J’en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites ; et, pour comprendre ce qu’elle est, il suffit que vous l’aimez.
CLÉANTE
J’ai découvert sous main qu’elles ne sont pas fort accommodées1, et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu’elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d’une personne que l’on aime ; que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d’une vertueuse famille ; et concevez quel déplaisir ce m’est de voir que, par l’avarice d’un père, je sois dans l’impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour.
1
C’est-à-dire qu’elles n’ont pas beaucoup de bien.
ÉLISE
Oui, je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin.
CLÉANTE
Ah ! ma sœur, il est plus grand qu’on ne peut croire. Car, enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu’on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange où l’on nous fait languir. Eh ! que nous servira d’avoir du bien, s’il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d’en jouir, et si, pour m’entretenir même, il faut que maintenant je m’engage de tous côtés ; si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours le secours des marchands, pour avoir moyen de porter des habits raisonnables ? Enfin, j’ai voulu vous parler pour m’aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis ; et, si je l’y trouvois contraire, j’ai résolu d’aller en d’autres lieux, avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout, pour ce dessein, de l’argent à emprunter ; et, si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu’il faille que notre père s’oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable1.
1
Déjà se manifestent le mépris, la haine des enfants pour leur père ; déjà commencent le châtiment de l’avare et la leçon morale de l’ouvrage.
ÉLISE
Il est bien vrai que tous les jours il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère, et que...
CLÉANTE
J’entends sa voix ; éloignons-nous un peu pour achever notre confidence ; et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur.