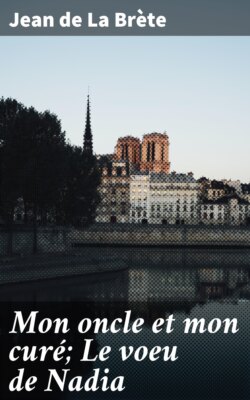Читать книгу Mon oncle et mon curé; Le voeu de Nadia - Jean de La Brète - Страница 10
II
ОглавлениеMa tante me brutalisait quand j'étais enfant, et j'avais tellement peur des coups que je lui obéissais sans discuter.
Elle me battit encore le jour où j'atteignis mes seize ans, mais ce fut pour la dernière fois. À partir de ce jour, fécond pour moi en événements intimes, une révolution, qui grondait sourdement dans mon esprit depuis quelques mois, éclata tout à coup et changea complètement ma manière d'être avec ma tante.
En ce temps-là, le curé et moi nous repassions l'histoire de France, que je me flattais de très bien connaître. Il est certain que, étant données les lacunes et les restrictions de mon livre, mon savoir était aussi grand que possible.
Le curé professait pour ses rois un amour poussé jusqu'à la vénération, et, cependant, il n'aimait pas François Ier. Cette antipathie était d'autant plus singulière que François Ier était valeureux et qu'il est resté populaire. Mais il n'allait pas au curé, qui ne perdait jamais l'occasion de le critiquer; aussi, par esprit de contradiction, je le choisis pour mon favori.
Le jour dont j'ai parlé plus haut, je devais réciter la leçon concernant mon ami. Je ruminai longtemps la veille pour trouver un moyen de le faire briller aux yeux du curé. Malheureusement, je ne pouvais que répéter les expressions de mon histoire, en émettant des opinions qui reposaient beaucoup plus sur une impression que sur un raisonnement.
Il y avait une heure que je me cassais la tête à réfléchir, quand une idée brillante me traversa l'esprit:
«La bibliothèque!» m'écriai-je.
Aussitôt, je traversai en courant un long corridor, et pénétrai, pour la première fois, dans une pièce de moyenne grandeur, entièrement tapissée de rayons couverts de livres réunis entre eux par les fils tenus d'une multitude de toiles d'araignée. Elle communiquait avec les appartements qu'on avait fermés après la mort de mon oncle pour ne plus jamais y entrer; elle sentait tellement le moisi, le renfermé, que je fus presque suffoquée. Je m'empressai d'ouvrir la fenêtre qui, très petite, n'avait ni volets ni persiennes et donnait sur le coin le plus sauvage du jardin; puis je procédai à mes recherches. Mais comment découvrir François Ier au milieu de tous ces volumes?
J'allais abandonner la partie, quand le titre d'un petit livre me fit pousser un cri de joie. C'étaient les biographies des rois de France jusqu'à Henri IV exclusivement. Une gravure assez bonne, représentant François Ier dans le splendide costume des Valois, était jointe à la biographie. Je l'examinai avec étonnement.
«Est-il possible, me dis-je émerveillée, qu'il y ait des hommes aussi beaux que cela!»
Le biographe, qui ne partageait pas l'antipathie du curé pour mon héros, en faisait l'éloge sans aucune restriction. Il parlait, avec une conviction enthousiaste de sa beauté, de sa valeur, de son esprit chevaleresque, de la protection éclairée qu'il accorda aux lettres et aux arts. Il terminait par deux lignes sur sa vie privée, et j'appris ce que j'ignorais complètement, c'est que:
«François Ier menait joyeuse vie et aimait prodigieusement les femmes. Qu'il préféra grandement et sincèrement belle dame Anne de Pisseleu, à laquelle il donna le comté d'Étampes, qu'il érigea en duché pour lui être moult agréable.»
De ces quelques mots, je tirai les conclusions suivantes: Premièrement, ayant découvert, depuis un mois, que mon existence était monotone, qu'il me manquait beaucoup de choses, que la possession d'un curé, d'une tante, de poules et de lapins ne suffisait point au bonheur, je décidai qu'une joyeuse vie étant évidemment le contraire de la mienne, François Ier avait fait preuve d'un grand jugement en la choisissant;
Deuxièmement, qu'il professait certainement la sainte vertu de charité prêchée par mon curé, puisqu'il aimait tant les femmes;
Troisièmement, qu'Anne de Pisseleu était une heureuse personne, et que j'aurais bien voulu qu'un roi me donnât un comté érigé en duché pour m'être «moult agréable».
«Bravo! m'écriai-je en lançant le livre au plafond et en le rattrapant lestement. Voici de quoi confondre le curé et le convertir à mon opinion.»
Le soir, dans mon lit, je relus la petite biographie.
«Quel brave homme que ce François Ier! me dis-je. Mais pourquoi l'auteur ne parle-t-il que de son affection pour les femmes? Pourquoi n'a-t-il pas écrit qu'il aimait aussi les hommes? Après tout, chacun a son goût! mais si je juge les femmes d'après ma tante, je crois que j'aurais une préférence marquée pour les hommes.»
Puis je me rappelai que le biographe était du sexe masculin, et je pensai qu'il avait sans doute cru poli, aimable et modeste, de se passer sous silence, lui et ses congénères.
Je m'endormis sur cette idée lumineuse.
Le lendemain, je me levai fort contente. D'abord j'avais seize ans; ensuite, la petite créature, qui se regardait dans la glace, examinait un visage qui ne lui déplaisait pas; puis je fis deux ou trois pirouettes en songeant à la stupéfaction du curé devant ma science nouvelle.
Dans mon impatience, j'étais installée à ma table depuis un temps assez long, quand il arriva, rose et souriant. À sa vue, le cœur me battit un peu, comme celui des grands capitaines à la veille d'une bataille.
«Voyons, ma petite, me dit-il quand les devoirs furent corrigés et qu'il eut fait la grimace sur leur laconisme, passons à François Ier, et examinons-le sous toutes les faces.»
Il s'établit commodément dans son fauteuil, prit sa tabatière d'une main, son mouchoir de l'autre, et, me regardant de côté, se prépara à soutenir la discussion qu'il prévoyait.
Je partis à fond de train sur mon sujet; je m'agitai, m'animai, m'enthousiasmai; j'appuyai beaucoup sur les qualités prônées dans mon histoire, après quoi je passai à mes connaissances particulières.
«Et quel charmant homme, monsieur le curé! Sa taille était majestueuse, sa figure noble et belle; une si jolie barbe taillée en pointe et de si beaux yeux!»
Je m'arrêtai un instant pour reprendre haleine, et le curé, effarouché, se dressant tout raide comme ces diablotins à ressort enfermés dans des boîtes en carton, s'écria:
«Où avez-vous pris ces balivernes, mademoiselle?
—Ceci, c'est mon secret», dis-je avec un petit sourire mystérieux.
Et brûlant mes vaisseaux:
«Monsieur le curé, je ne sais pas ce que vous a fait ce pauvre François Ier! Savez-vous qu'il avait beaucoup de jugement? Il menait joyeuse vie et aimait prodigieusement les femmes.»
Alors les yeux du curé s'ouvrirent si grands que j'eus peur de les voir éclater. Il cria: «Saint Michel! saint Barnabé!» et laissa tomber sa tabatière avec un bruit si sec, que le chat, étendu dans une bergère, sauta à terre avec un miaulement désespéré.
Ma tante, qui dormait, se réveilla en sursaut et s'écria:
«Vilaine bête!»
En s'adressant à moi, non au chat, sans savoir de quoi il s'agissait. Mais cette épithète composait invariablement l'exorde et la péroraison de tous ses discours.
Certes, je m'attendais à produire un grand effet; cependant, je restai un peu interdite devant la physionomie vraiment extraordinaire du curé.
Mais je repris bientôt imperturbablement:
«Il aima particulièrement une belle dame à laquelle il donna un duché. Avouez, monsieur le curé, qu'il était bien bon, et que c'eût été bien agréable d'être à la place d'Anne de Pisseleu?
—Sainte Mère de Dieu! murmura le curé d'une voix éteinte, cette enfant est possédée!
—Qu'y a-t-il? cria ma tante en transperçant son chignon d'une de ses aiguilles à tricoter. Mettez-la à la porte, si elle se permet des impertinences.
—Mon enfant, reprit le curé, où avez-vous appris ce que vous venez de me dire?
—Dans un livre, répondis-je laconiquement, sans faire mention de la bibliothèque.
—Et comment pouvez-vous répéter de telles abominations?
—Abominations! dis-je, scandalisée. Quoi! monsieur le curé, vous trouvez abominable que François Ier fût généreux et aimât les femmes! Vous ne les aimez donc pas, vous?
—Que dit-elle? rugit ma tante, qui, m'écoutant attentivement depuis quelques instants, tira de ma question les pronostics les plus désastreux. Petite effrontée! vous...
—Paix, ma bonne dame, paix! interrompit le curé, paraissant-en ce moment soulagé d'un grand poids. Laissez-moi m'expliquer avec Reine. Voyons, que trouvez-vous de louable dans la conduite de François Ier?
—Vraiment, c'est bien simple, répondis-je d'un ton un peu dédaigneux, en songeant que mon curé vieillissait et commençait à avoir la compréhension lente. Vous me prêchez tous les jours l'amour du prochain, il me semble que François Ier mettait en pratique votre précepte favori: Aimez le prochain comme vous-même pour l'amour de Dieu.»
À peine eus-je fini ma phrase que le curé, essuyant son visage sur lequel coulaient de grosses gouttes de sueur, se renversa dans son fauteuil et, les deux mains sur le ventre, s'abandonna à un rire homérique qui dura si longtemps que des larmes de dépit et de contrariété m'en vinrent aux yeux.
«En vérité, dis-je d'une voix tremblante, j'ai été bien sotte de me donner tant de mal pour apprendre ma leçon et vous faire admirer François Ier.
—Mon bon petit enfant, me dit-il enfin, reprenant son sérieux et employant son expression favorite lorsqu'il était content de moi, ce qui m'étonna beaucoup, mon bon petit enfant, je ne savais pas que vous professiez une telle admiration pour les gens qui mettent en pratique la vertu de charité.
—Dans tous les cas, ce n'est pas risible, répondis-je d'un ton maussade.
—Allons, allons, ne nous fâchons pas.»
Et le curé, me donnant une petite tape sur la joue, abrégea la leçon, me dit qu'il reviendrait le lendemain et s'en alla confisquer la clef de la bibliothèque qu'il connaissait sans que je m'en doutasse.
Il n'avait pas encore quitté la cour que ma tante s'élançait sur moi, et me secouant à m'en disloquer l'épaule:
«Vilaine péronnelle! qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait pour que le curé s'en aille si tôt?
—Pourquoi vous mettez-vous en colère, dis-je, si vous ne savez pas ce dont il est question?
—Ah! je ne sais pas! n'ai-je pas entendu ce que vous disiez au curé, effrontée?»
Jugeant que les paroles ne suffisaient pas pour exhaler sa colère, elle me donna un soufflet, me frappa rudement, et me mit à la porte comme un petit chien.
Je m'enfuis dans ma chambre, où je me barricadai solidement. Mon premier soin fut d'ôter ma robe, et de constater dans la glace que les doigts secs et maigres de ma tante avaient laissé des marques bleues sur mes épaules.
«Vile petite esclave, dis-je en montrant le poing à mon image, supporteras-tu longtemps des choses pareilles? Faut-il que, par lâcheté, tu n'oses pas te révolter?»
Je m'admonestai durement pendant quelques minutes, puis la réaction se produisant, je tombai sur une chaise et pleurai beaucoup.
«Qu'ai-je donc fait, pensai-je, pour être traitée ainsi? La vilaine femme! Ensuite, pourquoi le curé avait-il une si drôle de figure pendant que je lui récitais ma leçon?»
Et je me mis à rire, tandis que des larmes coulaient encore sur mes joues. Mais j'eus beau creuser ce problème, je n'en trouvai pas la solution.
M'approchant de la fenêtre ouverte, je contemplai mélancoliquement le jardin et je commençais à reprendre mon sang-froid, quand il me sembla reconnaître la voix de ma tante qui causait avec Suzon. Je me penchai un peu pour écouter leur conversation.
«Vous avez tort, disait Suzon, la petite n'est plus une enfant. Si vous la brutalisez, elle se plaindra à M. de Pavol, qui la prendra chez lui.
—Je voudrais bien voir ça! Mais comment voulez-vous qu'elle songe à son oncle? C'est à peine si elle connaît son existence.
—Bah! la petite est futée! il lui suffira d'un instant de mémoire pour vous envoyer promener, si vous la rendez malheureuse, et ses bons revenus disparaîtront avec elle.
—Ah! bien, nous verrons... Je ne la battrai plus, mais...»
Elles s'éloignaient, et je n'entendis pas la fin de la phrase.
Après le dîner, où je refusai de paraître, j'allai trouver Suzon.
Suzon avait été l'amie de ma tante avant de devenir sa cuisinière. Elles se disputaient dix fois par jour, mais ne pouvaient pas se passer l'une de l'autre. On aura peine à me croire, si je dis que Suzon aimait sincèrement sa maîtresse; cependant c'est l'exacte vérité.
Mais si elle pardonnait à ma tante personnellement son élévation dans l'échelle sociale, elle s'en prenait, sans doute, au prochain, aux circonstances et à la vie, car elle grognait toujours. Elle avait la mine rébarbative d'un voleur de grands chemins, et portait constamment des cotillons courts et des souliers plats, bien qu'elle n'allât jamais à la ville vendre du lait et que son imagination ne trottât point comme celle de Perrette.
«Suzon, lui dis-je en me plaçant devant elle d'un air délibéré, je suis donc riche?
—Qui vous a dit cette sottise, mademoiselle?
—Cela ne te regarde pas, Suzon; mais je veux que tu me répondes et me dises où demeure mon oncle de Pavol.
—Je veux, je veux, grogna Suzon; il n'y a plus d'enfant, ma parole! Allez vous promener, mademoiselle! Je ne vous dirai rien, parce que je ne sais rien.
—Tu mens, Suzon, et je te défends de me répondre ainsi. J'ai entendu ce que tu disais à ma tante tout à l'heure!
—Eh bien, mademoiselle, si vous avez entendu, ce n'est pas la peine de me faire parler.»
Suzon me tourna le dos et ne voulut répondre à aucune de mes questions.
Je remontai dans ma chambre, très agacée, et, restant longtemps accoudée à la fenêtre, je pris la lune, les étoiles, les arbres à témoin que je formais la résolution immuable de ne plus me laisser battre, de ne plus avoir peur de ma tante et d'employer tout mon esprit à lui être désagréable.
Et laissant tomber les pétales d'une fleur que j'effeuillais, je jetai en même temps au vent mes craintes, ma pusillanimité, mes timidités d'autrefois. Je sentis que je n'étais plus la même personne et m'endormis consolée.
Dans la nuit, je rêvai que ma tante, transformée en dragon, luttait contre François Ier qui la pourfendait de sa grande épée. Il me prenait dans ses bras et s'envolait avec moi, tandis que le curé nous regardait d'un air désolé et s'essuyait le visage avec son mouchoir à carreaux. Il le tordait ensuite de toutes ses forces, et la sueur en découlait comme s'il l'avait trempé dans la rivière.