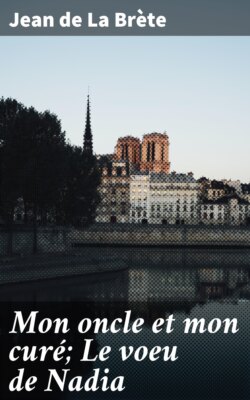Читать книгу Mon oncle et mon curé; Le voeu de Nadia - Jean de La Brète - Страница 12
IV
ОглавлениеLa guerre était déclarée et, dès lors, je passai mon temps à lutter contre Mme de Lavalle. Autrefois, j'osais à peine ouvrir la bouche devant elle, excepté quand le curé était en tiers entre nous; elle m'imposait silence avant même que j'eusse fini ma phrase.
J'affirme que cette manière de procéder m'était particulièrement pénible, car je suis extrêmement bavarde. Je me dédommageais bien un peu avec le curé, mais c'était absolument insuffisant; aussi avais-je pris l'habitude de parler tout haut avec moi-même. Il m'arrivait souvent de me planter devant mon miroir et de causer avec mon image durant des heures entières...
Mon cher miroir! ami fidèle! confident de mes plus secrètes pensées!
Je ne sais si les hommes ont jamais réfléchi sérieusement à l'influence énorme que ce petit meuble peut exercer sur un esprit. Remarquez que je ne détermine pas le sexe de cet esprit, étant bien convaincue que les individus barbus tiennent autant que nous au plaisir d'observer leurs qualités extérieures.
Si j'écrivais un ouvrage philosophique, je traiterais cette question: «De l'influence du miroir sur l'intelligence et le cœur de l'homme.»
Je ne nie pas que mon traité serait peut-être unique dans son espèce, qu'il ne ressemblerait en aucune façon à la philosophie dans laquelle Kant, Fichte, Schelling, etc..., ont pataugé toute leur vie pour leur plus grande gloire et le bonheur bien grand de la postérité, qui les lit avec un plaisir d'autant plus vif qu'elle n'y comprend rien. Non, mon traité n'irait point sur les brisées de ces messieurs: il serait clair, net, pratique, avec une pointe de causticité, et il faudrait pousser bien loin l'amour de la contradiction pour ne pas convenir que ces qualités ne sont point l'apanage des philosophies ci-dessus mentionnées. Mais, ne trouvant pas mon intelligence assez mûre pour ce grand œuvre, je me contente de conserver à mon miroir une sincère affection et de m'y regarder chaque jour très longtemps, par esprit de reconnaissance.
Je sais bien que, devant cette révélation, quelques-uns de ces esprits fâcheux, grincheux, qui voient tout en noir, insinueront que la coquetterie joue un grand rôle dans le sentiment que je prétends éprouver pour mon miroir. Mon Dieu! on n'est point parfait! et remarquez, beau lecteur, que si vous êtes de bonne foi, ce qui n'est pas certain, vous avouerez que l'intérêt personnel, pour ne pas dire un plus gros mot, tient la première place dans la plupart de vos sentiments.
Pour en revenir à mon sujet, je dirai que, ayant rompu complètement avec mes anciennes terreurs, je ne cherchais plus à modérer ma loquacité devant ma tante. Il ne se passait pas un repas sans que nous eussions des discussions qui menaçaient de dégénérer en tempêtes.
Quoique je ne connusse pas encore son origine, je n'avais pas tardé à découvrir qu'elle était ignorante comme une carpe, et qu'elle éprouvait une vive contrariété quand j'appuyais mes opinions sur mon savoir ou sur celui du curé. Du reste, je n'hésitais jamais à donner la qualification d'historiques à des idées tirées de mon propre cerveau. Malheureusement, il m'était impossible de lutter contre l'expérience personnelle de ma tante, et, lorsqu'elle m'affirmait que les choses se passaient de telle et telle façon dans le monde, que les hommes n'étaient guère que des sacripants, des suppôts de Satan, j'enrageais, car je ne pouvais rien répondre. J'avais assez de bon sens pour comprendre que les personnages avec lesquels je vivais ne pouvaient me donner qu'une idée très imparfaite sur le genre humain dans les circonstances ordinaires de la vie.
Le curé dînait tous les dimanches à la maison. Il avait, sans doute, ses raisons secrètes pour ne point vanter devant moi le roi de la création,—excepté quand il s'agissait de ses héros antiques dont il ne pouvait plus craindre l'esprit entreprenant,—car il n'opposait que de bien faibles dénégations aux affirmations de ma tante.
Le dîner du dimanche se composait invariablement d'un chapon ou d'un poulet, d'une salade aux œufs durs et de lait égoutté, quand c'était la saison. Le curé, qui faisait assez maigre chère chez lui, et dont le palais savait apprécier la cuisine de Suzon, arrivait en se frottant les mains et en criant la faim.
Nous nous mettions bien vite à table, et le commencement de la conversation était non moins invariable que le menu du dîner.
«Il fait beau temps, disait ma tante, dont la phrase, s'il pleuvait, n'était modifiée que par le changement du qualificatif.
—Un temps superbe! répondait le curé joyeusement. C'est charmant de marcher par ce joli soleil!»
S'il avait plus, s'il avait neigé, s'il avait gelé, s'il était tombé de la grêle, des pierres ou du soufre, le curé eût également exprimé sa satisfaction, soit en s'étendant sur l'agrément d'un appartement bien clos, soit en chantant les charmes d'un feu bien brillant.
«Mais il ne fait pas chaud, reprenait ma tante. C'est étonnant! De mon temps on prenait des robes blanches à Pâques.
—Les robes blanches vous allaient-elles bien?» demandais-je vivement.
Ma tante, qui prévoyait quelque impertinence, me foudroyait d'un regard préventif avant de répondre:
«Certainement, très bien.
—Oh! m'écriais-je, d'un ton qui ne laissait aucun doute sur mon intime conviction.
—De mon temps, affirmait ma tante, les jeunes filles ne parlaient que lorsqu'on les interrogeait.
—Vous ne parliez pas dans votre jeunesse, ma tante?
—Quand on m'interrogeait, pas autrement.
—Toutes les jeunes filles vous ressemblaient-elles, ma tante?
—Certainement, ma nièce.
—La vilaine époque!» soupirais-je en levant les yeux au ciel.
Le curé me regardait d'un air de reproche, et Mme de Lavalle laissait ses regards errer sur les divers objets qui couvraient la table, avec la tentation bien évidente de m'en lancer quelques-uns à la tête.
La conversation, arrivée à ce point... aigu, tombait subitement, jusqu'au moment où les sentiments amers de ma tante, refoulés par les efforts de sa volonté, éclataient tout à coup, comme une machine soumise à une trop forte pression. Elle exhalait son courroux sur la création entière. Hommes, femmes, enfants, tout y passait. De ces pauvres hommes, il ne restait, à la fin du dîner, qu'un horrible mélange, non d'os et de chairs meurtris, mais de monstres de toutes les espèces.
«Les hommes ne valent pas les quatre fers d'un chien», disait ma tante dans le langage harmonieux et élégant qui lui était habituel.
Le curé, qui avait la certitude désolante de n'être point une femme, baissait la tête et paraissait rempli de contrition.
«Quels mécréants! quels sacripants! reprenait-elle en me regardant d'un air furieux, comme si j'avais appartenu à l'espèce en question.
—Hum! répondait le curé.
—Des gens qui ne pensent qu'à jouir, qu'à manger! continuait ma tante, qui avait sur le cœur la pauvreté léguée par son mari. Quels suppôts de Satan!
—Hum! hum! reprenait le curé en hochant la tête.
—Monsieur le curé, m'écriais-je avec impatience, hum! n'est pas un argument très fort.
—Permettez, permettez, répondait le brave homme troublé dans la dégustation de son dîner; je crois que Mme de Lavalle va au delà de sa pensée en employant cette expression: suppôts de Satan. Mais il est certain que beaucoup d'hommes ne méritent pas une grande confiance.
—Vous êtes comme François Ier, vous aimez mieux les femmes? disais-je de mon petit air candide.
—Palsambleu! s'écriait ma tante, qui avait remplacé certains mots très énergiques par cette expression empruntée à son mari et qui lui paraissait tout aristocratique; palsambleu! taisez-vous, sotte!»
Mais le curé lui adressait un signe mystérieux, et l'excellente dame se mordait les lèvres.
«Et vos héros, monsieur le curé? et vos Grecs? et vos Romains?
—Oh! les hommes d'aujourd'hui ne ressemblent guère à ceux d'autrefois, disait le curé, bien convaincu qu'il exprimait une grande vérité.
—Et les curés? reprenais-je.
—Les curés sont hors de cause», répondait-il avec un bon sourire.
Ce genre de conversation, rempli de sous-entendus, avait pour privilège de m'agacer énormément. J'avais conscience qu'un monde d'idées et de sentiments, que je ne devais pas tarder du reste à découvrir, m'était fermé. Je doutais que le jugement porté par ma tante sur l'humanité fût absolument juste, mais je comprenais que j'ignorais beaucoup de choses et que je risquais de croupir longtemps dans mon ignorance.
Un matin que je méditais sur cette lamentable situation, l'idée me vint de consulter les trois personnes que j'étais à même de voir tous les jours: Jean, le fermier, Perrine et Suzon.
Cette dernière ayant vécu à C..., je décidai que son appréciation devait être basée sur une grande expérience, et je la gardai pour la bonne bouche.
M'enveloppant dans un capulet, je pris mes sabots et m'acheminai vers la ferme, située à un kilomètre de la maison.
Tout en barbotant, pataugeant, enfonçant, j'arrivai près de Jean, qui nettoyait sa charrue.
«Bonjour, Jean.
—Ben le bonjour, mamselle! dit Jean en ôtant son bonnet de laine, ce qui permit à ses cheveux de se dresser tout droits sur sa tête. Quand ils n'étaient pas soumis à une pression quelconque, c'était une particularité de leur tempérament de se livrer à ce petit exercice.
—Je viens vous consulter sur une chose très, très importante, dis-je en appuyant sur l'adverbe pour éveiller son intelligence, que je savais disposée à courir la prétantaine quand on le questionnait.
—À votre service, mamselle.
—Ma tante, dit que tous les hommes sont des sacripants; quel est votre avis sur ce sujet, Jean?
—Des sacripants! répéta Jean, qui écarquilla les yeux comme s'il apercevait un monstre devant lui.
—Oui, mais c'est l'opinion de ma tante et je veux avoir la vôtre?
—Dame! ça se pourrait ben tout de même!
—Mais ce n'est pas une opinion, cela, Jean! Voyons! croyez-vous, oui ou non, que les hommes sont généralement des sacripants?»
Jean appuya le bout de son nez sur l'index de sa main droite, ce qui est, comme on le sait, l'indice d'une profonde méditation.
Après avoir réfléchi une bonne minute, il me fit cette réponse claire et décisive:
«Écoutez, mamselle, je vas vous dire! ça se pourrait ben que oui, mais ça se pourrait ben que non.
—Buse!» lui dis-je, indignée de contempler un tel phénomène de bêtise.
Il ouvrit les yeux, il ouvrit la bouche, il ouvrit les mains, il eût ouvert toute sa personne, s'il avait pu, pour mieux manifester son étonnement.
Je revins dans la cour du Buisson, en pestant contre la boue, mes sabots, Jean et moi-même.
«Perrine, criai-je, viens ici!»
Perrine, qui nettoyait les terrines de sa laiterie, accourut aussitôt, une poignée d'orties à la main, les bras nus, le visage rouge comme une pomme d'api et le bonnet sur le derrière de la tête, selon son habitude.
«Quelle est ton opinion sur les hommes? dis-je brusquement.
—Sur les hom...»
Et Perrine, de pomme d'api devenue pivoine, laissa tomber ses orties, prit le coin de son tablier, releva la jambe gauche et resta perchée sur la droite en me regardant d'un air ébahi.
«Eh bien, réponds donc! Que penses-tu des hommes?
—Mamselle veut rire, ben sûr!
—Mais non, je parle sérieusement. Réponds vite!
—Dame! mamselle, me dit Perrine en se remettant d'aplomb sur les deux jambes, quand ce sont de beaux gas, m'est avis qu'il y a des choses pus désagréables à regarder!»
Cette manière d'envisager la question me donna grandement à réfléchir.
«Je ne parle pas du physique, repris-je en haussant les épaules, mais du moral?
—Ma foi! je les trouve ben aimables! répondit Perrine, dont les petits yeux brillaient.
—Comment! tu ne les trouves pas mécréants, sacripants, suppôts de Satan?»
Perrine se mit à rire à pleine bouche.
«Voyez-vous, mamselle, le parler des mécréants est si doux que...»
Ici, elle s'interrompit pour se donner un grand coup de poing sur la tête. Elle tortilla son tablier, baissa les yeux, et me parut disposée à prendre la poudre d'escampette.
«Après! Finis donc!
—Mamselle va me faire dire des sottises, ben sûr! je m'en vas.»
Et, m'adressant la plus belle de ses révérences, elle disparut dans les profondeurs de sa laiterie, dont elle me ferma la porte au nez.
«Pourquoi dirait-elle des sottises?... Allons! je n'ai plus de ressource que dans Suzon; reste à savoir si elle voudra parler.»
J'entrai dans la cuisine. Suzon, armée d'un balai, se préparait à le faire fonctionner activement. Il me sembla qu'elle était dans ses jours sombres, et je jugeai qu'il serait habile d'user de quelques précautions oratoires avant de poser ma question.
«Comme tes cuivres sont beaux et reluisants! lui dis-je d'un air gracieux.
—On fait ce qu'on peut, grogna Suzon. Après tout, ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à le dire.
—Tu réussis très bien la fricassée de poulet, Suzon, continuai-je sans me décourager, tu devrais m'apprendre à la faire.
—C'est pas votre besogne, mademoiselle; restez chez vous, et laissez-moi tranquille dans ma cuisine.»
Mes moyens de corruption ne produisant aucun effet, je dirigeai mes batteries sur un autre point.
«Sais-tu une chose, Suzon? Tu as dû être bien jolie dans ta jeunesse!» dis-je, en pensant à part moi que, si j'avais été son mari, je l'aurais mise à cuire dans le four pour m'en débarrasser.
J'avais touché la corde sensible, car Suzon daigna sourire.
«Chacun a son beau temps, mademoiselle.
—Suzon, repris-je, profitant de ce subit adoucissement pour arriver au plus vite à mon sujet, j'ai envie de te faire une question!—Quelle est ton opinion sur les hommes... et les femmes?» ajoutai-je, songeant qu'il était ingénieux d'étendre mes études sur les deux sexes.
Suzon s'appuya sur son balai, prit son air le plus rébarbatif, et me répondit avec une conviction entraînante:
«Les femmes, mademoiselle, sont des pas grand'chose, mais les hommes sont des rien du tout.
—Oh! protestai-je, en es-tu bien sûre?
—C'est aussi sûr que je vous le dis, mademoiselle!»
Elle administra un grand coup de balai aux débris de légumes qui se trouvaient par terre, et les fit disparaître avec autant de dextérité que s'ils avaient représenté les bipèdes, objets de son antipathie.
Je me retirai dans ma chambre pour méditer sur l'axiome misanthropique énoncé par Suzon, assez découragée en pensant que je n'étais pas grand'chose, et que mes amis inconnus, les hommes, méritaient la dénomination humiliante de rien du tout.