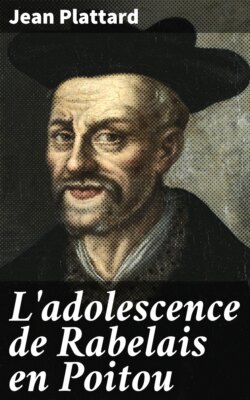Читать книгу L'adolescence de Rabelais en Poitou - Jean Plattard - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rabelais à Fontenay-le-Comte.
ОглавлениеRabelais a négligé de nous indiquer au début du Pantagruel quel pays fut le théâtre des «enfances» de son géant. Sans doute est-ce l’Utopie, cette contrée fabuleuse dont il a emprunté le nom et l’idée à Thomas Morus. Le père de Pantagruel, Gargantua, est en effet présenté comme le souverain de ce pays . Badebec, sa mère, est fille du roi des Amaurotes , nom donné par Thomas Morus à une ville d’Utopie. C’est d’Utopie que Gargantua, lorsqu’il disparaît de ce monde, est transporté par la fée Morgue, «au pays des Phées comme fut jadis Ogier et Artus ». Un chapitre de la seconde partie de Pantagruel nous renseigne sur l’itinéraire que suivit le géant pour se rendre de France par mer dans son royaume d’Utopie, que le conteur place dans cette Chine mystérieuse vers laquelle tendaient alors toutes les entreprises des navigateurs. Mais c’est en vain que nous chercherions des précisions sur la patrie du géant dans le récit de sa nativité et de ses premiers exploits.
On n’y trouve qu’indications incertaines ou contradictoires, qui témoignent de la parfaite indifférence du conteur à cette question. Il nous dit que pour faire cuire la bouillie nécessaire à l’héritier présomptif du royaume d’Utopie, tous les poêliers de Saumur en Anjou, de Villedieu en Normandie, de Bramont en Lorraine travaillèrent à fabriquer un poêlon. Nous sommes donc en France? «Et luy bailloit on ladicte bouillie en un grand timbre, qui est encores de present à Bourges près du palays.» Il y avait, en effet, du temps de Rabelais devant le palais de Jean de Berry, à Bourges, une cuve de pierre, dite écuelle du géant, que l’on remplissait une fois par an de vin destiné aux pauvres . Nous voici donc transportés en Berry! Bientôt Rabelais va nous dérouter de nouveau. C’est La Rochelle, Lyon, Angers qui conservent les grosses chaînes de fer dont Pantagruel, par ordre de son père, fut lié en son berceau ; c’est en Bourbonnais, au château de Chantelle, que l’on peut voir la grande arbalète dont il se servait tout enfant pour «s’esbatre après les oisillons» .
Brusquement, cette indétermination du théâtre de la geste gigantale prend fin et l’action se déroule pour un certain temps dans une seule province française. Gargantua décide d’envoyer son fils «à l’eschole, pour apprendre et passer son jeune eage».
«De faict vint à Poictiers.»
Là, par manière de passe-temps, le jeune Pantagruel détache d’un grand rocher nommé Passelourdin un quartier, qui dressé par ses soins sur quatre piliers devient le dolmen de la Pierre Levée, où les escholiers vont banqueter à force flacons, jambons et pastez «et escripre leurs noms dessus avec un cousteau... Et en memoire de ce, n’est aujourd’huy passé aulcun en la matricule de la dicte université de Poitiers, sinon qu’il ait beu en la fontaine Caballine de Croustelles, passé à Passelourdin et monté sur la Pierre levée.»
Et voici que se multiplient les noms de lieu, les allusions à des particularités de la province poitevine; même des noms de personnes contemporaines de Rabelais sont citées. «En après, lisant les belles chronicques de ses ancestres, trouva que Geoffroy de Lusignan, dict Geoffroy à la grand dent, grand pere du beau cousin de la seur aisnée de la tante du gendre de l’oncle de la bruz de sa belle mere, estoit enterré à Maillezays, dont print un jour campos pour le visiter comme homme de bien. Et partant de Poictiers avecques aulcuns de ses compaignons passerent par Legugé, visitant le noble Ardillon, abbé, par Lusignan, par Sansay, par Celles, par Colonges, par Fontenay-le-Comte saluant le docte Tiraqueau et de là arrivèrent à Maillezays.»
Il n’est aucun des noms de lieu énumérés ici qui ne désigne une localité réelle. Il n’en est peut-être pas deux qui aient jamais eu quelque notoriété. Comment Rabelais les connaissait-il donc? Pourquoi se sont-ils imposés à son choix? Entre Poitiers, Maillezais et la légende de Pantagruel, telle qu’elle existait antérieurement à Rabelais, il n’y avait aucun rapport. Ligugé, Sanxay, Celles, Colonges n’étaient pas sur la route de Poitiers à Maillezais dont nous connaissons les étapes par la Guide des chemins de France de Charles Estienne . A quelles circonstances ces localités doivent-elles donc le privilège d’être associées à la légende de Pantagruel par maître Alcofribas? Comment s’explique cette place que le Poitou prend soudain dans le récit?
Par le rôle qu’il avait joué dans la vie de Rabelais au cours des douze années qui avaient précédé la rédaction du Pantagruel. Là s’était écoulée la meilleure partie de sa jeunesse. La Touraine avait été son berceau. Mais c’est en Poitou qu’il s’était éveillé à la vie de l’esprit. De son séjour à Fontenay-le-Comte, à Maillezais, à Ligugé, à Poitiers, il avait gardé bien autre chose que des dénominations géographiques propres à jalonner les premières étapes du tour de France universitaire qu’entreprend le géant escholier. Pour Rabelais ces noms évoquaient des étapes de sa propre vie: les premières études en lettres latines et grecques, les longs espoirs et les vastes pensées du jeune érudit encouragé par des amis et des protecteurs, les premières épreuves aussi. Retracer la jeunesse de Rabelais en Poitou, c’est le suivre dans sa formation intellectuelle et dans l’acquisition de la plus grande partie de cette érudition qui regorge de ses livres. C’est aussi pénétrer parfois dans le secret de sa formation morale.
Le séjour de Rabelais à Fontenay-le-Comte est, dans sa biographie, la première notion certaine, établie sur un texte authentique. On ignore la date de sa naissance. Ecartant des traditions mal fondées, d’après lesquelles il serait né à Chinon, en 1485 ou 1490, d’un père cabaretier, la critique moderne a déduit de l’examen du texte de Gargantua qu’il était né en 1494, dans le voisinage de Chinon, sur la paroisse de Seuilly, à la Devinière, petite métairie qui appartenait alors à Antoine Rabelais, licencié ès-lois, avocat au siège de Chinon. Cette conjecture est extrêmement vraisemblable . Elle est confirmée par une tradition que recueillit sur place en 1699 l’archéologue Gaignères . Mais jusqu’ici aucun document authentique, contemporain de Rabelais ne la confirme.
De même, nous ne savons rien de certain sur l’enfance et l’éducation première de notre écrivain chinonnais. Si l’on en croit le témoignage d’un avocat angevin, Bruneau de Tartifume, qui écrivait vers le milieu du XVIIe siècle il aurait été élevé au couvent des cordeliers de La Baumette, près d’Angers . La valeur de ce renseignement est contestée. Il faut avouer notre ignorance sur les premières années de la vie de Rabelais.
Mais le 4 mars 1521, il envoie de Fontenay-le-Comte à Guillaume Budé, une lettre latine qui nous a été conservée .
Ce document nous fournit d’abord une indication sur la date de la naissance de Rabelais. Il s’y déclare confus de l’honneur que son correspondant illustre lui fait, à lui, adolescent inculte et obscur: adolescens ἄμoυσóς τε ϰαɩ σϰoτεɩνóς. Le mot d’adolescens s’appliquait chez les Romains au troisième âge de la vie, qui allait de la quatorzième à la vingt-huitième année . Si la date de naissance de Rabelais était, comme on le croyait naguère, 1490, il lui eût été déjà difficile de se qualifier d’adolescens en 1521, à trente et un ans. Si, au contraire, comme nous le croyons, il est né en 1494, il était encore dans l’adolescentia au moment où il écrivait cette lettre, n’ayant que vingt-six ans.
Il était alors depuis peu de temps au couvent des Frères Mineurs de Fontenay. C’est du moins ce qui ressort d’une lettre adressée le 10 février 1520 par Guillaume Budé à un autre moine du même couvent, frère Pierre Amy. Budé plaint, en effet, son correspondant d’être seul dans sa communauté à se plaire aux études latines et grecques. Il n’a donc pas encore entendu parler de Rabelais, qui dut entrer dans le monastère vers la fin de 1520 .
Pourquoi était-il entré en religion chez les Frères Mineurs? et pourquoi se trouvait-il au monastère de Fontenay plutôt que dans telle autre maison du même Ordre plus rapprochée de son pays natal, à Mirebeau par exemple? ou encore à Cholet? ou à Clisson? c’est ce que nous ignorons. Le couvent du Puy-Saint-Martin, à Fontenay-le-Comte, était un des plus anciens de la province franciscaine de Touraine-Pictavienne, ayant été fondé en 1321, sur le chemin du Gros-Noyer, entre la rivière de Vendée et le coteau qui domine la ville à l’ouest . Peut-être devait-il à son ancienneté une réputation particulière. Quoiqu’il en soit des raisons qui attirèrent Rabelais dans ce couvent, il s’y trouvait en 1521.
Il nous apparaît donc pour la première fois, dans sa vingt-sixième année, sous le froc de bure couleur de cendre propre aux Franciscains, les reins ceints d’une corde, les pieds nus ou chaussés de sandales. Des quatre vœux monastiques ordinaires, obéissance, humilité, chasteté, pauvreté, le dernier avait été particulièrement recommandé par le fondateur de l’Ordre, saint François d’Assise. C’est en entendant ce verset de l’Evangile dans la messe des apôtres: «Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures», qu’il s’était décidé à remplacer la ceinture de cuir où l’on portait ordinairement la monnaie, par une simple corde. Celle-ci était devenue, dans l’opinion commune, l’attribut des Franciscains: on les appelait les Cordeliers.
Le vœu de pauvreté obligeait les Cordeliers à vivre d’aumônes. Leurs couvents étaient situés généralement dans des villes ou de gros bourgs, d’où quelques-uns des moines se répandaient dans la campagne pour faire des tournées de quête. En principe ils ne portaient jamais d’argent sur eux; leurs mains devaient fuir le contact de toute monnaie. Quelques-uns éludaient la règle, nous assure Erasme, en mettant des gants! Ces casuistes étaient sans doute peu nombreux. Non moins rares étaient ceux qui poussaient l’observation de la règle jusqu’au scrupule, comme ce frère Adam Couscoil, du couvent de Mirebeau, dont Rabelais nous cite le trait suivant . Un jour, certain receveur l’avait prié de le prendre sur ses épaules pour lui faire passer une rivière à gué. Frère Couscoil y consentit. Parvenu au plus profond du gué, il apprend que la gibecière du receveur était pleine. Alors pour ne point enfreindre la défense de porter de l’argent sur lui, sans tarderai jette à l’eau le receveur et sa gibecière.
L’effet le plus apparent de cette pauvreté que devaient chérir les Cordeliers, était la malpropreté. Ils s’y abandonnaient avec indolence, semble-t-il. Pendant plusieurs siècles leur saleté a égayé la verve des conteurs.
Un article de leurs statuts enjoignait à ceux qui étaient ignorants de ne pas se soucier d’apprendre les lettres. Il n’en faudrait pas conclure que les Franciscains faisaient profession d’ignorance. Leur ordre a donné à la philosophie médiévale quelques-uns de ses plus grands penseurs: Alexandre de Halès, saint Bonaventure, Roger Bacon, Duns Scot. Au XVIIe siècle un compilateur, Wadding, a pu dresser un catalogue de dix-huit cents écrivains franciscains . Mais c’est un fait qu’au début du XVIe siècle tous les humanistes flétrissent l’ignorance dans laquelle croupissent les Cordeliers.
Rabelais ne pouvait donc, en entrant au couvent du Puy-Saint-Martin, se flatter de l’espoir d’y trouver un asile propice à l’étude. Son initiation aux lettres latines et grecques, qui date de son séjour parmi les frères Mineurs, ne doit rien ni à l’influence de l’Ordre, ni à l’atmosphère du couvent de Fontenay. Elle procède d’un amour inné du savoir et elle atteste la force de sa volonté.
Parmi beaucoup d’obstacles, quelques circonstances favorables secondèrent d’ailleurs le zèle du jeune étudiant. Tout d’abord, il eut la chance de rencontrer au couvent un moine instruit, frère Pierre Amy qui fut pendant trois ans son compagnon d’études. Pierre Amy avait déjà appris le latin et même le grec lorsque, pour des raisons que nous ignorons, il fut contraint par son père d’entrer au couvent. Il mit à profit les loisirs de la vie monastique pour s’adonner avec ardeur à la lecture de l’Ecriture Sainte et des Pères. Il s’intéressait à la métaphysique d’Aristote, aux mathématiques, à la philologie . Il était en relations avec Guillaume Budé, le prince des philologues français, qui, par ses exhortations, par ses conseils, par la publication de ses ouvrages sur les Pandectes et sur les monnaies anciennes (De Asse, 1515) était en train de conquérir à la cause de l’humanisme et des lettres antiques les plus distingués des magistrats et des officiers de finances à Paris. A l’aube de notre Renaissance, c’est vers Guillaume Budé, comme vers leur guide et leur patron que tournaient leurs regards tous les Français qui travaillaient à la restitution des bonnes lettres .
Rabelais ne tarda pas à conquérir l’estime et l’amitié de Pierre Amy par son ardeur au travail. On peut se représenter le jeune cordelier dans sa cellule, semblable au savant que les gravures du temps nous montrent enfermé dans un cabinet aux murailles nues, qu’éclaire une étroite fenêtre cintrée, assis devant un pupitre massif et haut comme un lutrin, ayant à portée de sa main, rangés à plat sur une ou deux tablettes, quelques livres.
Doué d’un appétit de savoir plus «strident que le feu parmi les brandes», il ne se contentait pas d’étudier les lettres latines, il apprenait le grec. Tâche ardue à cette époque où l’hellénisme en était encore à ses débuts chez nous. Les maîtres, les livres, les instruments de travail étaient rares. Vers la fin du XVe siècle deux professeurs venus d’Italie, Georges Hermonyme de Sparte et Janus Lascaris avaient donné à Paris quelques leçons de grec; de 1508 à 1512, Jérôme Alexandre avait enseigné cette langue dans un collège de l’Université. Mais le groupe des hellénistes parisiens ne comprenait guère qu’une dizaine de professeurs, de magistrats, de médecins. Quant aux livres indispensables, grammaires et textes, ils devaient encore être importés à grands frais d’Italie. C’est à peine s’il était sorti plus de deux douzaines d’ouvrages grecs des presses de Gilles de Gourmont, le seul imprimeur de grec à Paris de 1508 à 1520 (1).
Ces difficultés ne rebutèrent pas Rabelais. Dès le mois d’octobre 1520, frère Pierre Amy estimait que son compagnon d’études pouvait se faire connaître du savant Guillaume Budé et il l’engageait à se recommander à lui par une lettre. Le jeune apprenti ès lettres grecques hésita d’abord. Ne convenait-il pas d’attendre pour tenter cette démarche que son style se fût perfectionné ? Pierre Amy lui représentant que Budé s’intéressait à quiconque avait le goût des lettres, Rabelais céda aux instances de son compagnon, rédigea une épitre et l’envoya. Elle est aujourd’hui perdue et nous ne la connaissons que par celle qui la suivit; sans doute le nouvel helléniste avait-il voulu y présenter quelques spécimens de son savoir: une prière en vers grecs la terminait (1).
Budé était alors secrétaire du roi et parfois très occupé par ces fonctions. Mais il ne laissait échapper aucune occasion d’éveiller ou d’encourager chez les jeunes gens la curiosité des lettres antiques. Sa correspondance pour les années 1516-1522 (quatre livres de lettres latines et un de lettres grecques) nous donne une haute idée de l’activité qu’il déployait comme zélateur de la philologie. Par l’intermédiaire de Pierre Amy, il fit savoir à Rabelais qu’il avait reçu sa lettre.
Ce fut une grande joie pour celui-ci de se savoir connu du prince des hellénistes. Dans une seconde lettre, datée du 4 mars 1521, il s’empressa d’excuser la témérité de sa démarche et de s’applaudir de son succès.
Quelque temps après, il avait l’honneur de recevoir lui-même une longue lettre de Guillaume Budé. Elle lui était envoyée de Villeneuve-sur-Vingeanne, en Bourgogne, où le secrétaire royal avait accompagné François Ier. Dans les tracas de la vie de cour, il enviait, déclarait-il, les loisirs, la liberté, la jeunesse d’Amy et de Rabelais, tout entiers à leur commerce avec la Philologie. Incidemment il louait son correspondant de son style grec et latin: Epistola tua... utriusque linguae peritiam singularem redolens .
Dans les deux années qui suivirent (1522-1523), Rabelais écrivit plusieurs fois à Budé. Toutes ses lettres ne parvinrent pas à leur adresse et le recueil des lettres de Budé ne contient que deux réponses de cet humaniste aux missives de Rabelais.
Qu’est-ce que nous apprend cette correspondance sur les studieuses occupations de Rabelais au couvent du Puy-Saint-Martin? Il se montre naturellement soucieux de donner à son savant protecteur une idée avantageuse de son érudition. Il insère dans sa rédaction latine de longs développements en grec. Deux de ses lettres se terminaient par des vers grecs de sa composition. Il cite le texte d’un vers d’Homère. Il plaisante volontiers. Il se gausse par exemple des riches ignorants qui pullulent à la cour et tourne une épigramme en grec contre leur idole l’aveugle Plutus, à qui Budé seul pourrait ouvrir les yeux à la belle lumière du jour. Il s’amuse encore à menacer Pierre Amy d’une action juridique, de dolo malo, pour l’avoir poussé à tenter une démarche téméraire auprès de Budé.
Celui-ci mêle également à son latin de longs fragments en grec. Au reste, trop éloigné de Rabelais pour diriger pratiquement ses études, il ne lui donne aucun conseil. Il se borne à le féliciter et à l’encourager. Il répond copieusement à ses plaisanteries. Il lui fait remarquer que la faute qu’il reproche à Pierre Amy appellerait une action juridique ex stipulatu, non de dolo malo; et il ajoute: ut nosti, qui juris studiosus fuisti.
Rabelais était donc à cette époque versé dans la connaissance du droit romain. C’est qu’une influence plus directe et plus efficace que les encouragements lointains de Budé s’exerçait alors sur lui, celle d’un groupe de légistes qu’il fréquentait à Fontenay-le-Comte. Cette humble cité, par une destinée singulière, était un des foyers de la Renaissance en France. Elle pouvait même s’enorgueillir de posséder plusieurs hellénistes. Ils appartenaient à la robe.
Fontenay, ancienne ville féodale, qui avait été d’abord aux comtes de Poitou (d’où son nom) appartint successivement au domaine royal, aux Anglais, au duc Jean de Berry, au duc de Bretagne. Ses remparts, son château, muni de cinq grosses tours et d’un donjon, en avaient fait, pendant tout le moyen âge, une solide forteresse , dont il reste d’imposants vestiges.
Elle avait été réunie définitivement à la couronne par Louis XI. Ce roi, qui rendit la prospérité à son royaume en favorisant le commerce et l’industrie, érigea Fontenay en commune. Dès lors, la ville se développa et s’enrichit. Les corporations des drapiers et des tanneurs y devinrent florissantes. Des halles en bois, ornées d’une belle façade sculptée, abritaient chaque année trois foires importantes. La ville, primitivement resserrée sur le coteau qui domine la rive droite de la Vendée, vit ses faubourgs s’étendre. Deux églises, Saint-Nicolas et Saint-Jean, celle-ci encore debout, furent reconstruites. L’église Notre-Dame dressa au-dessus des toits serrés des vieux quartiers l’élégante pyramide de son clocher gothique, qui fait encore l’admiration des connaisseurs, même après la restauration qu’elle a subie au début du XVIIIe siècle (2). Pour consacrer l’importance de cette capitale du Bas-Poitou, Louis XI en fit un siège royal (juridiction correspondant à une cour d’appel). Le siège royal comportait un assesseur ou lieutenant du sénéchal du Poitou, un lieutenant criminel et particulier, des conseillers, des avocats, des procureurs (c’est-à-dire des avoués) et des clercs de justice.
A l’époque où Rabelais entra au couvent du Puy-Saint-Martin, il régnait dans ce cercle de légistes une grande fièvre de savoir. Les sciences juridiques y étaient étudiées selon les méthodes nouvellement mises en honneur par les humanistes, l’Italien Laurent Valla et notre Guillaume Budé. En outre, ces gens de loi s’intéressaient aux «lettres d’humanité », c’est-à-dire à l’histoire, à la philosophie, à la poésie des anciens.
Les plus notoires d’entre eux étaient le lieutenant criminel et particulier, Artus Cailler et son gendre, le juge André Tiraqueau. C’est chez ce dernier que l’on se réunissait ordinairement, dans le parterre du jardin ou sous un berceau de ces lauriers-tins si communs dans la région. Les entretiens de ce petit cénacle portaient sur le droit, la morale, la philosophie, la poésie. Ce n’était pas un «salon», les femmes en étant absentes, mais des réunions de gens du monde, qui devaient ouvrir à frère Amy et à frère Rabelais, évadés de leur cellule, des échappées sur le siècle. Les doctes propos de leurs amis les légistes, leur apprenaient bien des choses que ni leur vie monastique ni leurs livres, ne les invitaient à étudier. Par exemple, il fut un temps où la plupart de ces conversations portèrent sur le mariage et les femmes .
Tiraqueau, en effet, avait acquis une certaine notoriété pour avoir publié à l’âge de vingt-quatre ans deux traités sur le mariage (1513). L’un était une réédition d’un livre latin de l’Italien Francesco Barbaro, De re uxoria, qui avait eu au delà des Alpes un succès attesté par trois éditions et une traduction en italien.
L’autre était une œuvre originale . Elle se présentait comme la première partie d’un commentaire que Tiraqueau projetait d’écrire sur la coutume du Poitou, pour éclairer ses compatriotes les Poitevins, race qui n’est, ajoutait-il, ni lourde, ni stupide, «gentem alioquin nec bardam, nec stupidam». Il commençait ce commentaire par l’examen du titre XV du Coutumier du Poitou, codifié à Parthenay , en 1457: «De la puissance et administration des maris.» Il intitulait son ouvrage: De legibus connubialibus (Lois du mariage). Ce qu’il entend par Leges ce ne sont point les clauses du Coutumier, les lois civiles, mais des préceptes moraux qu’il formule lui-même dans un latin d’une concision impérieuse.
L’ouvrage était dédié à Arthus Cailler, son beau-père: il contenait le programme de vie conjugale qu’adoptait Tiraqueau au moment où il se mariait, de même que le De re uxoria représentait les règles de conduite qu’il recommandait à Marie Cailler, sa très jeune épouse .
Un même esprit règne dans les deux ouvrages. Le De re uxoria de Francesco Barbaro prescrit aux femmes de garder en toutes circonstances une sage réserve. Il leur interdit sévèrement tout ce qui est marque de légèreté : l’allure trop prompte, l’agitation des mains, la mobilité du regard. Rire aux éclats est honteux, déclare-t-il, et indécent à une femme. Il ne condamne pas la parure, mais il la borne aux articles solides et durables: or, pierreries, joyaux, qui ne demandent pas à être renouvelés sans cesse, comme les étoffes délicates et les colifichets. Toutes ses recommandations tendent à confiner les femmes dans la vie conjugale et les soins du ménage.
Les préceptes que Tiraqueau appelle les lois matrimoniales (leges connubiales) répondent à la même conception du rôle de la femme dans le mariage. Le titre XVe de la coutume du Poitou stipulait que «la femme est au pouvoir de son mary». Commentant ce texte, Tiraqueau formule ainsi sa première loi matrimoniale:
Viri uxoribus imperanto,
Uxores viris obediunto.
Les onze préceptes (leges) qui suivent s’inspirent plus ou moins de ce principe. Ils sont corroborés par force citations empruntées principalement aux juristes. Toutes ces «lois» sont fondées sur cet axiome indiscuté, que la femme, est un être faible par nature. Toutes légitiment la tutelle maritale, dont les abus eux-mêmes ne choquaient alors ni la coutume, ni l’opinion. Ainsi dans la question, si souvent débattue au cours du moyen âge, de savoir si les sexes sont égaux, Tiraqueau prenait parti contre la femme qu’il tenait pour inférieure à l’homme .
Son ouvrage fit quelque bruit. Un jurisconsulte messin, Claude Chansonnette, le plagia. Tiraqueau résolut d’en donner une seconde édition, augmentée de tous les textes latins, grecs et italiens que ses lectures lui fourniraient à l’appui de ses thèses. Il mit vraisemblablement à profit non seulement ses lectures, mais encore celles de ses amis de Fontenay et les questions relatives aux femmes et au mariage furent maintes fois débattues sous le bosquet de laurier-tin, en présence d’Amy et de Rabelais.
Pendant qu’il préparait ainsi cette seconde édition de son De legibus Connubialibus, paraissait en 1522, à Paris, chez son propre éditeur, Josse Bade, une apologie du sexe féminin, en latin et sous un titre grec: τη̃ς γυναɩϰεɩ́ας ϕυτλη̃ς apologia.
Elle était l’œuvre d’un magistrat qui était lié avec Tiraqueau, Amaury Bouchard, lieutenant général du sénéchal de Saintonge au siège royal de Saint-Jean-d’Angély .
Le livre s’ouvrait sur une épitre latine de frère Pierre Amy à Tiraqueau. Il faut bien croire que les moines du Puy-Saint-Martin n’étaient pas strictement obligés à la résidence, car c’est de Saintes, où il habite, chez Bouchard, depuis quelque temps, qu’Amy écrit à Tiraqueau. Il le charge d’affectueux messages pour son compagnon Rabelais, «le plus érudit des Franciscains», et il expose, avec quelques ménagements, l’objet du livre: c’est un plaidoyer pour les femmes que Tiraqueau a quelque peu discréditées. Désormais, déclare-t-il, une joute est engagée entre les deux amis .
Dans cette lutte Bouchard eut l’avantage de la courtoisie. Il ne s’en faisait pas accroire sur la portée de son livre. Etant de loisir à Bordeaux, où il attendait l’issue d’un procès, il s’était amusé à écrire, par manière de passe-temps cette réfutation du De legibus connubialibus. Son apologie du sexe féminin était un exercice de dialectique et de style, et il en parlait avec un certain détachement.
Au contraire, Tiraqueau, dont l’amour-propre était chatouilleux, n’entendait pas la plaisanterie sur sa thèse antiféministe. Lorsque, deux ans plus tard, il publia la seconde édition du De legibus connubialibus, qu’il préparait depuis longtemps, il se répandit en récriminations contre Amaury Bouchard. Pour faire le galant et capter les grâces du sexe féminin ce «Boucharmant», comme il l’appelle dans un calembour grec (βουχαρɩ́εɩς) n’avait pas hésité à déchirer, à diffamer, à piétiner un livre écrit par un ami! Il reconnaissait, sur un ton aigre-doux, que l’ouvrage de Bouchard n’était pas sans agrément, bien que les idées en fussent confuses et l’expression obscure. Il maintenait au reste sa thèse, se bornant dans cette seconde édition du De legibus connubialibus à confirmer et à développer les idées que son adversaire avait voulu ébranler et renverser.
Cette confirmation de ses thèses consistait en allégations d’autorités aussi nombreuses que variées. Tiraqueau citait pêle-mêle les philosophes et les poètes, les historiens et les orateurs, Tite-Live et Cicéron, Platon et Pétrarque, Ezéchiel et Properce. L’ouvrage s’augmentait ainsi considérablement. De 27 feuillets que comportait la première édition il passait à 27G.
Ainsi se querellaient les légistes du cercle de Fontenay! Que faisaient cependant nos deux moines, frère Pierre Amy et frère Rabelais? Liés avec l’un et l’autre adversaires, ils les admiraient également. En tète de la seconde édition du De legibus connubialibus, on lit un compliment de Rabelais à Tiraqueau, en vers grecs: si ces lois, dit ce quatrain, édictées par le jurisconsulte poitevin étaient de Platon, y aurait-il parmi les hommes quelqu’un de plus illustre que Platon?
Et frère Amy, dans un quatrain latin, renchérissait sur cet éloge, proclamant par la même occasion son admiration pour le savoir de Rabelais, son compagnon d’études . Celui que tu loues, affirme-t-il, ne peut être que docte; il l’est d’autant plus que c’est toi, ô Rabelais, qui le loues!
Tiraqueau ne restait pas sans répondre à de tels témoignages d’estime et de sympathie. Il glissait parmi ses allégations et références des éloges de Rabelais et d’Amy. Il nous donne, en passant, un renseignement sur les exercices auxquels se livrait Rabelais dans sa cellule du Puy-Saint-Martin: il y avait traduit le second livre d’Hérodote. Sans doute cette traduction était-elle en latin, puisqu’elle était destinée à combler une lacune de la translation latine entreprise et laissée inachevée par l’humaniste italien Laurent Valla. En tout cas, elle était élégante et Tiraqueau tient, à ce propos, à rendre cet hommage à Rabelais que son érudition dans les deux langues grecque et latine, ainsi que dans toute sorte de doctrine, était bien supérieure à ce que l’on pouvait attendre d’un homme de son âge et surtout d’un moine cordelier. «Franciscus Rabelaesus Minoritanus, vir supra aetatem praeterque ejus sodalicii morem, ne nimiam religionem dicam, utriusque linguae omnifariaeque doctrinae peritissimus .»
A cette érudition, qui devenait encyclopédique, le cénacle de Fontenay apportait sa contribution. Il exerça d’abord sur la culture de Rabelais une influence particulière. A cette époque, il n’y avait pas pour l’humanisme français d’orientation générale. Dans le trésor des lettres grecques et latines, nos érudits choisissaient pour leurs études, qui les poètes, qui les philosophes, qui les historiens au gré des circonstances, des relations, des goûts personnels. Il était naturel que les légistes qui s’intéressaient professionnellement à l’homme, à ses mœurs et à ses coutumes fussent sollicités généralement par les moralistes, les orateurs et les historiens. A Fontenay-le-Comte, Plutarque et Lucien étaient particulièrement en faveur . Or ce sont précisément les moralistes, Plutarque par exemple, et Lucien qui sont le «gibier» de Rabelais . Des poètes, à part quelques exceptions, il n’a cure. A cette direction spéciale de sa curiosité de lettré, il est vraisemblable que le commerce des légistes de Fontenay ne fut pas étranger.
Sur une question en particulier, celle de la faiblesse naturelle de la femme, ses idées concordent avec celles de Tiraqueau. Lorsqu’il fera du troisième livre de Pantagruel une longue consultation sur le mariage, il se souviendra des arguments allégués en faveur de cette thèse dans le De legibus connubialibus, dont une troisième édition parut précisément en 1546, en même temps que le Tiers Livre; et l’on a pu montrer qu’une bonne part de sa documentation sur les femmes et le mariage se trouve dans l’ouvrage de Tiraqueau .
Ce fut donc pour Rabelais une heureuse fortune que la rencontre de ces légistes, qui travaillaient à faire bénéficier les sciences juridiques de leurs études latines et grecques. Encouragé par Guillaume Budé, stimulé par les familiers du docte Tiraqueau, loué par celui-ci, il s’essayait, en traduisant Hérodote, aux travaux de l’humanisme, ne nourrissant d’autre ambition que de devenir un «abîme de science ». La félicité de cette existence laborieuse fut troublée vers la fin de 1523.
A cette époque, la Faculté de théologie de Paris, ou, comme l’on disait alors, la Sorbonne, du nom du collège où se réunissait ordinairement le conseil de cette Faculté, fut alarmée par la publication des commentaires d’Erasme sur le texte grec de l’Evangile de saint Luc. Le luthéranisme, qui datait d’une demi-douzaine d’années à peine, commençait à s’infiltrer en France. Ses thèses principales offraient beaucoup de rapports avec les idées du doyen des humanistes français, Jacques Lefèvre d’Etaples. Celui-ci professait que l’Ecriture est le seul fondement de la doctrine du Christ, que les dogmes sont l’œuvre des hommes, que nous ne sommes pas «justifiés» par les œuvres, mais par la foi, qu’au reste une seule chose importe: le retour à l’Evangile. De là le nom d’Evangélisme donné à cet ensemble d’aspirations et d’idées.
Or, la plupart de nos humanistes étaient des Evangéliques; ils affectaient, en outre, le mépris le plus superbe pour la scolastique et ses suppôts. La Sorbonne les tenait donc pour suspects. Il lui parut qu’il y avait du danger à leur laisser commenter le texte grec de l’Ecriture, comme Erasme venait de le faire, et elle conçut le projet d’interdire en France l’étude de la langue grecque .
Par suite de cette résolution, les moines du Puy-Saint-Martin confisquèrent les livres grecs de Pierre Amy et de Rabelais. On imagine l’émotion de nos deux hellénistes! Jusqu’alors la discipline monastique avait été pour eux fort douce: Amy, nous l’avons vu, pouvait quitter le cloître pour aller résider à Saintes! Cette mesure de rigueur leur sembla intolérable. Pierre Amy, affolé, songea bientôt à s’enfuir. Avant de se décider, suivant un usage renouvelé de l’antiquité, il consulta l’avenir en ouvrant au hasard les œuvres de Virgile. Il tomba sur ce vers du troisième chant de l’Enéide:
Heu! fuge crudeles terras! fuge littus avarum!
Il suivit le conseil du sort et partit, échappant sain et sauf, nous dit Rabelais, de l’embuche des farfadetz, c’est-à-dire des Cordeliers .
Il se réfugia vraisemblablement au couvent des bénédictins de Saint-Mesmin, près d’Orléans. De là il passa en Suisse où il mourut, ayant adhéré, semble-t-il, au luthéranisme.
Dans leurs tribulations, les deux amis ne trouvèrent d’abord de réconfort que de Guillaume Budé, qui les soutenait en leur montrant le triomphe prochain des bonnes lettres sur l’ignorance. «Quel outrage on a fait aux Muses, écrivait-il à Pierre Amy, en vous tracassant pour le zèle que vous apportez à l’étude du grec! Comme on voudrait pouvoir châtier ces supérieurs de couvent qui cultivent l’ignorance sous le nom d’orthodoxie!... Ce sont les dernières œuvres d’Erasme, déclare-t-il, qui ont provoqué cet assaut des théologiens contre la langue grecque. Heureusement, ceux-ci n’ont plus aucun crédit à la cour et rien désormais n’arrêtera la renaissance des lettres .»
Cette lettre nous apprend que le 25 février 1524, Rabelais et Pierre Amy étaient séparés. Où était Rabelais? Quel parti prenait-il, en butte aux avanies et à la suspicion des moines ses confrères? Vraisemblablement il courbait le dos sous l’orage et il y aurait quelque rigueur à se scandaliser de son attitude. Rabelais était prêtre: devait-il donc pour l’amour du grec entrer en rebellion contre ses supérieurs et aller au besoin jusqu’à l’apostasie? Il préféra patienter. Il s’en trouva bien. Au bout de quelque temps, ses livres grecs lui furent rendus. Craignant toutefois qu’ils ne lui attirassent de nouveaux ennuis de la part des Franciscains, il se résolut à quitter leur ordre pour passer dans celui des Bénédictins. Ce n’est point que les disciples de saint Benoît fussent alors plus cultivés que les Franciscains: mais il y avait à trois lieues de Fontenay, à Maillezais, une abbaye bénédictine, dont le supérieur, Geoffroy d’Estissac, s’intéressait aux lettres. Rabelais se plaça sous sa protection et entra dans son monastère. Une vie nouvelle allait commencer pour lui, plus large, plus facile, sinon plus féconde pour son développement que ses années de moinage chez les frères mineurs.
Il resta en relations avec les membres du Cénacle de Fontenay. Peu à peu ceux-ci se dispersèrent. Amaury Bouchard, devenu maître des requêtes de l’hôtel du roi (1531), passa en Allemagne et en Angleterre où il s’acquitta de missions diplomatiques délicates. L’avocat Hilaire Goguet, autre ami de Rabelais, devint sénéchal de Talmond . Tiraqueau demeura dix ans encore à Fontenay. Chaque année sa maison s’accroissait d’un enfant, sa postérité spirituelle d’un livre. Sa réputation de jurisconsulte était telle qu’en 1541 le roi le nomma conseiller à la Grand’Chambre du Parlement de Paris, sans qu’il eût préalablement, selon l’usage, exercé de fonctions à la Chambre des Enquêtes.
Cependant Fontenay-le-Comte continuait de prospérer. Ses rues s’ornaient d’hôtels et de logis aux façades décorées de pilastres, de niches à coquilles, de bandeaux sculptés. Son église principale, Notre-Dame, s’agrandissait par l’adjonction de deux chapelles latérales dans le style franco-italien.
LE JURISCONSULTE TIRAQUEAU COMMENTANT UN OUVRAGE DE DROIT.
Frontispice de son livre De jure constituti possessorii, publié à Venise en 1551
Pour abriter la fontaine à laquelle la ville doit son nom, un architecte du pays, Liénard de La Réau, construisait en 1542 un délicat édifice à colonnes doriques et à fronton triangulaire. Aujourd’hui encore, Fontenay garde son caractère architectural de la Renaissance. «C’est une de ces petites villes gracieuses, élégantes et parfumées qui sont la vraie parure de la France .»
L’activité intellectuelle de cette cité ne connut pas de relâche jusqu’au début du XVIIe siècle. Aux membres de son petit cénacle de 1520 succédèrent d’autres savants et d’autres lettrés. C’était un disciple de Tiraqueau, le jurisconsulte Jean Imbert, dont les Institutiones forenses devinrent un traité classique de droit civil dans nos écoles. Plus tard, ce fut Barnabé Brisson, autre jurisconsulte; Sébastien Collin, qui publia plusieurs traités de pharmacie; le mathématicien François Viète; les poètes André Rivaudeau et Nicolas Rapin, l’historien Besly. Fontenay avait bien mérité le blason que lui avait octroyé François Ier en 1541. Il représente une fontaine avec cette noble devise: felicium ingeniorum fons et scaturigo, source bouillonnante d’esprits heureusement doués. De cette fontaine généreuse, les eaux fécondes du savoir se répandirent, un siècle durant, sur le Poitou et sur la France.