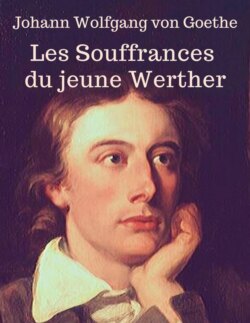Читать книгу Les Souffrances du jeune Werther (En lettres d'ancre) - Johann Wolfgang von Goethe - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16 juin.
ОглавлениеPourquoi je ne t’écris pas ? tu peux me demander cela, toi qui es si savant ! Tu devais deviner que je me trouve bien, et même… Bref, j’ai fait une connaissance qui touche de plus près à mon cœur. J’ai… je n’en sais rien.
Te raconter par ordre comment il s’est fait que je suis venu à connaître une des plus aimables créatures, cela serait difficile. Je suis content et heureux, par conséquent mauvais historien.
Un ange ! Fi ! chacun en dit autant de la sienne, n’est-ce pas ? Et pourtant je ne suis pas en état de l’expliquer combien elle est parfaite, pourquoi elle est parfaite. Il suffît, elle asservit tout mon être.
Tant d’ingénuité avec tant d’esprit ! tant de bonté avec tant de force de caractère ! et le repos de l’âme au milieu de la vie la plus active !
Tout ce que je dis là d’elle n’est que du verbiage, de pitoyables abstractions qui ne rendent pas un seul de ses traits. Une autre fois… non, pas une autre fois ; je vais te le raconter tout de suite. Si je ne le fais pas à l’instant, cela ne se fera jamais : car, entre nous, depuis que j’ai commencé ma lettre, j’ai déjà été tenté trois fois de jeter ma plume et de faire seller mon cheval pour sortir. Cependant je m’étais promis ce matin que je ne sortirais point. À tout moment je vais voir à la fenêtre si le soleil est encore bien haut…
Je n’ai pu résister, il a fallu aller chez elle. Me voilà de retour. Mon ami, je ne me coucherai pas sans t’écrire. Je vais t’écrire tout en mangeant ma beurrée. Quelles délices pour mon âme que de la contempler au milieu du cercle de ses frères et sœurs, ces huit enfants si vifs, si aimables !
Si je continue sur ce ton, tu ne seras guère plus instruit à la fin qu’au commencement. Écoute donc ; je vais essayer d’entrer dans les détails.
Je te mandai l’autre jour que j’avais fait la connaissance du bailli S…, et qu’il m’avait prié de l’aller voir bientôt dans son ermitage, ou plutôt dans son petit royaume. Je négligeai son invitation, et je n’aurais peut-être jamais été le visiter, si le hasard ne m’eût découvert le trésor enfoui dans cette tranquille retraite.
Nos jeunes gens avaient arrangé un bal à la campagne, je consentis à être de la partie. J’offris la main à une jeune personne de cette ville, douce, jolie, mais du reste assez insignifiante. Il fut réglé que je conduirais ma danseuse et sa cousine en voiture au lieu de la réunion, et que nous prendrions en chemin Charlotte S… « Vous allez voir une bien jolie personne, » me dit ma compagne quand nous traversions la longue forêt éclaircie qui conduit au pavillon de chasse. « Prenez garde de devenir amoureux ! ajouta la cousine. — Pourquoi donc ? — Elle est déjà promise à un galant homme que la mort de son père a obligé de s’absenter pour ses affaires, et qui est allé solliciter un emploi important. » J’appris ces détails avec assez d’indifférence.
Le soleil allait bientôt se cacher derrière les collines, quand notre voiture s’arrêta devant la porte de la cour. L’air était lourd ; les dames témoignèrent leur crainte d’un orage que semblaient annoncer les nuages grisâtres et sombres amoncelés sur nos tètes. Je dissipai leur inquiétude en affectant une grande connaissance du temps, quoique je commençasse moi-même à me douter que la fête serait troublée.
J’avais mis pied à terre : une servante qui parut à la porte nous pria d’attendre un instant mademoiselle Charlotte, qui allait descendre. Je traversai la cour pour m’approcher de cette jolie maison ; je montai l’escalier, et en entrant dans la première chambre j’eus le plus ravissant spectacle que j’aie vu de ma vie. Six enfants, de deux ans jusqu’à onze, se pressaient autour d’une jeune fille d’une taille moyenne, mais bien prise. Elle avait une simple robe blanche, avec des nœuds couleur de rose pâle aux bras et au sein. Elle tenait un pain bis, dont elle distribuait des morceaux à chacun, en proportion de son âge et de son appétit. Elle donnait avec tant de douceur, et chacun disait merci avec tant de naïveté ! Toutes les petites mains étaient en l’air avant que le morceau fut coupé. À mesure qu’ils recevaient leur souper, les uns s’en allaient en sautant ; les autres, plus posés, se rendaient à la porte de la cour pour voir les belles dames et la voiture qui devait emmener leur chère Charlotte. « Je vous demande pardon, me dit-elle, de vous avoir donné la peine de monter, et je suis fâchée de faire attendre ces dames. Ma toilette et les petits soins du ménage pour le temps de mon absence m’ont fait oublier de donner à goûter aux enfants, et ils ne veulent pas que d’autres que moi leur coupent du pain. » Je lui fis un compliment insignifiant, et mon âme tout entière s’attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien. J’eus à peine le temps de me remettre de ma surprise pendant qu’elle courut dans une chambre voisine prendre ses gants et son éventail. Les enfants me regardaient à quelque distance et de côté. J’avançai vers le plus jeune, qui avait une physionomie très-heureuse : il reculait effarouché, quand Charlotte entra, et lui dit : « Louis, donne la main à ton cousin. » Il me la donna d’un air rassuré ; et, malgré son petit nez morveux, je ne pus m’empêcher de l’embrasser de bien bon cœur. » Cousin ! dis-je ensuite en présentant la main à Charlotte, croyez-vous que je sois digne du bonheur de vous être allié ? — Oh ! reprit-elle avec un sourire malin, notre parenté est si étendue, j’ai tant de cousins, et je serais bien fâchée que vous fussiez le moins bon de la famille ! » En partant, elle chargea Sophie, l’ainée après elle et âgée de onze ans, d’avoir l’œil sur les enfants, et d’embrasser le papa quand il reviendrait de sa promenade. Elle dit aux petits : « Vous obéirez à votre sœur Sophie comme à moi-même. » Quelques-uns le promirent ; mais une petite blondine de six ans dit d’un air capable : « Ce ne sera cependant pas toi, Charlotte! et nous aimons bien mieux que ce soit toi. » Les deux aînés des garçons étaient grimpés derrière la voiture : à ma prière, elle leur permit d’y rester jusqu’à l’entrée du bois, pourvu qu’ils promissent de ne pas se faire de niches et de se bien tenir.
On se place. Les dames avaient eu à peine le temps de se faire les compliments d’usage, de se communiquer leurs remarques sur leur toilette, particulièrement sur les chapeaux, et de passer en revue la société qu’on s’attendait à trouver, lorsque Charlotte ordonna au cocher d’arrêter, et fit descendre ses frères. Ils la prièrent de leur donner encore une fois sa main à baiser : l’aîné y mit toute la tendresse d’un jeune homme de quinze ans, le second beaucoup d’étourderie et de vivacité. Elle les chargea de mille caresses pour les petits, et nous continuâmes notre route.
« Avez-vous achevé, dit la cousine, le livre que je vous ai envoyé ? — Non, répondit Charlotte ; il ne me plaît pas ; vous pouvez le reprendre. Le précédent ne valait pas mieux. » Je fus curieux de savoir quels étaient ces livres. À ma grande surprise, j’appris que c’étaient les œuvres de *** [2]. Je trouvais un grand sens dans tout ce qu’elle disait ; je découvrais, à chaque mot, de nouveaux charmes, de nouveaux rayons d’esprit dans ses traits que semblait épanouir la joie de sentir que je la comprenais.
« Quand j’étais plus jeune, dit-elle, je n’aimais rien tant que les romans. Dieu sait quel plaisir c’était pour moi de me retirer le dimanche dans un coin solitaire pour partager de toute mon âme la félicité ou les infortunes d’une miss Jenny ! Je ne nie même pas que ce genre n’ait encore pour moi quelque charme ; mais, puisque j’ai si rarement aujourd’hui le temps de prendre un livre, il faut du moins que celui que je lis soit entièrement de mon goût. L’auteur que je préfère est celui qui me fait retrouver le monde où je vis, et qui peint ce qui m’entoure, celui dont les récits intéressent mon cœur et me charment autant que ma vie domestique, qui, sans être un paradis, est cependant pour moi la source d’un bonheur inexprimable. » Je m’efforçai de cacher l’émotion que me donnaient ces paroles ; je n’y réussis pas longtemps, Lorsque je l’entendis parler avec la plus touchante vérité du Vicaire de Wakefield et de quelques autres livres [3], je fus transporté hors de moi, et me mis à lui dire sur ce sujet tout ce que j’avais dans la tête. Ce fut seulement quand Charlotte adressa la parole à nos deux compagnes, que je m’aperçus qu’elles étaient là, les yeux ouverts, comme si elles n’y eussent pas été. La cousine me regarda plus d’une fois d’un air moqueur dont je m’embarrassai fort peu.
La conversation tomba sur le plaisir de la danse. « Que cette passion soit un défaut ou non, dit Charlotte, je vous avouerai franchement que je ne connais rien au-dessus de la danse. Quand j’ai quelque chose qui me tourmente, je n’ai qu’à jouer une contredanse sur mon clavecin, d’accord ou non, et tout est dissipé. »
Comme je dévorais ses yeux noirs pendant cet entretien ! comme mon âme était attirée sur ses lèvres si vermeilles, sur ses joues si fraîches ! comme, perdu dans le sens de ses discours et dans l’émotion qu’ils me causaient, souvent je n’entendais pas les mots qu’elle employait ! Tu auras une idée de tout cela, toi qui me connais. Bref, quand nous arrivâmes devant la maison du rendez-vous, quand je descendis de voiture, j’étais comme un homme qui rêve, et tellement enseveli dans le monde des rêveries qu’à peine je remarquai la musique, dont l’harmonie venait au-devant de nous du fond de la salle illuminée.
M. Audran et un certain N… N… (comment retenir tous ces noms !), qui étaient les danseurs de la cousine et de Charlotte, nous reçurent à la portière, s’emparèrent de leurs dames, et je montai avec la mienne.
Nous dansâmes d’abord plusieurs menuets. Je priai toutes les femmes l’une après l’autre, et les plus maussades étaient justement celles qui ne pouvaient se déterminer à donner la main pour en finir. Charlotte et son danseur commencèrent une anglaise, et tu sens combien je fus charmé quand elle vînt à son tour figurer avec nous ! Il faut la voir danser ! Elle y est de tout son cœur, de toute son âme ; tout en elle est harmonie ; elle est si peu gênée, si libre, qu’elle semble ne sentir rien au monde, ne penser à rien qu’à la danse ; et sans doute, en ce moment, rien autre chose n’existe plus pour elle.
Je la priai pour la seconde contredanse ; elle accepta pour la troisième, et m’assura avec la plus aimable franchise qu’elle dansait très-volontiers les allemandes. « C’est ici la mode, continua-t-elle, que pour les allemandes chacun conserve la danseuse qu’il amène ; mais mon cavalier valse mal, et il me saura gré de l’en dispenser. Votre dame n’y est pas exercée, elle ne s’en soucie pas non plus. J’ai remarqué, dans les anglaises, que vous valsiez bien : si donc vous désirez que nous valsions ensemble, allez me demander à mon cavalier, et je vais en parler de mon côté à votre dame. » J’acceptai la proposition, et il fut bientôt arrangé que pendant notre valse le cavalier de Charlotte causerait avec ma danseuse.
On commença l’allemande. Nous nous amusâmes d’abord à mille passes de bras. Quelle grâce, que de souplesse dans tous ses mouvements ! Quand on en vint aux valses, et que nous roulâmes les uns autour des autres comme les sphères célestes, il y eut d’abord quelque confusion, peu de danseurs étant au fait. Nous fûmes assez prudents pour attendre qu’ils eussent jeté leur feu ; et les plus gauches ayant renoncé à la partie, nous nous emparâmes du parquet, et reprîmes avec une nouvelle ardeur, accompagnés par Audran et sa danseuse. Jamais je ne me sentis si agile. Je n’étais plus un homme. Tenir dans ses bras la plus charmante des créatures ! voler avec elle comme l’orage ! voir tout passer, tout s’évanouir autour de soi ! sentir !… Wilhelm, pour être sincère, je fis alors le serment qu’une femme que j’aimerais, sur laquelle j’aurais des prétentions, ne valserait jamais qu’avec moi, dussé-je périr ! tu me comprends.
Nous fîmes quelques tours de salle en marchant pour reprendre haleine ; après quoi elle s’assit. J’allai lui chercher des oranges que j’avais mises en réserve ; c’étaient les seules qui fussent restées. Ce rafraîchissement lui fit grand plaisir ; mais, à chaque quartier qu’elle offrait, par procédé, à une indiscrète voisine, je me sentais percer d’un coup de stylet.
À la troisième contredanse anglaise, nous étions le second couple. Comme nous descendions la colonne, et que, ravi, je dansais avec elle, enchaîné à son bras et à ses yeux, où brillait le plaisir le plus pur et le plus innocent, nous vînmes figurer devant une femme qui n’était pas de la première jeunesse, mais qui m’avait frappé par son aimable physionomie. Elle regarda Charlotte en souriant, la menaça du doigt, et prononça deux fois en passant le nom d’Albert d’un ton significatif.
« Quel est cet Albert, dis-je à Charlotte, s’il n’y a point d’indiscrétion à le demander ? » Elle allait me répondre, quand il fallut nous séparer pour faire la grande chaîne. En repassant devant elle, je crus remarquer une expression pensive sur son front.
« Pourquoi vous le cacherais-je ? me dit-elle en m’offrant la main pour ta promenade ; Albert est un galant homme auquel je suis promise. » Ce n’était point une nouvelle pour moi, puisque ces dames me l’avaient dit en chemin ; et pourtant cette idée me frappa comme une chose inattendue, lorsqu’il fallut l’appliquer à une personne que quelques instants avaient suffi pour me rendre si chère. Je me troublai, je brouillai les figures, tout fut dérangé ; il fallut que Charlotte me menât, en me tirant de côté et d’autre ; elle eut besoin de toute sa présence d’esprit pour rétablir l’ordre.
La danse n’était pas encore finie, que les éclairs qui brillaient depuis longtemps à l’horizon, et que j’avais toujours donnés pour des éclairs de chaleur, commencèrent à devenir beaucoup plus forts ; le bruit du tonnerre couvrit la musique. Trois femmes s’échappèrent des rangs, leurs cavaliers les suivirent ; le désordre devint général, et l’orchestre se tut. Il est naturel, lorsqu’un accident ou une terreur subite nous surprend au milieu d’un plaisir, que l’impression en soit plus grande qu’en tout autre temps, soit à cause du contraste, soit parce que tous nos sens, étant vivement éveillés, sont plus susceptibles d’éprouver une émotion forte et rapide. C’est à cela que j’attribue les étranges grimaces que je vis faire à plusieurs femmes. La plus sensée alla se réfugier dans un coin, le dos tourné à la fenêtre, et se boucha les oreilles. Une autre, à genoux devant elle, cachait sa tête dans le sein de la première. Une troisième, qui s’était glissée entre les deux, embrassait sa petite sœur en versant des larmes. Quelques-unes voulaient retourner chez elles ; d’autres, qui savaient encore moins ce qu’elles faisaient, n’avaient plus même assez de présence d’esprit pour réprimer l’audace de nos jeunes étourdis, qui semblaient fort occupés à intercepter, sur les lèvres des belles éplorées, les ardentes prières qu’elles adressaient au ciel. Une partie des hommes étaient descendus pour fumer tranquillement leur pipe ; le reste de la société accepta la proposition de l’hôtesse, qui s’avisa fort à propos de nous indiquer une chambre où il y avait des volets et des rideaux. À peine fûmes-nous entrés, que Charlotte se mit à former un cercle de toutes les chaises ; et, tout le monde s étant assis à sa prière, elle proposa un jeu.
À ce mot, je vis plusieurs de nos jeunes gens, dans l’espoir d’un doux gage, se rengorger d’avance et se donner un air aimable. « Nous allons jouer à compter, dit-elle ; faites attention ! Je vais tourner toujours de droite à gauche ; il faut que chacun nomme le nombre qui lui tombe, cela doit aller comme un feu roulant. Qui hésite ou se trompe reçoit un soufflet, et ainsi de suite, jusqu’à mille. » C’était charmant à voir. Elle tournait en rond, le bras tendu. Un, dit le premier ; deux, le second ; trois» le suivant, etc. Alors elle alla plus vite, toujours plus vite. L’un manque : paf ! un soufflet. Le voisin rit, manque aussi ; paf ! nouveau soufflet ; et elle d’augmenter toujours de vitesse. J’en reçus deux pour ma part, et crus remarquer, avec un plaisir secret, qu’elle me les appliquait plus fort qu’à tout autre. Des éclats de rire et un vacarme universel mirent fin au jeu avant que l’on eût compté jusqu’à mille. Alors les connaissances intimes se rapprochèrent. L’orage était passé. Moi, je suivis Charlotte dans la salle, « Les soufflets, me dit-elle en chemin, leur ont fait oublier le tonnerre et tout. » Je ne pus rien lui répondre. « J’étais une des plus peureuses, continua-t-elle ; mais, en
affectant du courage pour en donner aux autres, je suis vraiment devenue courageuse. » Nous nous approchâmes de la fenêtre. Le tonnerre se faisait encore entendre dans le lointain ; une pluie bienfaisante tombait avec un doux bruit sur la terre ; l’air était rafraîchi et nous apportait par bouffées les parfums qui s’exhalaient des plantes. Charlotte était appuyée sur son coude ; elle promena ses regards sur la campagne, elle les porta vers le ciel, elle les ramena sur moi, et je vis ses yeux remplis de larmes. Elle posa sa main sur la mienne, et dit : O Klopstock ! Je me rappelai aussitôt l’ode sublime qui occupait sa pensée, et je me sentis abîmé dans le torrent de sentiments qu’elle versait sur moi en cet instant. Je ne pus le supporter ; je me penchai sur sa main, que je baisai en la mouillant de larmes délicieuses, et de nouveau je contemplai ses yeux… Divin Klopstock ! que n’as-tu vu ton apothéose dans ce regard ! et moi, puissé-je n’entendre plus de ma vie prononcer ton nom si souvent profané !