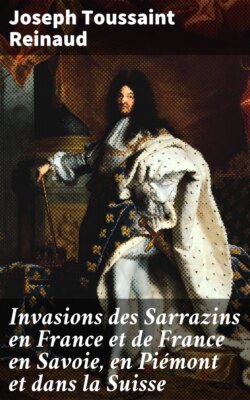Читать книгу Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie, en Piémont et dans la Suisse - Joseph Toussaint Reinaud - Страница 4
PREMIÈRE PARTIE.
ОглавлениеPREMIÈRES INVASIONS DES SARRAZINS EN FRANCE JUSQU’A LEUR EXPULSION DE NARBONNE ET DE TOUT LE LANGUEDOC, EN 759.
Un auteur arabe, racontant la conquête de l’Espagne par ses compatriotes, rapporte d’abord ces paroles, qu’il place dans la bouche de Mahomet: «Les royaumes du monde se sont présentés devant moi, et mes yeux ont franchi la distance de l’Orient et de l’Occident. Tout ce que j’ai vu fera partie de la domination de mon peuple[26].» On put croire, en effet, que tout l’univers allait fléchir sous le joug du prophète. En quelques années, la Mésopotamie, la Syrie, la Perse, l’Égypte et l’Afrique jusqu’à l’Océan atlantique, furent soumises par le glaive. D’une part, les guerriers arabes envahissaient l’Espagne, et, s’avançant à travers la France, menaçaient de subjuguer le reste de l’Europe; de l’autre, franchissant l’Oxus et l’Indus, ils semblaient ne vouloir reconnaître d’autres bornes que celles que la nature elle-même a données à la terre que nous habitons.
Le centre de cet immense empire était en Syrie, dans l’antique ville de Damas. La souveraine puissance, tant pour le spirituel que pour le temporel, se trouvait entre les mains des khalifes ommiades; celui qui régnait alors se nommait Valid.
Les Arabes, en pénétrant dans l’Afrique, avaient rencontré dans l’intérieur, particulièrement dans les chaînes du mont Atlas, d’innombrables tribus nomades, appelées du nom général de Berbers. Ces peuplades, qui avaient successivement défendu leur liberté contre les Carthaginois et les Romains, professaient, les unes le judaïsme, les autres le christianisme, quelques-unes le culte des idoles. La plupart de ces peuplades parlaient une langue particulière appelée le berber, qui subsiste encore. Mais quelques-unes faisaient usage d’un langage qui se rapprochait de l’arabe, de l’hébreu et du phénicien[27], soit que ces tribus fussent des restes des peuples du pays de Chanaan et de la Phénicie qui, du tems de Josué et dans les tems postérieurs, s’embarquèrent pour les parages d’Afrique[28], soit que, comme le disent les plus savans d’entre les écrivains arabes, dans les premiers siècles de notre ère, plusieurs tribus de l’Yémen ou Arabie Heureuse, qui professaient le judaïsme, ayant été obligées de s’expatrier pour échapper aux persécutions des Éthiopiens, alors maîtres de cette partie de la presqu’île, se fussent réfugiées à travers les provinces romaines dans ces régions éloignées[29]: quoi qu’il en soit, ces rapports de langage ne contribuèrent pas peu à hâter les succès des Arabes; et, bien que les Berbers continuassent en général à professer la religion qu’ils avaient suivie jusque-là, ils furent d’un immense secours aux vainqueurs pour les nouvelles conquêtes qu’ils étaient sur le point d’entreprendre. En effet, les uns et les autres étaient habitués à la vie nomade, à une vie dure et sauvage, qui se prêtait admirablement à une guerre d’enthousiasme et de triomphes.
Dès que la puissance des vainqueurs en Afrique commença à être affermie, ils songèrent à traverser le petit détroit qui sépare cette partie du monde de l’Europe. On était alors dans l’année 710. Celui qui gouvernait l’Afrique au nom du khalife s’appelait Moussa, fils de Nossayr. Né dans les dernières années du règne du khalife Omar, Moussa avait pour ainsi dire sucé avec le lait les idées de prosélytisme et de guerre qui caractérisaient l’islamisme. Il était alors âgé de près de quatre-vingts ans; mais il avait encore toute l’ardeur d’un jeune guerrier. Quant à l’Espagne, elle était au pouvoir des Goths, et le prince qui régnait s’appelait Rodéric. La monarchie des Goths, qui comprenait dans ses limites le Roussillon et une partie du Languedoc et de la Provence, renfermait des villes florissantes, des armées nombreuses. Mais l’esprit de faction s’était emparé de chacun, et la corruption générale avait énervé les courages. Il était facile de voir qu’un royaume, en apparence très-puissant, succomberait devant un petit nombre d’enthousiastes et de sectaires, excités par la soif du butin et qui se croyaient envoyés de Dieu même.
Moussa fit faire une première tentative par quelques Berbers, qui, débarquant au lieu où fut bâti plus tard Tharifa[30], parcoururent les côtes de l’Andalousie, enlevant les troupeaux et pillant les villes ouvertes. Comme les Berbers ne rencontrèrent pas de résistance, Moussa, l’année suivante (711), fit partir une nouvelle expédition beaucoup plus nombreuse. Celle-ci, composée de douze mille hommes, presque tous Berbers, était commandée par son affranchi Tharec, fils de Zyad, le même qui donna son nom au rocher de Gibraltar, près duquel il débarqua[31]. Pour les musulmans pieux, la guerre qu’on allait entreprendre devait accroître le nombre des fidèles, et ils s’assuraient à eux-mêmes le paradis; pour ceux qui ne visaient qu’à la gloire, aux richesses ou aux plaisirs, ils entraient dans un pays riche et fertile, où ils trouveraient tout ce qui excite ordinairement les désirs des hommes.
La petite armée de Tharec suffit pour renverser l’armée des Goths. Le roi fut vaincu, et sa tête envoyée comme trophée à la cour de Damas. En moins d’un an, Tharec s’empara de Cordoue, de Malaga et de Tolède. Un écrivain arabe rapporte que, pour inspirer plus de terreur, il avait fait tuer quelques-uns de ses captifs, et après les avoir fait cuire, les avait donnés à manger à ses soldats[32]. Une des principales causes de ces succès sans exemple, ce fut l’appui que les vainqueurs trouvèrent dans les juifs, alors très-nombreux en Espagne. Les juifs étaient impatiens de se venger des vexations auxquelles ils étaient en butte de la part des chrétiens, et d’ailleurs ils voyaient des frères dans une partie des conquérans.
A la nouvelle de progrès si glorieux, Moussa éprouva le désir d’en partager l’honneur. Il accourut du fond de l’Afrique avec une autre armée composée d’Arabes et de Berbers, comptant d’autant plus sur le succès, qu’on remarquait dans ses rangs un des compagnons du prophète, âgé de près de cent ans, et plusieurs enfans des compagnons de Mahomet. Moussa porta ses pas d’un autre côté que son lieutenant, et subjugua successivement Mérida, Saragosse et d’autres cités. Puis se disposant à s’éloigner encore plus du centre de ses forces, il prit avec lui une troupe d’élite armée à la légère. Les fantassins, du reste en petit nombre, ne portaient que leurs armes. Les cavaliers, qui formaient la meilleure portion de l’armée, et qui étaient montés en partie sur les chevaux des vaincus, n’avaient avec leurs armes qu’un petit sac pour les provisions et une écuelle en cuivre. Chaque escadron et chaque bataillon reçut un nombre déterminé de mulets pour le transport des bagages.
Suivant les auteurs arabes, Moussa porta ses courses jusqu’en France. A Narbonne, il trouva dans une église sept statues équestres en argent; et, à Carcassonne, l’église de Sainte-Marie offrit à son avidité sept colonnes d’argent de grandeur colossale[33]. Les Arabes donnent à la France le surnom de grande terre, désignant par là toute la contrée située entre les Pyrénées, les Alpes, l’Océan, l’Elbe et l’empire grec, vaste contrée, qui en effet répond à la France du tems de Charles-Martel, de Pepin, et surtout de Charlemagne, et où, suivant la remarque des auteurs arabes, il se parlait un grand nombre de langues.
Ce qui étonnait le plus les chrétiens, c’était de voir leurs ennemis presque partout en même tems. Quand un pays se soumettait de lui-même, les vainqueurs respectaient les propriétés et le culte établi. Seulement ils s’emparaient d’une partie des églises qu’ils convertissaient en mosquées, et prenaient les richesses des églises, les terres vacantes, et les biens dont les propriétaires s’étaient expatriés: ils s’emparaient également des armes et des chevaux qui leur étaient si utiles dans cette carrière de guerres et d’aventures continuelles; enfin ils imposaient aux habitans un tribut qui variait suivant les circonstances, et ils se faisaient donner des otages comme un garant de fidélité. Pour les pays qui ne s’étaient soumis qu’à la force, ils étaient exposés à toute la violence de la conquête, et le tribut qui leur était imposé s’élevait au double des autres[34]. Quelquefois les vainqueurs jugeaient nécessaire de laisser une garnison; et cette garnison se composait en partie de juifs espagnols dont la haine pour les chrétiens était un gage assuré de dévouement.
Les auteurs arabes ajoutent que le projet de Moussa était de s’en retourner à Damas auprès du khalife son maître, à travers l’Allemagne, le détroit de Constantinople et l’Asie-Mineure, menaçant de ne faire de la mer Méditerranée qu’un grand lac qui aurait servi de voie de communication aux diverses provinces de cet immense empire[35].
Quant aux auteurs chrétiens, ils ne font aucune mention de l’entrée de Moussa en France, et il est probable que cette invasion se borna à quelques légères incursions. Mais il est certain que la chrétienté courait en ce moment le plus grand danger, et l’on frémit à l’idée de ce qui aurait pu arriver, si la discorde ne s’était mise de bonne heure parmi les vainqueurs.
Moussa, dès l’origine de la conquête de l’Espagne, avait vu avec un vif sentiment de jalousie la gloire dont se couvrait son lieutenant Tharec. D’ailleurs il aurait voulu s’approprier la meilleure partie du butin, se réservant de satisfaire, par le don de quelques objets précieux, au précepte de l’Alcoran qui attribue au souverain le cinquième des richesses prises sur l’ennemi. Tharec, au contraire, qui désirait exécuter le précepte dans toute sa rigueur, mettait fidèlement le cinquième du butin à part, et distribuait le reste aux soldats. La querelle en vint au point que le khalife crut devoir appeler les deux rivaux devant son tribunal.
La conquête de l’Espagne et d’une partie du Languedoc s’était faite en moins de deux ans. Moussa choisit pour le remplacer dans les pays subjugués son fils Abd-alazyz, qui fixa sa résidence à Séville, et il le mit sous la surveillance d’un autre de ses fils, à qui il avait donné le gouvernement de l’Afrique. Celui-ci résidait à Cayroan, ville située à quelques journées de Tunis, dans l’intérieur des terres.
Comme Moussa n’avait pas à sa disposition de flotte qui pût le conduire en Syrie, il prit la voie de terre. Traversant le détroit de Gibraltar, il longea la côte d’Afrique jusqu’en Egypte. Il était suivi des otages, au nombre de trente mille, qu’il s’était fait livrer par les peuples vaincus. Parmi ces otages, on remarquait quatre cents personnes choisies dans les familles les plus illustres, et qui, au rapport des auteurs arabes, avaient le droit de porter une ceinture et une couronne d’or. Quant au butin, il était immense. Une partie était portée sur des chars, une autre à dos d’animaux[36].
Le débat entre Moussa et son lieutenant n’était pas encore réglé, lorsque le khalife Valid mourut. On était alors en 715. Soliman, frère et successeur de Valid, qui s’était laissé prévenir contre Moussa, accueillit fort mal le vieux guerrier; et non content de le soumettre à une amende très-forte pour laquelle le vainqueur de l’Espagne fut obligé de recourir à la générosité de ses amis, il déclara une guerre implacable à ses enfans. Abd-alazyz, gouverneur de l’Espagne, après s’être distingué par sa bravoure, se faisait chérir par sa justice et sa douceur envers les vaincus. Mais Abd-alazyz, à l’exemple de plusieurs d’entre ses compagnons, s’était empressé d’épouser une femme du pays. Celle dont il fit choix était la veuve même de Roderic. Ses égards pour son épouse et le soin qu’il avait de ménager les peuples confiés à sa garde, fournirent à ses ennemis un prétexte pour l’accuser d’aspirer au trône. Il fut mis à mort, et sa tête ayant été envoyée dans du camphre à Damas, le khalife ne craignit pas de la montrer à Moussa, que tant d’ingratitude n’avait pas encore fait renoncer à ses projets d’ambition. A ce spectacle, le père, saisi d’horreur, maudit le jour où il avait sacrifié son repos et son sang pour des maîtres aussi barbares, et alla mourir dans son pays, aux environs de Médine. Quant à Tharec, il finit ses jours dans l’obscurité.
Ces événemens jetèrent quelque trouble parmi les conquérans, et leurs progrès durent s’en ressentir. D’ailleurs l’attention du khalife et des Sarrazins d’Asie et d’Afrique était alors portée vers Constantinople, qui était assiégée par une armée de cent vingt mille guerriers et une flotte de dix-huit cent voiles, venue des ports de Syrie et d’Egypte. Cependant les auteurs arabes[37] font mention de quelques nouvelles incursions faites en Languedoc sous le gouvernement d’Alhaor, en 718. Les vainqueurs, d’après leur récit, s’avancèrent jusqu’à Nîmes sans rencontrer d’obstacle, et repassèrent les Pyrénées emmenant captifs un grand nombre de femmes et d’enfans. L’usage était alors dans les armées chrétiennes et mahométanes, et c’est encore l’usage des mahométans de nos jours, que chaque guerrier eût sa part des objets pris sur l’ennemi; et les captifs, par la facilité que les vainqueurs avaient de les employer à leur usage personnel ou de les vendre, formaient en général la portion la plus précieuse du butin.
Les provinces méridionales de la France se trouvaient hors d’état d’opposer une résistance efficace. On était au tems des rois fainéants; le Languedoc, appelé Gothie, à cause du long séjour des Goths, et Septimanie à cause de ses sept principales villes, Narbonne, Nîmes, Agde, Béziers, Lodève, Carcassonne et Maguelone, se trouvait en partie dans la limite des pays échus à Eudes, duc d’Aquitaine. Mais Eudes, qui se glorifiait d’être issu du sang de Clovis, et qui par conséquent était parent des princes du nord de la France[38], voyait avec ombrage l’ascendant que les maires du palais prenaient dans cette partie de l’empire; et toute sa politique consistait à empêcher ces ministres ambitieux de supplanter leurs maîtres. De leur côté, les maires du palais ne songeaient qu’à accroître leur autorité; et d’ailleurs occupés à maintenir la domination des Francs qui s’étendait alors fort loin en Allemagne, ils voyaient avec quelque indifférence les progrès des Sarrazins dans le midi.
Au milieu de ces circonstances, le Languedoc et la Provence, jusque-là au pouvoir des Goths, se trouvaient pour ainsi dire abandonnés à eux-mêmes. La masse de la population, issue des anciens Gaulois et des colons romains, portait encore le nom des antiques maîtres du monde; mais la classe dominante appartenait aux Goths. Les deux races conservaient entre elles une ligne de démarcation, et avaient chacune leurs lois et leurs usages. Il s’était même formé divers partis qui voulaient s’arroger toute l’autorité.
Ce qui défendait le mieux le midi de la France, c’était le désordre qui n’avait pas tardé à se mettre parmi les vainqueurs. On a vu que le gouvernement de l’Espagne relevait du gouvernement de l’Afrique, lequel relevait à son tour du khalifat de Damas. Il était impossible qu’une autorité ainsi partagée, et dont le siége se trouvait dans plusieurs contrées à la fois, maintînt dans le devoir des hommes élevés au milieu du tumulte des armes. La division éclata entre les différens peuples qui avaient pris part à la conquête, entre les Arabes et les Berbers, entre les musulmans et ceux qui ne l’étaient pas. Comme les terres enlevées aux chrétiens avaient été la proie de quelques hommes puissans, les guerriers se plaignirent de n’avoir pas été récompensés dignement de leurs services, et se portèrent plus d’une fois à des violences sanglantes.
Une autre circonstance fort heureuse pour la France, ce fut la résistance que quelques chrétiens d’Espagne commencèrent dès lors à opposer aux oppresseurs de leur patrie. Une poignée de guerriers, fidèles à leur culte et à leur pays, se réfugièrent dans les montagnes des Asturies, de la Galice et de la Navarre, et là, sous la conduite de Pélage, entreprirent une lutte qui ne devait finir qu’à l’entière expulsion des disciples du prophète[39].
Le nouveau khalife de Damas, Omar, fils d’Abd-alazyz, s’étant fait instruire de l’état des choses, choisit, pour remédier à ces maux, Alsamah, qui s’était fait remarquer en Espagne par son zèle et ses talens. Alsamah, également célèbre comme administrateur et comme guerrier, était chargé de rétablir l’ordre dans les finances et de donner satisfaction aux troupes. En effet, des terres considérables, provenant des dernières conquêtes, leur furent distribuées, et le reste des biens fut confié à des hommes intègres qui devaient en verser le revenu dans le trésor public. Alsamah avait de plus ordre de faire un recensement exact des pays subjugués, et d’en indiquer la population respective et les ressources[40].
Le khalife, qui était très-pieux, et qui s’effrayait du grand nombre de personnes restées fidèles à leur ancienne religion, aurait voulu qu’on forçât tous les chrétiens de l’Espagne et de la Septimanie à quitter leur patrie, et à venir dans le centre de l’empire, où leur présence n’inspirerait pas les mêmes craintes. Alsamah rassura le prince, en disant que le nombre des nouveaux musulmans s’accroissait chaque jour, et que bientôt l’Espagne ne reconnaîtrait plus d’autres lois que celle de Mahomet. Les auteurs arabes, de qui nous empruntons ce récit, et qui écrivaient à une époque où les chrétiens, descendus de leurs montagnes, avaient commencé à se répandre dans les provinces méridionales de l’Espagne, déplorent la faiblesse d’Alsamah, et regrettent que la pensée du khalife n’eût pas été mise à exécution[41].
Enfin Alsamah avait ordre de ranimer parmi les guerriers le zèle contre les chrétiens un peu refroidi, depuis que tant d’ambitions étaient parvenues à se satisfaire. Il devait présenter la guerre sacrée comme l’action la plus agréable à Dieu, comme la source de toutes les faveurs célestes en cette vie et en l’autre.
Dès que l’ordre eut été rétabli, Alsamah résolut de signaler son ardeur par quelque exploit éclatant. Il aurait pu tourner ses efforts contre les chrétiens retranchés dans les montagnes du nord de l’Espagne, et les accabler avant qu’ils eussent le tems de s’y fortifier; il préféra se porter en France, se flattant d’exécuter ce que n’avait pu accomplir Moussa. On était alors en 721, sous le règne du khalife Yezyd: onze ans s’étaient écoulés depuis la première entrée des Arabes en Espagne. C’est à ce moment que les chroniqueurs français commencent à parler des bandes sarrazines et de leur chef, qu’ils appellent Zama. D’après leur récit, les Sarrazins venaient accompagnés de leurs femmes et de leurs enfans, dans l’intention d’occuper le pays. En effet, il arrivait continuellement en Espagne des familles pauvres d’Arabie, de Syrie, d’Égypte et d’Afrique, et les chefs comptaient sur les conquêtes futures pour satisfaire des besoins si nombreux[42].
Alsamah, à l’exemple de ses prédécesseurs, s’avança dans le Languedoc, et forma le siége de Narbonne, qui sans doute avait été fortifiée dans l’intervalle. La ville ayant été obligée d’ouvrir ses portes, les hommes furent passés au fil de l’épée, les femmes et les enfans emmenés en esclavage. Narbonne, par sa situation près de la mer et au milieu de marais, offrait un accès facile aux navires qui venaient d’Espagne, et était en état, du côté de terre, d’opposer une longue résistance. Alsamah résolut d’en faire la place d’armes des musulmans en France, et il en augmenta les fortifications. Il fit de plus occuper les villes voisines; puis il marcha du côté de Toulouse. Cette ville était alors la capitale de l’Aquitaine. Eudes, craignant pour sa capitale, accourut avec toutes les troupes qu’il put rassembler. Les Sarrazins avaient commencé le siége de la ville, et ils mettaient en usage les machines qu’ils avaient apportées. De plus, avec leurs frondes, ils cherchaient à repousser les habitans de dessus les remparts; la ville était sur le point de se rendre lorsque Eudes arriva. Au rapport des auteurs arabes, telle était la multitude des chrétiens, que la poussière soulevée par leurs pas obscurcissait la lumière du jour. Alsamah, pour rassurer les siens, leur rappela ces paroles de l’Alcoran: «Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Les deux armées, ajoutent les Arabes, s’avancèrent l’une contre l’autre avec l’impétuosité de torrens qui se précipitent du haut des montagnes, ou comme deux montagnes qui cherchent à se rencontrer. La lutte fut terrible et le succès long-tems incertain. Alsamah se montrait partout; semblable à un lion que l’ardeur anime, il excitait les siens de la voix et du geste, et on reconnaissait son passage aux longues traces de sang que laissait son épée; mais pendant qu’il se trouvait au plus épais de la mêlée, une lance l’atteignit et le renversa de cheval. Les Sarrazins l’ayant vu tomber, le désordre se mit dans leurs rangs, et ils se retirèrent laissant le champ de bataille couvert de leurs morts. Cette bataille se donna au mois de mai de l’année 721, et il y périt un grand nombre d’illustres Sarrazins, notamment de ceux qui avaient eu part aux conquêtes précédentes[43]. Abd-alrahman, appelé par nos vieilles chroniques Abdérame, prit le commandement des troupes, et les ramena en Espagne.
Ce succès rendit le courage aux chrétiens du Languedoc et des Pyrénées, qui se hâtèrent de secouer le joug. Malheureusement les Sarrazins restaient maîtres de Narbonne, et de cette place avancée, ils avaient la facilité de faire des courses dans les contrées voisines. Des secours leur ayant été envoyés d’Espagne, ils reprirent l’offensive, et mirent presque tout le Languedoc à feu et à sang.
A cette époque, le clergé était tout-puissant, et les églises et les monastères passaient pour receler de grandes richesses. Les Sarrazins devaient d’ailleurs décharger de préférence leur fureur sur ces asiles de la piété, comme sur des lieux d’où partait le plus souvent le signal de la résistance. D’un autre côté, les courts récits qui nous sont parvenus sur cette déplorable partie de notre histoire sont en général l’ouvrage des moines et des ecclésiastiques. Il n’est donc pas étonnant que les églises et les couvens figurent presque exclusivement dans les récits lamentables qu’ils nous ont transmis de cette époque.
Des documens qui remontent à une assez haute antiquité, font mention de la destruction du monastère de Saint-Bausile, près de Nîmes, du couvent de Saint-Gilles, près d’Arles, là où a été bâtie plus tard une ville du même nom, de la riche abbaye de Psalmodie, aux environs d’Aiguemortes. Ce dernier monastère était, dit-on, ainsi appelé, parce que les moines s’étaient imposé pour règle de chanter jour et nuit et à tour de rôle les louanges du Seigneur. L’arrivée des Sarrazins fut si précipitée, que, dans ces divers couvens, les moines eurent à peine le tems de se retirer ailleurs, et d’emporter avec eux les reliques des saints[44]. Les barbares avaient soin de briser les cloches des églises ou plutôt les instrumens analogues avec lesquels on était alors dans l’usage d’appeler les fidèles à la prière[45].
Sans doute les Sarrazins rencontrèrent de la part des habitans quelque résistance, ou bien les incursions étaient l’ouvrage de quelques bandes isolées. Il est certain qu’en général les Sarrazins n’avaient pas exercé les mêmes violences dans les pays qui s’étaient soumis de plein gré.
En 724, le nouveau gouverneur d’Espagne, Ambissa, franchit lui-même avec une nombreuse armée les Pyrénées, et résolut de pousser la guerre avec vigueur. Carcassonne fut prise et livrée à toute la fureur du soldat. Nîmes ouvrit ses portes, et des otages choisis parmi ses habitans furent envoyés à Barcelonne pour y répondre de leur fidélité[46]. Les conquêtes d’Ambissa, suivant Isidore de Beja, furent plutôt l’ouvrage de l’adresse que de la force; et telle fut l’importance de ces conquêtes, que sous le gouvernement d’Ambissa l’argent enlevé de la Gaule fut le double de ce qui en avait été retiré les années précédentes[47]. Le cours de ces dévastations fut un moment ralenti par la mort d’Ambissa, qui fut tué dans une de ses expéditions, en 725; son lieutenant, Hodeyra, fut obligé de ramener l’armée sur la frontière; mais bientôt la guerre reprit avec une nouvelle fureur, et de grands secours étant venus d’Espagne, les chefs, enhardis par le peu de résistance qu’ils rencontraient, ne craignirent pas d’envoyer des détachemens dans toutes les directions. Le vent de l’islamisme, dit un auteur arabe, commença dès-lors à souffler de tous les côtés contre les chrétiens. La Septimanie jusqu’au Rhône, l’Albigeois, le Rouergue, le Gévaudan, le Velay, furent traversés dans tous les sens par les barbares, et livrés aux plus horribles ravages. Ce que le fer épargnait était livré aux flammes. Plusieurs d’entre les vainqueurs eux-mêmes furent indignés de tant d’atrocités. Les barbares ne conservaient que les objets précieux qu’ils pouvaient emporter, ou les armes, les chevaux, et ce qui, en épuisant le pays, devait accroître leurs forces.
Parmi les lieux qui eurent le plus à souffrir de ces dévastations, on cite le diocèse de Rhodès. Les barbares s’étaient établis dans un château-fort, que les uns croient répondre à celui de Roqueprive, et les autres à celui de Balaguier[48]. Aidés par des hommes du pays, ils parcouraient impunément tous les environs. Il nous reste à ce sujet le témoignage d’un poète qui écrivait au commencement du neuvième siècle, et ce témoignage est trop important pour que nous ne l’insérions pas ici. Il y est parlé d’un jeune homme appelé Datus ou Dadon, qui, à l’approche des Sarrazins, avait pris les armes, et qui, laissant sa mère seule, s’était retiré à quelque distance avec les guerriers du pays. Pendant son absence, les barbares envahirent sa maison, et après avoir tout dévasté, ils se retirèrent emmenant sa mère et le reste du butin dans leur château-fort. A cette nouvelle, Dadon accourt avec quelques-uns de ses compagnons; il était monté sur un cheval, et armé de pied en cap. Ici nous allons laisser parler le poète.
«Dadon et ses amis étaient disposés à forcer l’entrée du château; mais de même que le cruel épervier, après avoir enlevé le timide oiseau qui s’était aventuré dans les airs, se retire avec sa proie et laisse les compagnons de sa victime faire retentir le ciel de leurs gémissemens, de même les Maures, tranquilles à l’abri de leurs remparts, se rient des menaces de Dadon et de ses efforts. A la fin, cependant, un d’entre eux adresse la parole à Dadon, et, d’un ton railleur, lui demande ce qui l’a amené. «Si, ajoute-t-il, si tu veux que nous te rendions ta mère, donne-nous le cheval sur lequel tu es monté; sinon ta mère va être égorgée sous tes yeux.» Dadon, irrité, répond qu’on peut faire de sa mère ce qu’on voudra, que jamais il ne cèdera son cheval. Là-dessus le barbare amène la mère de Dadon sur le rempart, et lui coupant la tête, il la jette au fils en disant: «Voilà ta mère!» A ce spectacle, Dadon recule d’horreur. Il pleure, il gémit, il court ça et là en criant vengeance; mais comment forcer l’entrée de la forteresse?» A la fin, il s’éloigne, et, disant adieu au monde, il se retire dans une solitude sur les bords du Dourdon, dans le lieu où s’éleva plus tard le monastère de Conques[49].
Un autre fait, en l’absence de témoignages plus nombreux, servira encore à faire connaître le caractère des épouvantables invasions auxquelles une grande partie de la France fut alors en proie; c’est ce qui arriva au monastère du Monastier, dans le Velay. Les Sarrazins avaient envahi les diocèses du Puy et de Clermont, et dévasté l’église de Brioude[50]. Les barbares, approchant du Monastier, saint Théofroi, autrement appelé saint Chaffre, abbé du monastère, assembla ses moines, et les exhorta à se retirer dans les bois des environs avec ce que le couvent renfermait de plus précieux, et à y rester jusqu’à ce que des tems meilleurs leur permissent de reprendre leurs anciennes occupations; pour lui, il déclara qu’il était décidé à subir les traitemens que les barbares voudraient lui faire éprouver, heureux si par ses exhortations il pouvait les ramener dans la bonne voie; plus heureux encore si, par sa mort, il obtenait la palme du martyre. A ces mots, les moines se mirent à fondre en larmes, demandant qu’il s’enfuît avec eux dans la forêt, ou qu’il leur permît de mourir avec lui; mais le saint persista dans sa résolution, et, pour ce qui les concernait, il leur représenta qu’il était plus conforme à la volonté divine de se dérober à un danger qu’on pouvait éviter, lorsque surtout on avait l’espoir de se rendre plus tard utile à la religion. Là-dessus il leur cita l’exemple de saint Paul, qui, étant poursuivi à Damas par les juifs, ses ennemis, se fit descendre la nuit dans une corbeille hors des murs de la ville; ainsi que celui de saint Pierre, qui, en butte aux fureurs de Néron, eut également pris la fuite, si Dieu lui-même n’était venu à sa rencontre pour arrêter ses pas. Pour ce qui le regardait personnellement, il fit voir qu’il était quelquefois du devoir d’un pasteur de se dévouer pour le salut de son troupeau; que peut-être il aurait le bonheur d’ouvrir les yeux des barbares à la vérité, et que s’il était mis à mort, son sang désarmerait la colère céleste, irritée sans doute par les péchés des hommes.
A la fin les moines se résignèrent, et leur départ fut fixé pour le lendemain. Après qu’ils eurent entendu la messe, l’abbé leur fit une nouvelle exhortation; ensuite ils se chargèrent des objets les plus précieux du couvent, et s’éloignèrent. Deux d’entre eux seulement restèrent secrètement, et allèrent se placer au haut d’une montagne qui domine le monastère, afin d’être témoins de ce qui arriverait.
Les barbares ne tardèrent pas à se présenter. Comme l’abbé s’était retiré dans un coin, occupé à prier Dieu, ils ne firent aucune attention à lui, et se mirent à visiter le monastère, espérant faire un riche butin. Leur projet était de s’emparer des moines les plus jeunes et les plus vigoureux, et de les vendre en Espagne comme esclaves. Quand ils reconnurent que les moines étaient partis, et que les objets les plus précieux avaient été enlevés, ils entrèrent en fureur, et l’abbé s’étant enfin offert à leurs yeux, ils l’accablèrent de coups.
Ce jour-là était pour les barbares un jour de fête, où ils avaient coutume d’offrir un sacrifice à Dieu. Le chroniqueur d’après lequel nous parlons ne dit pas en quoi consistait ce sacrifice. Il paraît seulement qu’il consistait en libations; d’où on pourrait induire que la bande sarrazine qui envahit le Velay n’était pas mahométane, mais se composait de Berbers, dont plusieurs étaient encore plongés dans les ténèbres de l’idolâtrie. Quoi qu’il en soit, les barbares s’étant retirés à l’écart pour s’acquitter de leurs devoirs religieux, le saint, qui s’en aperçut, crut que c’était une occasion favorable pour les faire rentrer en eux-mêmes. Là-dessus, il s’approcha d’eux, et leur représenta qu’au lieu de se prostituer ainsi au culte des démons, ils feraient bien mieux de réserver leurs hommages pour l’auteur de toutes choses, pour celui qui a créé les élémens et tout ce qui existe. Mais cette exhortation ne fit que redoubler la fureur des barbares; ils tournèrent leur rage contre lui, et l’homme qui célébrait le sacrifice, saisissant un gros caillou, le lui jeta à la tête, et le fit tomber par terre presque sans vie. Les Sarrazins se disposaient même à mettre le feu au monastère, et à n’y pas laisser pierre sur pierre, lorsqu’on annonça l’approche de troupes chrétiennes, ou plutôt, si on en croit l’auteur d’après lequel nous parlons, lorsque le Seigneur, justement irrité d’un tel attentat, suscita une horrible tempête, accompagnée de grêle et de tonnerre, qui força les barbares à prendre la fuite. Le saint mourut quelques jours après; mais les moines purent revenir en toute sûreté[51].
C’est probablement à la même époque, bien que les écrivains arabes ne s’expriment pas clairement, et que les auteurs chrétiens varient entre eux, qu’il faut placer l’invasion des Sarrazins en Dauphiné, à Lyon et dans la Bourgogne. Un écrivain mahométan s’exprime ainsi: «Dieu avait jeté la terreur dans le cœur des infidèles. Si quelqu’un d’eux se présentait, c’était pour demander merci. Les musulmans prirent du pays, accordèrent des sauvegardes, s’enfoncèrent, s’élevèrent, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent à la vallée du Rhône. Là, s’éloignant des côtes, ils s’avancèrent dans l’intérieur des terres[52].»
On ne connaît les lieux où pénétrèrent les Sarrazins que par les souvenirs des dégâts qu’ils y commirent. Aux environs de Vienne, sur les bords du Rhône, les églises et les couvens n’offrirent plus que des ruines. Lyon, que les arabes appellent Loudoun, eut à déplorer la dévastation de ses principales églises[53]; Mâcon et Châlons-sur-Saône furent saccagées[54]; Beaune fut en proie à d’horribles ravages; Autun vit ses églises de Saint-Nazaire et de Saint-Jean livrées aux flammes; le monastère de Saint-Martin, auprès de la ville, fut abattu[55]; à Saulieu, l’abbaye de Saint-Andoche fut pillée[56]; près de Dijon, les Sarrazins abattirent le monastère de Bèze[57].