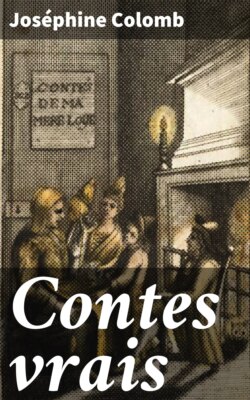Читать книгу Contes vrais - Josephine Colomb - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOUVELLE
ОглавлениеQuand j’étais enfant, assez grand portant pour me permettre d’avoir mon opinion sur les choses de ce monde, je tenais le village de Katzenbach pour le plus joli village qu’il y eût dans toute l’Alsace. A la vérité, j’étais loin de connaître toute l’Alsace; je n’y connaissais même que le village de Katzenbach, deux ou trois autres bourgs ou hameaux où j’avais des parents, et un peu Phalsbourg, où j’avais accompagné mon père deux ou trois fois. Mais Katzenbach était si riant, avec sa vieille église au porche moussu et à la flèche grise, et ses maisons à toits rouges, disséminées entre les vergers, les potagers et les bouquets d’arbres! Quand on le regardait d’un peu loin, étalé sur la pente de la colline, avec son ruisseau qui serpentait au soleil, on ne pouvait pas s’empêcher d’avoir le cœur épanoui; et si, comme moi, on y était né, on pouvait bien penser et dire qu’il n’y avait pas dans toute l’Alsace un plus joli village que Katzenbach.
C’est donc à Katzenbach que je suis né et que j’ai grandi, entre mon père, ma mère et mes deux petites sœurs Gredel et Louison. Nous n’étions pas riches, quoique mon père fût propriétaire de sa maison et de son jardin; mais la maison était si petite, et le jardin produisait si peu de chose! Ma mère s’occupait du ménage; elle lavait, repassait, racommodait tous les vêtements et le linge de la maison, et, comme nous n’en avions guère, il fallait le raccommoder sans cesse. Mon père allait en journée; il n’était pas difficile sur l’ouvrage et acceptait toute besogne honnête, pourvu qu’il y gagnât notre pain: bûcheron, jardinier, carrossier, charretier, casseur de cailloux, il était tout ce qu’on voulait. Mes sœurs faisaient ce qu’elles pouvaient; moi, j’étais chargé de faire pousser des légumes dans le jardin, pour qu’on ne fût pas obligé d’en acheter. Je n’y réussissais pas beaucoup; peut-être que le terrain ne valait rien, ou bien que je ne savais pas m’y prendre; ce qu’il y a de plus sûr, c’est que mes produits n’auraient pas été admis dans une exposition. Cela me contrariait un peu; mais je n’avais pas de goût pour le jardinage. J’aimais mieux me servir de clous, de marteaux et de scies que de bêches et de râteaux; je récoltais soigneusement le moindre bout de planche, la plus petite latte, et je trouvais toujours moyen d’en faire quelque chose. Je dois même dire que j’étais fort aise lorsqu’un escabeau perdait un de ses pieds, que la porte vermoulue du poulailler menaçait de livrer passage aux chiens ou aux chats, ou que la barrière du jardin, pourrie. par la pluie, tombait en ruine. Je prenais mes outils, parmi lesquels mon couteau était encore le moins mauvais, et je mesurais, je taillais, j’ajustais, je clouais, je collais: en quelques instants, le malheur était réparé.
On a bien raison de dire que nos passions nous mènent. Pour me rapprocher de maître Zahn, le menuisier du village, j’avais fait amitié, à l’école, avec son fils Georges, un chenapan bête comme une oie et paresseux comme un loir, avec qui personne ne voulait jouer, parce qu’il était aussi mauvais camarade que mauvais écolier. Le père Zahn me recevait très bien au commencement; il était flatté de l’attention avec laquelle je le regardais travailler, et il me mettait lui-même le rabot ou la scie en main, pour donner de l’émulation à son fils. Et tout le temps que je maniais les outils, j’avais le plaisir de l’entendre dire: «Très bien, Fritz! bon coup de rabot... Tu manies la gouge comme un apprenti de deux ans ne le ferait pas... Là ! voilà un angle bien taillé... Est-il adroit; ce gaillard-là ! Ce n’est pas toi qui en ferais autant, grand nigaud! Voyez-moi ce garçon-là, qui est né dans la menuiserie, et qui tient sa planche comme si c’était la queue de la poêle! Regarde Fritz, animal, et tâche de faire comme lui: ça n’est pas son métier, pourtant! Ah! le père Wirth est bien heureux d’avoir un enfant comme Fritz!»
Les éloges répétés du menuisier firent éclore dans mon cerveau des idées bien ambitieuses. Au lieu d’être, comme mon père, un journalier qui n’est pas toujours sûr de trouver de l’emploi, pourquoi ne serais-je pas menuisier? Maître Zahn ne refuserait peut-être pas de me prendre en apprentissage; et plus tard, si Georges continuait à ne pas mordre au métier, pourquoi ne serait-ce pas moi qui succéderais au père Zahn? Voilà qui serait bien! Je bâtirais dans notre jardin, au bout, là où la terre est si mauvaise et où l’on ne peut presque rien faire pousser, un beau hangar qui me servirait d’atelier; plus tard, quand j’aurais assez d’argent, je le fermerais avec des vitrages. Ce serait superbe! ma mère y viendrait tricoter, quand elle aurait fini le ménage, et je chanterais en travaillant pour la distraire. Je gagnerais beaucoup d’argent, plus que le père Zahn, qui ne passe pas pour bien habile; je doterais Gredel et Louison, et je leur trouverais de bons maris. Comme on danserait à leur noce! Où danserait-on? Dans l’atelier? Oui, ce serait bien; mais je crois pourtant que la grande salle du père Lormann, l’aubergiste du Grand-Saint-Antoine, conviendrait encore mieux, avec son papier à bouquets rouges et bleus, et sa belle pendule dorée qui représente saint Antoine et son compagnon. Quelle occasion pour mon père de mettre le bel habit!
Le bel habit! Remarquez que je ne dis pas: son bel habit. C’est que le bel habit, qui comprenait une culotte, un gilet et un tricorne, était chez nous une partie notable du patrimoine de la famille. Il appartenait bien à mon père, puisque c’était lui qui le portait dans les grandes occasions; mais avant d’être à lui, il avait été à mon grand-père, qui l’avait mis pour la dernière fois, je m’en souvenais bien, au repas de baptême de Louison. Il me semblait même que le bel habit avait rajeuni tout d’un coup, en quittant le vieux corps courbé et amaigri de mon grand-père pour venir habiller mon père, qui n’avait que quarante ans et qui se tenait droit comme un des sapins de la forêt. Enfin, tout ce beau costume de l’ancien temps, avec ses couleurs vives, ses grands boutons de métal brillant, sa coupe antique et ses étoffes inusables, avait appartenu aux Wirth depuis qu’il y avait des Wirth à Katzenbach. Et même sa beauté et sa solidité affirmaient, d’une façon irréfutable, la décadence des Wirth: fallait-il qu’il fût riche, le Wirth d’autrefois qui s’était fait faire un costume pareil! Ce n’était pas mon père, assurément, qui aurait pu se permettre une telle dépense.
A vrai dire, il n’y songeait pas: le bel habit était plus respectable à ses yeux que s’il avait été neuf. C’était son trésor, son orgueil; c’était le plus ancien costume alsacien qui se trouvât dans le pays, et il témoignait du rang que les Wirth avaient occupé dans le monde: il y a bien des titres de noblesse qui ne valent pas celui-là. Quand mon père passait en vêtements de travail, certes personne n’eût manqué de le saluer ou de répondre à son salut: il était estimé comme un honnête homme doit l’être; mais il y avait. une nuance de respect dans la manière dont les gens lui ôtaient leur chapeau quand il portait l’antique vêtement de ses aïeux; c’était tout le passé d’une longue suite de braves gens, pleins de probité et d’honneur, qu’on saluait en lui ce jour-là. Il le sentait bien, et il tenait au bel habit comme à la prunelle de ses yeux.
J’y tenais beaucoup aussi; c’était une tradition de famille. Mes petites sœurs partageaient mon admiration pour la douceur du velours, pour l’éclat des boutons, pour les broderies du grand gilet, pour l’ampleur majestueuse du tricorne; et elles touchaient toutes les pièces du costume respectueusement, du bout des doigts, quand ma mère les sortait de l’armoire pour leur donner de l’air; seulement, le bel habit ne serait jamais pour elles qu’un spectacle. Mais moi, moi qui étais destiné par ma naissance à avoir un jour l’honneur insigne de le porter? il me semblait déjà être un homme quand je le regardais.
Je grandissais donc entre le culte du bel habit et la passion de la menuiserie; et quand j’eus treize ans, et qu’il fut question de me faire apprendre, un métier, je suppliai mon père de me faire entrer en apprentissage chez le père Zahn, au lieu de me mettre chez maître Kalb, le boucher du village, comme il en avait envie.
Mon père fut un peu contrarié ; il trouvait la profession de boucher plus lucrative que celle de menuisier; et puis, maître Kalb se faisait vieux et n’avait pas d’enfants: qui sait s’il ne me laisserait pas son fonds un jour? Au lieu que Georges Zahn était là qui ne manquerait pas de succéder à son père; et sûrement il n’y aurait jamais à Katzenbach de l’ouvrage pour deux menuisiers: c’est tout au plus s’il y en avait pour un seul. Pourtant mon père céda; et, jugeant que la démarche était fort solennelle, il mit le bel habit pour se rendre chez maître Zahn.
Ce n’était pas la peine, en vérité ! Maître Zahn suffisait à sa besogne; il avait déjà son fils et n’avait pas besoin d’un autre apprenti; enfin il refusa net de me prendre. Il maugréait pourtant bien assez, huit jours auparavant, sur le départ de son ouvrier, qui était allé se fixer à Phalsbourg; mais il aimait encore mieux faire son ouvrage tout seul ou avec l’aide maladroite de Georges que de me prendre chez lui. Il savait bien que je serais un ouvrier habile quand Georges ne serait encore qu’un mauvais apprenti; et il craignait qu’alors je ne vinsse à m’établir à Katzenbach et à enlever toute la clientèle de son fils.
Je devinais bien un peu ses motifs, mais l’orgueil que j’en ressentais ne me consolait pas. Mon rêve de menuiserie était fini! Je ne pouvais pas demander à mon père de me mettre en apprentissage à la ville; cela coûtait trop cher. Je lui dis donc en soupirant que j’étais prêt à entrer chez maître Kalb; mais je pleurai toute la nuit au lieu de dormir. J’aimais les besognes propres, et la boucherie me déplaisait souverainement; et puis j’avais le cœur tendre, et je ne pouvais pas seulement me décider à tuer un lapin: que serait-ce quand il faudrait assommer un bœuf? Bien sûr, je n’avais pas la vocation pour être boucher.
Mon père comprit sans doute ma répugnance, car il laissa passer plusieurs jours sans me reparler d’apprentissage.
On était alors au mois d’octobre, et mon père partit, avant d’avoir rien décidé à mon égard, pour s’en aller, comme il faisait tous les ans, scier et ranger le bois de chauffage chez M. le comte de Rieuwy: il avait là de l’ouvrage pour plusieurs jours, et on le payait bien, sans compter qu’on lui donnait une petite provision de bois, et qu’on lui prêtait même une charrette et un cheval pour l’amener chez nous. Le château de Rieuwy était à huit lieues de Katzenbach.
Pendant que mon père était absent, nous, reçûmes une singulière visite. Gredel et Louison, qui jouaient sur la route, accoururent tout essoufflées, criant à la fois: «Maman, Fritz! la carriole du vieux Israël! la carriole du vieux Israël!»
Ma mère en laissa tomber le chou qu’elle tenait (nous étions en train de tailler des choux pour la choucroute de l’hiver), et je courus à la porte pour voir si les petites filles ne se trompaient point. Ce n’était pas que le vieux Lévi Israël, le brocanteur de Phalsbourg, fût par lui-même un être bien extraordinaire; il faisait deux tournées par an, jamais plus, jamais moins, une à Pâques et une à la Saint-Michel; celle de la Saint-Michel était passée, il y avait quinze jours, et certes les ménagères de Katzenbach n’avaient plus rien à lui vendre. Il achetait de tout, le vieux Lévi Israël, les bijoux qui valaient des milliers d’écus, et des chiffons à deux liards la livre; il emportait son butin dans sa vieille maison, derrière la halle de Phalsbourg, et là, il triait, rangeait, étiquetait et vendait avec de bons profits, à ce qu’il paraît, car il avait richement établi ses garçons et marié ses filles. C’était un fort honnête homme, malgré ses manières de grippe-sou, et on ne pouvait pas dire qu’il eût jamais rien pris à personne. Les gens qui lui avaient vendu dix écus un vieux bouquin mangé des vers ou un vieux bahut à moitié pourri, et qui apprenaient un beau jour qu’il l’avait revendu cinq cents francs, jetaient les hauts cris et l’appelaient voleur: je trouve, moi, qu’ils avaient tort. Ne s’étaient-ils pas estimés bien heureux de recevoir ses dix écus pour un objet dont ils ne faisaient rien, et qu’ils n’auraient pas voulu payer vingt sous s’ils l’avaient rencontré chez lui! Ils avaient cru faire une bonne affaire, et ils l’avaient faite réellement: tant mieux pour lui s’il connaissait la valeur des choses et s’il savait en tirer parti. A la maison, nous le recevions toujours très bien: il nous débarrassait des vieux os, des vieux chiffons et des vieux papiers et il nous payait encore pour cela! Ce n’est pas nous qui l’aurions appelé voleur.
C’était bien sa carriole qui approchait, traînée par sa vieille jument blanche, et c’était bien lui qui était dans sa carriole: je voyais briller ses grandes lunettes au-dessus de son nez crochu et de sa barbe grise. Quand il fut près de notre maison, il avança la tête, et me voyant sur la porte, il arrêta sa jument.
«Eh! bonjour, Fritz! tout le monde va bien?
— Très bien, monsieur Israël, et vous?
— Moi aussi, mon ami, moi aussi... Ton père est à la maison?
— Non, monsieur Israël; mais la mère y est, et les petites sœurs aussi. Voulez-vous entrer vous rafraîchir?
— Hé ! ça n’est pas de refus: nous sommes un peu las, n’est-ce pas, Trotteuse? et nous avons encore du chemin à faire. Je vais demander un pot de bière à Mme Wirth, et laisser reposer un peu Trotteuse. Oh! il n’y a pas besoin de rester à la tenir: il n’y a pas de risque qu’elle s’en aille!»
Il descendit de sa carriole et se retourna pour tendre la main à quelqu’un que je n’avais pas vu. Un pied chaussé de souliers plus fins que ceux du père Israël se posa sur le marchepied; à ce pied tenait une jambe contenue dans un pantalon gris; puis un corps apparut, et ce corps habitait une redingote et un gilet de beau drap noir; sur le gilet brillait une belle chaîne d’or. Quand l’homme tout entier se trouva debout à côté du vieux Lévi Israël, je vis que c’était un vieux monsieur de la ville, un monsieur riche certainement, et je me demandai si notre bière allait être assez bonne pour lui.
Le vieux Lévi Israël était toujours très poli, mais je crois que ce jour-là il le fut encore plus qu’à l’ordinaire. Il fit des compliments à ma mère sur sa bière, sur sa choucroute, à propos des choux qu’elle taillait; sur ses enfants, sur son mari, sur sa maison, sur son jardin (il fallait qu’il eût bien envie de faire des compliments). Ensuite, il passa à l’éloge du pays, et de Katzenbach en particulier, en invoquant à tout propos le témoignage de son compagnon. Notre vallée était la plus belle vallée de l’Alsace, notre clocher le plus joli clocher qu’on pût voir, et Katzenbach le plus joli village de la vallée: un peu plus, ils auraient trouvé que notre maison était la plus jolie maison de Katzenbach. Du moins, elle était bâtie à l’ancienne mode, ce qui plaisait beaucoup au vieux monsieur; et il déclara que Katzenbach lui faisait tout à fait l’effet d’un village de l’ancien temps. C’était bien dommage qu’il ne fût pas peuplé de gens habillés à la mode d’autrefois; malheureusement les anciens costumes disparaissaient, et on n’en voyait plus du tout.
Ici, le vieux Lévi Israël interrompit son compagnon. Il y avait encore, dit-il, dans certaines familles, des costumes alsaciens que l’on conservait précieusement et qu’on portait dans les grandes occasions: ainsi, il lui semblait se rappeler qu’il y en avait un chez nous, très complet et comme neuf. Ma mère hocha la tête d’un air fier, et je me rengorgeai; le monsieur demanda alors si Mme Wirth voudrait bien consentir à le lui montrer. Ma mère y consentit sans se faire prier, et le bel habit sortit de l’armoire, avec ses boutons enveloppés de papier de soie; il y avait aussi des feuilles de papier cousues sur les broderies du gilet pour empêcher l’air et la poussière de les faner.
Le vieux monsieur regarda, palpa d’un air de connaisseur toutes les pièces du costume; et je pensais en moi-même que mon père serait joliment content s’il voyait son admiration. C’était du vrai; c’était du beau; c’était du solide; il n’y manquait rien, on n’en trouvait nulle part d’aussi bien conservés; cela avait une grande valeur, et si on voulait le vendre...
«Le vendre! s’écria ma mère, vendre le bel habit! Jamais mon mari ne le vendra, monsieur, c’est l’héritage de ses ancêtres. Le vendre!»
Et, tout effarouchée, elle se mit à renvelopper les boutons, un à un, dans leur papier de soie, en regardant d’un air de défiance l’étranger et le vieux Lévi Israël. Tous les deux s’excusèrent du dérangement qu’ils lui avaient causé, et, s’apercevant tout à coup qu’il se faisait tard, ils remontèrent dans la carriole. Israël dit: «Hop, Trotteuse!» et fit claquer son fouet; Trotteuse fit un effort, la carriole s’ébranla et disparut bientôt au tournant de la route.
Le lendemain, quand mon père revint, on ne manqua pas de lui raconter la visite du vieux brocanteur et du beau monsieur qui avait tant admiré le bel habit; même, comme nous étions quatre, il l’entendit quatre fois: chacun de nous se rappelait quelque détail oublié et recommençait, toute l’histoire pour pouvoir le loger à sa place. Il ne parut pas y prendre grand plaisir; même, je remarquai qu’il était plus soucieux qu’à l’ordinaire; il fumait sa pipe sans rien dire, d’un air triste, et il ne jouait pas même avec la petite Louison, sa favorite; mais cela ne pouvait pas être la faute de Lévi Israël, en vérité.
Huit jours se passèrent. Je m’attendais tous les matins à être conduit chez maître Kalb pour commencer mon apprentissage dans la boucherie; mais point: mon père sortait seul, avec ses habits de travail, et s’en allait en journée, sans rien décider sur mon sort.
Enfin, au bout de huit jours, je le vis partir un matin en habits du dimanche: il ne rentra que fort avant dans la soirée, et quand je fus couché, je l’entendis longtemps causer avec ma mère; seulement, à travers la cloison, je n’entendais plus que le bruit des voix, et je ne saisissais pas ce qu’on disait. Le lendemain, il repartit, emportant un assez gros paquet. Ma mère eut l’air triste toute la journée, et elle s’occupa sans relâche de visiter toute ma garde-robe, remettant des cols et des boutons aux chemises et consolidant le fond des culottes.
Mon père revint pour dîner; et quand nous fûmes sortis de table, au lieu d’allumer sa pipe, il m’attira à lui et me tint debout entre ses jambes.
«J’ai à te parler, garçon, me dit-il. Tu n’as pas grande envie d’entrer chez Kalb, n’est-ce pas?»
Je fis signe que non.
«Eh bien, tu n’iras pas chez Kalb! Puisque Zahn ne veut pas te prendre, tu entreras chez un autre menuisier. Connais-tu, par exemple, maître Hirsch, qui demeure près du vieux rempart, à Phalsbourg?»
Si je le connaissais! Son atelier n’était pas loin du marché, où j’avais quelquefois accompagné mon père; et quand il n’avait pas besoin de moi je ne manquais jamais de m’échapper pour aller regarder les belles planches et les lattes menues rangées le long de ses murs. Je restais en contemplation devant les ouvriers, suivant des yeux le long ruban en tire-bouchon qui s’enroulait sous le rabot; et c’était là que j’avais appris bien des petits procédés que j’appliquais à notre usage, à la maison.
Mon père continua:
«Tu vas réunir tes petites affaires, ton linge est prêt, ta mère l’a arrangé ; et demain matin je te conduirai chez maître Hirsch, qui veut bien te prendre en apprentissage. Je lui ai promis qu’il serait content de toi; j’espère que tu ne manqueras pas à ma parole: jamais les Wirth n’y ont manqué.»
Je me jetai au cou de mon père, je le remerciai, je lui lis mille promesses; et puis j’allai préparer mon paquet. J’emportai mes billes pour faire une partie à l’occasion et des plumes et du papier pour écrire à mes parents; mais je n’emporterai point mes pauvres outils. J’allais en avoir de bien plus beaux à présent. Quand tout fut prêt, je m’en allai errer dans le village, au clair de la lune; et en passant devant la boucherie de maître Kalb, dont les grilles étaient fermées, je ne pus retenir un geste peu poli: heureusement qu’à cette heure maître Kalb fumait sa pipe dans sa salle à manger, et ne s’inquiétait pas des gamins qui passaient dans la rue.
Je fus, pendant le premier mois, l’apprenti le plus docile, le plus attentif, le plus zélé, et aussi le plus heureux que jamais patron ait eu à diriger; puis, je commençai à me blaser un peu sur les charmes du métier, et à me laisser quelquefois distraire de mon travail par les autres apprentis, mes camarades. Ils étaient si gais! ils contaient de si drôles d’histoires! ils inventaient de si bons tours! Le moyen de se coucher et de dormir tranquillement dans mon grenier, quand Yéri, Kobus et Bernard s’en allaient courir les champs, maraudant les fruits quand les branches des arbres se permettaient de pendre au delà des murs, ou même se faisant la courte échelle pour atteindre le raisin remarqué et convoité dans la journée! quand ils erraient par les rues, en quête de folies à faire, effrayant les chiens, poursuivant les chats, ébranlant les sonnettes, décrochant les marteaux des portes, changeant les enseignes des boutiques, ou criant: «Au feu!» pour éveiller les bourgeois paisibles! Je fus bientôt de toutes ces fêtes; et, au bout d’un an d’apprentissage, quand je revins à la maison pour passer la semaine de Pâques, mon père me reçut froidement.
«Tu n’es pas maladroit, me dit-il, et c’est heureux pour toi, car, sans cela, maître Hirsch t’aurait déjà renvoyé à cause de ta conduite; mais si tu continues, ne pourra pas te garder, et au moins il te laissera apprenti sans gages, au lieu que si tu voulais, tu pourrais déjà gagner quelque chose. Tu n’as pas tenu tes promesses: j’avais espéré mieux de toi, et si j’avais su...»
Mon père s’interrompit, et je ne le priai pas de continuer. J’étais trop confus de m’être attiré ses reproches, car je l’aimais, et depuis que j’étais de retour à Katzenbach, m’éveillant au son fêlé de la vieille horloge que je connaissais si bien, toutes mes impressions d’enfance agissaient de nouveau sur moi, et me rendaient mes bons sentiments et mes bonnes intentions de l’année précédente. Pourtant je ne passai pas beaucoup de temps à réfléchir sur mes méfaits et sur les moyens de les éviter à l’avenir. A l’âge que j’avais, on ne peut guère suivre plusieurs idées à la fois, et j’avais à ce moment-là une idée fixe, la noce de ma cousine.
Ma cousine habitait Katzenbach, et elle allait se marier, pendant les fêtes de Pâques, avec le garde forestier de Erdeneau. Sa mère était veuve, et n’avait pas dans le pays de plus proche parent que mon père; elle l’avait donc prié de conduire la mariée à la mairie et à l’église, et nous étions tous de la noce, ma mère, mes petites sœurs et moi. Il y a des gens qui n’aiment pas les noces, mais moi je les aimais beaucoup, ainsi que toute espèce de fête et de réjouissance; et je repassais dans mon esprit, du matin au soir, tous les divertissements que j’aurais pendant les trois jours que durerait la noce de ma cousine. Car Rose était à son aise, et la famille du forestier était riche: ce serait certainement une belle noce.
J’eus ma première déception la veille même de la noce. Ma mère achevait de repasser les collerettes de mes sœurs et de ranger sur des chaises, pour le lendemain matin, toute la toilette de chacun de nous. La mère Lisbeth, la femme du sacristain, qui venait demander à mon père combien il faudrait réserver de bancs à l’église pour notre, compagnie, entra et vit nos apprêts: «Ah! ah! dit-elle, on sera beau demain, n’est-ce pas? et nous verrons le bel habit de M. Wirth?» A ma grande surprise, ma mère ne répondit rien, et mon père ôta sa pipe de sa bouche pour dire ce seul mot: «Non!»
La mère Lisbeth en resta bouche béante.
«Pas possible! dit-elle quand la parole lui fut revenue. Vous ne le mettrez pas? Que dira le monde? Est-ce que vous ne voulez pas faire honneur à Rose et à sa mère? Ce sont de bien honnêtes femmes pourtant! Vous n’avez rien contre elles, bien sûr, puisque vous avez accepté de conduire la mariée?
— Je n’ai rien contre elles, et le monde est un sot s’il s’occupe de cela. Je ne mettrai pas le bel habit, parce qu’il n’est plus chez moi: voilà !
— Il n’est plus. chez vous! Seigneur! qu’est-ce que vous en avez fait, voisin?
— Si on vous le demande, vous direz que vous n’en savez rien.»
Et sur cette réponse catégorique, mon père se leva et sortit. La mère Lisbeth en fit autant.
Mes sœurs restaient immobiles, comme pétrifiées; moi, j’étais atterré. Mon père ne mettrait pas le bel habit, notre gloire! Et il disait qu’il ne l’avait plus chez lui! Pourquoi? Où était-il? Depuis quand? J’étais blessé, humilié dans mon orgueil; j’étais inquiet aussi, sans savoir de quoi. L’avait-on vendu? L’avait-on mis en gage? Y avait-il eu des malades à la maison, et y avait-on manqué d’argent, pendant que je m’amusais sottement avec mes étourdis de camarades? Quand j’étais à la maison, je travaillais, je rendais bien des petits services; je gagnais aussi quelques sous par-ci par-là ; je leur avais peut-être manqué. Et puis, je ne m’étais jamais inquiété de savoir à quelles conditions j’étais entré chez maître Hirsch; j’y pensais pour la première fois. Mon père devait le payer pour me loger, me nourrir et m’apprendre son état; je lui coûtais donc beaucoup d’argent... plus que je ne valais, me disait ma conscience. Le remords s’éveillait: il allait me gâter tout le plaisir de la noce.
Le lendemain, ce fut bien autre chose. En voyant mon père, très proprement mis sans doute, mais privé du costume que tout le village connaissait si bien, les gens ne s’écrièrent pas: «Ah! Seigneur!» comme la mère Lisbeth; d’ailleurs ils n’étaient sans doute pas surpris, car elle avait dû raconter la nouvelle à quiconque avait des oreilles à Katzenbach. Mais je vis des mines effarées, des clignements d’yeux, des gestes d’étonnement; je surpris divers propos où la malveillance se mêlait à la compassion... et je ne m’amusai pas du tout à la noce.
Dans la soirée, las de danser, car le poids de mes pensées m’alourdissait les jambes, je me glissai en cachette dans une grange, afin de m’y reposer. Je m’étendis sur le foin, et je restai immobile; mais je ne fus pas longtemps seul. Trois ou quatre commères, qui ne dansaient plus pour leur compte et qui ne trouvaient pas grand plaisir à voir danser la jeunesse, entrèrent ensemble dans la grange, et, s’étant bien commodément arrangé des sièges et des coussins avec des bottes de foin, elles se mirent à deviser de choses et d’autres: de la mariée, du marié, des deux familles, du repas, des toilettes, des divers incidents de la noce; et naturellement on parla du bel habit. Son absence étonnait tout le monde. Qu’est-ce que le père Wirth pouvait bien en avoir fait? L’avait-il vendu, prêté, mis en gage? Une des commères affirmait qu’il était engagé, mais que c’était comme s’il était vendu, parce que les Wirth ne pourraient jamais le dégager.
«C’est la faute, disait-elle, de ce petit polisson de Fritz: il paraît que, depuis qu’il est à la ville, il s’est tout à fait perdu dans la mauvaise compagnie.
— C’est vrai, répondait une autre: on dit qu’il fait des dettes, et que ses pauvres parents sont obligés de se saigner aux quatre membres pour les payer.
— Et tous les dégâts qu’il fait dans la ville! cela coûte aussi.
— Peut-être bien qu’il a détourné de l’argent à son patron.
— C’est bien-possible: ces vauriens-là, c’est capable de tout, une fois que ça s’y met.
— Voilà ce que c’est que d’envoyer ses enfants à la ville. Le père Wirth pouvait bien faire de son fils un journalier comme lui; il a voulu en faire un menuisier, et pas un menuisier de village, encore! le père Zahn n’était pas un assez bon patron pour lui. Il est puni de sa vanité : c’est bien fait, après tout.
— C’est égal, il doit avoir joliment du chagrin. Cet habit-là, il y tenait comme à un enfant... je devrais dire comme à un père... enfin, j’aurais toujours cru qu’il le garderait jusqu’à son dernier soupir...
— Madame Swebach! madame Niederlich! mademoiselle Suzel! où êtes-vous donc? On vient de mettre un nouveau tonneau en perce; venez donc goûter le vin!» crièrent des voix, tout près de la grange.
Mes bavardes se levèrent bien vite et coururent rejoindre les gens qui les appelaient. Moi, je me gardai bien de me faire voir.
J’étais indigné. Les méchantes femmes! qu’est-ce que je leur avais fait pour me calomnier ainsi? Dire que j’avais fait des dettes! que j’avais peut-être volé ! Je pleurais de rage dans le foin, que j’avais ramené sur moi pour que personne ne pût m’y découvrir; et mes remords de tout à l’heure s’étaient envolés bien loin. Devant les accusations mensongères des vieilles bavardes, je me trouvais innocent comme l’enfant qui vient de-naître: c’était le genre humain tout entier qui avait des torts envers moi.
Peu à peu cependant ma conscience, qui s’était tue d’abord, commença à me parler tout doucement. Je ne méritais pas les accusations qu’on portait contre moi; mais ma conduite ne les autorisait-elle pas un peu? Volé... je n’avais pas, je n’aurais jamais volé d’argent; mais les fruits que j’avais tant de fois pris par escalade, dans les vergers du prochain, ne représentaient-ils pas de l’argent? Les prendre, c’était bien un vol. Et le temps que je perdais, ne le volais-je pas, soit à mon patron, qui comptait sur mon travail, soit à mon père, qui payait mon patron pour qu’il m’enseignât ce que j’étais si peu soucieux d’apprendre?
Ici ma vanité relevait la tête. «Je travaille très bien, me faisait-elle dire; je suis encore le meilleur des quatre apprentis de l’atelier.» Oui; mais comme réponse à ma vanité, il me revenait en mémoire une phrase que le patron m’avait dite souvent: «Tu serais-un si bon ouvrier, si tu voulais! tu es né menuisier, tu n’as qu’à vouloir pour bien faire!» Et ma conscience reprenait: «On ne fait pas ce qu’on doit quand on ne fait pas tout ce qu’on peut: la facilité à réussir est un don de Dieu, et il n’y a rien de plus coupable que de laisser perdre les dons de Dieu.» Et puis, le souvenir du bel habit me revenait; quoique je n’eusse ni volé, ni fait des dettes, c’était peut-être bien à cause de moi qu’il avait disparu, rien que pour payer ma pension. Et j’avais si mal répondu au sacrifice de mon père!
Je ne me rappelle plus le reste de la noce; je sais seulement que je ne m’y amusai guère. Je rentrai chez le père Hirsch aussitôt que les fêtes furent passées, et il en fut même étonné, car les autres n’étaient pas encore revenus, quoiqu’ils fussent de Phalsbourg même. Je me mis au travail et je fis de mon mieux; le patron me loua beaucoup et me cita même en exemple aux autres apprentis, qui avaient fini par rentrer, la tête lourde et les mains maladroites. Ils ricanèrent en me regardant en dessous, et je compris vite que je ne devais plus compter sur leur amitié : à vrai dire, je n’y tenais guère ce jour-là.
Tout en travaillant, je réfléchissais; je me rappelais la conversation des commères, quand j’étais tapi dans le foin, et j’y découvrais de plus en plus de nouveaux sujets de tristesse. On me déchirait, on me calomniait; mais on blâmait aussi mes parents à cause de moi, on les accusait de vanité, on disait «que c’était bien fait» s’il leur arrivait des ennuis et des pertes d’argent. Et c’était moi qui avais donné aux mauvais propos des apparences de vérité ! et à présent, que pouvais-je faire pour réparer le mal?
Je cherchais aussi à deviner ce qu’avait pu devenir le bel habit. Je finis par songer à la singulière visite que nous avait faite, l’année précédente, le vieux Lévi Israël. Comme il était arrivé adroitement, à force de compliments, à se faire montrer le bel habit! Sans doute qu’il voulait l’acheter, non pas pour lui, mais :pour ce vieux monsieur... Bah! quelle idée! un monsieur si bien mis! en si beau drap fin! il ne pouvait pas vouloir s’habiller comme un campagnard de l’ancien temps. C’est égal, Lévi Israël devait y être pour quelque chose.
L’horloge de l’église, avec sa grosse voix, flt entendre un «boum!» retentissant. C’était le premier coup de midi. «A table, garçons!» dit le patron en posant son rabot sur l’établi. Chacun de nous quitta son ouvrage, les ouvriers pour s’en aller chez eux manger leur soupe, et les apprentis, ceux du moins qui logeaient chez le patron, pour savourer le lard et les choux de Mme Hirsch. Après le dîner, nous avions une bonne demi-heure de repos, que nous employions généralement à faire une partie de balle ou de bouchon; mais ce jour-là je m’esquivai, et je courus chez le brocanteur:
Il était là, paisiblement assis, comme à l’ordinaire, au milieu de sa boutique, entre des faïence à fleurs rouges ou bleues, des meubles de vieux bois sculpté, de vieilles armes, de vieux cuivres qui reluisaient dans l’ombre; et puis des ferrailles, des bêtes empaillées, des instruments de musique, et des loques de tout âge qui pendaient aux murs, accrochées à des clous: on aurait dit les femmes de Barbe-Bleue. Il se mit à rire en me voyant, ce qui découvrit les dents jaunes qui lui restaient.
«Hé ! hé ! c’est toi, petit! Que vais-je te vendre aujourd’hui! Tu arrives de Katzenbach, n’est-ce pas? comment se porte ton père?
— Très bien, répondis-je d’un ton distrait.
— Très bien? cela m’étonne. Chez nous, les pères se portent très bien quand leurs fils leur donnent de la satisfaction; autrement... Mais ce n’est pas mon affaire. Qu’est-ce que tu me veux?»
J’étais fort intimidé ; j’avais donc bien mauvaise réputation! Je baissai la tête sous le blâme du vieux juif, et je lui dis timidement:
«Je voudrais bien savoir quelque chose, monsieur Israël... quelque chose que vous pouvez me dire, je crois... Mon père n’avait pas son beau costume, vous savez, celui que vous avez vu l’an dernier; et, aux gens qui s’en informaient, il a répondu qu’il ne l’avait plus... Est-ce que vous savez, vous, ce qu’il est devenu? »
Le vieillard releva la tête et me regarda en face, de ses petits yeux perçants.
«Autrement dit, tu penses que ton père l’a vendu, et tu veux savoir si je l’ai acheté, n’est-ce pas? Eh bien, oui, mon bonhomme, je l’ai acheté et payé un bon prix, pour le monsieur qui était avec moi, le jour que tu te rappelles si bien. Ce monsieur fait des collections; le bel habit de ton père, avec tout le reste, fait maintenant partie d’une collection de costumes de différents pays. Tu me demanderas peut-être pourquoi ton père l’a vendu: je pourrais te répondre que je n’en sais rien; mais j’aime mieux te dire ce qui en est. Il l’a vendu (et il a essuyé ses yeux avec sa manche en le quittant) pour payer l’apprentissage d’un garnement qui est en train depuis ce temps-là. de ne devenir rien qui vaille. Oui, il s’en est séparé, de ces vêtements qui étaient ce qu’il possédait de plus précieux, pour que son fils pût prendre le métier qu’il aimait. C’était bien la peine, en vérité !»
Oh! comme les reproches du vieux juif, comme le mépris que je sentais dans son regard, dans le geste de sa main, dans le son de sa voix, m’allaient au cœur et me remplissaient de confusion! En quelques minutes, tout un monde de pensées s’agita dans mon cerveau; je revis toute la dernière année, et je compris tout ce que j’aurais dû faire et tout ce que je n’avais pas fait. Et en même temps, un désir ardent de réparer le mal s’empara de moi. Je travaillerais, je ne donnerais plus aucun sujet de plainte, je deviendrais ce que mon père souhaitait, un bon ouvrier, habile, consciencieux... Mais ce n’était pas assez.
«Pourrait-on le racheter? demandai-je timidement, en osant à peine regarder Lévi Israël.
— Le racheter? il faudrait que son propriétaire actuel voulût le vendre, et il n’y a pas à compter là-dessus, à moins qu’on ne lui en trouvât un plus beau; mais c’est difficile, et si cela arrivait, il faudrait le payer cher.
Je vais bientôt gagner de l’argent... je le mettrai tout de côté. Je vous en prie, cherchez un plus beau costume, monsieur Israël.»
. Le vieillard me regarda.
«Tu pleures? dit-il. Oh! ne te cache pas, n’aie pas honte de pleurer, mon garçon; ces larmes-là effacént tes fautes passées. Retourne chez ton patron, et remets-toi à l’ouvrage avec une conscience toute neuve. Je chercherai; il faudra du temps; on verra bien si tu as du courage et de la patience.»
Je vous assure qu’en ce moment-là je n’avais pas envie de me moquer du vieux Lévi Israël, de sa longue personne maigre et de sa figure ridée; je lui trouvais quelque chose de majestueux, de sévère et consolant à la fois, et comme une vague ressemblance avec le Père éternel, tel que je l’avais vu dans un vieux tableau, au-dessus du maître autel de l’église. Je fis ce qu’il me disait; je retournai à l’atelier, et je m’appliquai si bien à des mortaises que j’étais chargé d’ajuster, que le patron m’en fit compliment. Et un instant après, comme l’horloge sonnait trois heures, il m’appela:
«Serais-tu capable d’aller poser des étagères dans une armoire? J’avais promis d’y aller aujourd’hui, mais je vois que je n’aurai pas le temps. Il-faut que ce soit de l’ouvrage proprement fait. Es-tu capable de t’en tirer?
— Oui, patron! oui, patron! m’écriai-je, transporté de joie de ce qu’il s’adressait à moi, le plus jeune et le moins ancien de l’atelier.
— C’est rue des Trois-Cigognes, au deuxième étage; tu demanderas Mme Osterich. Pars vite, et ne t’amuse pas en route; il y aura encore de l’ouvrage ici quand tu reviendras.»
Je le savais bien. Jamais le patron n’envoyait un de nous en course, ouvrier ou apprenti, sans lui recommander de ne pas s’amuser en route, et sans ajouter celte formule ironique: «Il y aura encore de l’ouvrage ici quand tu reviendras.»
Mme Osterich était une femme généreuse, ou bien elle fat touchée du soin et de l’ardeur que je mettais à poser ses étagères, car elle me donna l’énorme pourboire de cinquante centimes! Je ne me sentais pas de joie: c’était le commencement de ma réhabilitation. Sans doute, il en faudrait beaucoup de pièces de cinquante centimes, pour arriver à racheter ou à remplacer le bel habit; mais il me semblait que je les tenais déjà. Les camarades eurent beau flairer ma fortune et s’efforcer de m’entrainer dans une partie de bouchon, je demeurai inébranlable, non seulement ce jour-là, mais tous les jours suivants. J’avais mis ma pièce de dix sous, et tous les sous que je recevais, dans une boîte que je m’étais fabriquée avec des rognures de planches. Seulement ma boîte n’avait pas de serrure; si Yéri ou Bernard, furieux de ce que. je ne leur payais plus ni sucre d’orge ni pain d’épice, allaient un jour m’épier, dénicher mon trésor, et... j’en avais la chair de poule. Je cherchai longtemps un asile pour mes économies; il y avait bien la caisse d’épargne: mais il aurait fallu, que le patron, ou mon père, vînt déposer avec moi, et je n’aurais pas pu retirer mon argent sans eux; et je voulais thésauriser à l’insu de tout le monde.
De tout le monde, non; j’avais déjà un confident: pourquoi ne pas m’adresser à lui? Il savait si bien, le jour où je lui avais parlé, que j’étais en train de devenir un mauvais garnement? il devait savoir aussi, maintenant, que je me conduisais bien et que le patron était content de moi; sûrement, il ne m’accueillerait pas mal. Je me dirigeai donc un jour vers sa boutique. Du plus loin qu’il me vit, il me sourit.
«J’ai douze francs, monsieur Israël! lui dis-je en lui présentant ma boîte.
— Douze francs, mon petit, c’est un joli commencement! Il n’y a pas encore assez pour ce que tu veux, sans doute, mais cela viendra, cela viendra! Ne te décourage pas.
— Eh non! Seulement... je ne sais pas où mettre mon argent, j’ai peur qu’on me le prenne... Si vous vouliez bien me le garder?»
Il se mit à rire: ses rides remontaient jusqu’à ses yeux, qu’on ne voyait plus que comme une petite fente brillante.
«C’est cela, petit! dit-il, je serai ton banquier, et je ne te prendrai pas de commission encore! Nous allons faire les choses en règle. Prends ce petit cahier, écris: «Le 19 juin, remis douze francs à Lévi Israël.» Bien. J’en prends un pareil, et j’y écris: «Le 19 juin, reçu douze francs de Fritz Wirth.» Quand tu m’apporteras de l’argent, je l’inscrirai sur ton cahier, et tu l’écriras sur le mien: tu comprends?
— Et quand il y en aura assez, vous chercherez un costume pareil à celui que mon père a vendu?
— Je te l’ai promis: chose promise, chose faite. Il n’y a plus que la difficulté de le trouver: cela, je n’y peux rien. Mais sois tranquille, petit, il y a de bonnes chances pour les bons garçons.» .
Si je n’avais pas su calculer, le petit cahier du vieux Israël m’aurait appris à faire les additions. Quelle joie, lorsque j’eus rempli la première page, de faire la somme de la première colonne, et de l’écrire, avec la mention «Report», en haut de la page suivante! Mon magot grossissait; et je devenais un bon ouvrier, parce que je m’appliquais de toutes mes forces à mon ouvrage pour mériter des pourboires. Je ne sais pas si c’était pour m’encourager ou pour me récompenser, ou bien encore si le vieux Israël m’avait trahi, mais le patron m’envoyait très souvent travailler au dehors. Je m’efforçais d’être très poli, pour plaire aux clients, et j’avais souvent le plaisir de les entendre dire: «Envoyez-nous le petit apprenti blond.» Le vieux Israël me voyait souvent.
Il y a un mauvais côté à toute chose: je devenais avare sans m’en douter. Depuis que je ne payais plus rien aux autres apprentis, ils m’avaient complètement tourné le dos, et je ne jouais plus avec personne. Il n’y avait pas grand mal à cela: mieux vaut point de compagnie du tout que la mauvaise compagnie. Mais distraire un sou de mon trésor me paraissait une chose impossible; et un jour le vieux Israël me vit arriver chez lui suivi par une pauvre femme en haillons, qui portait ou traînait quatre enfants hâves et maigres. Tout cela murmurait en me tendant la main: «La charité, s’il vous plaît!» Mais je ne les écoutais pas; j’arrivai jusqu’à la boutique du juif sans avoir détourné la tête, et je ne le vis même pas prendre dans son tiroir une pièce qu’il donna à la malheureuse. Moi, je vidai sur le comptoir ma poche pleine de sous. Il les compta, les mit en piles, les inscrivit sur mon cahier, me les fit inscrire sur le sien, sans m’adresser la parole; et enfin, toussant pour s’éclaircir la voix:
«Celui qui possède les biens de ce monde et qui n’en fait point part à ses frères qui ont faim, ne prospérera pas sur la terre, et l’Éternel détournera sa face de lui, disent nos saints livres. Est-ce que les livres des chrétiens ne disent pas la même chose?
Je rougis et baissai la tête, puis je me retournai vivement pour chercher la mendiante; mais elle n’était plus là.
«Elle est partie, me dit Israël: tu as laissé perdre l’occasion de racheter tes péchés par l’aumône. Combien en as-tu perdu de semblables, depuis que tu m’apportes ton argent?»
Combien! je ne les avais pas comptées; toutes celles qui s’étaient présentées, assurément. Je m’étais interdit toute dépense inutile; et je m’apercevais avec effroi que j’avais rangé parmi les dépenses inutiles la charité, le premier de tous les devoirs.
«Je ne sais si je connais bien le père Wirth, reprit Lévi Israël; mais il me semble qu’il ne voudrait pas d’un habit racheté de cette façon-là. Penses-y, et si tu trouves que j’ai raison, ne m’apporte plus d’argent sans mettre de côté la part des pauvres.»
Je le lui promis; j’aurais bien donné tout ce que je lui apportais pour pouvoir retrouver la pauvresse. Il vit mon repentir, et causa un peu avec moi pour me consoler; et comme j’étais en veine de confiance, je lui-avouai que je m’ennuyais souvent depuis que je ne jouais plus avec les camarades. Je n’avais plus envie de retourner avec eux bien sûr, d’aller marauder comme autrefois; mais enfin je ne savais que faire le soir, et je m’ennuyais.
«Il ne faut pas s’ennuyer, me dit sévèrement le vieux juif. Tu ne sais donc pas lire?
— Si! mais lire quoi? Il n’y a pas de livres chez le patron, rien que l’almanach de l’année, et je le sais par cœur.
— Je t’en prêterai; et puis je parlerai à M. Hirsch; il faudra que tu ailles aux écoles du soir; tu y apprendras à dessiner, à calculer mieux que tu ne fais, enfin bien des choses qui te seront utiles et qui t’empêcheront de t’ennuyer. Tu as bien fait de me dire cela. S’ennuyer, Dieu d’Abrah am! quand on a tant de choses à apprendre!»
L’automne commençait, les écoles du soir se rouvraient; je me mis à les suivre, et, comme disait le vieux Lévi Israël, j’y appris bien des choses qui me furent utiles, même dans mon métier. Il en résulta que, vers le milieu de l’hiver, M. Hirsch commença à me payer, et que la part des pauvres n’empêcha pas mon trésor de grossir.
Je possédais une somme assez ronde, au mois d’avril, lorsque le vieux brocanteur se remit en route pour ses tournées. Il resta longtemps absent, et quand j’allai, à son retour, lui porter mes économies, il paraissait tout joyeux: il avait fait de très bonnes affaires, à ce qu’il me dit. EL comme il arrivait de Katzenbach, il me remit une grande galette que ma mère avait pétrie exprès pour moi. Il me donna aussi des nouvelles du village: mes parents allaient hier, Gredel et Louison avaient beaucoup grandi, et tous se réjouissaient de me voir aux fêtes de Pâques.
Ah! les fêtes de Pâques! Moi aussi, je me réjouissais bien d’aller passer huit jours au village, d’embrasser ma mère, de jouer avec mes petites sœurs, et de recevoir de mon père un autre accueil que celui de l’année précédente; mais j’avais tant espéré ne rentrer à Katzenbach qu’en y rapportant le bel habit! J’avais mal calculé ; il m’était impossible d’amasser tant d’argent en moins d’une année. Il fallait en prendre mon parti, et me consoler avec ma bonne conscience et le bon témoignage que mon patron rendrait de moi cette fois-ci.
Les fêtes de Pâques arrivèrent; je quittai Phalsbourg en remerciant Mme Hirsch de tous les soins qu’elle avait pris de moi. Depuis huit jours, elle ne faisait que s’occuper de mon trousseau, repassant elle-même mes chemises pour qu’elles fussent plus belles, nettoyant ma veste et mon pantalon des dimanches mieux que ne l’aurait fait le dégraisseur, enfin me traitant comme son propre fils. J’allai dire adieu au vieux brocanteur, qui me donna force poignées de main et me souhaita beaucoup déplaisir; et je partis joyeux pour Katzenbach.
Ah! comme j’y fus reçu! Mon père ne pouvait se lasser de m’embrasser; il avait les larmes aux yeux en disant: «Mon bon garçon! mon cher garçon! est-il grand! est-il fort! Regarde-moi en face, mon Fritz: je vois une bonne conscience dans ces yeux-là, n’est-ce pas? Quelle différence d’avec l’année dernière! Non, n’en reparlons plus; tout est effacé, tout est oublié ! Nous allons passer de fameuses fêtes de Pâques!»
Le lendemain matin, toute la maison était en l’air: Gredel et Louison s’évertuaient à faire le ménage avec notre mère; on me servit une bonne assiettée de soupe, en me recommandant de me dépêcher: c’était seulement pour attendre le dîner, qui serait un fameux dîner. Et tout en parlant, elles rangeaient sur le lit leurs jolies jupes rouges, leurs corsets de velours noir, leurs tabliers brodés, leurs fines chemisettes blanches et leurs grands nœuds de ruban noir: toute leur toilette des grandes fêtes, enfin.
«Est-ce que vous allez mettre cela aujourd’hui? leur demandai-je, étonné.
— Je crois bien! Dépêche-toi de manger pour t’habiller aussi: le baptême est à onze heures, et le dîner à midi.
— Quel baptême? quel dîner? Je ne sais rien du; tout, moi?
— Hé ! le baptême du petit garçon de Rose! Tu ne sais pas? Rose est chez sa mère, et elle vient d’avoir-un petit garçon: c’est papa qui est le parrain, et on fait le baptême aujourd’hui. Il a une petite commère, la sœur du mari de Rose; elle s’apelle Christel, et elle a dix ans: tu verras comme elle est gentille. Nous allons encore plus nous amuser qu’à la noce de Rose!»
Encore plus qu’à la noce de Rose! Pour ma part je n’y aurais pas grand’peine, ou plutôt je n’y prévoyais que les mêmes ennuis: mon père était parrain, et je n’avais pas encore pu lui rendre le bel habit; j’entendrais peut-être encore les mêmes vilains propos, et Dieu sait quel chemin ils avaient pu faire depuis un an! Ah! comme j’aurais voulu être resté à raboter des planches dans l’atelier du père Hirsch, plutôt que d’être venu à ce malencontreux baptême.
Mais, bon gré mal gré, il fallait y aller. Je m’habillai et je suivis mes sœurs. «Allez-vous-en les premiers, enfants, nous dit mon père; j’ai quelque chose à faire ici, je vous rejoindrai tout à l’heure.» Gredel et Louison me prirent chacune par une main et m’entraînèrent vers la maison de Rose.
Rose était là toute souriante, avec son mari et sa mère debout derrière elle, et son poupon sur ses genoux; et les commères qui se pressaient autour d’elle tombaient toutes d’accord que pour un enfant de vingt-huit jours, c’était un bien bel enfant. On me le fit embrasser, et puis on me présenta à la marraine, qui riait d’être en grande toiletter et d’avoir à son corsage un gros bouquet de fleurs artificielles avec de longs rubans qui pendaient. Elle nous emmena pour nous montrer la table déjà mise, le grand nougat qui était au milieu, et aussi les dragées que le «parrain» avait envoyées la veille. Nous étions très bons amis, lorsqu’un brouhaha étrange nous apprit qu’il se passait dans la chambre à coucher quelque chose d’extraordinaire; et aussitôt on nous appela.
Ce qui frappa mes regards tout d’abord, ce fut mon père, debout au milieu de la chambre, mon père tel que je me rappelais l’avoir vu autrefois, avec le tricorne, la grande redingote à boutons brillants, le gilet brodé, la culotte de velours, les souliers à boucles d’argent, le bel habit au complet, aussi frais, aussi bien conservé que s’il n’eût jamais quitté le tiroir où ma mère l’embaumait si soigneusement dans la lavande et le thym! C’était lui, c’était bien lui; les étoffes, les boutons, les nuances, certains plis marqués par les attitudes favorites des Wirth du temps passé, je reconnaissais tout cela... Il nous était donc rendu! mais comment cela s’était-il fait? qui pouvait m’avoir volé ma joie?
Mon père ne me laissa pas longtemps dans l’ignorance. Il me prit par la main, et, faisant un geste pour demander du silence, il dit tout haut, de façon que tout le monde l’entendît:
«Ma chère cousine, je suis charmé que cela vous fasse plaisir de me revoir dans ces habits que voici, pour le baptême de votre enfant. Je ne les avais pas à votre mariage; j’avais été obligé de les vendre pour payer l’apprentissage de mon garçon, qui désirait être menuisier et que M. Zahn ne pouvait pas prendre chez lui. Mon cher Fritz n’en savait rien; mais il l’a appris plus tard, et alors il s’est mis à travailler, à épargner, à se priver de tout, pour pouvoir amasser de quoi me rendre un jour ce costume que tant de mes aïeux ont porté. Le vieux brocanteur Lévi Israël l’a aidé ; il s’était chargé de racheter le costume ou d’en chercher un tout pareil. Le bonheur a voulu que le mien lui-même se trouvât en vente la semaine dernière: Lévi Israël l’a racheté et me l’a apporté ; et je l’ai mis aujourd’hui, tant pour vous faire honneur que pour faire une surprise à mon garçon.»
J’entendis une foule de paroles confuses, d’éloges, de félicitations, de compliments: tout le monde parlait à la fois. Je ne m’occupai guère à débrouiller cet écheveau; mon père m’ouvrait ses bras, je m’y jetai... Il y a des gens qui prétendent qu’il n’y a pas de bonheur dans la vie: s’ils avaient été à ma place ce jour-là !
Mon père, me tenant serré contre sa poitrine, reprit, en s’adressant à Rose et à son mari:
«C’est pour cela, mes amis, que je vous ai priés de prendre à ma place mon fils Fritz pour parrain de votre enfant: vous êtes sûrs qu’il lui donnera de bons exemples et de bons conseils. Nous donnerons à l’enfant le nom de son parrain; et puisse-t-il devenir aussi laborieux, aussi courageux, aussi bon fils que l’est mon-cher garçon!»
On applaudit; la petite marraine vint attacher à ma boutonnière un bouquet pareil au sien, et elle me conduisit à Rose, qui me remercia de vouloir bien tenir son enfant sur les fonts de baptême. Et son mari me félicita de ma conduite, et il ajouta: «M. Wirth peut être sûr, à présent, que le bel habit continuera à être porté dignement dans la famille.»
Quel beau baptême! Nous marchions en tête, Christel et moi, nous donnant la main; puis venait mon père, qui donnait le bras à Rose, et la mère de Rose qui portait notre filleul; puis ma mère avec le père de l’enfant, et mes petites sœurs avec d’autres enfants de la famille. Et le dîner de baptême! Je le trouvai bien plus beau que le dîner de noce; il est vrai que j’avais mes raisons pour cela.
Quand je fus de retour à la ville, ma première visite fut pour le vieux brocanteur.
«Es-tu content, petit? me cria-t-il dès qu’il m’aperçut.
— Comment avez-vous fait? répondis-je.
— C’est le hasard! Le vieux monsieur aux collections est mort; ses héritiers ne tenaient pas à toutes les défroques dont il avait rempli des vitrines tout autour d’une belle salle: ils ont fait une vente de toutes ses curiosités, et j’y suis allé. J’ai eu le costume de ton père pour un morceau de pain: qui est-ce qui se soucie, à présent, des vieux costumes d’Alsace? De sorte que j’ai de l’argent à te rendre.
— Gardez-le, si vous voulez bien, monsieur Israël; je ne serai pas fâché de le trouver à l’occasion, quand on aura besoin de quelque chose au village, là-bas.
— Ou quand tu voudras t’établir menuisier; cela arrivera bien quelque jour.»
Le père Lévi Israël avait la vue longue, plus longue que moi, car je me mis à rire à cette idée de m’établir menuisier. Mais il ne devinait déjà pas si mal. Le père Zahn est mort quelques années plus tard; Georges, qui n’avait jamais pu apprendre à ajuster proprement les deux moitiés d’une planche, s’est fait soldat et a vendu les outils et l’établissement de son père. J’étais alors le premier ouvrier du père Hirsch, et il m’engageait fort à me fixer à Phalsbourg: mais, comme je vous le disais en commençant, Katzenbach est le plus joli village de toute l’Alsace. Un bon menuisier peut très bien y gagner sa vie, surtout quand il a la clientèle des châteaux environnants. J’achetai donc le fonds du père Zahn; j’agrandis le jardin de mon père, et j’y bâtis un atelier qui ne chôme guère à présent. Mon père, avec le bel habit, préside à toutes nos fêtes de famille; mes sœurs sont mariées: nous sommes tous très heureux. Ah! j’allais oublier, —mais vous l’auriez deviné peut-être, que j’ai épousé Christel, ma gentille commère, et que notre filleul est mon apprenti. Et vous devinez sûrement aussi, sans que je vous le dise, que le vieux Lévi Israël ne passe jamais par Katzenbach sans s’arrêter chez nous et s’asseoir à notre table, et que les jours où il vient sont comptés parmi nos meilleurs jours de fête.