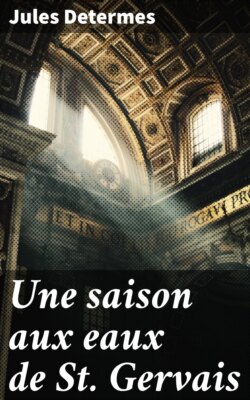Читать книгу Une saison aux eaux de St Gervais - Jules Determes - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Propriétés des Eaux.
ОглавлениеCascade des Bains de St. Gervais.
Ne crains rien, mon ami, je serai aussi sobre, qu’il me sera possible, de mots techniques; les nomenclatures se hérissent journellement et avec une profusion désespérante, d’expressions plus ou moins bizarres, plus ou moins barbares, de telle sorte que chaque objet aura bientôt une douzaine d’appellations différentes. — On croirait que les auteurs visent, avant tout, à nous rendre Grecs. — Notre époque invente fort peu de choses, mais elle invente beaucoup de mots.
Nos savans — que Dieu les bénisse! — ne sont, du reste, jamais en peine; d’une manière ou d’une autre, ils définissent, ils expliquent tout.
Un savant avouant qu’il ne sait pas!.. Ce serait joli!
Hélas! quand voudra-t-on, quand pourra-t-on être prudent et circonspect avant de juger? La grande illusion de notre raison bornée, c’est de méconnaître ses étroites limites, et de rendre avec trop de hâte des décisions absolues: il y a, dans l’intelligence humaine, quelque chose de plus saillant encore que son imperfection, c’est sa vanité......
On s’est demandé plus d’une fois quelle est la véritable cause de la chaleur des eaux minérales. Sur ce phénomène, comme sur beaucoup d’autres également surprenans, chacun a formulé son opinion, sa théorie, son système; système, théorie, opinion presque toujours contradictoires, plausibles et ingénieux par fois, insuffisans toujours.
Les uns admettent, dans l’intérieur du globe, un feu central d’où les eaux thermales tirent leur température élevée, foyer toujours actif et s’alimentant sans le contact de l’air.
D’autres, adoptant cette idée, croient pouvoir ajouter que ce feu est sous forme de charbons incandescens et sans flamme.
Il en est qui attribuent la chaleur des eaux à l’action du soleil.
Suivant d’autres, un second soleil est caché dans le sein de la terre, et produit les mêmes effets que notre soleil visible.
Pour plusieurs, enfin, cette chaleur est due soit à une fermentation intérieure, soit à la combinaison d’acides et d’alcalis, soit à la décomposition des pyrites qui imprègnent quelquefois les terrains environnant les sources, soit à des volcans ou à des masses de charbon de terre enflammées, soit à l’électricité, etc.
«Dans l’impuissance où je suis, disait avec raison Didelot, de concilier tant d’opinions diverses, il ne me reste qu’à mettre la chaleur des eaux au nombre des grands phénomènes qui sont faits moins pour satisfaire la curiosité que pour exciter l’admiration, qui ont des causes physiques, mais tellement élevées au-dessus de notre portée, que nous n’y connaissons rien, et nous ne devons pas en être surpris. L’homme n’est pas fait pour tout comprendre; il y a mille questions sur lesquelles on disputera jusqu’à la fin des siècles, sans qu’on puisse assurer qu’on a trouvé la vérité. On croit lever le voile qui couvre les opérations les plus mystérieuses; mais la nature ne laisse pas facilement pénétrer son secret, c’est souvent en vain qu’on multiplie les expériences, et qu’on perfectionne les procédés. Quelques succès plus spécieux que réels éblouissent; on les fait reparaître sous une autre forme; on les annonce comme de nouveaux progrès, comme de nouvelles notions acquises; cependant on est toujours au même point, et la masse des connaissances n’en est pas augmentée. C’est le goût pour la nouveauté qui enfante la manie des systèmes, et l’on s’efforce de les rendre dominants par la fantaisie que l’on a de prétendre à l’explication de tous les phénomènes de la nature.»
Il ne faut pas trop rire — comme on l’a fait — des paroles d’un autre savant modeste, de Richardot, réduit à dire, après beaucoup de recherches: «Les eaux thermales sont chaudes parce que telle fut la volonté de Dieu!»
Mais, si les causes sont ignorées, beaucoup d’effets sont connus. L’on sait, par exemple:
Que les eaux thermales, quoique déjà pourvues d’un degré considérable de température, n’entrent pas plus vite en ébullition que l’eau commune, toutes choses égales d’ailleurs;
Qu’elles se refroidissent plus lentement, et n’abandonnent pas avec autant de facilité les gaz dont elles sont saturées;
Que des eaux à + 60° c., par exemple, prises en boisson, ne produisent aucune impression désagréable; la langue et le voile du palais n’en souffrent pas, tandis que l’eau commune chauffée à + 48° c. les brûlerait et produirait des accidens graves;
Qu’à égalité de température au thermomètre, les eaux minérales ont une chaleur beaucoup plus douce que celle des bains d’eau commune chauffée, ce qui rend l’immersion dans les eaux thermales beaucoup plus agréable, etc.
L’eau minérale de Saint-Gervais est thermale, incolore, d’une limpidité parfaite, légèrement amère , d’une odeur très- prononcée de gaz hydrogène sulfuré qui se perd par le refroidissement, très-douce au toucher, et laissant sur la peau des baigneurs une onctuosité remarquable due à une grande quantité de glairine en dissolution. Ce dernier caractère la distingue des eaux de Bourbonne qui rendent la peau riche.
Il y a, à Saint-Gervais, neuf sources dont la température relative est différente, mais dont chacune a une température invariable. La source la plus chaude est de + 42° c.; les autres ont + 39°, 37°, 32°, 29° et 18° c.
M. Bakewell a commis une erreur évidente en n’évaluant qu’à + 36°, 66 la température des eaux de Saint-Gervais. Si cet Anglais a expérimenté lui-même, il faut qu’il ne soit pas descendu dans le souterrain, et qu’il se soit contenté d’examiner la source du bord du torrent.
La constance de température de chaque source fut constatée, dès l’origine, par M. le professeur Pictet. Ayant observé, une seconde fois, les eaux de St-Gervais, plus de deux mois après la visite qui fit l’objet du rapport lu à la Société d’histoire naturelle de Genève (1806), ce physicien ne trouva aucune variation dans la température de la source, quoique l’air environnant ne fût qu’à + 6° R. au lieu de + 23° R., et quoique le temps écoulé entre les deux observations eût été remarquablement froid et pluvieux. Ce résultat précieux que MM. Senebier et B. de Saussure avaient soupçonné, sans avoir le temps de le confirmer, a été plus tard mis hors de doute par les expériences nombreuses faites, à diverses époques de la saison et à différentes heures de la journée, par M. le docteur Matthey, ancien médecin des Bains de Saint-Gervais. La température des eaux n’a jamais manifesté la moindre variation .
Cette constance de température qui caractérise particulièrement les eaux de Louëche, en Vallais, manque à celles d’Aix, en Savoie. Celles-ci, en effet, lorsqu’ arrivent des fontes de neige ou de fortes pluies, tombent d’une haute température à + 20 et quelques degrés, ce qui peut faire penser que des eaux étrangères viennent s’y mêler et en altérer les principales propriétés. C’est ainsi qu’en 1755, lors du tremblement de terre de Lisbonne et, en 1783, lors de celui qui ébranla une partie de la Calabre, les eaux de la source dite de soufre, à Aix, se troublèrent et se refroidirent. En 1816, les pluies ayant été très-abondantes, les eaux de la source improprement appelée d’alun, se refroidirent extrêmement, et celles de soufre ne marquaient plus que + 25°. En 1822, par suite d’une secousse qui ébranla tout le sol de la Savoie, la source de soufre resta froide pendant six heures.
Ces variations de température ont encore été constatées à Bagnères-Adour, à Chaudes-Aigues, au Mont-d’Or, etc.
Sous le point de vue chimique, les eaux de Saint-Gervais sont de nature saline, gazeuse, gélatineuse et sulfureuse.
Elles renferment, en effet:
Divers sels: sulfate de soude (sel de Glauber, sel admirable) en grande proportion. — Chlorure de sodium (sel commun) — Chlorure de magnésium, etc.
Des gaz: acide carbonique, — acide sulphydrique, — air atmosphérique très-pur. — Azote, etc.
Une grande abondance d’une matière végéto-animale gélatineuse (glairine, d’Anglada, barégine, de Longchamp.)
Beaucoup de soufre.
On y trouve aussi du pétrole et d’aures substances.
Il n’est pas inutile de remarquer que les analogies observées à priori entre les eaux de Saint-Gervais et d’autres eaux thermales, ne tardent pas à se modifier par un examen plus attentif, et ce n’est pas, on peut le dire, au détriment des premières.
Ainsi, les eaux de Bourbonne, fortement salées et légèrement amères, ne sont ni savonneuses, ni douces au toucher, elles donnent même de la rudesse à la peau des baigneurs et, en outre, l’absence de sulfate de soude doit les rendre beaucoup moins purgatives que celles de Saint-Gervais. — Celles d’Aix sont, à la vérité, onctueuses au toucher, mais les sels purgatifs qu’elles contiennent n’y sont pas en quantité suffisante pour produire des effets sensibles. Il en est de même à Plombières, à Louëche, etc.
La température des eaux de Saint-Gervais est très-convenablement appropriée à leur application, comme moyens curatifs. Celle de certaines eaux est une richesse superflue, puisque l’on est obligé de l’amener, suivant les cas, et même pour l’ordinaire, à des degrés fort inférieurs à leur chaleur normale. A Bade (Suisse), par exemple, on est obligé de préparer les bains huit ou dix heures d’avance, afin de laisser refroidir l’eau. A Louëche, l’eau nécessaire aux bains est conduite le soir dans les bassins, et y reste toute la nuit pour se refroidir jusqu’à + 36° à + 37°.
Or, il est facile de concevoir combien ces eaux doivent, pendant ce temps, perdre de leurs propriétés salutaires.
Les inconvéniens sont encore plus grands, sans doute, lorsqu’il s’agit de chauffer les eaux minérales de température peu élevée, comme celles de Schinznacht, de Bagnoles, de Saint-Amand, etc., afin de leur donner une chaleur favorable.
Il ne faut pas perdre de vue qu’il y a plusieurs sources à Saint-Gervais; celle à + 42° tomberait, en quelques circonstances, dans l’inconvénient que j’ai signalé ; il en serait de même de la source à + 18°, en des circonstances opposées. Mais les eaux de la source à + 37°, par exemple, peuvent être souvent employées et, fussent-elles un peu trop chaudes, étant aspirées parle corps de pompe qui les saisit avant qu’elles aient rejeté leur bouillon en l’air, il est facile de les faire voyager dans des conduits de plomb plus ou moins longs qui leur permettent de se refroidir à l’abri du contact de l’air, sans rien perdre de leurs vertus médicinales.
Les eaux de Saint-Gervais, une fois découvertes, examinées, analysées, il fallut songer à leur applicacation, à leur emploi dans les maladies. MM. les professeurs Boissier, de La Rive, Jurine, Odier, Pictet et Tingry ayant été nommés, à cet effet, en 1807, par la Société d’histoire naturelle de Genève, disaient:
«Toutes les eaux dont la température est, jusqu’à un certain point, uniforme et supérieure à celle du corps humain, qui contiennent d’ailleurs des principes salins et solubles, et qui développent un gaz hydro-sulfureux, ont été reconnues utiles, soit en bains, soit en vapeurs, soit en douches, soit en boisson, pour différentes maladies chroniques, et particulièrement pour celles de la peau, pour les affections goutteuses et rhumatismales, et enfin pour celles qui ont leur siège dans les organes de la digestion. Les eaux de Saint-Gervais, possédant toutes ces qualités, auront probablement les mêmes effets:
1° Que celles de Schinznacht ou de Louëche qui sont celles où nous envoyons de préférence les malades atteints de dartres ou autres éruptions chroniques et rebelles;
2° Que celles d’Aix, en Savoie, où l’on va principalement pour la goutte, le rhumatisme et les faiblesses qui résultent fréquemment d’une attaque de paralysie;
3° Que celles de Plombières, où nous envoyons, pour l’ordinaire, les malades atteints de quelque obstruction abdominale.»
«J’ai reconnu, disait à la même époque M. le docteur Jurine, que l’effet des eaux de Saint-Gervais était fort doux; que les malades n’en éprouvaient aucune fatigue, et qu’ils pouvaient les prendre plusieurs jours de suite, sans aucune interruption. Je pense donc que ces eaux remplaceront utilement celles de Balaruc, et que l’humanité doit se féliciter d’une telle découverte.»
Le même savant écrivait trois ans après:
«Dès qu’une analyse exacte nous eut fait connaître la nature des eaux thermales de Saint-Gervais, je les considérai comme une espèce de trésor pour notre département (le Léman), et je m’attachai à en suivre les effets, soit en les donnant intérieurement, à la place de celles de Balaruc avec lesquelles elles ont beaucoup de rapport quant à leurs principes fixes, soit en les faisant administrer extérieurement en bains et en douches.
«Ces effets ont complètement répondu à mon attente: un grand nombre de mes compatriotes les emploient journellement pour se purger, et les cures qu’elles ont opérées sur des individus qui étaient surtout atteints de maladies cutanées, sont vraiment étonnantes. J’ai vu des dartres formidables qui avaient résisté à un traitement méthodique, se dissiper promptement par l’effet de ces eaux, de sorte qu’on pourrait dire qu’elles réunissent les avantages de celles de Courmayeur, à ceux de celles de Loueche (Vallais), puisque, comme ces dernières, elles poussent ordinairement à la peau, sans avoir besoin de prolonger autant la durée des bains ... Tout ce que j’ai vu relativement aux propriétés et à l’efficacité des eaux de Saint-Gervais, me porte à croire qu’il n’en existe pas en France de plus utiles, puisqu’elles réunissent le double avantage d’être assez purgatives à la dose de cinq ou six verres, et d’agir sur la peau comme hydrosulfureuses.»
Des cures remarquables répandirent promptement la réputation de l’Établissement naissant. M. le docteur Matthey a consigné les plus saillantes dans l’ouvrage fort intéressant qu’il publia, en 1818, sur les Bains de Saint-Gervais . Depuis cette époque, il put recueillir de nouveaux faits, grâce au concours des malades, qui s’accrut d’année en année, et aux améliorations successives qui durent être introduites dans le local et dans l’administration des bains: je ne parle pas des embellissemens ajoutés à une nature déjà si belle!
«On a employé les eaux de Saint-Gervais, dit Alibert, pour combattre les névralgies qu’on peut appeler chroniques, provenant de quelque vice intérieur qu’il importe d’expulser par les mouvemens artificiels d’une fièvre salutaire.... Leurs effets purgatifs sont salutaires aux hypocondriaques; elles agissent favorablement sur les estomacs fatigués par la dyspepsie. Quand l’appétit cesse de se manifester, quand l’abdomen se tuméfie et que les digestions sont laborieuses, quand une constipation opiniâtre attriste et tourmente les malades, elles sont manifestement indiquées, etc.»
Comme purgatives, toniques, diurétiques et révulsives, les eaux de Saint-Gervais, prises en boisson ou en bains et, le plus souvent, en boisson et en bains tout à la fois, administrées avec sagesse et perspicacité ; sont appliquées au traitement des maladies résultant de désordres des organes digestifs et d’autres viscères, des diverses affections du système nerveux, des affections rhumatismales et catarrhales, des affections cutanées, etc., toutes maladies que je m’abstiens de te détailler ici (B).
On dit souvent: «Lorsqu’un médecin a employé tous les moyens pour combattre vainement certaines maladies, ou bien, quand il a fait beaucoup d’expériences sur son malade, il se débarrasse de ses importunités, en l’envoyant aux eaux.» — Cela peut être vrai dans beaucoup de circonstances, et de la part de certains médecins, mais le malade, quand il va aux eaux qu’on lui a indiquées ou qu’il s’est choisies lui-même, outre ces eaux avec leur action salutaire, outre la nature, avec la coopération bienfaisante de ses sites, de son climat, de sa beauté et de tous ses autres élémens qui consolent l’esprit ou soulagent le corps, qu’y trouve-t-il? un médecin.
Le médecin des eaux minérales reçoit le nouvel arrivé qu’il n’a jamais vu, la plupart du temps, dont il n’a jamais ouï parler. Il faut bien qu’il s’en rapporte au pauvre malade souffrant depuis tant d’années, qu’à peine se souvient-il du début de l’affection, ou des affections diverses qui le dévorent. A peine aussi, bien souvent, peut-on lire la feuille négligée où son médecin a tracé à la hâte quelques indications sommaires. Il faut que le médecin des eaux interroge longuement, patiemment, qu’il cherche les fils nombreux des différens traitemens déjà subis, qu’il constate en lui-même leurs effets, qu’il les lie à l’état actuel, qu’il encourage, qu’il exhorte, qu’il relève le moral affaissé, qu’il jette dans l’imagination et dans le cœur la tranquillité et l’espérance. Et puis, il prescrit, il règle la marche que devra suivre la cure, et tout n’est pas fini; ce n’est là qu’un préambule, ce n’est que le premier pas. Ne craignez point que le regard vigilant et que la sollicitude du médecin des eaux abandonnent cet homme ou cette femme. Précautions préliminaires, hygiène, régime, accidens imprévus, durée, température des bains, des douches, de la boisson, etc., tout est surveillé, prévu, modifié, sagement combiné, et cela avec les mêmes soins pour tous les malades.
A côté des devoirs du médecin des eaux, il y a aussi des obligations aux-quelles est tenu le malade: sagacité et zèle pour le premier, obéissance et prudence pour le second.
Il y a des gens qui disent aujourd’hui: «Les personnes qui vont aux eaux ont l’avantage de jouir d’une bonne santé.»
Les eaux minérales, en général, sont en effet — et malheureusement — devenues un point de réunion pour les nombreux voyageurs qui, ne trouvant plus dans les grandes capitales les plaisirs turbulens de l’hiver, vont les faire renaître aux eaux, devenues dès-lors le centre des dissipations les plus licencieuses et des désordres les plus honteux, au sein d’un luxe effréné, des intrigues coupables, et du jeu enfin, de cette plaie hideuse que la France a rejetée loin d’elle. Ce n’est pas là assurément qu’il faut aller pour se guérir de ses maladies, ni pour se reposer de ses travaux, ni pour trouver des jours de calme, à l’abri des discussions et des querelles de l’ambition et de l’intérêt.
Ce qui distingue surtout Saint-Gervais, c’est que c’est là, avant tout, une maison de santé. Que la nature ait beaucoup fait dans ce but, c’est ce qui ne peut être contesté, et c’est pour cela que les malades forment l’immense majorité des baigneurs qui y séjournent. Les eaux de Saint-Gervais ne sont certainement pas une panacée, mais, d’après les observations déjà recueillies, d’après les faits établis et certains, d’après les résultats constatés, il est vrai que les malades qui y viennent maintenant, y sont envoyés avec un discernement remarquable par les médecins de Genève, de France, etc., de telle sorte que, presque toujours, si les succès ne répondent pas, dans certains cas, aux espérances conçues, c’est qu’il faut en attribuer la cause aux malades eux-mêmes, tandis qu’on a, au contraire, grand soin de la faire retomber directement sur les eaux thermales.
Bordeu déclarait incurable toute maladie qui avait résisté à l’action des eaux minérales appropriées; l’on pourrait ajouter que cette incurabilité s’étend sur toute maladie que l’on confie à leur action, sans prudence? sans prévoyance et sans conseils: les maladies s’en aggravent même quelquefois, inconvéniens qui se résument d’une manière pittoresque et vraie, dans ce dystique d’un ancien:
«Qui sinè prœceptis servandis balnea captat,
«In pertusa vagas dolta portat aquas.»
Si tu écoutes la tradition locale, on te dira que la cure est de 21 bains, après lesquels on peut s’en retourner. Comme s’il était possible de déterminer un nombre fixe de bains, en présence de tant de maladies et de constitutions diverses, des accidens qui peuvent intervenir pendant la cure, et qui obligent à une suspension, à des intermittences ou à une prolongation de traitement, etc.!
Je ne parle pas des abus et des excès où l’on peut tomber en activant immodérément sa cure, en outrant toutes les prescriptions médicales; je ne parle pas davantage des écarts de régime ou de la négligence des plus simples précautions hygiéniques. Les exemples sont innombrables de ces deux dernières fautes, qui ont souvent des suites funestes, et qui rappellent ce qu’écrivaient deux auteurs célèbres:
«L’hygiène n’est ni une science ni un
«art, c’est une vertu.»
«Prêcher la frugalité à des gens que
«l’abondance entoure, c’est prêcher la
«générosité à des avares. On dirait que
«nos grands et nos riches sont pressés
«de mourir.»
Il y a aussi des donneurs, et surtout des donneuses de conseils, comme on en rencontre, du reste, partout où il y a des malades. Tu entendras plus d’une fois, à Saint-Gervais, des conversations qui peuvent se réduire à ceci:
«Votre bain est trop chaud, — ou trop froid, — à tel degré..... Vous ne buvez pas assez d’eau, ma chère! croyez-moi, je connais cela: il y a quinze ans que je viens à Saint-Gervais. »
Car, pour donner ces conseils, il y a des dames qui vont jusqu’à dire leur âge vrai! — Je leur accorde d’ailleurs de très-bonnes intentions.
Et, il y a des malades qui ne consultent pas le médecin, et qui écoutent ces commérages, et s’y conforment avec une docilité charmante!
Un fait auquel doivent avoir égard les malades est observé, chaque année, à diverses eaux minérales, et particulièrement à Saint-Gervais; je veux parler de cette aggravation, de cette augmentation, de ce retour de douleurs que plusieurs ressentent dès le commencement, ou pendant la durée de leur cure. Cette exaspération dans les affections nerveuses, par exemple, donne quelquefois au caractère des meilleures gens du monde une acrimonie, une impatience, une rudesse insupportables et qu’il est bon, pourtant, de laisser se manifester, jusqu’à un certain point, sans croire, pour cela, les eaux nuisibles, et sans se laisser abattre par ces apparences trompeuses. Cette exacerbation, le plus souvent passagère, ainsi qu’on l’a dit cent fois, peut se prolonger jusqu’après le départ des malades qui, rentrés dans leurs foyers, éprouvent un amendement d’autant plus marqué que la crise a été plus forte. Cette excitation a besoin de se calmer, pour que le bienfait des eaux devienne sensible. Il est donc essentiel que les malades, en quittant les eaux, continuent, pendant un ou plusieurs mois, le régime prescrit tandis qu’ils en faisaient usage, et qu’ils s’abstiennent de tout remède actif. Il arrive malheureusement à presque tous les malades d’oublier tout cela dès leur sortie du vallon des Bains, de s’élancer dans des voyages longs et pénibles, au lieu de s’en retourner à petites journées, en saisissant, pour voyager les momens où les chaleurs sont moins fortes, et de se laisser aller à d’autres défauts de régime, qui détruisent tout le bon effet des eaux.
On voit bien souvent cet effet ne se manifester qu’au bout de quelques semaines et même de plusieurs mois. Les malades s’imaginant alors que les eaux ont été inutiles pour eux, ont recours à une médication nouvelle, qu’autorisent ou qu’ordonnent des médecins peu versés dans la manière d’agir des eaux minérales. Que s’en suit-il? que cette nouvelle médication contraire entrave et arrête la marche lente, cachée, mystérieuse des eaux, qui allait, quelques jours plus tard, porter d’heureux fruits. L’effet salutaire avorte et succombe, sous ces nouveaux moyens activement mis en œuvre, et c’est dans un corps épuisé parfois sous vingt années de ravages et de souffrance, que l’on a à livrer ce funeste combat. Et que fait-on encore alors? On se garde bien de blâmer l’imprudente impatience du malade; encore moins accuse-t-on le médecin: mais l’on s’en va criant que les eaux ne valent rien....
Certes, il ne faut point espérer que les eaux de Saint-Gervais, ou toutes autres, puissent, en une seule saison, ou même en plusieurs, détruire entièrement les germes de certaines affections chroniques depuis longtemps assimilées, pour ainsi dire, à toutes les parties de l’économie. Mais quand, à celui qui souffre sans relâche, à celui que des douleurs aiguës clouent sur son lit, à la moindre variation atmosphérique, quand elles ne donneraient que quelques mois, que quelques jours de soulagement et de repos vainement demandés à toutes les ressources de la médecine ordinaire, ne serait-ce donc rien?
Et c’est pour cela, sans doute, que tous les praticiens et les observateurs consciencieux ont grand soin de renvoyer et de renvoyer encore leurs malades aux eaux qui les ont, si non guéris, du moins calmés, tranquillisés. Que dis-je? les malades eux-mêmes y retournent, comme par instinct et par reconnaissance!...
Sur un autre sujet qui se rattache assez intimement aux divers moyens curatifs que la nature a départis à Saint-Gervais, je laisse parler M. le docteur Matthey:
«La position des Bains, dans le fond d’un vallon étroit, dominé par de hautes montagnes, semble, au premier coup-d’œil, devoir rendre ce séjour insalubre, soit en raison du peu de temps que le soleil l’éclaire, soit en raison du défaut des vents réguliers, à l’abri desquels le vallon est mis par les monts qui le bornent de tous côtés; soit, enfin, en raison de l’humidité atmosphérique qui doit résulter nécessairement de l’abondante quantité d’eau dont le sol est abreuvé.
«Cependant, après un examen plus approfondi, il sera facile de démontrer, par le fait même de la localité, que l’air qu’on respire aux Bains de Saint-Gervais est non-seulement salubre, mais qu’il a, en outre, des effets salutaires qui lui sont particuliers.
«D’abord, il est certain que l’humidité atmosphérique n’est pas ici de même nature que celle qui existe dans les lieux bas où croupissent les eaux froides et les substances végétales désorganisées; on sait que leurs émanations donnent à l’air des qualités nuisibles. A Saint-Gervais, au contraire, les vapeurs salino-sulfureuses qui s’élèvent constamment du sol, et se mêlent à l’air, donnent certainement à celui-ci des qualités salubres. — Un fait remarquable vient à l’appui de ce que j’avance; en 1803 et 1804, il régna dans tout le Faucigny une épidémie de fièvres intermittentes, et la seule vallée de Saint-Gervais en fut entièrement à l’abri.
«D’un autre côté, l’évaporation continue de l’eau thermale doit rendre la température de l’atmosphère et ses variations beaucoup moins sensibles que dans les lieux où cette condition n’existe pas. L’on sait généralement, et les observations particulières du docteur Percival et du professeur Odier ont démontré, que les années pluvieuses sont bien moins fécondes en maladies que les années de sécheresse.
«En troisième lieu, le cours rapide du torrent établit un courant frais qui se fait sentir, surtout le soir, après le coucher du soleil. Ainsi, il remplace très-efficacement le souffle impétueux du vent du nord ou la bise; il n’est point, comme celui-ci, nuisible par sa violence et par la sécheresse qu’elle occasionne dans l’atmosphère, et dont l’influence se fait sentir aux fibres délicates et irritables.
«.... L’air qu’on respire, après avoir passé le pont du Bonnant ( au Fayet ), à mesure qu’on s’approche de Sallanches, est sensiblement plus lourd. On voit, en effet, au coucher du soleil, s’élever, de plusieurs points de la vallée, des brouillards épais dont l’odeur marécageuse est très-sensible. Ce phénomène n’est point observé aux Bains et, d’ailleurs, leur situation les préserve entièrement de l’accès des vapeurs de la vallée.»
Il n’est peut-être pas inutile d’ajouter que la foudre n’est jamais tombée à Saint-Gervais et que, suivant la disposition des lieux, les personnes les plus craintives doivent se rassurer pour l’avenir.