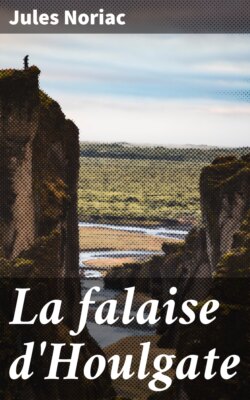Читать книгу La falaise d'Houlgate - Jules Noriac - Страница 3
I
COMMENT ON ÉTAIT EN BRETAGNE EN1748
ОглавлениеEn1749, la partie de la côte normande qui s’étend de Notre-Dame-de-Grâce de Honfleur à la pointe de Courseuil, était confiée à la garde d’un capitaine nommé M. de Cerny.
La destinée avait été cruelle pour ce pauvre gentilhomme.
D’une famille ancienne, autrefois riche et toujours estimée du Beauvoisis, il était entré dans le monde par la porte dorée.
A peine débarqué à la cour, après de nombreux voyages en mer il avait, avec une facilité singulière, lié commerce d’amitié avec les plus grands seigneurs du temps.
L’un d’eux surtout, le prince de Clamont, lui avait témoigné une affection particulière.
M. de Cerny était admirablement favorisé de la nature, il était jeune «et fait le mieux du monde,» comme on disait alors.
Il possédait toutes les qualités qui distinguent, ou plutôt qui devraient distinguer un homme de condition. Il joignait le sang-froid au courage, l’adresse à la force, n’était point ignorant des choses de la guerre, facultés plus aimables, il avait un grand cœur et n’était pas sans esprit.
Malgré toutes ces brillantes qualités, ce n’était, après tout, qu’un simple gentilhomme, les Huon de Cerny n’étaient même pas titrés.
Aussi cette amitié subite d’un prince, qui tenait au roi par les liens du sang, pour un simple cadet de province, ne laissa-t-elle pas d’étonner une cour qui, hélas! depuis longtemps, était habituée à ne s’étonner de rien.
Cette amitié tant commentée, calomniée même, avait une origine bien simple et bien naturelle.
M. de Cerny avait eu la bonne fortune de sauver la vie du prince en risquant la sienne, dans une aventure qui devait à tout jamais demeurer secrète.
Sauver la vie d’un prince n’est point une action étonnante de la part d’un gentilhomme; mais savoir se taire après l’avoir accomplie, est certainement chose bien plus rare.
M. de Cerny ne tomba pas dans les pièges que sa vanité dut lui tendre; il fut discret.
Le prince ne lui fit aucun remercîment. Il ne lui dit rien, sinon qu’en toute occasion il pouvait faire état de lui.
Aussi bons que soient les princes, il y a toujours du danger à leur rendre service. M. de Cerny le vit bien, lorsqu’un matin, sans l’avoir demandé, il reçut du roi le commandement de la Minerve, frégate de haut pont qui devait prendre la station des îles Saint-Louis.
M. de Cerny n’était pas riche, il accepta. Son voyage ne fut pas heureux; blessé en arrivant, il eut les fièvres du pays, et le maître chirurgien de la frégate alla même jusqu’à déclarer, après sa guérison, que le capitaine avait un poumon offensé.
De retour en France, M. de Cerny revint à Versailles, où personne, le prince étant absent, ne reconnaissait ce pauvre officier jaune, maigre et chancelant.
Les gens de cour n’aiment pas ceux qui souffrent, parce que cela leur rappelle que la douleur luit pour tous.
Le malheureux gentilhomme commençait à désespérer. Ses faibles ressources s’épuisaient, et M. de Clamont ne revenait pas.
Heureusement une dame, qui n’avait pas été insensible aux charmes de sa jeunesse, en écrivit au prince. Celui-ci écrivit au roi, et, au moment où M. de Cerny avait perdu tout espoir, il apprit que Sa Majesté lui accordait une des rares charges qui ne se vendaient point en ce temps-là, celle de trésorier de l’escadre.
Désormais fixé sur la terre ferme, M. de Cerny épousa une fille noble de la famille de Penkoëck, de Brest, ville où était sa trésorerie.
Après trois années de mariage, il devint veuf.
Il adorait sa jeune femme, modèle de grâce et de vertu. Son désespoir fut extrême. Il pleura toutes les larmes de son cœur et de ses yeux, pensant bien qu’il n’avait plus besoin de larmes, et que, après ce malheur, aucun malheur plus grand ne saurait l’atteindre.
Le pauvre gentilhomme se trompait: d’autres douleurs plus grandes s’amoncelaient à l’horizon de sa vie.
Deux ans après la mort de sa femme, il reçut ordre d’embarquer sur-le-champ une flottille qui devait croiser dans les eaux de la Manche.
M. de Cerny se rendit à l’Amirauté, et fut obligé de déclarer qu’il n’était pas en mesure d’exécuter l’ordre transmis. Pressé de questions, il avoua qu’un déficit de quatre-vingt mille livres existait dans les caisses de la trésorerie. Sommé de s’expliquer, il ne s’expliqua pas.
Les bruits les plus contradictoires coururent parmi la noblesse de la ville. Le vieux baron Le Bellic de Penkoeck assembla les membres de sa famille et ses amis pour tâcher, en cherchant dans toutes leurs poches, de sauver l’honneur d’un gentilhomme qui avait été leur allié.
Hélas! les poches de tous ces bons Bretons étaient pleines d’honneur, de dévouement et de bonne volonté, mais d’argent, point!
Les Bretons logent tous le diable en leur bourse. C’est ce qui les rend si dévots.
Quelques parents offrirent bravement d’engager des terres, mais, outre que ces terres étaient pour la plupart des grèves sans fin ou des landes bornées, il eût fallu du temps pour trouver des prêteurs et accomplir les formalités. La coutume de Bretagne n’est pas tendre aux emprunteurs. Or, comme le scandale était imminent, il n’y fallait pas songer.
Donc, la quinzaine franche avait été donnée au trésorier pour rendre ses comptes, et le dernier jour était arrivé avec une rapidité effrayante.
Le matin de ce quinzième jour, M. de Cerny, qui jusque-là avait été fort accablé, se releva tout à coup. Dès l’aube, il mit son bel uniforme de drap bleu au large collet rouge fleurdelisé d’or, il prit sa plus belle épée, ses gants les plus frais, alla entendre la messe, et revint dans son logis, le visage calme et tranquille. Il s’assit à sa table et écrivit la lettre suivante:
«A M. le baron Le Bellic de Penkoëck, en son château de Penkoëck.
» Monsieur le baron,
» Mon beau-frère, le jeune chevalier de Penkoëck, votre fils, que pour complaire à ma femme regrettée, et à vous, monsieur, j’avais attaché à la trésorerie, vient de passer aux Indes après avoir soustrait quatre-vingt mille livres confiées à ma garde. La passion du jeu l’a poussé à cet acte odieux. Puisse Dieu lui pardonner comme je lui pardonne moi-même! Peut-être la trop grande confiance que j’ai eue en ce jeune homme lui a-t-elle facilité son crime. Je m’en accuse, afin que, si plus tard il venait à s’amender, l’aveu de mon aveuglement vous puisse à votre tour faciliter le pardon.
» Je vais mourir, ne voulant pas survivre à mon honneur. Mais, monsieur, je viens vous adresser une prière. Je voudrais qu’en échange de ma vie, que je vais sacrifier pour l’honneur de votre famille, vous me rendissiez le service d’aller trouver monseigneur le prince de Clamont et de l’instruire sincèrement des causes de ma mort. Je suis sûr que le prince n’hésitera pas à engager sa parole de vous en garder le secret. Je sais tout ce que la démarche que j’ai l’honneur de vous prier d’accomplir aura de cruel pour vous. Mais, monsieur, je vous supplie de considérer quel ne serait pas mon désespoir, si je mourais en pensant qu’un aussi grand prince, qui m’a comblé de bienfaits, pourrait charger ma mémoire d’un forfait dont je suis innocent.
» J’ose espérer, monsieur, que vous voudrez bien épargner cette cruelle disgrâce à celui qui a l’honneur de se dire,
» Monsieur le baron,
» Votre très-humble serviteur,
» TIMOLÉON DE CERNY.»
Le chevalier plia, cacheta la lettre. Puis il se leva, prit un pistolet dans une boîte de chêne. Il ouvrit la batterie, fit flamber quelques grains de poudre pour s’assurer que la pierre était bonne, et que la lumière n’était point obstruée.
Avec le même sang-froid, le chevalier chargea son arme académiquement, c’est-à-dire après avoir mesuré minutieusement la charge de poudre et bourré la balle avec la baguette par trois mouvements réguliers.
Après cela, il prit le pistolet de la main gauche, et porta la droite à son front en disant:
–Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit…
– Amen! répondit la voix rieuse d’un homme qui venait d’ouvrir la porte.
–Monseigneur! fit M. de Cerny atterré.
–Oui, chevalier, moi-même, et, sarpediable! il paraît que j’arrive à temps.
–Ma foi, oui, monseigneur: une minute plus tard, je n’aurais pas pu dire à Votre Altesse combien je suis son serviteur.
–Je le vois pardieu bien! Voici une lugubre histoire, chevalier. Offrez-moi un siège et contez-moi donc cela, je vous prie!
–C’est triste à dire, triste à entendre, monseigneur.
–Tant pis, chevalier; mais j’ai fait cent soixante lieues pour savoir, et je désire savoir.
–J’allais mourir, monseigneur, et je n’avais qu’un regret: je craignais que Votre Altesse ne gardât un mauvais souvenir de celui à qui elle daigna donner son amitié. Dans cette lettre, je priais le chef de ma nouvelle famille de vous instruire des causes de ma mort. Que Votre Altesse daigne donc lire cette lettre, elle m’épargnera un récit amer et douloureux.
Le prince déchira l’enveloppe de la lettre et lut rapidement.
–Ah! mon pauvre chevalier, s’écria-t-il, mes pressentiments ne m’ont donc pas trompé!
Et oubliant son rang, il pressa le gentilhomme dans ses bras.
Le prince de Clamont avait à cette époque de vingt-huit à trente ans. Grand, élancé, il portait la beauté et la grâce que ceux de sa race ont communiquées même à leurs bâtards.
Le jeune prince possédait, plus que personne, ce type bien connu qui, depuis Henri IV, semble protester contre les historiettes licencieuses qui eurent pour héroïnes les femmes alliées à l’illustre maison de France. Il tenait de sa mère ce regard doux et voilé de ceux qui doivent mourir jeunes. Il suffisait de le voir pour se sentir attiré vers lui par une sympathie irrésistible, mais qui n’excluait ni le respect, ni la déférence.
Par une délicatesse charmante, il avait revêtu l’habit bleu, la veste et la culotte rouge des officiers de marine. Il ne portait ni épaulettes ni broderies.
Oubliant son titre de colonel du régiment des Vaisseaux, il avait voulu venir chez son malheureux ami comme un égal et surtout ne donner aucune prise à la curiosité.
Après s’être tenus longtemps embrassés, les deux gentilshommes se regardèrent avec des sentiments bien différents.
Le prince semblait rayonner de bonheur, le chevalier était en proie à une profonde tristesse.
–Allons, mon cher Cerny, dit le prince, rappelez le sourire sur vos lèvres pâles; vos quatre-vingt mille livres sont entre les mains du trésorier général; remettez à votre côté cette loyale épée; allez rassurer votre famille, et demain, après m’avoir consacré cette journée que vous me devez bien, vous reprendrez vos occupations.
–Hélas! monseigneur, Votre Altesse me pénètre de reconnaissance par ses bontés, mais tout cela est impossible. L’argent ne répare point l’honneur. Ma honte est publique. La noblesse de la ville et les officiers de l’escadre ne me salueront plus.
–Au diable! vous direz la vérité.
–Jamais, monseigneur, je l’ai juré.
–A qui?
–A moi.
–Mais sarpediable! déliez-vous d’un serment ridicule.
–Un serment n’est ridicule que lorsqu’on ne le tient pas, Votre Altesse sait cela mieux qu’homme de France. D’ailleurs, pour sauver mon honneur, il faudrait perdre celui de toute une famille, et je n’en aurais point le courage, quand bien même j’en aurais le dessein.
–Certes, reprit le prince, j’apprécie vos scrupules; mais, ne vous semble-t-il pas, chevalier, que votre propre famille doit passer avant celle des autres?
–Ma famille ne fit jamais rien pour moi, celle-ci m’avait donné un ange.
–Dieu vous l’a repris; vous êtes quittes.
–Monseigneur, ma résolution est inébranlable; grâce à vous, je puis vivre encore, mais je m’exilerai; si vous le voulez bien permettre, je partirai sur-le-champ.
–Encore faut-il que les vôtres sachent votre sacrifice.
–C’est inutile, monseigneur, il y a là un pauvre et noble vieillard qui mourrait de chagrin.
–Soit, dit le prince après un moment de silence. Partez donc, puisque vous le voulez. Je ne puis rien vous ordonner. Vous êtes mon obligé. Mais partez vite, car, sarpediable! je ne sais si j’aurais la force de vaincre longtemps le désir que j’ai de raconter cette histoire à toute la ville et de crier sur les toits combien je vous aime.
Le prince venait à peine de prononcer cette cavalière et cordiale imprécation, que la porte s’ouvrit et qu’un vieillard, accompagné d’une quinzaine de personnes, apparut sur le seuil.
Ce vieillard était le baron Le Bellic de Penkoëck.
Il se tint un instant sur la porte et s’avança gravement.
C’était un homme sec, petit et ridé. De longs cheveux blancs tombaient sur son épaule. Son habit de velours vert bouteille marquait une autre époque. Il s’appuyait sur une grande canne à pomme d’argent, et, sans une épée trop longue pour sa taille, on l’eût pris plutôt pour un honorable bourgeois que pour un vénérable gentilhomme.
–Entrez tous, cria-t-il d’un ton de commandement à ceux qui l’accompagnaient. Puis, s’adressant au prince:
–Monsieur, lui dit-il, nous venons ici régler une affaire de famille, affaire d’importance, croyez-le bien; ne trouvez donc pas mauvais, je vous prie, que je vous exprime le désir que nous avons de ne pas mêler un étranger à des choses qui doivent demeurer entre nous.
M. de Cerny allait nommer le prince, lorsque celui-ci, qui avait deviné son intention, mit son doigt sur ses lèvres pour lui ordonner le silence.
Le prince se leva et salua le vieillard.
–Monsieur le baron, dit-il, je crois que nul plus que moi n’a le droit de rester ici, en cette circonstance comme en toute autre; je suis le frère de M. de Cerny.
–Souffrez, répondit le vieillard, que je ne vous en congratule point.
Et, tournant le dos, il dit au chevalier:
–Monsieur de Cerny, le marquis de Kerven, mon parent, mon ami, mon ancien frère d’armes, le marquis de Kerven, l’exemple et l’honneur de la noblesse de Bretagne, apprenant la triste conjoncture où se trouve ma famille par suite d’une faute qui lui est étrangère, a bien voulu nous prêter pour dix ans, et sur parole, une somme de trois mille louis, qui nous a aidés à parfaire les quatre-vingt mille livres que vous devez à la trésorerie de l’escadre du roi.
–Monsieur… fit M. de Cerny, veuillez…
–Ne m’interrompez pas, je ne serai pas long. Voici cette somme. Vous allez précéder nos gens qui la portent, et la déposer vous-même ès-mains de M. le trésorier général.
M. de Cerny voulait parler. Le vieillard l’arrêta d’un geste brusque.
–Ne m’interrompez pas, vous dis-je. Ce n’en est pas la peine. Il vous plaira d’en tirer reçu, car vous déposerez en même temps votre démission; n’est-ce pas, monsieur? Cela fait, vous partirez sur l’heure, vous quitterez la France. Vous vous y engagez?
–Je m’y engage, répondit M. de Cerny.
–Comme après l’action que vous avez commise, nous avons le droit de douter de votre parole, deux de nos parents vous conduiront à la frontière ou sur un navire en partance.
–Monsieur, s’écria le chevalier, sans vous en douter, vous commettez vous-même une action bien détestable.
–Je n’ai que faire de vous répondre, j’ordonne.
Le prince se mordait les lèvres et aurait probablement éclaté sans le regard suppliant de son ami.
–Monsieur, reprit M. de Cerny avec une vive émotion, vous ordonnez, et j’obéis. Vous m’imposez silence, et je me tais. Mais je veux que vous sachiez que c’est par respect pour vous, et aussi parce qu’il ne me plaît point de me défendre. Je partirai, soit; c’était du reste mon dessein; mais je me permets de vous faire observer que je pars de mon plein gré, et que s’il n’en était ainsi, ce ne serait certainement ni la présence de ces messieurs, ni leur volonté qui pourraient m’y forcer.
–Je n’ai pas, Dieu merci, à discuter avec vous, s’écria le vieillard. Mais, que me venez-vous dire, je vous prie? Tenez, j’ai voulu vous ménager en souvenir de celle qui n’est plus; vous ne méritiez pas de tels ménagements, dictés par un excès de délicatesse. Vous devez la vie, sachez-le, aux vives instances de notre cousin, M. l’archiprêtre de Saint-Bruno. Moi et les miens que voici, nous vous avions condamné à mort.
Cette fois, le prince ne put se contenir. Il poussa un formidable éclat de rire.
–Sarpediable! bonhomme, s’écria-t-il, comme vous y allez!
Les assistants s’attendaient si peu à cette sortie, qu’elle produisit parmi eux une véritable stupéfaction. Le prince en profita pour continuer.
–En votre vieux nid de pierres de Penkoëck, vous avez peut-être droit de haute et basse justice. Je ne veux pas vous contester ce droit un peu bien caduc, M. le baron, mais Brest est une ville du roi, je pense!
–Un gentilhomme est justicier partout où son honneur est attaqué, fit M. de Penkoëck avec véhémence.
–Voilà qui simplifie la question, continua le prince, toujours souriant; mais en vérité, ce serait trop facile…
Un violent murmure accueillit les paroles de M. de Clamont qui continua sans paraître avoir rien entendu:
–D’abord, monsieur, lorsqu’un gentilhomme, un chef de famille se fait justicier, son premier devoir est d’être équitable. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous venez de traiter M. de Cerny, qui est gentilhomme d’aussi bonne maison que la vôtre, monsieur de Cerny, qui est ici chez lui, comme un lieutenant de la prévôté ne traiterait pas un manant rogneur d’écus ou faussaire.
–M. de Cerny, reprit sourdement le baron de Penkoëck, affectant de ne point vouloir répondre directement au prince, dans deux heures vous aurez quitté Brest; ces messieurs vous accompagneront. Il eût été plus convenable de nous éviter les apostrophes déplacées de monsieur l’officier, qui me paraît maintenant être plutôt votre complice que votre frère.
Le prince rougit légèrement, mais il reprit bien vite son sourire railleur.
M. de Cerny, lui, avait pâli en entendant l’affront brutal fait à ce proche parent du roi qui venait de lui donner tant de marques d’affection.
Il allait éclater lorsqu’à son tour le prince le retint.
–Ne vous emportez pas, chevalier, s’écria-t-il. Les injures de ce brave homme ne sauraient m’atteindre…
–Quelles sont les injures qui pourraient atteindre des gens tels que vous? demanda le vieux baron avec une ironie amère.
–Celles que vous méritez, monsieur, répondit sévèrement le prince.
–C’en est trop I s’écria le baron en portant la main sur la garde de son épée. A moi Penkoëck!…
–Laissez votre vieille brette au fourreau, bonhomme, repartit M. de Clamont; et vous, messieurs les parents, tenez-vous en place, ou sarpediable! j’aurais le regret de casser la tête au premier d’entre vous qui ferait un pas de plus.
Le prince avait pris le pistolet que M. de Cerny venait de charger une heure avant.
–Voici donc cette vieille loyauté bretonne dont on parle tant! dit-il avec hauteur. Quoi, messieurs, vous, si jaloux de votre honneur, vous vous mettez à vingt pour charger un seul homme? En vérité, ce serait à n’y pas croire, si on ne le voyait. Oh! ne craignez rien, je ne vous échapperai pas. Si tout à l’heure l’un de vous me veut trouver, il me trouvera, je le promets. Mais en attendant, il me plaît de ne pas vous laisser commettre un acte odieux, plus qu’odieux, stupide! Assez d’abnégation comme cela. Cerny, parlez, c’est moi qui vous l’ordonne.
–Monseigneur, de grâce.
–Parlez, vous dis-je; je le veux. Vous vous taisez? Eh bien, je parlerai, moi. Et, tout d’abord, messieurs de Bretagne, quittez vos airs sinistres et démasquez la porte. Personne ne songe à fuir ou à appeler à son aide les gens du roi, et quelle que soit la mauvaise opinion que vos allures puissent donner de vous, je ne suppose pas que votre intention soit de vous mettre à vingt pour expédier deux gentilshommes.
–Monsieur, dit un jeune homme pâle et vêtu de noir, je ne sais ni qui vous êtes ni ce que vous voulez; mais vous me semblez embrouiller singulièrement nos affaires de famille.
–C’est vrai, dirent les assistants, qui jusque-là, étonnés par la désinvolture du prince, n’avaient manifesté leurs impressions que par des gestes et des murmures.–
–Tout à l’heure, reprit le jeune homme, vous avez dit que vous étiez le frère de M. de Cerny. M. de Cerny n’a plus de frère; donc vous avez menti.
–Mon jeune monsieur, répondit le prince, vous avez mal entendu. J’ai dit qu’en toute circonstance je servirais de frère au chevalier, ce qui n’est point la même chose.
Ce démenti, auquel le prince répondait sans colère, faillit changer complétement la situation. Les bons Bretons qui, malgré eux, se sentaient attirés vers lui, murmurèrent de plus en plus. Pour eux, un homme acceptant un tel affront le sourire aux lèvres, perdait sans retour le prestige que ses bonnes façons avaient pu lui donner.
Le jeune homme grandissait dans leur esprit: ils le trouvaient brave et clairvoyant.
Le vieillard, entêté comme un vieillard et comme un Breton, vint encore brouiller les cartes.
–Taisez-vous, monsieur de Saint-Caprais, s’écria-t-il; moi seul ai le droit de parler ici.
–Pourquoi? demanda le prince, toujours railleur. Ce jeune monsieur parlait, ma foi, très-bien.
–M. de Cerny, reprit gravement le vieillard, les mesures que j’avais prises tendaient à sauvegarder l’honneur de la famille et aussi à vous garder contre vous-même. Au lieu de réparer votre faute, vous trouvez plus naturel de vous soustraire à mon autorité et de me faire insulter par un homme que vous n’osez nommer. Soit, monsieur. Nous subirons ce second affront, comme nous avons subi la première tache qui, grâce à vous, ait souillé notre nom. Messieurs, fit-il en se tournant vers les siens, portez cet argent à qui il est dû, et laissons M. de Cerny continuer en France, à Brest même, si cela lui plait, à perdre l’honneur que notre argent lui laisse.
–A la bonne heure! s’écria le prince; voilà qui est parler. Mais évitez-vous toute peine, messieurs. Voici une décharge en règle qui atteste que M. de Cerny ne doit rien à personne.
Le jeune homme pâle lut le papier que le prince tendait au vieillard, et puis il s’écria:
–Sur ma foi, mon oncle, c’est bien la vérité!
Le baron prit à son tour le papier et l’examina avec une attention pleine de méfiance.
–En effet, dit-il, ceci est en règle. Partons, messieurs…
–Un instant, fit le prince, voilà une heure que vous torturez le plus vertueux et le plus infortuné des hommes. Avant de le quitter ne lui adresserez-vous point, sinon quelques paroles d’excuses, au moins quelques mots de regrets?
Il se fit un silence.
La plupart des assistants eussent volontiers tendu les mains à leur allié; mais aucun d’entre eux n’osait commencer avant que le chef de la famille n’eût décidé.
–Monsieur, dit le baron, si, grâce à un expédient que j’ignore, et que je ne veux pas connaître, M. de Cerny a comblé le déficit qu’il avait laissé dans les caisses du roi, je n’ai rien à dire. Mais il n’en résulte pas moins un fait certain, c’est que ce déficit a existé. Comme je demeure convaincu que M. de Cerny n’a pu, par lui-même, payer cette somme, puisqu’il n’a point de fortune, je garde sur lui mon opinion première. Quel que soit le dénouement de cette triste affaire, je le tiens encore pour un gentilhomme déloyal.
–Monsieur le baron Le Bellic de Penkoëck, dit gravement le prince, je prends les vôtres à témoin que j’ai fait tout ce qu’il était humainement possible pour vous épargner une grande douleur. Mais puisque rien ne peut dompter votre vanité et votre entêtement, je vais vous nommer le coupable.
–J’attends, monsieur, fit le baron.
–Le coupable…
M. de Cerny renouvela ses muettes supplications, mais le prince fit un geste d’autorité suprême et reprit:
–Le coupable est celui qui devrait être là pour accuser en votre lieu et place, baron; le coupable s’appelle Honorat de Penkoëck.
–Mon fils! s’écria le baron, mon fils! Et le pauvre vieux gentilhomme se prit à trembler de tous ses membres, ses dents se mirent à claquer comme les deux os de la cliquette d’un lépreux, et de grosses larmes tombant de ses yeux se dispersèrent dans les rides profondes qui sillonnaient son visage.
Les parents de M. de Penkoëck se regardaient consternés.
–Mais non! ce n’est pas possible! ce n’est pas possible, dit le baron en se relevant avec énergie. Mon fils n’a pu commettre une semblable action. Vous mentez!…
–Pourquoi n’est-il pas là?
–Il est parti pour Versailles, où il était mandé. Ah! vous voyez bien que vous êtes un imposteur! Vous voulez profiter de son absence pour l’accuser? Vous vous êtes dit: Il n’est pas là, je vais l’accuser? Ah! messieurs, je comprends tout maintenant.
Le baron se tourna vers les siens.
–Quoi! dit-il, Honorat est accusé, et vous ne vous levez pas tous, pour dire à cet homme qu’il ment!
Mais les parents baissaient les yeux sans rien répondre.
–Si c’était vrai, pourtant! fit le vieillard désespéré. Mais non, cela ne peut pas être! Cerny, s’il vous reste encore une goutte de sang noble dans les veines, dites la vérité; ne laissez pas accuser le frère de celle qui vous aimait tant. Cerny, vous m’appeliez jadis votre père; Cerny, je vous ai donné mon Élise, ce que j’avais de plus cher au monde. Tenez, je vous pardonnerai, je vous le jure: jamais je n’aurai pour vous un mot de reproche. Je jure! vous savez que je sais tenir un serment, tout le monde le sait. Que puis-je donc dire pour vous toucher? Dites que c’est une imposture; dites que ce jeune gentilhomme a voulu se rire de moi, punir ma vanité. Oui, c’est cela, il l’a dit lui-même qu’il voulait «punir ma vanité bretonne». Dites ce que vous voudrez, enfin, mais parlez, parlez donc! Je vous en supplie, Cerny, si vous ne voulez que je meure de honte et de chagrin.
Le chevalier baissait la tête sous le coup d’une profonde émotion.
–Vous vous taisez. C’est donc vrai?
–Hélas! monsieur, j’ai fait ce que j’ai pu pour vous épargner cette douleur. Pourquoi faut-il que vous m’ayez empêché d’accomplir un sacrifice qui vous eût évité tant de douleur?
–Mais, fit le malheureux père qui cherchait à se cramponner à un espoir, quelque léger qu’il fût, si Honorat a pris cet argent, comment se fait-il que vous l’ayez pu rendre, vous, M. de Cerny, qui n’en avez point?
–L’argent n’a pas été rendu par moi.
–Par qui?
–Par Son Altesse, monseigneur le prince Henry de Clamont, que voici.
–C’est la vérité, dit le prince.
Les Bretons, qui venaient d’éprouver tant de sensations diverses, s’inclinèrent troublés en entendant prononcer le nom d’un prince du sang.
–Monseigneur, pardonnez-moi, dit le baron avec effort. J’ai été cruel pour M. de Cerny. Hélas! je voulais par un châtiment terrible donner une leçon sévère à mon fils, que je soupçonnais de légèreté. Pardonnez-moi d’avoir manqué au respect qui vous est dû: je ne connaissais point Votre Altesse.
–Je vous pardonne, monsieur, et vous plains de tout mon cœur.
–Avec cette somme qui vous est due, acceptez, monseigneur, la reconnaissance de ma famille. Grâce à vous, le crime d’un Penkoëck demeurera peut-être ignoré.
–Vous ne me devez rien, monsieur le baron. J’avais donné cette somme à mon cher ami M. le chevalier de Cerny.
Le baron renouvela en pleurant sa gratitude. Cerny, le prince et les membres de la famille essayèrent de consoler ce père infortuné, en lui garantissant un secret inviolable, en lui donnant l’espoir que son fils exilé s’amenderait peut-être.
Le vieillard écoutait sans entendre; il ne voulait pas être consolé.
Il partit.
En entrant, il traînait ses années; en sortant, ses années le traînaient.
Les siens le suivirent. Au moment où le jeune homme pâle, qui était le dernier, allait franchir le seuil de la porte, le prince le rappela.
–Monsieur de Saint-Caprais?
–Monseigneur.
–Vous m’avez donné un démenti tout à l’heure; ne vous en souvient-il pas?
–Oh! si, monseigneur. J’espérais qu’une aussi sotte injure ne saurait vous atteindre.
–Vous vous trompiez.
–Acceptez, monseigneur, mes regrets bien sincères.
–Vos regrets?
–Mes plus humbles excuses.
–Pouah! monsieur, quels vilains mots vous venez de prononcer là!
–C’est vrai, monseigneur; mais je m’en console parce que je ne les ai jamais dit et que je ne les dirai plus.
–Si je ne me contentais pas de vos excuses, monsieur de Saint-Caprais?
–Ma vie, monseigneur, appartient à Votre Altesse.
–Allez, monsieur. Je vous fais compliment: vous êtes prudent pour votre âge. Vous vivrez vieux!
Le jeune homme plus pâle que jamais salua sans rien ajouter et sortit à reculons.
–Triste sire! dit le prince.
–Peuh! fit Cerny, il ne faudrait pas s’y fier.
Les deux amis causèrent pendant quelques instants.
Le prince engageait fort le chevalier à demeurer à son poste. Celui-ci lui représentait que c’était impossible, que le mal était sans remède.
Pour tout au monde, il était bien décidé à ne pas révéler le nom du coupable. Il n’avait d’ailleurs aucune preuve. Honorat était parti, et bien des gens trouveraient extraordinaire que le chevalier se fût laissé accuser si longtemps sans rien dire. La noblesse bretonne se soutenait fort et ne manquerait pas de l’accabler de préférence, lui étranger. Dans tous les cas, il prévoyait de nombreuses offenses, et il ne se sentait nullement en disposition de ferrailler avec tous les gentilshommes du pays et les officiers de l’escadre.
Il fut décidé que le chevalier partirait avec le prince qui obtiendrait facilement quelque emploi pour son ami dans une autre province.
Le prince et le chevalier sortirent.
Le prince n’avait pas voulu laisser son protégé seul en son logis et l’avait prié de l’accompagner jusqu’à l’intendance, où il allait donner à ses gens des ordres pour le départ.
Comme Cerny et son protecteur traversaient le mail, deux officiers, que le premier avait connus à bord de l’Astrolabe, passèrent auprès d’eux.
Le chevalier leur ôta courtoisement son chapeau.
Le prince, qui était la bonne grâce même, en fit autant.
Les deux officiers passèrent en regardant fixement M. de Cerny, mais ils ne saluèrent point.
–Voyez, monseigneur, fit le pauvre gentilhomme profondément froissé, quand je vous disais que je ne pouvais plus rester ici.
–Sarpediable! répondit le prince, voilà sur ma foi de bien sottes gens.
–Non, monseigneur, ce sont de braves officiers. Mais, que voulez-vous? à moins de crier toute cette histoire sur les toits, je n’en sortirai jamais.
–Dites-moi, chevalier, il me vient une idée.
–Laquelle, monseigneur?
–Si nous allions apprendre la politesse à ces messieurs?…
–En leur trouant la peau, n’est-ce pas?
–Vous l’avez dit.
–Hélas! monseigneur, j’y avais bien pensé, mais cela ne servirait à rien; d’ailleurs, ce serait trop long.
–Vous croyez qu’un bon exemple ne suffirait pas?
–J’en suis sûr. Votre Altesse ne connaît pas ces hommes-là. Tenez! fit le chevalier qui venait par hasard de tourner la tête, voici M. de Saint-Caprais, mon parent, qui leur présente ses compliments et les félicite sans doute.
–C’est impossible.
–Rien n’est plus vrai.
–Comment pourrait-il les féliciter de leur parti pris d’impolitesse envers vous, mon cher chevalier? il l’ignore. En vérité, vous vous forgez des visions.
–Hélas! non, M. de Saint-Caprais a tout vu. Il était à la porte du jeu de paume; je l’avais remarqué. En me voyant pâlir sous l’affront, il a souri.
–Bast! qu’importe, un de plus ou un de moins! et celui-ci surtout qui est un drôle bilieux et poltron.
Le chevalier ne répondit point. Il se contentait de guider le prince.
A l’intendance, les choses se passèrent mieux qu’on n’aurait pu l’espérer.
L’incognito du prince avait été trahi par les familiers, si bien que, lorsqu’il entra, le délégué du gouverneur s’élança à sa rencontre et que toutes les têtes se découvrirent comme par enchantement.
M. de Cerny tenait son chapeau sous son bras. Il était donc impossible qu’il lui arrivât une nouvelle disgrâce.
Quand le prince se couvrit, par une de ces attentions délicates que les grands savent trouver quand ils aiment leurs favoris ou qu’ils se veulent faire des amis, il prit Cerny sous le bras.
Manquer de respect à l’un eût été manquer à l’autre.
–Tout le monde sentit la situation.
Les ordres ayant été donnés pour que le départ du prince pût s’effectuer le matin au point du jour, Cerny demanda permission d’aller faire, lui aussi, ses préparatifs de voyage.
Le prince s’y opposa.
Soit qu’il craignît quelque rencontre désagréable, soit qu’il eût peur que le chevalier ne prît quelque parti extrême, il n’y voulut pas entendre.
Il donna au chevalier un de ses gens, homme intelligent, qui fut chargé de vendre tout ce qui ne serait pas armes ou habits, excepté toutefois une cassette enfermant quelque argent et des papiers de famille.
Le lendemain, le soleil n’était pas levé que le prince se mettait en route. Cerny, monté sur un beau normand blanc, marchait silencieux à côté de M. de Clamont, qui, par délicatesse sans doute, ne lui parlait pas, afin de ne le point troubler dans ses méditations.
La suite du prince était peu nombreuse. Elle se composait d’un coureur qui trottait devant à cinquante pas, d’un gentilhomme de la maison du prince, d’un officier du régiment des vaisseaux et de deux écuyers domestiques.
La petite troupe était à peine sortie de la ville, que le coureur s’arrêta.
Les gentilhommes piquèrent des deux pour s’enquérir.
Lorsqu’ils arrivèrent, le coureur avait mis pied à terre. Tout le monde l’imita afin de lui prêter aide. Il s’agissait de porter secours à un gentilhomme grièvement blessé.
–Quoi, s’écria Cerny, c’est vous, monsieur de Brucourt? Dans quel triste état n’êtes-vous pas?
–Hélas! oui, chevalier, et bien que ce soit vous qui en soyez la cause, je suis heureux de vous voir. Cela m’aurait fort ennuyé de mourir sans vous faire mes excuses. Embrassez-moi donc, je vous prie, et me pardonnez mes offenses comme je les pardonne moi-même à ceux qui m’ont offensé.
L’un des écuyers du prince, qui était quelque peu chirurgien, avait ouvert la veste du blessé, étanché le sang et lavé la plaie avec une eau hémostatique.
Cela fait, M. de Brucourt avait été assis commodément sur un tertre.
Le bon écuyer lui faisait prendre un cordial.
–Où diable ai-je vu cette figure? demanda le prince à M. de Cerny.
–Mais, répondit celui-ci, c’est un des officiers qui hier, sur le Mail, m’ont refusé le salut.
–Maurice! fit le prince à l’écuyer-chirurgien, la blessure de ce gentilhomme est-elle grave?
–Monseigneur, avec des soins on en viendrait facilement à bout.
–Avec des soins, ajouta le prince en réfléchissant. Allons! il faut rendre le bien pour le mal, c’est écrit. N’importe, il est fâcheux d’être obligé de revenir dans cette pépinière à cancans. Voyez, Maurice, à prendre vos mesures pour ramener le blessé en sa demeure.
Pendant que le prince donnait cet ordre, M. de Cerny s’était approché du blessé.
–Pardon, monsieur, dit-il, vous m’avez dit tout à l’heure que j’étais la cause indirecte de l’état fâcheux dans lequel vous vous trouvez. Si vous ne vous sentiez trop faible, je vous saurais gré de m’expliquer cela. Je vais partir; excusez, je vous prie, ma curiosité.
–Maurice, demanda le prince, monsieur peut-il parler sans danger?
–Pourvu qu’il ne parle pas trop, je n’y vois point grand inconvénient.
M. de Brucourt se souleva et dit en s’adressant à Cerny:
–C’est bien simple, et ce ne sera pas long à raconter. Hier, au moment où je venais de vous croiser sur le Mail en compagnie de M. de Tranoy, nous fûmes accostés par un de vos parents, M. de Saint-Caprais:
«–Messieurs, nous dit-il, vous avez la vue basse. Nous n’avez pas aperçu M. de Cerny, mon cousin, qui vous a tiré civilement son chapeau.
»–Monsieur, répondit M. de Tranoy, nous saluons qui bon nous semble, et il ne nous plaît pas de saluer M. de Cerny.
»–En ce cas, monsieur, il me plaît à moi de vous dire que vous ignorez les règles les plus élémentaires de la politesse.
M. de Tranoy était très-violent et…»
–Pardon, s’écria Cerny, vous dites: «M. de Tranoy était… » M. de Tranoy ne serait-il plus?…
–M. de Saint-Caprais l’a tué hier à la porte du jeu de paume.
–Sarpediable! dit le prince, le Saint-Caprais va bien.
–A mon tour j’ai appelé M. de Saint-Caprais, et vous voyez… Cependant, je dois lui rendre justice et convenir qu’il a usé de tous les moyens possibles pour empêcher la rencontre. Il m’a dit combien vous aviez été malheureux en toute cette affaire, monsieur de Cerny. Si les excuses d’un mourant peuvent vous toucher, je vous adresse les miennes de tout mon cœur.
Cerny prit la main de M. de Brucourt et lui assura qu’il ne conservait nul ressentiment.
Comme les gens du prince coupaient des branchages pour confectionner une civière, deux cavaliers apparurent au détour de la route.
Dire que ces deux cavaliers apparurent n’est point absolument bien dit.
L’un arrivait au galop, monté sur un petit cheval breton couleur gris d’ardoise. L’autre, juché sur une haute jument de couleur blanche criblée de petites taches rousses et, malgré toute sorte d’efforts et de coups de houssine, arrivait bon dernier à cinquante pas au moins de son compagnon.
Le second cavalier était un chirurgien; le premier était M. de Saint-Caprais. Il demeura stupéfait en voyant son adversaire si entouré.
–M. de Saint-Caprais, fit le prince en s’approchant du jeune homme et en lui tendant la main, je suis au regret de n’avoir pas hier accepté vos excuses. Vous êtes un brave et aimable gentilhomme.
Cerny tendit également la main à son parent, mais sans lui rien dire. Les gens de cœur n’ont pas besoin de parler pour se comprendre.
Saint-Caprais annonça avec empressement qu’une chaise était en route pour venir prendre le blessé.
Rassuré par le docteur, le prince se remit en chemin, non sans avoir assuré à M. de Brucourt qu’il faisait des souhaits ardents pour son prompt rétablissement.
–M. de Saint-Caprais, dit le prince au jeune homme, qui s’était élancé pour lui tenir l’étrier, si vous venez à Versailles, n’oubliez pas, je vous prie, que vous y avez un protecteur.
–Monseigneur, répondit M. de Saint-Caprais, d’une voix émue mais fière, si Votre Altesse revient en Bretagne, je la supplie humblement de daigner se souvenir qu’elle y a le plus dévoué de ses serviteurs.
Le prince, suivi des siens, s’éloigna au galop. Au haut de la côte, les chevaux reprirent leur allure ordinaire.
Son Altesse, après avoir laissé Cerny à ses réflexions, profita de l’heure du repas pour lui parler d’avenir. Mais le chevalier coupa court aux propositions de son illustre ami.
Cerny déclara qu’il ne voulait plus revenir à la cour; qu’il sentait bien que son avenir était fort aventuré;.que d’ailleurs il n’avait plus de but dans la vie, qu’il ne voulait rien et qu’il n’avait qu’une ambition, vivre retiré du monde.
M. de Clamont le plaisanta d’abord, mais il finit par s’apitoyer sur la tristesse de son ami, bien qu’il la trouvât un peu exagérée.
Le prince avait l’espèce humaine trop en mépris pour faire le moindre cas du plus ou moins de considération qu’elle pouvait accorder à l’un des siens.
A cette époque de sa vie, il n’avait pas encore aimé sérieusement. Il ne pouvait donc pas apprécier l’étendue des deux douleurs qui venaient d’abattre le pauvre gentilhomme dont il avait fait son ami.
Le lendemain du deuxième jour, le prince, qui, par ordre du roi, devait visiter les côtes, s’embarqua à Morlaix.
M. de Clamont avait quitté Versailles dans le véritable but de voler au secours de son malheureux ami. Mais à cette époque, comme à toutes les époques possibles, les princes étaient bien moins libres que les autres hommes. Afin donc que la cour n’eût pas à faire les commentaires les plus bizarres sur son voyage, M. de Clamont avait été supplier le roi de lui ordonner d’aller visiter les côtes.
L’Angleterre a toujours tracassé la France. En tout temps, on a fait semblant de visiter les côtes; cela ne sert à rien, mais cela tranquillise.
Le roi avait donc autorisé son cousin, avec d’autant plus de plaisir que ses cousins ne lui demandaient pas toujours la permission de faire ce qu’il leur plaisait.
Pour l’acquit de sa conscience, le prince s’embarqua à bord de l’Espoir, gentil brick côtier qui le mena à petite marée de Morlaix à Dinan, de Dinan à Jersey, de Jersey à Cherbourg. Là, il échangea son brick contre une grande gabarre qui le devait conduire à Courseuil et de Courseuil à Honfleur, où il rentrerait en Seine jusqu’à Rouen.
Il y avait à la cour bien des amiraux qui n’avaient pas fait un aussi long voyage.
Un jour, surprise par un fort temps, la gabarre du prince entra se mettre à l’abri dans la petite rivière de Dives.
M. de Clamont, menacé d’attendre longtemps dans cet endroit, s’informa des gentilshommes du voisinage, mais il en fut pour ses questions: les grands gentilshommes du pays étaient à Versailles, les petits étaient des paysans.
Le prince eut l’idée de s’en retourner par terre; mais, outre que les chemins étaient fort mauvais, ses chevaux avaient été dirigés sur Rouen, et il tenait d’ailleurs à accomplir jusqu’au bout le voyage qu’il avait annoncé.
Pour tuer le temps, ce grand ennemi des grands seigneurs, M. de Clamont, en compagnie de Cerny, alla tirer quelques coups de fusil. Un jour il chassa la sauvagine en remontant la Dives par devers la vieille chaussée de Varaville. Le lendemain il courut le rivage pour tirer quelque oiseau de mer.
Surpris par la marée, M. de Clamont et Cerny durent prendre un sentier à pic qui les mena promptement au haut de la falaise d’Houlgate.
Après avoir admiré le splendide point de vue qui se déroulait à ses yeux, le prince voulut revenir sur ses pas, mais M. de Cerny insista respectueusement pour demeurer quelques instants encore sur la falaise; il ne pouvait se lasser d’admirer cet horizon magique.
La mer était agitée, le ciel était chargé de nuages. Par un phénomène qui n’est pas excessivement rare, les rayons du soleil de midi irradiaient aux deux points opposés de cette immense nappe de nuages noirs, dont ils doraient les franges, et, pendant que la côte était presque plongée dans l’obscurité, les deux extrémités, la pointe de Courseuil et le cap d’Antifère, apparaissaient brillants d’un jour radieux.
–Ah! monseigneur, s’écria M. de Cerny, de grâce restons encore. Que c’est grand, que c’est beau! Ne vous semble-t-il pas que la colère des dieux a frappé cette plage de tristesse pour punir ses habitants rebelles aux sacrifices, tandis qu’ils ont comblé les pays voisins? Voyez, ici tout est morne et lugubre, regardez là-bas, ne croirait-on pas voir des îles jouissant d’un printemps éternel, habitées par des nymphes, présidées par une déesse?
–Sarpediable! mon cher ami, dit le prince, vous parlez comme M. de Cambrai en son livre de Télémaque! Moi, je ne vois qu’une ennuyeuse bourrasque qui est ici et non là-bas, et qui me contrarie fort. Ce qui fait que je voudrais être là-bas et non ici, parce qu’entre nous je vous avouerai que je commence à m’ennuyer beaucoup. La galerie du palais me manque encore plus que les salons de Versailles. Au diable ce pays normand, où l’on fait du vin avec des pommes, et où les femmes ont des bonnets de coton!
Le prince n’avait pas absolument tort; il n’est pas de beau pays sans soleil et sans amour.
Quelques gouttes d’eau forcèrent les deux chasseurs à chercher un abri.
Ils jetèrent les yeux à droite et à gauche, et finirent par découvrir, non sans peine, une petite maison située tout en haut, sur le versant de la falaise, et abritée à peine par un bouquet de pommiers.
Ils se dirigèrent vers cette habitation avec une certaine défiance.
Depuis qu’il pleuvait, ils s’étaient aperçus que l’heure du repas avait sonné, et l’estomac du prince battait la chamade. Or, il était facile de deviner à l’extérieur du logis qu’ils ne trouveraient probablement pas, dans l’intérieur, un festin préparé à leur intention.
–Ah! mon cher chevalier, s’écria le prince, pourquoi n’ai-je pas comme vous des visions poétiques! Je tâcherais de me persuader que cette bicoque est une grotte et qu’une déesse, éprise du prince, mon père, va mettre pour moi les petits plats dans les grandes assiettes, en doux souvenir de lui.