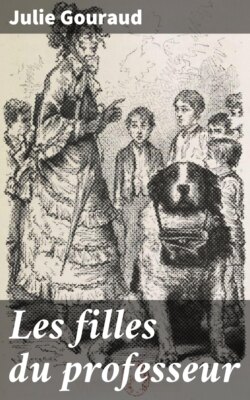Читать книгу Les filles du professeur - Julie Gouraud - Страница 5
La famille Liébert. — Janique.
ОглавлениеSix heures sonnaient à la cathédrale de Clermont-Ferrand, lorsqu’une voiture s’arrêta devant la porte d’une modeste maison de la rue de la Treille.
M. Liébert venait occuper la chaire de philosophie à la Faculté de cette ville Il était attendu et désiré, non-seulement à cause de son mérite, mais parce qu’on espérait que sa famille serait une agréable société.
Madame Liébert était, disait-on, une femme tout à la fois sérieuse et aimable. Sa fille aînée Marie avait dix-huit ans; Hélène entrait dans sa quinzième année; puis venaient un collégien de quatorze ans et une petite fille de sept ans qui était aveugle.
Les nouveaux venus attirèrent immédiatement l’attention, et comme la maison n’avait pas de cour, il fallut déballer les meubles dans la rue, circonstance favorable à la curiosité des voisins.
Deux jeunes filles, qui demeuraient en face, coururent à la fenêtre au premier coup de marteau qui annonçait l’ouverture des caisses; et suivirent avec intérêt le déballage du mobilier.
«Oh! dit mademoiselle Elvire Bertin, la philosophie n’est pas brillante! Nous n’avons pas, je crois, grand plaisir à attendre d’elle! Regarde donc, Laure, ces fauteuils râpés, ces tables et ces armoires. Que de vieilleries! M. Évrard était autrement meublé ! C’est vraiment avoir du malheur! Il faudra bien cependant faire connaissance avec ces nouveaux venus. Mon père est prévenu en leur faveur: mais moi je bâille d’avance. Ces demoiselles sont tellement absorbées dans le déballage, qu’elles n’ont pas tourné la tête une seule fois de notre côté.
— Je peux cependant t’assurer, Elvire, qu’elles n’ont pas l’âge de leurs meubles. Comment peuvent-elles être si fraîches après avoir passé une nuit en wagon!
— La mère se contente de les regarder, elle ne s’occupe absolument que de la petite fille qui l’accable de questions, la bonne dame semble faire partie des paquets: elle m’impatiente!»
L’intérêt s’accrut encore à l’apparition d’une jeune servante, dont le costume bizarre était une nouveauté pour les habitants du pays: un bonnet de toile empesée, découpé en forme de cœur; une casaque de drap gris grossièrement brodée de laine jaune, un jupon court de droguet vert, le tout fané et froissé. Tel était le costume de Janique, la servante bretonne;
La brave fille était trop occupée pour remarquer l’effet qu’elle produisait sur les voisins et sur les passants.
La journée n’était pas finie, et déjà un certain ordre régnait dans la maison. Janique s’était empressée de mettre des petits rideaux aux fenêtres pour déconcerter l’indiscrétion. La porte étant fermée, il était déjà possible de se reposer dans le salon.
«Aline, dit M. Liébert à sa femme, tu te plairas ici; l’Auvergne est un beau et bon pays, les habitants de cette ville accueillent les étrangers avec bienveillance. Nos filles trouveront certainement d’aimables compagnes qui les aideront à se consoler de la perte de celles qu’elles ont laissées à Paris. Le mois de septembre permet encore de faire de longues promenades, et lorsque nous connaîtrons le pays, il nous sera plus facile de supporter l’hiver qui est parfois très-rigoureux.
— Marie, tu me raconteras tout ce que tu verras, dit la petite Anne.
— Oui, cher ange. Et la sœur prit l’enfant sur ses genoux.
— A quoi pense ma fille Hélène?
— Je pense, mon bon père, que la rue Saint-Jacques avec son tapage et notre vilaine chambre avait plus de charmes pour moi que ne m’en offrira l’Auvergne avec ses montagnes.»
La présence de Janique fit que cette réflexion demeura sans réponse.
Vingt-quatre heures plus tard, l’arrivée du professeur était connue de toute la ville.
La famille Liébert se rendit le dimanche suivant à la cathédrale. La première impression fut favorable aux étrangers: les parents avaient l’air distingué ; les jeunes filles étaient charmantes; leur mise, que l’on s’étonna de trouver si modeste, était du meilleur goût; mais au sortir de l’église, l’examen fut plus sérieux. La jeune voisine, déjà revenue de ses préventions, trouva moyen de placer un petit salut qui fut compris et rendu.
Anne, jusqu’alors oubliée, fixa l’attention; le voile dont sès yeux étaient couverts excita une surprise à laquelle succéda aussitôt une tendre compassion: «Elle est aveugle!» se disait-on tout bas. Les mères, habituées à lire dans les yeux de leurs petits enfants, ne comprirent réellement leur bonheur qu’en présence de cette grande infortune. Anne devint le sujet de toutes les conversations, et ses parents eurent leur part de la sympathie qu’elle inspirait.
Le déballage d’un piano ranima la curiosité des demoiselles Bertin. Beaucoup de gens auraient dit peut-être: Encore un piano de plus dans la ville! L’impression des jeunes voisines fut tout autre; elles étaient impatientes d’entrer en relation avec ces charmantes étrangères.
Dès que le professeur eut fait les visites d’usage, on les lui rendit avec empressement, et un mois s’était à peine écoulé, qu’un cercle d’aimables connaissances entourait la famille Liébert.
L’éducation des jeunes filles avait naturellement été l’objet de tous les soins de leur père. Aux leçons régulièrement données s’ajoutaient les lectures du soir, lectures historiques ou littéraires. L’aînée avait une instruction solide et de plus un joli talent de dessin. La position modeste de sa famille lui avait laissé jusque-là une grande liberté ; à l’étude succédaient la couture et la broderie; déjà même elle n’était pas embarrassée pour faire ses robes et celles d’Hélène qui avait peu de goût pour les ouvrages vertueux, comme elle disait en riant.
D’ordinaire, la vie de province allonge les heures. Il n’en fut pas ainsi à Clermont. L’aimable accueil qu’on fit à madame Liébert et à ses filles changea forcément leurs habitudes. La lecture et surtout le dessin furent peu à peu négligés, et bientôt abandonnés. La sœur aînée se soumit aux circonstances avec sa douceur ordinaire, et on ne l’entendit jamais exprimer un regret.
Anne était toujours aux côtés de sa mère ou de Marie, mais les visiteurs n’osaient parler d’elle. On la caressait sans faire de questions: on attendait une confidence.
Cette confidence arriva: dès l’âge de trois ans, un glaucome avait voilé les yeux de l’enfant. Cette cécité ne nuisait pas à son caractère, et l’intelligence dont elle était douée suppléait merveilleusement au sens qui lui manquait. Cette explication était toujours entremêlée de larmes, et pourtant jamais la mère n’évitait de répondre aux questions qui désormais se renouvelèrent fréquemment.
Cette enfant était chère à tous ceux qui la connaissaient. C’était à qui lui ferait plaisir, lui donnerait une petite joie.
Après avoir parcouru la maison avec ses sœurs, Anne ne tarda pas à passer seule d’une pièce à l’autre sans hésiter; elle se garait des obstacles avec une adresse si grande, qu’on la voyait sans crainte agir et se mouvoir.
La sœur aînée s’occupait déjà de l’éducation de la pauvre enfant. Ses petits doigts touchaient légèrement les caractères particuliers d’un livre destiné aux aveugles; il n’était pas rare que cette lecture excitât sa gaieté ; mais rien ne la distrayait autant que la musique.
Le piano, qui avait été le premier lien entre Elvire et Hélène, était uniquement destiné à Anne.
Une inspiration maternelle avait fait naître la pensée d’essayer de ce moyen comme d’un simple amusement, et quelques mois avaient suffi pour découvrir que la petite fille était née musicienne.
Rien n’était à la fois plus triste et plus charmant que de la voir assise sur un grand tabouret, jouant les airs connus de nos méthodes. Souvent sa voix juste et douce attirait son père qui, après avoir souri, rentrait tout triste dans son cabinet.
Le piano d’Anne était le seul meuble de luxe qu’on remarquât dans la maison.
C’est à sa sœur aînée que l’enfant s’adressait de préférence:
«Tu m’expliques mieux, disait-elle; quand tu parles, c’est comme si je voyais.»
Ces deux existences se trouvaient ainsi liées l’une à l’autre. Mais la province, qui se montrait si aimable, avait ses exigences et imposait de nouvelles occupations auxquelles la sœur aînée se donnait tout entière. Anne se rapprocha davantage de sa mère, heureuse de ce retour.
L’intimité s’était promptement établie entre les demoiselles Bertin et les filles du professeur; le voisinage en faisait presque une obligation.
Si M. Bertin habitait une vieille maison de la rue de la Treille, c’est qu’il respectait l’héritage de son père. Une large aisance n’en régnait pas moins chez lui. Hélène fut frappée, et presque humiliée, d’un luxe qui contrastait avec la simplicité de la maison paternelle. Toutefois, le plaisir d’avoir des compagnes de son âge effaça ce premier sentiment, et il ne se passa bientôt plus de jour sans qu’une occasion naturelle donnât aux jeunes filles un prétexte de se visiter; de plus, Hélène. était heureuse de voir son père apprécié par une famille honorable.
L’hiver resserra encore ces relations; car si les demoiselles Bertin allaient dans le monde, elles ne dédaignaient pas les soirées du voisinage. Laure surtout s’attachait à Marie, dont elle subissait, sans le vouloir, la bonne influence.
Jusque-là M. et Mme Liébert s’étaient contentés de recevoir simplement quelques amis. Mais la mère pressentait qu’il faudrait bientôt faire un peu plus de frais. C’est bien ce qu’Hélène pensait; elle entrevoyait avec bonheur une existence nouvelle: la jeune fille croyait que l’économie de ses parents était plutôt une vertu qu’une nécessité. Ne lui en voulons pas; Hélène était une de ces gracieuses créatures qu’on se plaît à laisser dans l’ignorance de tout ce qui peut attrister. Enfant gâtée, il faut le dire, elle ne s’inquiétait nullement de la marche des choses. Son père était respecté, il avait été reçu chez le ministre; que lui fallait-il de plus?
A quinze ans, on ne prend qu’une part bien restreinte aux soins du ménage, surtout lorsqu’ une sœur aînée est là ; d’ailleurs l’habitude de voir agir les autres autour d’elle persuadait aisément à Hélène que son concours était inutile.
Deux jeunes filles bien élevées sont fort appréciées dans la ville qu’elles habitent. La famille Liébert reçut de la préfecture une invitation de bal. Cette invitation combla Hélène de joie et rendit ses parents sérieux.
«Que ferons-nous, Aline? dit M. Liébert.
— Refuser est impossible, mon ami. Il serait d’ailleurs bien triste de sevrer nos filles de tout plaisir. C’est aussi le moment de présenter notre chère Marie dans le monde.... qui sait?
— La difficulté n’est pas seulement d’aller au bal de la préfecture, mais de séparer les deux sœurs.
— Il n’y faut pas songer: n’as-tu pas remarqué avec quel plaisir Hélène a accueilli l’idée de cette fête?
— Hé bien! ma chère amie, arrange cela comme tu sais arranger toutes choses.»
La mère n’hésite pas: elle s’occupe sans tarder de la toilette de ses deux filles. Elle consulte tout naturellement Marie. Le désir de la fille aînée eût été de ne point paraître à ce bal. L’autorité de sa mère lui imposa de ne pas refuser cette distraction.
«Après tout, se dit Mme Liébert, la jeunesse se pare à peu de frais, et je ne suis pas fâchée de montrer mes filles. Mais quel travail pour ma bonne Marie!»
Dès qu’elles entendirent parler du bal de la préfecture, les demoiselles Bertin vinrent voir leurs amies; il leur tardait de connaître leurs projets de toilette pour cette brillante réunion.
«Nous venons, dit Elvire, vous apporter l’adresse de notre couturière; Mme Poly est la première tailleuse de Clermont, c’est une femme qui sait faire valoir ses clientes avec un art tout particulier, son goût est si sûr!»
Marie remercia ses amies et leur dit qu’elle faisait habituellement ses robes et celles de sa sœur, et qu’en cette circonstance elle se piquerait d’honneur.
«C’est admirable, sans doute; mais, ma chère, quelle que soit votre habileté, il vous manque certainement ce je ne sais quoi qu’ont les bonnes couturières, et votre mère pourra bien regretter d’avoir fait une économie dans une circonstance semblable.»
Laure souffrait de l’indiscrétion d’Elvire, et elle crut arranger les choses en demandant à Marie quelles fleurs elle et sa sœur mettraient dans leurs cheveux.
«J’ignore si ma mère nous permettra d’en porter.
— Mais, reprit vivement Elvire, c’est un grand bal! Attendez-vous à voir des toilettes comme on en voit à Paris! En tout cas, voici l’adresse de notre fleuriste. Elle a des guirlandes ravissantes; c’est ce qu’on porte cette année.»
Laure et Elvire se retirèrent sans être tout à fait convaincues de l’inutilité de leur démarche.
Hélène ne songea plus qu’à la couturière et à la fleuriste de ses amies. Toutefois, Marie mettait tant d’ardeur au travail qu’elle eut honte de laisser voir ses inquiétudes. Une robe de tulle blanc à deux jupes fut essayée et déclarée irréprochable. La couturière était, à bon droit, fière de son travail:
«Tu seras charmante, petite sœur, pour faire ton entrée dans le monde, disait l’aimable fille tout en posant ici et là ses épingles. Voyons, paye-moi donc d’un baiser! Tu as l’air d’un mannequin des montagnes russes. A quoi penses-tu?
— Je pense à beaucoup de choses, Marie....: d’abord, que tu es la plus aimable des sœurs, mais que, si nous étions riches, tu ne te fatiguerais pas à faire nos robes.
— Est-ce tout?
— Non.
— Achève! achève!
— Eh bien! je ne crois pas que nos robes soient à la dernière mode.
— Il est bien possible qu’elles ne soient qu’à l’avant-dernière, que veux-tu! Il me semble cependant que je n’ai jamais aussi bien réussi. Maman prépare nos ceintures roses, et.... je ne doute pas, moi, que nous ne fassions beaucoup d’effet.
— Qu’aurons-nous sur la tête, Marie?
— Nos cheveux!
— Il n’y a pas moyen d’être sérieux avec toi!
— La gravité est-elle donc de rigueur pour aller au bal?
— As-tu donné à maman l’adresse de la fleuriste?
— Non, je sais que M. Lieutaud nous réserve quelques-uns des beaux camélias roses qui font l’ornement de sa serre. Je voulais t’en faire la surprise, mais tu m’as arraché mon secret.
— J’aurais préféré des fleurs artificielles.
— Chère Hélène, ne te préoccupe pas tant de ta toilette; si tu devenais coquette, maman n’accepterait plus d’invitation.
— Elle te l’a dit?
— Non, c’est la raison qui vient de me faire cette confidence. Tu seras charmante; crois-moi, ne change pas ta couturière; elle fera des prodiges pour te contenter. Que veux-tu! nous ne sommes pas riches, et peut-être n’est-ce pas un malheur.
— Bien certainement, s’il existait une chaire de philosophie pour les femmes, on devrait te la confier. Tu es née philosophe et.... couturière. »
Les deux sœurs s’embrassèrent tendrement.
Le grand jour est arrivé ; les toilettes sont prêtes, madame Liébert complète la coiffure de ses filles en y attachant de frais camélias. Hélène fait remarquer que le rose est d’un meilleur effet sur les cheveux noirs de sa sœur que sur sa chevelure blonde.
Anne vint en ce moment promener ses petites mains sur les robes de bal:
«Es-tu bien contente d’être si belle, Hélène?»
Cette question ramena le sourire sur les lèvres de la jeune fille; pour toute réponse, elle embrassa l’enfant. Mais la sage Marie répondit:
«On n’est pas contente, Anne, parce qu’on a une robe de tulle; pour un rien, nous laisserions là le bal, et nous mettrions notre bonnet de nuit.
— Est-ce que j’irai au bal quand j’y verrai, maman?
— Oui, mon enfant, répondit la mère en levant les yeux au ciel.
— Marie, tu me diras si c’est beau à là préfecture; Quand vous serez parties, je danserai une ronde avec Janique, et puis j’irai me coucher... J’entends la voiture! Embrassez-moi: bonsoir;»
Les sœurs partirent après l’avoir embrassée, et Janique, fidèle à sa promesse, chanta la ronde favorite d’Anne.
Marie et Hélène furent éblouies et intimidées en entrant dans les salons de la préfecture. Le luxe déployé à cette occasion était tout à fait nouveau pour elles. L’aimable accueil que leur fit la femme du préfet, l’empressement que l’on mit à leur faire place, les égards dont furent entourés M. et Mme Liébert, tout les enchanta; elles osèrent enfin jeter les yeux autour d’elles, et se crurent sous l’impression d’un rêve.
Mlles Bertin firent leur entrée plus tard. Leurs robes de crêpe rose ornées de bouquets de jasmin blanc, leurs couronnes de fleurs semblables, produisaient un charmant effet, tout en les vieillissant un peu.
Elvire s’approcha de ses amies avec une grâce charmante et approuva leur toilette, mais s’apercevant qu’elles portaient des souliers de satin noir, elle dit tout bas à Hélène, d’un air vraiment désolé :
«Des souliers noirs, ma pauvre amie, y songez-vous!
— On nous a dit que les souliers de satin blanc n’étaient pas de rigueur.
— Erreur, erreur! passe pour les demoiselles Roland, des vieilles filles de vingt-cinq ans, mais vous! Je ne puis vous dire à quel point je suis mortifiée!»
L’orchestre mit fin à cette conversation. Marie et Hélène figurèrent dans le même quadrille, et il eût été facile à Elvire d’admirer les petits pieds de son amie, qui exécutait en conscience des pas qu’un maître de bon goût lui avait appris, mais ces malheureux souliers noirs la rendaient aveugle pour tout le reste.
Cependant la contredanse n’était pas achevée et déjà les deux sœurs étaient citées comme le vrai type des jeunes personnes bien élevées. M. et Mme Liébert recevaient avec complaisance les éloges qui leur arrivaient de toutes parts. Ils étaient radieux.... Jamais encore ils n’avaient mieux constaté la grâce de Marie et la beauté d’Hélène. L’heureux père, tout philosophe qu’il était, ne put retenir un soupir et se dit que si ses filles avaient de la fortune, elles seraient comptées au nombre des meilleurs partis de la ville.
Cependant la critique est souvent voisine de la louange: Hélène était trop petite, et l’ainée manquait de cet enjouement qui fait partie d’une toilette de bal.
«Mais, dit une femme de bon sens, comme on ne passe pas sa vie au bal, et qu’une ou deux lignes de moins ne nuisent point au mérite, je suis très-désireuse que mes filles voient les demoiselles Liébert.»
Le bal.
Personne ne contredit la mère de famille dont les paroles étaient un appel à la bienveillance.
Deux heures ayant sonné, les Liébert se retirèrent; cet acte de sagesse fut un véritable scandale. Elvire se précipita vers ses amies:
«Déjà ! Mais, chère Madame, dit-elle en faisant jouer son éventail, c’est seulement maintenant qu’on va s’amuser! Le cotillon sera conduit par M. Anatole Richard, le premier danseur de Clermont. Restez, restez, je vous en prie.»
Les parents ayant tenu bon, Mlle Elvire se demanda s’ils aimaient réellement leurs filles:
«Ces Liébert sont des poules, ils vont désorganiser le bal, dit-elle à sa sœur en apercevant quelques personnes qui se disposaient également à se retirer. Si jamais je donne un bal, je fixerai l’heure de l’arrivée et celle du départ.»
Elvire communiqua ses réflexions et sa mauvaise humeur à quelques bonnes amies; M. et Mme Liébert furent accusés d’aimer à dormir la nuit. Les accusés eussent sans doute trouvé plus d’un défenseur dans cette brillante réunion.
Comme il était facile de le prévoir, l’invitation de la préfecture donna lieu à beaucoup d’autres. Toutes les bonnes raisons pour ne pas accepter étaient inutiles; il fallait céder à tant d’aimables instances.
«Nous n’avons été accueillis nulle part avec autant d’empressement, disait le père de famille. Que veux-tu, chère Aline! les plaisirs de nos enfants sont aussi des sacrifices.»
Mme Bertin et ses filles étaient vraiment heureuses de voir leurs amies lancées dans la société.
A la nouvelle d’une invitation à la Recette générale, les jeunes voisines accoururent encore pour causer toilette.
«Chère Hélène, quelle robe mettrez-vous? demanda Elvire.
— Ma robe de tulle.
— C’est impossible, on ne met pas plusieurs fois de suite la même toilette.
— Je la mettrai cependant, répondit Marie Liébert avec un sourire. Mais une nouvelle qui va vous ravir, ma chère, c’est qu’il a été décidé que, cette fois-ci, nous aurons des souliers de satin blanc. Nos douze contredanses ont fait justice des autres.
— Vous avez dansé douze contredanses! C’est quatre de plus que moi. Voilà certes un début remarquable. Que je suis donc contrariée que vous reparaissiez dans la même toilette!
— Rassurez-vous, chère Elvire: nous avons une grâce d’état qui consiste à être toujours satisfaites de nos toilettes de ville ou de bal.»
Hélène était mortifiée des observations d’Elvire. Elle raconta ce petit commérage à sa mère qui en fit ressortir la vanité. Mme Liébert annonça à ses filles que cette fois-ci les camélias seraient remplacés par des roses artificielles.
Le matin du bal, Elvire envoya à ses amies le nom de son coiffeur.
«Le nôtre demeure dans notre rue,» répondit Hélène en refermant brusquement la porte.
Janique savait à quoi s’en tenir sur le compte de ce fameux coiffeur, vu que c’était elle-même. Ajoutons que c’était «un coiffeur» qui ne manquait ni de talent ni d’inspiration. Elvire et Laure se demandèrent avec effroi si Marie était aussi bon coiffeur qu’adroite conturière.
Le coiffeur était une pure invention d’Hélène qui n’avait pas résisté au désir de se venger innocemment de la critique d’Elvire.
Par malheur le coiffeur habituel des voisines n’eut point d’inspiration ce soir-là et l’édifice élevé sur leurs têtes les vieillissait terriblement.
«Elvire, dit mademoiselle Liébert, comment avez-vous pu croire que nous, qui sommes si simples, aurions recours à un coiffeur? Il y a cinq ans que Janique coiffe maman. Aujourd’hui nous profitons du talent de notre bonne.»
Elvire ne répondit pas: il était évident qu’en dépit des robes qui avaient le tort de paraître pour la seconde fois, les honneurs de la soirée étaient pour les filles du professeur.