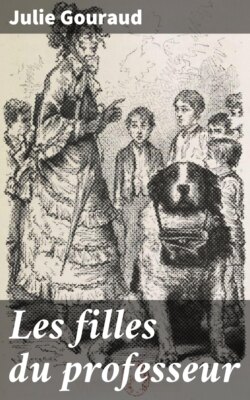Читать книгу Les filles du professeur - Julie Gouraud - Страница 8
Une amie d’enfance.
ОглавлениеAvant la fin de l’année la famille Liébert était admise dans toute la bonne société de Clermont. Les invitations à dîner étaient fréquentes. Était-il possible au professeur de ne pas faire à son tour quelques politesses?
Plus d’une fois, sans doute, des amis s’étaient assis à la table de madame Liébert; mais si Paris est le centre de la recherche, il faut convenir que chacun peut y vivre à sa convenance, et que si la maîtresse fait un petit extra, le budget peut n’en pas souffrir.
Il fut décidé qu’on recevrait la famille Bertin et quelques professeurs de la Faculté.
Grâce à l’habitude qu’avait prise Mme Liébert de n’ouvrir sa porte qu’une fois par semaine, le temps ne manquerait pas pour se préparer à recevoir douze personnes.
Les invitations sont faites, les provisions arrivent; la mère et ses filles ne négligeront rien de ce qui peut contribuer au succès de cette première réception.
La neige tombe; les promeneurs sont rares, il n’y a pas à craindre d’importuns.
Cependant la veille du grand jour, un matin que Janique était sortie, la sonnette résonna. Marie alla ouvrir sans s’inquiéter autrement d’être vue en négligé. C’était Elvire qui rapportait un livre. Mlle Liébert la reçut sans témoigner le moindre embarras.
Elvire eut le mauvais goût de dire à son amie:
«Pardon! je vois que je vous dérange, ma chère.
— Pas le moins du monde. Seulement je ne vous offre pas d’entrer, car je suis fort occupée de notre dîner.»
Cette explication donnée du ton le plus simple déplut à la jeune fille. Ainsi son amie descendait à certains détails d’intérieur, il se pouvait même qu’elle fît la cuisine.
Hélène n’était pas visible non plus. Le soin de parer la maison, d’orner la table, lui était confié, et elle s’en acquittait parfaitement.
Ceux qui se font servir ignorent le travail et la peine qu’exige le plus modeste dîner. Au jour dit, tout est prêt; les hommes ne se doutent pas de ce qu’il en coûte pour arriver à un semblable résultat, mais les femmes ne s’y trompent pas.
Mme Liébert était toute à ses convives. On eût pu croire qu’elle dînait en ville. La fille aînée avait moins de liberté ; elle suivait tous les mouvements de Janique, dont le regard l’interrogeait sans cesse.
Je ne sais si c’est par coquetterie ou pour se concilier la bienveillance des invités que la Bretonne avait revêtu son plus beau costume, ce qui est certain, c’est que son bon air plut à tout le monde.
Un jeune homme placé à côté de Mlle Elvire Bertin ayant fait en bien mangeant l’éloge du pâlé, la jeune fille lui dit d’un petit air mystérieux:
«C’est Mlle Marie qui l’a fait.
— Vraiment! Mais, savez-vous alors que c’est une excellente ménagère! Et vous, Mademoiselle, mettez-vous aussi quelquefois, comme on dit, la main à la pâte?
— Non, vraiment, Monsieur! Ma mère ne le souffrirait pas.
— Les gens qui ont ce talent sont parfois fort utiles au prochain et à eux-mêmes. Je voudrais qu’il entrât dans la destinée de mes lièvres d’être confiés à Mlle Liébert.»
Elvire resta sérieuse; le pâté lui pesa tout le reste de la soirée. Ce jeune homme devait la croire méchante.
«Je ne sais vraiment pas pourquoi j’ai été parler de ce pâté ; Marie est si bonne, si aimable!»
Ce jugement ne tarda pas à se confirmer, car Mlle Liébert, voyant son amie moins enjouée qu’à l’ordinaire, vint s’asseoir auprès d’elle, et lui demanda de se mettre au piano. Elvire avait du talent et n’était pas intimidée comme la plupart des jeunes personnes. En voyant les mains de Mlle Bertin sur le clavier, le jeune amateur de pâté comprit pourquoi elle négligeait la pâtisserie. Anne, qui s’était fait oublier par son silence pendant le dîner, eut les honneurs de la soirée. Elle joua un petit air qu’on applaudit de grand cœur. Chaque convive lui témoigna une véritable affection. Le recteur de l’Académie, oubliant sa dignité, se retira à l’écart avec elle; il la prit sur ses genoux et lui raconta une histoire.
Ce dîner fournit à la conversation des invités tout le reste de la semaine. On fit à un centime près l’évaluation de la dépense et justice fut rendue à Mme Liébert et à ses filles.
Le calme rentra bien vite dans ce modeste intérieur et, la rigueur de la saison aidant, la mère et ses filles reprirent leurs occupations habituelles.
«Que j’aime le mauvais temps! dit Anne à sa mère, un jour qu’elle entendait la neige frôler les vitres.
— Pourquoi, chère enfant?
— Parce que vous ne sortez pas et que je vous entends. Janique m’a dit que la neige est de la pluie blanche, et que les montagnes, les toits et les arbres sont tout blancs. Il neigera encore d’autres fois, n’est-ce pas, maman? Mon Dieu! que je voudrais donc y voir! et l’enfant pleura.
— Patience, chère petite fille. Tu as donc bien envie de voir la neige?
— Oh! ce n’est pas pour cela que je pleure, j’aimerais encore mieux voir les oiseaux et les fleurs.... mais c’est vous, mère chérie, papa, mes sœurs et Adrien, que je voudrais voir.»
En parlant ainsi, Anne promenait ses petites mains sur le visage de sa mère, des larmes vinrent les mouiller.
«Oh! mère, ne pleurez pas. Je me souviens un peu de votre figure: vous avez de grands yeux noirs et des cheveux blonds, n’est-ce pas?
«Marie a des cheveux noirs; Hélène et Adrien sont blonds. Papa a des lunettes et les dents blanches. Embrassez-moi bien fort, et je n’aurai plus de chagrin.»
Cette scène se renouvelait de temps à autre. Par bonheur, Anne trouvait dans la lecture des distractions d’un ordre supérieur. Comme sa mémoire était soigneusement cultivée, on pouvait lui enseigner l’histoire et la géographie. Son petit doigt voyageait sans hésitation sur une carte en relief; la musique était sa plus grande récréation et le tricot commençait à lui devenir facile. Le tact de ses mains, comme chez tous les aveugles, lui permettait de descendre et de monter l’escalier sans encombre; Janique se faisait un plaisir de réclamer les services de sa petite maîtresse qui aimait à se sentir un peu utile.
Quel que fût le succès du professeur de philosophie, on parlait beaucoup moins de lui que de sa petite fille. On aime l’enfant de l’affection généreuse qui n’attend pas de retour; la distraire, lui faire plaisir, telle était la pensée de tous ceux qui venaient voir sa mère.
Jusqu’ici, nous avons laissé Adrien au collége, peu soucieux de le suivre au milieu des ténèbres de la grammaire latine et des piéges que lui tendaient Tacite et Virgile. Au grand désespoir de son père, c’était un écolier paresseux; cependant il promettait toujours de mieux faire.
Un jour, qu’il était descendu encore plus bas que de coutume, Anne le fit entrer dans sa chambre, en ferma la porte à clef, monta sur une chaise et dit à Adrien stupéfait de ce manège:
«Grand frère, je vais te dire quelque chose que personne ne sait, pas même papa qui est un savant.
— Il est inutile, Anne, que tu sois ainsi perchée pour me parler. Tu sais que je t’écoute toujours avec plaisir.
— Oui, tu es bien bon, et je t’aime beaucoup; mais je crois, qu’ainsi perchée, j’aurai plus d’éloquence; écoute-moi: Tu es paresseux, mon frère. Papa et maman disent que c’est ton plus grand défaut. Veux-tu te corriger?
— Certainement, Anne.
— Suivras-tu mon conseil? Je te préviens que ce ne sera pas facile; mais tu seras tout à fait guéri.
— Voyons, sœur Anne.
— Tu auras des vacances à Pâques?
— Je m’attends à n’en pas avoir.... je n’en mérite pas.
— Laisse-moi parler. Je sais, moi, que papa doit vous faire faire une belle excursion. Eh bien, tu te banderas les yeux, bien serrés, bien serrés, tout le temps de la promenade. Tu entendras dire que c’est beau! Regardez donc cette montagne, ces effets de soleil, ces champs déjà verts, ces fleurs, et comme moi, Adrien, tu ne verras rien de ces belles choses, et tu auras tant de chagrin, mon frère, que le jour où tu ôteras ton bandeau tu seras guéri de la paresse. La vue de tes livres et de tes cahiers te transportera de joie. Tu travailleras, tu travailleras même trop. Papa sera obligé de modérer ton zèle, Adrien....
— Assez, assez, petit philosophe chéri!»
Il la prit dans ses bras et couvrit son visage de larmes et de baisers.
«Je suis déjà guéri, disait le brave garçon. Je ne veux plus d’autre plaisir que celui d’être près de toi. Quand le printemps sera venu, nous nous promènerons ensemble, c’est moi qui t’expliquerai tout; chère petite sœur, que tu es donc gentille!
— A propos, Adrien, dis-moi comment est ma figure, personne n’en parle. Papa dit qu’Hélène est jolie, que Marie ressemble à maman, mais il n’est jamais question de moi!
— Eh bien, mademoiselle Anne, asseyez-vous, levez la tête, restez tranquille. Vous avez de beaux cheveux noirs bouclés, un front charmant, de fins sourcils, un petit nez assez gentil, une bouche qui rit bien et laisse voir vos dents blanches.
— Et mes yeux, Adrien? tu les passes; je veux savoir comment ils sont.
— Ils sont grands, et lorsque tes larges paupières sont baissées, on ne se douterait pas....
— Que je suis aveugle, n’est-ce pas?
— C’est cela même, pauvre mignonne, et le jour où la lumière sera rendue à tes grands yeux bleus, on dira qu’ils sont bien doux, bien bons.
— Merci, mon frère! Ce sont des secrets que nous nous sommes dits, n’est-ce pas? Il n’en faut plus parler.
— Certainement; mais le jour où je serai premier de ma classe, tu me permettras de te rappeler que c’est toi qui m’as appris à sauter de la queue à la tête?
— Oui, Adrien. Saute, saute bien vite!»
Le frère et la sœur rentrèrent tout joyeux au salon.
A partir de ce jour, ils ne perdirent pas l’occasion d’être ensemble. Adrien qui, jusque-là, ne prenait un livre que pour apprendre sa leçon, devint le lecteur assidu d’Anne.
Le brave enfant apprenait par cœur, à haute voix, de sorte que la petite sœur retenait toujours quelque chose des leçons de son frère. C’est ainsi qu’elle prit goût à l’anglais et à l’allemand, et apprit plus tard ces deux langues sans qu’il lui en coûtât trop de peine.
Cette intimité n’avait pas seulement l’avantage de distraire Anne, elle donnait plus de liberté à ses sœurs dont les occupations augmentaient en raison des relations de leurs parents.
Le printemps fut très-beau cette année-là, et permit à M. Liébert de faire connaissance avec le pays. C’était une récompense promise au zèle d’Adrien, qui n’oubliait pas la leçon que lui avait donnée sa petite sœur.
Le professeur, véritable écolier ces jours-là, partait en compagnie d’Hélène, de son fils et de la petite aveugle, qui passait souvent du dos de son âne dans les bras de son père. Après avoir fait connaissance avec le mont Rognon, nos promeneurs ne s’effrayèrent pas, un certain jeudi, de monter jusqu’au puy de Dôme. Le ciel était d’une pureté admirable; M. Liébert nommait les vallées, les villages et les montagnes dont l’ensemble forme un panorama grandiose et gracieux à la fois.
Adrien se chargeait de distraire Anne; M. Liébert ne pouvait absolument pas prendre son parti de l’infirmité de sa petite fille, et lorsque celle-ci s’écria: «Oh! que les montagnes sentent bon!» il éprouva un véritable sentiment de joie, et l’on convint qu’à partir de ce jour on se rendrait souvent sur la montagne pour respirer l’air embaumé qui rafraîchissait la chère enfant. Anne déclara qu’il n’était pas juste de laisser sa mère el sa sœur à la maison; Janique elle-même dut se résigner à faire partie des excursions; sa présence était d’autant plus désirée, que la brave fille ne se mettait jamais en route sans s’être chargée d’un goûter excellent.
L’ascension de Gergovie mit le professeur en demeure de déployer son érudition. Adrien et Hélène prêtèrent une attention presque sérieuse au récit de la lutte mémorable de César et de Vercingétorix; M. Liébert développa longuement ce point curieux de l’histoire des Gaules, et ne négligea pas de placer quelques réflexions sur la chute des empires.
Anne, qui avait écouté patiemment jusque-là, déclara que tout cela lui était égal et que, puisque la guerre était finie, il fallait respirer tranquillement.
Cependant les montagnes qui entourent Clermont n’empêchent pas les habitants de souffrir beaucoup de la chaleur, et quiconque peut aller à la campagne se hâte de quitter la ville. La famille Bertin fut une des premières à user de ce privilége. Hélène sentit que le départ des voisines ferait un vide dans son existence. En dépit de tous ses efforts, elle ne pouvait dissimuler combien le séjour de Clermont était peu de son goût.
Un soir du mois de juillet, par un orage terrible, une voiture s’arrête à la porte. Janique s’empresse d’aller ouvrir.
«Madame Liébert? demande une étrangère.
— C’est ici.... mais Madame va bientôt se coucher. »
Sans faire la moindre attention à la réponse de la servante, l’étrangère, qui s’appelait madame de Saint-Alban, donne l’ordre à son domestique de payer le cocher et de déposer ses coffres; puis, faisant signe à sa femme de chambre, elle pénètre dans la maison. Janique, muette d’étonnement, obéit aux ordres de l’étrangère. Elle la conduit au salon, allume lentement une bougie destinée à parer la cheminée. Elle s’était enfin décidée à aller prévenir Mme Liébert de ce qui se passait, lorsque celle-ci entra dans le salon; les deux femmes s’embrassèrent; Janique resta stupéfaite.
«Avant toute chose, dis-moi ce que tu veux prendre.
— Du thé, chère amie, ma femme de chambre a tout ce qu’il faut pour le préparer prompte ment.
— Du thé ! par cette chaleur!
— C’est tout ce qu’il y a de plus rafraîchissant. Mais ton mari et tes enfants dorment-ils déjà ?
— Ce n’est pas impossible; ma fille aînée du moins aura le plaisir de venir te saluer.
— Tu veux dire: m’embrasser. Ma pauvre amie! tu es donc toujours la même? toujours cérémonieuse? Vois un peu: je me rends au mont Dore, je ne trouve pas de place dans vos.... hôtels, et au lieu de venir te voir demain, je frappe à ta porte et je te demande l’hospitalité. Eh bien, n’es-tu pas enchantée de me voir?
— Assurément, chère Geneviève, mais...
— Mais?
— Je n’ai à t’offrir qu’une chambre fort modeste.
— Pour qui me prends-tu, ma chère? Allons, le thé doit être prêt; viens me tenir compagnie.»
Cependant M. Liébert avait quitté sa robe de chambre; Marie et Hélène, instruites du grand événement, s’étaient hâtées de refaire leur toilette, et venaient saluer l’hôte qui s’annonçait avec tant d’assurance.
Les compliments de politesse étant épuisés de part et d’autre, la conversation s’engagea. Mme Liébert témoigna d’abord de l’étonnement de voir son amie aller seule au mont Dore..
«Que veux-tu? le ministre de l’intérieur ne sort pas aisément de chez lui. Mon mari ne s’absentera qu’en septembre, et mon asthme exige que j’aille à votre mont Dore. Tu as un aimable entourage, tandis que moi je suis sans enfants, quoique mère de trois garçons: l’un est à Saint-Cyr; le second se prépare à y entrer, et le troisième est à l’École de marine.
La physionomie de Mme de Saint-Alban devint sérieuse lorsqu’elle ajouta:
«Tu as encore une petite fille, je crois.
— Oui, ma pauvre petite aveugle.»
La pendule sonna minuit. Ce fut seulement alors que la voyageuse se ressouvint de l’avertissement qui lui avait été donné par Janique. Elle demanda à se retirer.
Mme Liébert la conduisit dans une petite chambre où tout avait été rapidement préparé pour la recevoir. Un lit excellent et le calme d’une rue de province présageaient une bonne nuit à la voyageuse; mais souvent les présages sont trompeurs.
Mme de Saint-Alban n’ignorait pas combien l’existence de la famille Liébert était modeste, mais aucune circonstance ne lui avait permis de mesurer la distance que la fortune avait mise entre elle et ses amis. Jamais non plus le luxe de son hôtel ne lui était apparu aussi excessif. Elle était émue de retrouver son amie d’enfance dans une position si modeste. Aline Beaumont s’était fait aimer et admirer de toutes ses compagnes; ses qualités et le charme de sa personne semblaient lui assurer un avenir brillant. Un jour, les pensionnaires s’étaient amusées à faire un plan imaginaire de leur avenir. Aline devait être ambassadrice; elle avait des manières nobles et gracieuses et le langage tout à fait diplomatique; rien ne ressemblait moins à un hôtel d’ambassade que la petite maison de la rue de la Treille. On y sentait toutefois une certaine aisance née de l’ordre et du savoir-faire. Les jeunes filles paraissaient heureuses, et leurs parents l’auraient été aussi sans l’infirmité de leur petite Anne.
Mme de Saint-Alban renonça franchement au sommeil et chercha un moyen de rendre son séjour agréable à ses amis. Le cœur a ses entêtements; l’amie d’enfance voulait absolument faire pénétrer un rayon de soleil dans cette petite maison si hospitalière. Mille projets furent accueillis et repoussés. Enfin, l’excellente femme s’arrêta à celui-ci: «Aline et ses enfants m’accompagneront au mont Dore. Ces charmantes filles ne doivent pas rester ainsi à l’ombre! Et moi j’aurai une société toute trouvée. Aucune de mes fantaisies ne m’aura donné autant de joie. C’est décidé, je les emmène.»
Cette volonté bien arrêtée eut l’effet d’un calmant. L’aimable personne s’endormit et n’ouvrit les yeux que pour répondre à un léger coup frappé à sa porte.
Mme Liébert entra presque aussitôt.
«Bonjour! chère Geneviève! Il est dix heures, que prendras-tu maintenant? nous déjeunons à midi.
— Ce que tu voudras; mais assieds-toi; j’ai à te communiquer un projet qui m’a tenue éveillée une partie de la nuit, et que j’entends réaliser.
— Toujours la même!
— A peu près.
— Je ne t’écouterai pas avant que tu aies pris une tasse de café.
— Tu as raison, Aline, il faut que je prenne des forces pour combattre et pour vaincre.
— Tu m’effrayes! Vas-tu livrer un assaut à notre paisible demeure?
— Absolument. Je sais que tes fortifications feront bonne résistance, mais elles tomberont en éclats sous les coups irrésistibles de ma volonté. »
Madame Liébert sortit en riant de l’humeur belliqueuse de son amie, et revint bien vite apportant sur un élégant.plateau un café à la crème dont la province a le secret.
«Assieds-toi, Aline.... Ah! quelle ambroisie! délicieux! délicieux! Mais je n’ai pas de temps à perdre. Écoute, ce ne sera pas long.»
Et prenant un air sérieux:
«Nous partons ensemble pour le mont Dore; j’ai besoin de ta société et de celle de tes filles. Ton mari ne contrariera pas mes projets, j’en suis sûre, et toi, ma bonne Aline, ne prends pas la peine de faire une objection. Va vite préparer tes caisses. Je me charge de traiter la question avec M. Liébert. Il est philosophe et me comprendra d’emblée. Laisse-moi, te dis-je, je ne t’écoute pas.»
Madame Liébert, de guerre lasse, finit par se retirer; rien ne put la distraire de l’étrange déclaration que venait de lui faire son amie. Dès que son mari fut rentré, elle l’informa de ce qui venait de se passer.
M. Liébert écouta tranquillement sa femme et se contenta de lui dire: «Je comprends cela!»
— Comment, mon ami, tu comprends que j’accepte une pareille invitation?
— Certainement! ton amie est riche et généreuse; son cœur a du bon sens. En pareille circonstance, tu ferais comme elle.»
Madame Liébert était atterrée de voir son mari donner si facilement son approbation. Elle fit cependant une objection.
«Ainsi, tu resteras seul pendant trois semaines?
— Pas précisément, ma chère; Adrien me tiendra compagnie, et Janique ne me laissera manquer de rien. D’ailleurs, puisque notre médecin m’a souvent dit que les eaux du mont Dore me convenaient, je profiterai de la circonstance pour aller vous retrouver.»
Ces paroles ramenèrent la sérénité dans l’esprit de la mère de famille. Elle s’attendrit à la pensée de procurer la distraction d’un voyage à ses chères filles, le monde les verrait, et elles prendraient un peu de repos. Leur santé ne pouvait qu’y gagner.
Madame de Saint-Alban ne rencontra pas d’autres objections de la part de madame Liébert que ces phrases de politesse que l’ont débite par habitude, sans y attacher d’importance.
Par un sentiment de délicatesse, les parents laissèrent à l’aimable femme le plaisir d’annoncer la grande nouvelle à Marie et à Hélène. C’est au déjeuner que madame de Saint-Alban fit son invitation; les jeunes filles cherchaient à lire dans les yeux de leur mère si ses paroles étaient sérieuses.
M. Liébert les confirma; alors les deux sœurs témoignèrent une joie qui enchanta l’aimable Geneviève. Anne, ayant reçu l’assurance qu’elle ferait aussi le voyage, se leva, battit des mains et voulut embrasser la bonne amie de sa maman.
La joie d’une enfant qui ne verrait rien de ce qu’admireraient les autres émut tout le monde; madame de Saint-Alban effaça cette impression douloureuse en annonçant qu’elle avait fixé le départ pour le surlendemain. «Ainsi, mesdemoiselles, hâtez-vous de faire vos caisses. Que la chaleur présente ne vous fasse pas oublier les vêtements chauds. Les robes légères sont aussi de rigueur. Nous irons au salon, vous danserez peut-être.»
Il est aisé de se figurer comment ces paroles furent accueillies. Cependant Marie ne quittait pas son père sans appréhension. La santé de M. Liébert exigeait des soins que la bonne fille se croyait seule capable de diriger. Toutefois l’espérance de le voir arriver quelques jours plus tard avec Adrien lui enleva tout scrupule; elle fit les préparatifs de voyage avec un entrain qui enchantait madame de Saint-Alban.
Une atmosphère nouvelle régnait dans la maison; tous les visages étaient joyeux.
«Tu es contente, Aline, dit à son amie madame de Saint-Alban, mais pas autant que moi. Ne t’imagine pas que ce soit uniquement parce que je suis l’occasion d’un plaisir pour tes filles; ce voyage en tête-à-tête avec mademoiselle Prudence, brave fille d’ailleurs, n’était pas une perspective bien gaie. Votre société me sera d’un agrément infini. Les amies d’enfance ignorent la froideur qu’apportent quelques années de séparation dans l’affection. Elles se retrouvent telles qu’elles étaient dans leur jeunesse.»
Madame Liébert se laissa persuader qu’elle rendait un service à son amie en l’accompagnant aux eaux.
Ceux qui connaissent le plaisir des voyages peuvent aisément comprendre la joie des deux sœurs. Aller au mont Dore! par un temps magnifique! et en compagnie d’une personne qui avait à leurs yeux les allures d’une fée!
Le jour du départ est arrivé ; l’heure en est fixée à sept heures, et nos jeunes filles sont prêtes depuis longtemps. Une large voiture s’arrête devant la porte. Les curieux sont aux fenêtres. En moins de dix minutes, la voiture est chargée; le nombre des voyageurs et des colis nécessite un attelage de quatre chevaux.
On s’embrasse: «Au revoir! sans adieu, papa! Nous serons bientôt de retour, ma bonne Janique. Repose-toi.»
La servante sourit et ferma la porte lorsqu’elle eut perdu de vue la voiture.
Ce ne fut qu’après avoir traversé le village de Chamaillères que Marie et Hélène se crurent réellement parties. Il avait été convenu entre les deux sœurs que pour ne pas affliger Anne elles admireraient en silence les beautés de la route. Elles se confiaient au guide très-fidèle dont madame de Saint-Alban les avait pourvues, se faisant de temps à autre de petits signes d’admiration.
On arriva au relais de Randame dont l’auberge est à peu près dépourvue de ressources..Ces dames ne l’ignoraient pas, aussi s’étaient-elles munies de provisions.
Parmi les personnes qui se trouvaient dans l’auberge, était un monsieur d’une cinquantaine d’années. Madame de Saint-Alban lui ayant demandé un renseignement, il lui répondit du ton le plus respectueux, et trouva un léger prétexte pour se rapprocher d’Anne qu’il observa avec attention. Cette attention n’avait rien de cette curiosité banale qu’excite trop souvent une infirmité.
On se remit en route, et bientôt nos voyageuses aperçoivent le village du mont Dore, le puy de l’Angle et le pic de Sancy. Hélène oublie ses résolutions et se trahit par un cri de surprise.
«Dis-moi donc, Marie, ce qu’on voit de si beau,» demanda Anne.
— D’abord, répondit la sœur aînée après avoir caressé l’enfant, on voit un ciel bleu sans nuages. Tu te rappelles bien le ciel, ma chérie?
— Oh! oui. Et puis le soleil, la lune et les étoiles, et aussi les nuages gros comme des balles de coton.
— Eh bien! ma petite chérie, tu connais ce qu’il y a de plus beau, car, si le ciel n’était pas bleu, les montagnes couvertes de neige qui ont tant surpris Hélène ne seraient pas si belles.
— Je comprends, sœur: je suis bien contente de me rappeler le ciel, puisque c’est ce qu’il y a de plus joli.»
Les deux mères écoutaient en silence, échangeant un regard, un serrement de main.
Un appartement avait été retenu à l’avance, et avec l’aide de bons domestiques il fut facile de s’y établir promptement.
La première personne que ces dames rencontrèrent le lendemain fut le Monsieur de Randame.
On se salua sans s’adresser la parole. Mme Liébert était impatiente de savoir le nom de l’homme qui avait témoigné tant d’intérêt à sa pauvre enfant.
Quelques heures plus tard, la liste des étrangers annonçait la présence de M. le docteur Aubrun, ex-médecin sanitaire en Orient. A table, soit à dessein, ou par hasard, le docteur se trouva près de Mme Liébert; les attentions que tout homme bien élevé doit à une femme furent l’occasion naturelle d’échanger quelques paroles, et quand on se sépara, Mme de Saint-Alban invita le docteur à passer la soirée chez elle.
A partir de ce moment, des relations amicales s’établirent entre eux. Quelques conseils ayant été demandés au docteur, il refusa de les donner, disant qu’il était plus prudent de consulter le médecin des eaux, ce qu’il faisait lui-même.
Parmi les personnes qui se trouvaient dans l’auberge était un monsieur d’une cinquantaine d’année.
Mme Liébert et ses filles trouvèrent dans M. Aubrun un chevalier très-entendu pour diriger les promenades. Il ne se passait guère de jour qui ne fût marqué par une course intéressante. Anne était toujours de la partie. Elle respirait l’air pur et semblait ne rien désirer de plus. Quelquefois le docteur la pressait dans ses bras.
L’intérêt avec lequel il l’observait n’échappait pas à Mme Liébert, elle gardait toutefois avec lui un silence absolu sur la cécité de sa fille.
Un jour qu’Anne creusait le sable dans le jardin de l’établissement et faisait une montagne dont elle appréciait la hauteur avec ses mains, son ami le docteur l’appela:
«Anne, venez vous asseoir près de moi, lui dit-il en la conduisant vers un banc.
— Est-ce que vous allez me raconter une histoire vraie? Je n’aime plus les contes de fées.
— Non, ma petite amie, je veux vous parler de vous.
— Ah! de mes yeux sans doute, tout le monde a pitié de moi. Je vous ai aimé tout de suite, je serais bien contente, si vous demeuriez à Clermont. Papa causerait avec vous....
— Anne, répondez-moi: avez-vous beaucoup de chagrin d’être privée de la vue?
— Mais oui, j’en ai beaucoup, beaucoup! Je pleure quelquefois lorsqu’on ne me voit pas. Ce qui me fait le plus de peine, c’est de ne pas me rappeler la figure d’Adrien, il est si gentil pour moi, mon frère! il viendra bientôt nous rejoindre avec mon papa.
— Je crois, ma petite amie, que je pourrais vous guérir.
— Vraiment! dit Anne en se rapprochant du docteur, qui la prit sur ses genoux et l’embrassa comme pour adoucir l’effet des paroles qui allaient suivre.
— Mais, chère enfant, on ne guérit pas sans souffrir.
— Ça ne fait rien. J’ai du courage, allez.
— Il faudrait être très-obéissante, ne pas s’impatienter, rester au lit pendant une grande semaine, au moins.
— Comment fait-on pour ne pas remuer?
— On ne remue pas, Anne.»
Cette réponse parut satisfaire la petite.
«Est-ce aujourd’hui que vous me guérirez?
— Non. Je vous accompagnerai à Clermont, je vous soignerai et je ne vous quitterai pas avant que vous ne soyez tout à fait guérie.»
Hélène, assise non loin de là, voyant Anne avec le docteur, n’avait pas cru devoir suspendre sa lecture, mais les exclamations bruyantes de la petite fille l’attirèrent.
«Ma sœur, bientôt je ne serai plus aveugle! C’est vrai, n’est-ce pas, Monsieur?»
Le docteur confirma ses paroles.
«Oh! que papa, maman et tout le monde vous aimera! On vous aime déjà. Mme de Saint-Alban a dit que vous avez l’air très-bon, que vous êtes très-aimable, que c’est très-heureux pour nous tous de vous avoir rencontré à Randame.
— Allons vite à l’hôtel leur dire que j’y verrai quand nous serons à Clermont.»
Anne fit son entrée dans le salon conduite par le docteur, qui lui laissait la joie d’annoncer les espérances qu’une observation sérieuse confirmait chaque jour.
Seul avec Mme Liébert, le docteur se montra surpris qu’on n’eût pas songé à opérer l’enfant.
«On nous a conseillé d’attendre, Monsieur, et je redoute tellement cette opération....»
Elle fondit en larmes.
«Madame, j’ai passé plusieurs années en Orient, et quoique la maladie de votre chère petite soit rare dans cette contrée, j’ai acquis de l’expérience, et lorsque je rencontre sur mon chemin quelqu’un qui est privé du bienfait de la lumière, je n’hésite pas à lui offrir mes services.»
On devine combien cette conversation émut la mère. Restée seule elle se jeta à genoux el remercia Dieu d’un bonheur que sa foi lui montrait déjà comme réel.
Mme de Saint-Alban voulut entendre le docteur confirmer les espérances qu’il venait de donner à son amie. Certes, elle n’était pas moins joyeuse que Mme Liébert. «Qui pouvait s’attendre que nous trouverions ici le libérateur d’Anne! Admirons, chère amie, comment la Providence vient au secours de ceux qui souffrent! Pour moi, je te déclare que je ne me plaindrai plus de mon asthme.»
Quoi qu’on en dise, les bonnes nouvelles vont aussi vite que les mauvaises! M. Liébert fut bien vite informé de ce qui se passait dans sa famille. Il hâta son départ et vint entendre les paroles d’espérance qui réjouissaient déjà les étrangers eux-mêmes.
M. Aubrun fut considéré dès lors comme un ami, un bienfaiteur qui avait droit à la reconnaissance de tous.
Marie et Hélène goûtèrent pleinement les distractions qui s’offraient à elles. Les chères enfants appréciaient avec calme le confort dont Mme de Saint-Alban les entourait. Elles donnaient un libre cours à leur joie. Adrien, qui avait profité de la leçon de sa petite sœur, revenait avec cinq couronnes qu’il posa sur la tête de la petite aveugle. Un collégien s’exalte toujours à l’idée de gravir des montagnes. Il n’était question que de longues courses devant lesquelles ne reculaient ni Marie ni Hélène.
«Allez, allez, disait Anne, je reste avec maman, nous causons de nos projets: Oh! mère chérie, que je serai donc contente de vous avoir! Il me semble qu’il me sera impossible de faire autre chose que de vous regarder les uns après les autres. Je ne suis plus triste du tout. Mais qu’on doit être heureux de rendre la vue aux aveugles! Adrien devrait se faire médecin.
Cependant la petite sœur avait aussi ses à-parté avec Adrien; elle lui faisait ses confidences. Que de belles choses ils admireraient bientôt ensemble et que de merveilles sortiraient des mains d’Anne: «Je te broderai des pantoufles, mon frère, et puis cette bonne Janique n’aura plus tant à faire! Qu’elle doit être contente! Enfin, je te verrai, mon petit Adrien!»
Un jour que son frère se complaisait à lui faire sans ménagement la description d’un beau soleil couchant qui faisait étinceler de mille feux le mont Dore, Anne l’interrompit: «Ne m’explique rien, nous reviendrons ici voir tout cela. La bonne madame de Saint-Alban me l’a dit.»
Anne mit de côté ses livres de caractères en relief; elle apprendrait tout, avec ses yeux. Cette foi dans une délivrance prochaine faisait trembler ses parents, M. Aubrun seul était ferme dans ses espérances.