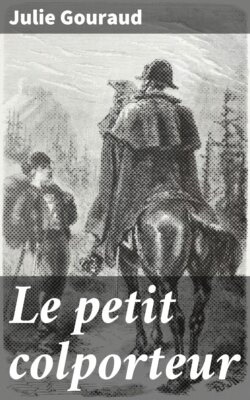Читать книгу Le petit colporteur - Julie Gouraud - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE I.
ОглавлениеTable des matières
Un épais brouillard couvrait la vallée de Niederbronn, l’une des plus pittoresques de l’Alsace: les maisons du hameau de Wasembourg étaient silencieuses, à l’exception d’une seule où plusieurs personnes étaient réunies: c’était celle de Constant Winkel, l’ancien maréchal ferrant. La veille, il avait reçu une lettre de son fils Georges qui lui annonçait son arrivée à New-York. Le vieillard, la tête découverte, tenait, près de la flamme épaisse de la lampe, une lettre dont les amis attendaient la lecture avec impatience....
«Enfin me voici arrivé après une promenade de douze jours sur l’Océan. Un temps magnifique et le cœur bon. J’ai trouvé tous les amis en débarquant, et il ne fallait pas moins que des figures connues pour me remettre de la triste impression que m’a causée la vue des Docks. Ah! que c’est triste! Faut-il aller si loin pour voir cela? Cependant, pour être juste, je dois vous dire, mon père, que New-York est une ville immense, étonnante: c’est grand à faire peur. Figurez-vous des maisons de cinq étages tout en fer; d’autres sont en marbre, mais tout aussi tristes que les premières. Ce qui est beau, c’est qu’après avoir vu les vagues de l’Océan s’agiter dans le port, les yeux se reposent sur une rivière qui porte une île au beau milieu de New-York. La grande rue qu’on appelle Broad-way est une fourmilière d’hommes. Ils vont dans tous les sens, le chapeau enfoncé jusque sur les yeux, au milieu d’une quantité effrayante de voitures, sans s’inquiéter de ce qui se passe autour d’eux. On reçoit à droite, à gauche, de bons coups de coude qu’il faut rendre à son tour pour arriver. Les femmes ne peuvent traverser d’un côté à l’autre de la rue sans être assistées d’un ou deux hommes de la police. Nos élégantes de Strasbourg feraient triste figure dans une pareille bagarre.
«Maintenant, passons au beau quartier, dans la Fith avenue, comme on dit, ce qui signifie la cinquième avenue. C’est plus beau que les Champs-Élysées, où nous nous sommes promenés l’année dernière: de chaque côté s’élèvent des palais en marbre blanc fort élégants et tous semblables les uns aux autres. Chacun de ces palais possède son parc, je devrais plutôt dire sa forêt; car jamais je n’ai vu de pareils arbres. Il y a de beaux édifices, comme Trinity-church, d’où l’on a une magnifique vue; mais si je vous en parle, c’est pour ajouter que, tout en rendant justice à la beauté du coup d’œil, je préfère la vue de la cathédrale de Strasbourg.
Le vieillard tenait, près de la flamme de la lampe, une lettre. (Page 1.)
«Dieu merci, il y a aussi une église pour les catholiques, et l’on est tout heureux de s’y rencontrer le dimanche.
«Pierre Leconte a une brasserie qui marche bien; les anciens camarades font de bonnes affaires; Rose Hulek et sa fille ont plus d’ouvrage qu’elles ne peuvent en faire. Ce n’est pas étonnant, les Américaines ont la passion des modes françaises.
«Cependant, mon bon père, le temps n’est plus où l’or poussait dans cette grande ville. Je n’y resterai pas, selon toute apparence; j’irai m’établir dans l’ouest, où, pour quatre ou cinq dollars, j’aurai un herbage. J’achèterai des bestiaux; c’est, m’a-t-on dit, le meilleur moyen de faire fortune aujourd’hui.»
Le vieillard commença une phrase qu’il n’acheva pas. Les voisins comprirent qu’il en resterait là, et, après l’avoir félicité et remercié, chacun regagna sa chaumière.
Quand on parcourt les belles vallées de l’Alsace, quand on voit ces champs si bien cultivés, on s’étonne de la facilité avec laquelle l’Alsacien quitte son pays. Mais son caractère aventureux explique ce goût d’émigration: ce n’est point la misère qu’il fuit, c’est la fortune qu’il cherche. D’une complexion forte et vigoureuse, il ne craint pas de s’engager avant que la conscription le réclame: «Si je meurs au champ de bataille,» se dit-il,
«voilà tout; si je reviens, je serai riche pour le le reste de mes jours; je me marierai, et ma vieille mère aura la première place au foyer.»
Les lettres de l’Amérique réveillent toujours l’ambition de l’Alsacien.
Parmi les personnes qui avaient assisté à la lecture de la lettre de Georges Winkel, se trouvait un garçon de treize ans, Pierre, le fils de la veuve Lipp. Son père avait été un des meilleurs ouvriers de la forge de Niederbronn, mais, un jour, ce cri sinistre: Un homme blessé ! retentit et glaça tous les cœurs. Cet homme était le père du petit Pierre, et cette blessure était mortelle.
L’enfant avait alors huit ans, la vue du corps de son père rapporté sans vie à la maison fit sur lui une impression qui ne s’effaça jamais. De turbulent, il devint calme; Madeleine sa mère, habituée à le voir sans cesse dehors, avait de la peine à le faire sortir de la maison. Il l’aidait dans les soins du ménage; soignait sa petite sœur Christine; il était apte à tout. La veuve de Lipp inspira le plus sincère intérêt; une petite pension lui fut accordée par les dignes propriétaires de la forge. On envoya Pierre à l’école, il s’y fit remarquer par son exactitude et son application.
C’était un beau et gentil garçon que Petit Pierre! avenant, le teint clair, les yeux noirs, la taille bien prise, l’allure ferme, chacun lui prédisait un bel avenir. Le maître d’école le considérait attentivement, hochait la tête et terminait son monologue par une prise ronflante,
Toutefois, à l’aisance du ménage avait succédé la gêne. Madeleine était journalière, commissionnaire; elle était tout ce qu’on voulait: forte et intelligente, elle élevait bien ses enfants, et elle avait su se mériter l’estime de tous les honnêtes gens.
Petit Pierre, la joie et l’espérance de sa mère, avait fait sa première communion, et il était arrivé à ce moment si difficile, où il faut choisir un état, entrer en apprentissage. Il avait horreur de la forge, et ne passait jamais par là sans nécessité.
De retour à la maison, Pierre raconta à sa mère et à sa petite sœur Christine toutes les merveilles qu’il avait entendues chez le vieux Winkel.
LA MÈRE.
Voyons, n’en perds pas l’appétit; avec ton Amérique, ne dirait-on pas que mon Pierrot va s’envoler?
PIERRE.
Et que diriez-vous, ma mère, si je vous disais que je suis décidé à voir du pays?
LA MÈRE.
Je dirais, mon cher enfant, que ce n’est pas à ton âge qu’on va courir les mondes. Je te permets d’aller jusqu’à Strasbourg, si ça te fait plaisir.
PIERRE.
Cette permission me suffit. Écoutez-moi. Et, quand vous m’aurez entendu, j’espère que vous bénirez mes projets.
J’étais encore bien petit le jour où le corps de mon père fut rapporté ici par ses camarades, et pourtant je ressentis un chagrin qui me changea tout à coup. Je n’avais encore pensé qu’à jouer, à courir, parce que je n’imaginais pas autre chose en ce monde. Quand je vous ai vue pleurer, et surtout, lorsque je n’ai plus vu le père à sa place, je me suis dit: Ah! je voudrais être grand pour gagner de l’argent! Bien souvent j’ai été pleurer à l’entrée du bois, puis un beau jour je n’ai plus pleuré. J’avais bien encore du chagrin, mais le désir d’apprendre me consolait. Je me figurais être grand, vous ne manquiez de rien, Christine non plus. Tout cela n’empêche pas que j’ai seulement treize ans et trois mois, et je me creuse l’esprit avec M. le curé pour savoir l’état qui va le plus vite. Eh bien! mère, je l’ai trouvé mon état: Je n’irai pas en Amérique; je serai marchand ambulant; mon apprentissage est fait: regardez-moi ces jambes-là, et ces bras, et ces bonnes épaules!
Petit Pierre, pour donner plus de poids à son discours, fit trois ou quatre enjambées, puis enleva Christine, en criant de sa plus grosse voix: «Bonne marchandise à vendre et pas cher, messieurs, mesdames.»
Christine perchée sur l’épaule de son frère riait de tout son cœur, et, si un de ces tristes heureux du monde l’eût vue, je crois bien qu’il eût donné une bonne somme pour réjouir son foyer privé de semblables joies enfantines.
LA MÈRE.
Tu as de bonnes idées, mon Pierre: il ne te manque que de l’argent. Où trouveras-tu l’argent nécessaire pour acheter de la marchandise?
PETIT PIERRE.
Oh! ce n’est pas difficile dans notre pays! Il ne manque pas de gens qui en prêtent.
LA MÈRE.
Assurément, mais c’est à quoi je ne consentirai pas, je t’en préviens, et je vais te raconter une histoire qui t’en fera passer l’envie à tout jamais.
PIERRE.
J’écoute.
LA MÈRE.
J’ai connu dans mon jeune temps un homme aisé qui avait un fils unique. Le père travaillait, amassait pour son fils, tandis que plein de vanité ; ce malheureux enfant aurait voulu être mis comme un monsieur. Un beau jour il lui prit la fantaisie d’avoir des boucles d’argent à ses souliers. C’était la grande mode alors. Son père qui s’était contenté toute sa vie d’attacher les siens avec des cordons de cuir, refusa absolument de donner de l’argent à son fils.
Irrité d’un refus si obstiné, le jeune homme emprunta trente francs, s’engageant à en payer l’intérêt. L’intérêt était gros, et chaque année le complaisant prêteur laissait volontiers l’intérêt s’ajouter à l’intérêt.
Les boucles étaient usées et la mode en était passée, lorsque quinze ans plus tard le père mourut, laissant à son fils unique un joli coin de terre. L’usurier se présenta, il n’obtint rien et promit encore de prendre patience: mais l’année suivante il se montra plus exigeant et il obtint cette fois un sillon du champ, enfin de sillon en sillon tout y passa et, quoique la chose paraisse invraisemblable à ceux qui n’en ont pas été témoins, cette paire de boucles coûta dix mille francs au vaniteux qui les avait portées.
«Bonne marchandise à vendre!» (Page 9.)
PIERRE.
Je n’aurai pas de boucles.
LA MÈRE,
C’est sérieusement que je te le dis, Pierre, j’ai horreur de ces prêteurs d’argent. Notre pauvre maisonnette et notre champ y passeraient. Renonce à ton idée? Tu es un brave garçon, le bon Dieu t’en enverra une autre, va!
PIERRE.
Je crois, mère, que celle-là est la meilleure. J’y tiens et voici comment je compte faire: Vous savez le beau château.... quoi! Eh bien! je vais aller trouver M. le comte et sa femme, et leur demander de me fournir un petit ballot.
LA MÈRE.
Tu veux mendier, mon fils?
PIERRE.
Mendier? jamais! n’est-ce pas, au contraire, une belle action d’aller dire au protecteur du pauvre: aidez-moi? Prêtez-moi la somme nécessaire pour acheter ma première balle de marchandises, et chaque fois que je reviendrai au pays je vous donnerai la moitié de mon gain.
LA MÈRE.
Tu es un sage enfant, petit Pierre. Il me semble entendre mon pauvre mari! Qui ne risque rien, n’a rien. Les proverbes sont là pour nous encourager. Eh bien! si la journée est belle demain, tu iras au grand château. Pendant ce temps-là, je prierai à la chapelle de Saint-Joseph.
CHRISTINE.
Tu m’emmèneras avec toi, frère. Mme la comtesse m’a parlé un jour que je me promenais dans son beau parc: «Tu es gentille, viens goûter avec mes enfants.» Et j’ai eu une tartine avec des confitures rouges qui tremblaient sur mon pain.
Madeleine, la mère de ces heureux enfants, finissait par prendre confiance dans les projets de Pierre. «On a vu ça, pensait-elle, un enfantcourageux tirer sa famille de peine, et certes, mon Pierre en est capable! Mais je serai triste de ne plus entendre sa voix sonore qui rappelle si bien celle de son père! Et quand je le saurai courant les chemins par le vent du nord aussi bien que par le soleil! Et puis, il suffit quelquefois d’une mauvaise rencontre pour perdre un cœur d’enfant. »
Madeleine n’était pas seulement une tendre mère, c’était aussi une femme de bon sens. Elle laissa sa raison naturelle dominer sa sensibilité, et finit par entrer courageusement dans les projets de son petit Pierre.
Dès le lendemain, elle prépara les meilleurs vêtements de ses enfants, les habilla de son mieux, et placée sur la porte de la maison, elle les vit partir se tenant par la main: après avoir levé les yeux au ciel, un sourire doux et triste erra sur ses lèvres.