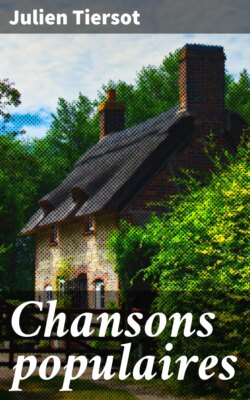Читать книгу Chansons populaires - Julien 1857-1936 Tiersot - Страница 6
PRÉFACE
ОглавлениеC’EST une manière d’alpinisme assez inédite que celle qui consiste à courir la montagne à la recherche des chansons populaires. Loin de s’en tenir à une observation superficielle, d’ailleurs sans négliger de contempler en passant les merveilles de la nature, l’on entre dans les chaumières, l’on s’entretient avec les habitants, on apprend à connaître leur vie, leurs mœurs, on évoque avec eux les souvenirs du passé de la race, et l’on pénètre ainsi dans la complète intimité du pays. Des recherches analogues aboutissent au même résultat: j’ai fait, au cours de mon exploration, maintes rencontres qui me le prouvèrent. Un jour, au pied des glaciers du mont Blanc, tandis que je conférais avec un instituteur sur les chansons d’autrefois, un étudiant en philologie d’une Université allemande s’approcha, et, se mêlant à notre entretien, vint demander des éclaircissements sur des particularités des patois savoyards. Ailleurs, une aimable hospitalité m’avait amené sous le même toit qu’un éminent naturaliste; chaque jour nous partions ensemble, lui, étudiant la flore alpestre, cherchant des traces de la chimérique manne de Briançon, tandis que, de mon côté, j’allais cueillir la fleur de la chanson, toujours vivace dans le jardin des vieux souvenirs. Et je tiens que, de part et d’autre, cette recherche était en tout point digne de la gravité de la science. Est-il rien de plus méritoire, en effet, que de chercher à surprendre sur place le secret de la nature? Une telle étude n’est-elle pas aussi féconde que celle qui prétend s’en tenir exclusivement aux vieux bouquins? Le Wagner de Gœthe dit: «On est bientôt las des forêts et des campagnes. Ah! quand vous déroulez un vénérable parchemin, c’est le ciel tout entier qui s’abaisse sur vous.» A quoi Faust, en proie à sa pensée intérieure, répond avec dédain: «C’est le seul désir que tu connaisses? Oh! n’apprends jamais à connaître l’autre!» Le famulus n’est pas un si beau modèle à suivre: cherchons à pénétrer plus loin, et considérons la vie dans la vie même.
La région dans laquelle j’ai entrepris cette enquête est étendue, et présente, en ses diverses zones, d’assez notables différences de physionomie.
C’est d’abord la Haute-Savoie, aux paysages amples, aux vallées larges, verdoyantes et fertiles, bornées par les lignes des fières montagnes, aux rochers dentelés, à travers les échancrures desquelles on aperçoit, s’étalant au loin, les majestueuses blancheurs des champs de neige. Déjà la Tarentaise, plus étroite, est plus sombre, avec ses noires forêts couronnant les cimes, et son Isère aux eaux grises courant au fond des rives encaissées. La Maurienne, plus étendue, accentue l’impression d’aridité, de vie primitive et quasi sauvage. Dans le Grésivaudan, riche et populeux, d’accès facile en son altitude basse, nous trouvons au contraire tout ce que la civilisation offre de plus avancé. Mais si nous remontons les vallées dans la direction de l’arête qui forme la frontière, tout change. Voici l’Oisans, l’une des plus âpres contrées des Alpes. Là, plus de verdure, et presque plus d’habitants. Les montagnes, en ardoise, ont des tons d’acier. Tout est noir: costumes noirs, villages noirs, perchés sur des roches noires. On éprouve un sentiment d’isolement complet. Comment l’homme pourrait-il chanter là, si loin du monde? Les travaux de la terre sont trop durs pour que le chant y puisse coopérer; les bergers, vivant seuls pendant de longs jours, ne songent même pas à lui demander les distractions qu’y cherchent les bergers de la plaine; et cela s’explique: ceux-ci, moins éloignés les uns des autres, s’entendent et se répondent:
De la montagne à la vallée,
La voix par la voix appelée
Semble un soupir;
Ainsi chante le pâtre breton de Brizeux. Mais le berger des Alpes n’a pas cette consolation. Accoutumé au silence, il n’éprouve même pas le désir d’entendre sa voix. L’aridité du sol va de pair avec la sécheresse de l’esprit. Un voile de tristesse, une impression de néant semble s’étendre sur la contrée tout entière.
Brusquement, quand, sortant de l’Oisans, on continue la course vers le sud, tout change: non pas tant l’aspect du pays que le caractère des habitants, chez qui l’on remarque une plus grande vivacité, et leur langage. J’ai pu faire sur le vif l’observation de cette différence en une seule journée de voyage, du Bourg d’Oisans à La Mure à travers le col d’Ornon. La veille, dimanche, avait été jour de «vogue» au Bourg d’Oisans, et jamais je ne vis fête populaire plus morne. La montagne traversée, tout changea. Au milieu du jour, passant par le petit village d’Entraiguës, je vis une grande animation par tout le pays; les habitants étaient sur les places, parlant à voix haute, riant, chantant, s’amusant aux jeux populaires qu’a décrits Mistral. Eux aussi avaient eu la veille leur fête patronale, et ils la prolongeaient joyeusement. Je sentis alors que j’étais arrivé dans un pays nouveau, le Midi, et rien dans la suite ne me démentit. Dans toute la partie méridionale du Dauphiné, sur les plateaux de la Matheysine et du Trièves, dans les vallées du Drac et de la Durance, enfin dans les villages haut perchés du Queyras, partout je renouvelai les mêmes remarques. Les paysages, non moins grandioses que les premiers, plus arides encore dans l’ensemble, sont de tons plus clairs, avec d’immenses rochers jaunes ou rouges se dressant à pic à des hauteurs vertigineuses, de belles forêts de mélèzes, au feuillage délicat, et, dans les fonds, les longues traces blanchâtres des torrents laissant à découvert leurs lits desséchés. Quant aux habitants, ils sont vifs et loquaces, mieux découplés que leurs voisins du nord et d’un type moins lourd; enfin leur langue populaire est le provençal déjà parfaitement constitué.
La différence des mœurs s’est naturellement marquée dans la manière dont, suivant les régions, j’appris à connaître le répertoire des chansons. Dans cette partie méridionale du Dauphiné, ce fut toujours en des réunions plus ou moins nombreuses, et fort animées, qu’elles me furent communiquées: d’ordinaire on ne se borna pas à chanter, mais on voulut me donner encore le spectacle de la vie populaire elle-même. C’est ainsi qu’à Mens, village que je pourrais appeler «la capitale du rigodon», les personnes qui se chargèrent de m’initier aux secrets de celte danse pittoresque, non contentes de faire entendre les airs à la voix, mandèrent un ménétrier, et dansèrent comme si c’eût été jour de fête. Près de là, à Clelles, où je ne passai qu’une soirée, l’on fit réveiller de braves travailleurs qui, harassés de leur journée de labeur, ne s’en rendirent pas moins avec empressement à mon appel, bien convaincus que la privation de sommeil qu’ils s’imposaient était dans l’intérêt de la science; encore à demi engourdis, ils surent me dire, et certains avec de fort jolies voix, de gracieuses et poétiques chansons d’amour. A Château-Queyras, les chanteurs, requis par le maire, furent réunis, dans la grande salle de la maison commune, et là chacun à son tour dit sa chanson, — bien heureux encore si je pouvais obtenir qu’ils ne chantassent pas tous à la fois! A Saint-Véran, ce fut encore le maire qui fit les convocations, pour le soir, dans la grande salle de l’auberge, et je n’oublierai de ma vie le tableau éminemment pittoresque de ces rudes montagnards, aux visages généralement hirsutes, pénétrés de leur importance d’habitants du village le plus élevé de France, dont plusieurs avaient apporté des vielles ou des violons, et qui, pendant plusieurs heures, me dictèrent à tour de rôle des airs de danse, des chansons de noces, des sérénades amoureuses.
En Savoie, je n’assistai à une scène aussi animée que dans une seule localité, Bessans. Il est vrai qu’elle fut mémorable. Bessans, village situé dans la partie la plus élevée de la Maurienne, a un caractère à part qui lui a valu une renommée. légitime dans la région. C’est un des rares endroits des Alpes où les femmes aient conservé un costume traditionnel complet. Sur la coiffe noire ou rouge, ornée de rubans, que portent habituellement les femmes de la Maurienne, elles mettent, pour aller aux champs, un chapeau de paille plat, aux larges bords tombants, garni de plumes d’autruche qui pendent par derrière, et d’une plume de paon se dressant sur le devant. Un mouchoir noué à la taille couvre les épaules; sur la poitrine, suspendue à un ruban, s’étale une croix dorée dont les dimensions variées indiquent la fortune de celle qui la porte. Des manches larges, engonçant les épaules, une jupe courte, généralement retroussée sur des jupons plus courts encore, et de gros souliers ferrés, complètent le costume des Bessanaises, sans élégance, mais non sans caractère . L’allure générale des personnages ne l’est pas moins. Il faut les voir, avec leur teint bronzé, leur démarche massive et leur air délibéré, s’en allant dans la montagne en portant sur l’épaule, comme les hommes, les gros outils de travail, ou, mieux encore, montant sur les mulets et les excitant à grands coups de pointe. La race est forte et habituée aux rudes tâches. Le caractère des habitants est indépendant, volontaire et décidé, non sans une forte tournure satirique, un peu sauvage au fond, et d’abord parfois difficile.
Ici, c’est le curé qui s’était chargé de me mettre en communication avec ses paroissiens chanteurs. Mais d’abord nos efforts parurent se heurter à un mauvais vouloir universel. Il est bien vrai que le paysan se méfie lorsqu’il voit venir à lui un inconnu, arrivant de Paris, lui demandant des chansons qu’il méprise, lui, car il trouve bien plus belles les niaiseries diverses qu’on lui apporte des cafés-concerts de la ville voisine. Que lui veut-on? qu’est-ce que ce Monsieur prétend faire de ses chansons? ne veut-il pas se moquer de lui? Ou bien ne serait-il pas lui-même détenteur d’un secret qu’il doit conserver? et puis il n’a pas le temps de chanter: il faut qu’il peine pour gagner sa vie! Nous trouvâmes donc à Bessans une première résistance qui sembla de mauvais augure. Je me rappelle notamment une grande fille que l’on m’avait désignée comme ayant la plus belle voix du pays, et avec qui les négociations furent particulièrement difficiles: en vérité, elle commença par repousser ma requête avec autant d’indignation que si je lui eusse adressé des paroles déshonnêtes! En outre je jouai de malheur: voilà qu’au jour fixé, un chanteur qui m’avait donné sa parole fut arrêté par les gendarmes pour fait de contrebande: aventure ordinaire, mais qui, chaque fois qu’elle se produit, n’en tient pas moins la population sous le coup d’une inquiétude momentanée. La réunion s’annonçait donc fort mal. Pourtant, le soir, deux ou trois jeunes gens se décidèrent, et nous commençâmes à travailler. Les chants s’entendaient du dehors: ils attirèrent d’abord les moins récalcitrants, puis les autres; la salle s’emplit peu à peu, et bientôt chacun voulut dire sa chanson. Mais le triomphe fut complet quand apparut la capricieuse «artiste» qui naguère m’avait si durement rabroué. La curiosité l’avait emporté ! Il fallut bien qu’elle chantât aussi: et, de fait, je lui dois une excellente version d’une de nos plus belles chansons françaises, Germaine, et.des airs de noëls de Bessans, qu’elle entonna d’une voix de clairon capable de faire résonner les échos depuis le mont Cenis jusqu’à la Vanoise! Ici encore la soirée se termina par une danse au son des chansons, et je n’en vis guère de plus animée.
Mais en général le paysan de Savoie n’a pas tant de vivacité. D’esprit sérieux, il est au premier abord peu communicatif. Les entretiens que j’eus avec la plupart de ceux qui consentirent à me faire part de leurs anciens souvenirs eurent un caractère de travail intellectuel que n’interrompit aucune distraction. C’est en Savoie aussi que j’ai trouvé le plus grand nombre de cahiers, anciens ou modernes, renfermant des copies de chansons populaires. L’on sait que cette province est une de celles où l’instruction primaire est le plus avancée, et qu’aussitôt après l’annexion, les départements qu’elle forma furent classés, à ce point de vue, à la tête des départements de France, venant immédiatement après les grandes villes. Je devais donc trouver, dans un pays aussi éclairé, les plus grandes facilités pour mon enquête, et ce ne fut pas là en effet qu’elle produisit les moindres résultats.
A vrai dire, on ne saurait trop répéter le cri d’alarme poussé depuis longtemps par ceux qui ont à cœur de sauver de l’oubli les vestiges de ces antiques manifestations de notre esprit national, car ils disparaissent de jour en jour, et je ne crois pas être prophète de malheur en prédisant que la génération qui naît actuellement n’en connaîtra plus rien. Le mal sera moins grand si les livres les ont conservés: encore, est-il bien sûr que nous soyons venus à temps? Que de fois n’ai-je pas vu des gens faire de vains efforts de mémoire et s’écrier, découragés: «Mon père chantait ceci! Ah! si vous aviez entendu ma grand’mère!» Mais les ancêtres sont morts depuis longtemps; les vieux n’ont plus que de vagues souvenirs, et les jeunes encore moins. J’ai vu des octogénaires disant qu’ils avaient ouï parler dans leur enfance, à leurs anciens, de coutumes dont eux-mêmes n’avaient jamais été témoins, par exemple les fêtes de Mai, si antiques, et auxquelles sont associées de si poétiques chansons. Il était nécessaire de noter ces souvenirs de choses abolies depuis un siècle et plus. Mais combien d’autres qu’on ne retrouvera jamais!
Sauf quelques rares exceptions, et si je mets à part le répertoire des danses populaires du sud du Dauphiné, encore généralement pratiquées et connues de tous, c’est donc à des vieillards, quelques-uns très avancés en âge, que je dois les plus intéressantes communications. Encore n’avais-je que trop raison de m’écrier: «Il n’est que temps! Il est trop tard!» car, depuis les cinq années que cette recherche fut entreprise, plusieurs de ces vénérables collaborateurs ont disparu de ce monde.
La première personne que j’entendis, le premier jour de mon entrée en Savoie, fut la vieille Fanny Roux, de Bonneville, née en 1805. Cette brave femme a passé tout le dix-neuvième siècle à offrir des gâteaux et des fruits aux Anglais traversant la ville pour se rendre au mont Blanc, jusqu’au jour où le chemin de fer lui a ravi ce gagne pain. C’était jadis une chanteuse renommée. Elle commença par me déclarer ses préférences pour les romances d’Estelle et Némorin, et me communiqua une liste des principaux chants de son répertoire, parmi lesquels je remarquai: Il pleut bergère, Dormez mes chères amours, Paul et Virginie; elle put aussi retrouver dans sa mémoire quelques vieilles chansons locales, en patois, et même un ou deux vrais airs populaires. Élevée à la ville, elle connaissait peu les chansons rustiques; elle n’en fut pas moins intéressante à observer, comme un véritable type d’un autre âge. Elle est morte peu de temps après mon passage.
Je trouvai mieux encore à Cervières, près Briançon, en la personne de Mme Faure Vincent, pauvre vieille impotente, clouée par la paralysie dans sa sombre maison de bois à demi enfouie dans la terre, mais ayant gardé toute sa lucidité d’esprit. Je lui dois toute une collection de chansons, qu’elle me dit d’une voix faible, mais très juste, et dans le meilleur style du chant populaire: j’en ai extrait plusieurs perles, notamment une intéressante version de la chanson de Renaud, et une chanson de Mai admirable de conservation et de caractère primitif. J’ai appris sa mort il y a deux ans.
J’avais reçu longtemps de bonnes nouvelles du père Paulin, de La Mure, le dernier homme de France, à coup sûr, qui ait vu Napoléon. Au retour de l’île d’Elbe, l’Empereur s’était arrêté quelques instants à La Mure: ses grenadiers, pour le soustraire à une curiosité trop indiscrète, faisaient ranger les habitants sur son passage; mais lui, jugeant le moment particulièrement opportun pour se rendre sympathique au peuple, avait fait approcher des enfants qui le regardaient avec de grands yeux, et leur avait parlé. Le père Paulin fut de ceux qui recueillirent cette auguste parole!... Il eût été déplacé de ne pas lui demander quelqu’une de ces chansons sur Napoléon dont le souvenir n’est pas effacé dans les vallées alpestres, et il s’exécuta de bonne grâce; mais il me dit bien d’autres choses encore, des rigodons en patois du pays, des chansons populaires françaises, qu’il débita avec une bonne humeur entraînante et une voix encore belle dont l’âge avait à peine altéré le timbre. Il a survécu plus longtemps que les précédents; cependant l’hiver dernier a fini par l’emporter à son tour .
Dois-je citer encore Mme Guichard, de Mens, dont le fils a publié d’intéressants travaux sur les patois du Trièves? Elle voulut bien, à mon appel, venir dans un milieu beaucoup plus juvénile, dont les représentants me chantèrent force rigodons. Mais elle fut la seule à savoir retrouver la mélodie de la vieille complainte du Maure Sarrasin, à laquelle son chant très lié et l’accent un peu indécis de sa voix prêtaient un charme archaïque très pénétrant.
A noter encore une observation faite dans cette même réunion: il s’y trouvait un joueur de violon qui exécutait avec la plus grande sûreté les airs de danse. Or, à une observation que je lui fis, il m’apparut qu’il ne savait pas une seule note de musique, et ne connaissait même pas le nom des cordes de son instrument! Cela soit dit en passant, pour répondre à ceux qui ne veulent pas admettre que l’art populaire soit un art purement instinctif, n’exigeant dans sa pratique ni effort ni étude. L’exemple est bien significatif, puisqu’il s’agit ici d’un talent essentiellement technique, et que cependant l’artiste populaire n’avait rien appris de personne, qu’il ignorait tout.
Je voudrais clore la série de ces souvenirs d’exploration en contant un épisode qui me procura une occasion, que je n’avais point cherchée, de recueillir des chansons. Son véritable héros fut un maître illustre, gloire du Dauphiné et de la France, sous l’invocation de qui je suis heureux de mettre ce livre dès ses premières pages: Hector Berlioz. Son nom devait, à tous égards, avoir sa place ici. Berlioz vivait dans un temps où les artistes ne se préoccupaient guère de la chanson populaire, qu’ils dédaignaient et ignoraient: on peut dire cependant qu’il en eut l’intuition. En Italie, où la musique qu’on faisait dans les théâtres vers 1830 ne lui inspirait que du dégoût, il alla chercher des impressions plus pures dans la montagne. «Je m’en tins à la musique des paysans, a-t-il écrit; au moins a-t-elle, celle-là, de la naïveté et du caractère.» Il donne en effet, dans ses Mémoires, des notations d’airs de pifferari dont il a reproduit les formes et les rythmes dans plusieurs de ses grandes œuvres: Benvenuto Cellini, la symphonie d’Harold. Et si, de retour à Paris, il n’eût eu à s’occuper de Beethoven, de Gluck, — et de Berlioz lui-même, — qui sait s’il ne se fût pas tourné vers l’étude de l’art populaire, et ne fût devenu ainsi le premier de nos folkloristes? car il sentait très vivement ce qu’il y a de vivace dans les mélodies rustiques: cela transparaît même à travers ses boutades. Veut-il parler du style volontairement archaïque dans lequel il a écrit son Mystère de la Fuite en Égypte, il s’exprime en ces termes: «L’ouverture est en fa dièze mineur sans note sensible, mode qui n’est plus de mode, qui ressemble au plain-chant, et que les savants vous diront être un dérivé de quelque mode phrygien, ou dorien, de l’ancienne Grèce, ce qui ne fait absolument rien à la chose, mais dans lequel réside évidemment le caractère mélancolique et un peu niais des vieilles complaintes populaires.» La vérité est que ces vieilles complaintes populaires, dont il parle d’un ton si dégagé, mais non sans une secrète sympathie, l’ont inspiré directement, peut-être sans qu’il s’en doutât, dans la composition du Mystère. Le récit du Repos de la Sainte Famille n’est-il pas d’une conception toute primitive? Je retrouve dans le thème initial:
«Les pèlerins étant venus», la ligne mélodique d’une chanson de Mai populaire dans tout l’Est, et que peut-être il entendit chanter en son enfance aux paysans de la Côte Saint-André. Il a écrit quelque part: «Je ne veux pas faire une réputation aux Dauphinois, que je tiens, au contraire, pour les plus innocents hommes du monde en tout ce qui se rattache à l’art musical» ; cependant, après cet exorde, il fait l’éloge d’une mélopée
«douce, suppliante et triste» qu’il leur entendait chanter aux processions des Rogations, et qui est une vraie mélodie populaire, le fameux tonus peregrinus de la psalmodie; et il en avait reçu si vivement l’impression qu’il l’introduisit dans l’œuvre capitale de son âge mûr, La Damnation de Faust: preuve certaine qu’il avait su bien écouter les chants de son pays natal.
Louis PAULIN, le vieux chanteur de La Mure (voyez, p. 11).
Longtemps avant de songer à recueillir les chansons populaires dauphinoises, j’avais visité les lieux décrits par Berlioz dans ses Mémoires, entre autres Meylan. L’on sait qu’en ce village, s’étageant sur le flanc du Saint-Eynard, habitait, au temps de son enfance, une belle jeune fille qui fut sa première passion. Le jour où j’y fus pour la première fois, un orage me retint plusieurs heures à l’auberge. C’était dimanche; la salle était pleine de gens attendant comme moi un rayon de soleil: j’imaginai, pour passer le temps et chercher à faire revivre les vieux souvenirs, de leur lire le chapitre dans lequel leur compatriote raconte le pèlerinage d’amour que, déjà vieux, il fit en ces lieux où son cœur avait subi le premier éveil. «Je sens bondir mes artères à l’idée de raconter cette excursion», écrit-il en commençant son récit. Cependant il s’étend plusieurs pages sur ce souvenir amer et doux: les événements de la douzième année reviennent à sa mémoire; il semble, dit-il, un homme mort qui revient à la vie. Le voilà gravissant la montagne: il s’égare, interroge les paysans; tous ont oublié : une vieille cependant se souvient; elle a vu autrefois cette «Mam’zelle Estelle si jolie que tout le monde s’arrêtait à la porte de l’église, le dimanche, pour la voir passer.» Il monte encore, il se reconnaît, il arrive enfin. «Dieu! l’air m’enivre... la tête me tourne... je m’arrête un instant, comprimant les pulsations de mon cœur.» Il revoit tout, la vieille tour, la maison sacrée, le jardin, les arbres sous lesquels il jouait de la flûte, et plus bas la vallée, l’Isère qui serpente, au loin les Alpes, la neige, les glaciers. «Saigne, mon cœur, saigne, mais laisse-moi la force de souffrir encore.» Elle est montée sur cette pierre; elle a cueilli des fruits à ce buisson de ronces; sur ce cerisier sa main s’est appuyée; et qu’est-ce encore? Un plant de pois qui fleurit à la même place. «Éternelle nature!... Les pois roses y sont encore, et la plante plus riche, plus touffue qu’autrefois, balance au souffle de la brise sa gerbe parfumée. Temps! faucheur capricieux! la roche a disparu et l’herbe subsiste... Je suis sur le point de tout prendre, de tout arracher... Mais non, chère plante, reste et fleuris toujours dans ta calme solitude... sois y l’emblème de cette partie de mon âme que j’y ai laissée jadis et qui l’habitera tant que je vivrai! Je n’emporte que deux de tes tiges avec leurs fleurs-papillons aux fraîches couleurs, papillons constants!... adieu!... adieu!... bel arbre aimé, adieu!... monts et vallées, adieu!... vieille tour, adieu!... vieux Saint-Eynard, adieu!... ciel de mon étoile, adieu!... Adieu ma romanesque enfance, derniers reflets d’un pur amour! Le flot du temps m’entraîne; adieu, Stella!... Stella!...
«Triste comme un spectre qui rentre dans sa tombe, je descendis la montagne.
«Et partout un doux soleil, la solitude et le silence.»
Le silence, il était dans la salle, où peu à peu tout le monde s’était rapproché pour écouter la lecture: silence profond, complet, pareil à celui qui règne au concert quand les sourdines murmurent la danse des Sylphes... L’admirable public que le peuple! Le chapitre fini, tous se taisaient encore, dans une attitude de recueillement, pénétrés de cette poésie qui venait de se révéler inopinément dans le terre à terre de leur vie quotidienne. Un vieux parla le premier, disant ces simples mots, d’un ton presque craintif, comme s’il osait à peine exprimer une opinion, pourtant avec un air de conviction intime: «C’est beau cela, Monsieur.» Et tous s’éloignèrent, émus. Je ne crois pas que Berlioz ait été souvent si bien compris dans son pays natal, et je me félicite grandement d’avoir été ce jour-là son porte-parole.
Or, douze ans plus tard (on voudra bien excuser cette longue digression en faveur du sujet), me retrouvant à Grenoble inoccupé pendant la fin d’un jour d’été, je voulus revoir ce village de Meylan aussi beau par le site qu’intéressant par le souvenir. Arrivé près de la vieille tour dont la ruine se cache parmi les herbes hautes, je rencontrai un homme qui gardait un troupeau en lisant un livre d’agriculture. Il faut s’habituer à vivre avec son temps. Autrefois les bergères aux champs filaient leur quenouillette: aujourd’hui les bergers lisent des livres d’agriculture. Nous liâmes conversation, et j’appris que j’avais affaire au possesseur actuel de cette terre jadis féodale. De mon côté, je lui parlai de ma recherche de chansons. Il était au courant; un journal de Grenoble avait publié naguère un article annonçant ma venue, et dans lequel était professée cette double opinion: qu’il était urgent en effet de recueillir les chansons populaires, mais que le Ministère de l’Instruction publique avait eu le plus grand tort de s’intéresser à la mission que j’avais entreprise et de m’en faciliter l’accomplissement, — conclusion dont personne ne contestera la logique admirable. L’homme avait lu l’article, et il faut avouer que les paroles amères ne l’avaient aucunement ému, tandis qu’il avait été séduit par l’idée du recueil de chansons dauphinoises: il se mit donc tout spontanément à ma disposition. Décidément la presse a du bon. Il me conduisit dans sa maison, voisine de celle où jadis avait vécu la belle Estelle, fit venir sa vieille mère, et lui demanda de chanter ses chansons, dont elle avait un répertoire nombreux et des mieux choisis. Et, tandis qu’auprès de l’antique donjon, dans le lieu qui avait été témoin des amours romantiques du maître musicien, la paysanne redisait les airs d’autrefois, j’écrivais, assis sur le seuil, dominant la vallée qui peu à peu s’emplissait d’ombre, levant parfois les yeux pour contempler au loin la ligne brisée des Alpes se découpant sur un ciel très pur: la Croix de Champrousse, les trois pics de Belledonne, le sombre Taillefer, maintenant colorés d’un rouge ardent par les derniers rayons du soleil, puis s’éteignant à leur tour dans le gris crépusculaire. Je restai là plusieurs heures, jusqu’à ce que la nuit complètement tombée interrompit notre commun travail, exécuté de part et d’autre avec une égale gravité, et je rapportai encore de Meylan une dizaine de chansons, sur lesquelles je n’avais pas compté. C’est à Berlioz que je les dois.
L’artiste trouve donc une satisfaction complète dans l’exécution d’une telle entreprise, et nous verrons bientôt que l’érudit n’en a pas moins. Il est évident que les chansons populaires ne peuvent nulle part être mieux appréciées que dans leur milieu. Bien que celles des régions alpestres ne se laissent pas aisément surprendre, — car, je l’ai dit, les vallées sont silencieuses, et les montagnards chantent peu, — l’importance de leur rôle dans la vie locale n’a pas échappé à certains observateurs. Une femme dont le nom est célèbre dans les annales de l’alpinisme, Mlle d’Angeville, la première Française qui ait fait l’ascension du mont Blanc, contant son expédition, rapporte l’épisode suivant. C’était le soir, aux Grands-Mulets; deux caravanes s’étaient rencontrées; Mlle d’Angeville eut l’idée de passer la soirée a donner un concert sur le glacier. «Les guides se réunirent et entamèrent à pleine voix leurs chants nationaux, une chanson en patois, et le Ranz des vaches. Ils furent interrompus par le bruit d’une avalanche tombant des monts Maudits avec le fracas de la foudre...» Il y a évidemment quelque dilettantisme dans ce récit, et pas mal de fantaisie. Le Ranz des vaches, par exemple, jamais les guides de Chamonix ne l’entonnèrent, aux Grands-Mulets ni ailleurs, par la raison que les Savoyards ignorèrent toujours ce chant, exclusivement helvétique. Mais admettons qu’il s’agissait de simples chansons pastorales (les montagnes en sont pleines): une telle audition, première enquête sur la chanson populaire des Alpes, ne dut-elle pas procurer à ceux qui y assistèrent des impressions autrement vives que s’ils avaient lu les mêmes morceaux sèchement notés dans un livre?
Femme de la Tarentaise.
Il est certain que les Alpes forment une scène admirable sur laquelle toute manifestation d’art ressort merveilleusement. Je conçois très bien l’effet que doit produire la Passion d’Oberammergau, effet certainement dû pour une plus grande part au milieu qu’aux mérites intrinsèques de la représentation. La Savoie ni le Dauphiné ne nous offrent, il est vrai, de spectacles semblablement organisés; et pourtant le hasard procure parfois au voyageur des sensations inattendues. Qu’on veuille bien me permettre encore de faire appel à mes souvenirs; le lecteur comprendra bien qu’en les lui communiquant je ne cède pas au vain désir de l’occuper de ma personne, mais qu’en lui décrivant les spectacles dont j’ai été témoin je cherche simplement à le placer lui-même dans le milieu qui convient.
Les manœuvres du 14e corps d’armée en 1892 venaient de s’achever dans la haute vallée de l’Arly, et les troupes, cantonnées dans les châlets des montagnes, jouissaient avec délices d’un repos bienfaisant, quand, au matin, une sonnerie se fit entendre, se répandant sur tout le pays. Massés sur une éminence, clairons et tambours, exécutaient le Réveil en campagne. On sait que la musique de cette sonnerie règlementaire, d’un usage exceptionnel et d’un développement inaccoutumé, se compose de deux mouvements, le premier calme, en style lié, le second en notes détachées, rapide et joyeux, tous deux alternant et se succédant l’un l’autre à plusieurs reprises. Je parlais tout à l’heure du Ranz des vaches: on dirait vraiment que l’auteur inconnu du Réveil en campagne a pris pour son modèle cet air instrumental des bergers suisses, car la forme en est toute pareille. Répétée par les échos les plus lointains, la claire sonnerie des clairons prenait une charme indéfinissable. L’évocateur solo de cor anglais, dans le Manfred de Schumann, ne laisse pas à l’audition une impression plus profonde: l’air militaire devenait un chant de montagne de la plus pénétrante poésie.
Une autre fois, c’était à la Grande-Chartreuse. L’office de Matines présentait ce rare intérêt que le corps d’un Père., mort la veille, était exposé devant l’autel, dans sa grande robe blanche, le visage couvert du capuchon, étendu sur une planche, sans cercueil. Dans leurs stalles, les Chartreux chantaient, impassibles. Parmi la monotonie de leur longue et sèche psalmodie, une mélodie se dessina, à la tonalité sombre, au rythme bien accentué, qu’ils répétèrent plusieurs fois: elle me produisit un véritable effet d’épouvante! Je la retrouvai plus tard dans les livres de chant: c’était une hymne ambrosienne, d’un grand caractère assurément, mais qui certes ne m’eût pas autant frappé en toute autre circonstance.
Quelle émotion tragique n’auraient pas causé les sombres complaintes de Jean Renaud ou de Pernette si on les eût entendues en un milieu analogue? Et combien les chansons mélancoliques des bergères sont mieux à leur place au milieu des prairies couronnées par les forêts sombres, les rocs et les glaciers, que dans un cabinet d’étude ou dans un salon parisien, accompagnées par le piano?
Profitons donc des derniers moments où nous en pouvons jouir encore pour déterminer quelle place la chanson populaire a tenue et tient encore dans l’existence des habitants des provinces alpestres.
Il est évident que la chanson est pour eux essentiellement une distraction et un délassement. On la chante à table, aux jours de fête, dans les réunions de famille, aux noces. On la chante aussi dans les veillées d’hiver, qui, pendant de longs siècles, furent les principaux conservatoires de la chanson. Il est tout un groupe de chansons amoureuses que les jeunes gens disent en l’honneur des jeunes filles, sous leurs fenêtres, en manière de sérénades; d’autres sont associées à d’anciens usages traditionnels, comme les chansons de mariage et celles des fêtes de Mai. Certains travaux des champs sont exécutés au son de chansons appropriées: nous trouverons, au cours du livre, des chants de moissons dont certaines, par leurs mélodies, ont grande allure. Les garçons qui tirent au sort et partent pour le service militaire ont aussi leur répertoire de chansons, nombreux, sinon très varié d’accent. Et les bergères ne cherchent-elles pas à tuer le temps en répétant quelques-unes de ces lentes pastourelles dont elles sont elles-mêmes les héroïnes? On n’en saurait douter. Quant aux danses, elles ont leur place toute marquée aux fêtes. Chaque genre a donc son affectation particulière, et la chanson, au lieu d’être un plaisir purement conventionnel, est intimement liée aux diverses manifestations de la vie.
L’art de ces chanteurs rustiques est, on le pense bien, très élémentaire: pour mieux dire, tout art est absent de leur interprétation; la nature seule chante en eux. J’ai trouvé quelques belles voix dans la partie méridionale des régions explorées, et j’ai tout lieu de croire que j’en aurais entendu davantage si j’avais poursuivi vers la Provence. Mais, en général, dans les hautes montagnes, en Savoie plus encore qu’en Dauphiné, les chanteurs populaires ne brillent guère par la beauté de la voix: la juste interprétation des paroles est leur préoccupation plus essentielle.
Les habitants des régions alpestres ont l’esprit, trop ouvert aux choses de l’intelligence pour avoir dédaigné de cultiver ce fonds d’art et de poésie. Ils ont fait encore mieux: l’on a retrouvé dans leurs vallées des traces de manifestations plus compliquées de littérature locale. Je ne veux pas parler ici de certaines productions semi-populaires, noëls, chansons d’actualité, etc., dont il a été conservé de nombreux échantillons; mais voici quelque chose de plus caractéristique encore, et de plus important. Par quel singulier phénomène se trouve-t-il que les montagnes ont toujours été un théâtre favorable à l’exécution de certaines œuvres scéniques, je ne saurais le dire. La Passion d’Oberammergau, déjà nommée, est aujourd’hui célèbre par toute l’Europe. Or, il se trouve que les régions les plus reculées de l’immense chaîne française ont eu, en des temps très anciens, des représentations analogues, dont la tradition semble avoir duré fort longtemps. Le savant archiviste des Hautes-Alpes, M. Paul Guillaume, a découvert, dans plusieurs paroisses du Briançonnais, des manuscrits de Mystères, dont certains, écrits en langue provençale du XVe siècle, portent les dates des premières années du siècle suivant: 1504, 1506. M. F. Truchet, de Saint-Jean-de-Maurienne, a fait des trouvailles analogues dans son pays. Il a signalé notamment la représentation d’un Mystère de l’Antéchrist et du Jugement à Modane, en 1580, et celle d’un Mystère de la Vie de saint Martin à Saint-Martin-de-la-Porte, en 1565, cette dernière donnée en suite d’un vœu, pour conjurer la peste. M. Guillaume a tiré de l’état des manuscrits l’observation suivante: «Certaines taches très caractéristiques prouvent que la lecture du Mystère avait souvent lieu à l’étable, probablement durant les longues soirées d’hiver.» C’était là en effet qu’on préparait les représentations, habituellement données aux fêtes de Pâques.
Ces coutumes théâtrales furent tellement vivaces qu’aujourd’hui encore elles ne sont pas entièrement tombées en désuétude. Il est vrai que le répertoire s’est modifié, et que l’on ne joue plus de Mystères; mais chaque année, les jeunes gens des hauts villages du Queyras (Saint-Véran, Molines), passent leur hiver à préparer une représentation théâtrale, qu’ils donnent publiquement à cette même date des fêtes de Pâques, première annonce du printemps; et leur répertoire, pour n’être plus ni local, ni populaire, n’en est que plus relevé, car, en ces dernières années, ces habitants de pays perdus n’ont pas craint de s’attaquer à la représentation des comédies de Molière.
Mais revenons à nos chansons. Il faudra bien nous résigner à ne bientôt plus les trouver que dans les livres, car, je le répète une fois de plus, l’art populaire du temps passé se meurt. Soit dit en passant, et quelque regret qu’on ait de le voir disparaître, j’estime que le devoir de ceux qui s’intéressent à ses manifestations n’est pas de prolonger son existence: l’entreprise ne serait pas seulement impossible, mais funeste. Il ne faut pas que l’étude des anciennes traditions populaires soit un prétexte à la restauration d’un passé aboli. Le peuple, aujourd’hui, est entré dans une voie nouvelle, qui s’ouvre devant lui largement: qu’il poursuive l’évolution commencée, et que personne ne cherche à le faire attarder au regret des choses accomplies. Nous, cependant, les observateurs, artistes ou savants, nous faisons œuvre salutaire, assurément, en cherchant à sauver les derniers vestiges de sa vie passée, parce qu’il est bon de connaître l’homme à travers tous les âges, utile de conserver à l’histoire les manifestations diverses de son génie; mais ce doit être là notre objectif unique.
L’art populaire, si humble qu’il soit, est incontestablement digne de notre considération. Avec des dehors plus modestes, il est souvent plus sincère et plus vivace que l’art des savants, qui si fréquemment s’égare dans les artifices d’une vaine technique: il est, celà est manifeste, plus durable aussi, ayant traversé tant de siècles et survécu à tant de modes successives. Sa place est donc marquée dans l’histoire générale de l’art. Les annalistes d’autrefois ne jugeaient digne de leur attention que les faits les plus apparents et les hommes les plus considérables: longtemps l’histoire des peuples fut uniquement celle des rois. Et de même les premiers historiens de la musique n’ont voulu connaître que l’opéra. Un Michelet est venu remettre les choses en place, faisant ressortir l’action réelle du peuple dans l’accomplissement des faits: que désormais les historiens de l’art en fassent autant et qu’ils apprennent à dégager le rôle qu’a joué si efficacement le peuple dans la formation et l’évolution de la musique et de la poésie.
Telle n’est pas, certes, la prétention de ce livre; elle est plus modeste: il tend simplement à apporter une pierre à l’édifice complet que d’autres sans doute construiront.
Il s’est publié en France depuis cinquante ans d’assez nombreux livres de chansons populaires recueillies dans les provinces. La matière cependant est loin d’être épuisée; bien des coins du territoire restent encore à explorer. L’intérêt que peut offrir le présent travail consiste en ce que, d’une part, il est le premier qu’on ait songé à consacrer à cette partie de la France; c’est aussi que les observations qu’il rapporte s’étendent sur une région très vaste, — deux grandes provinces, — à l’encontre de la plupart des recueils similaires, habituellement limités à des contrées restreintes.
Ce livre permettra donc d’avoir une vue d’ensemble assez complète de la Chanson populaire française. Ce n’est pas encore le recueil général, que des esprits mieux intentionnés qu’exactement informés voulaient former dès 1851, et pour la constitution duquel l’enquête n’est même pas encore terminée: du moins puis-je espérer qu’il formera une contribution de quelque importance et sera un acheminement vers l’achèvement de ce travail, destiné à être considérable.
Tous ceux qui se sont occupés des études de folk-lore savent que c’est bien à tort que trop souvent l’on attribue les chansons populaires aux pays où on les recueille, que telle chanson n’est pas normande, ou berrichonne, ou dauphinoise, parce qu’on l’a recueillie en Normandie, en Berri ou en Dauphiné, mais que les mêmes reparaissent dans toutes les provinces de France, sous des aspects parfois divers, mais toujours basés sur les mêmes thèmes et construits dans les mêmes formes. L’espace dans lequel on les retrouve est encore plus étendu: grâce à des travaux savamment concertés, des hommes tels que MM. Nigra et Gaston Paris ont pu établir que le domaine traditionnel de nos chansons comprend, avec la France entière, toute la Haute-Italie, la Catalogne, et, dans une certaine mesure, le Portugal. Cette constatation générale n’empêche pas qu’il se produise des préférences particulières. Ainsi le répertoire des rondes à danser est surtout abondant dans les provinces de l’Ouest, de la Normandie à la Gascogne, — l’ancienne France, — tandis que d’autres productions, par exemple certaines chansons de Mai, ou bien l’antique complainte amoureuse de Pernette, semblent avoir élu plus spécialement domicile dans les provinces de l’Est ou du Centre, de la Lorraine à la Provence et à l’Auvergne.
Certaines danses aussi peuvent être localisées. Ainsi, celles que nous avons recueillies en grand nombre dans le sud du Dauphiné, avec leurs petits couplets en langue provençale et le rythme alerte de leurs mélodies, se retrouvent sans doute dans les régions limitrophes, mais non dans les pays où la nature des habitants est moins vive, et où l’on parle une autre langue.
Enfin il est des traditions locales, parfois anciennes, qui ont laissé des traces dans la mémoire du peuple: nous n’avons pas dû omettre de les rapporter. M. Gaston Paris ne constatait-il pas, en publiant un manuscrit de chansons du quinzième siècle, que si l’ensemble des textes qu’il contient est français, certaines chansons «portent les traces incontestables de leur origine provençale, savoyarde ou gasconne» ? L’avant-dernier mot nous montre qu’une des provinces comprises dans notre exploration a joué son rôle dans la production des chansons populaires.
Observateur fidèle, nous nous efforcerons de tracer un tableau complet sans nous limiter à un genre aux dépens d’un autre, et en rapportant indistinctement tout ce qui, étant d’essence populaire, a été conservé par la mémoire des habitants dans les pays explorés.
Sans doute nous chercherons à distinguer au passage les phénomènes caractéristiques que présentent les principaux documents recueillis. S’il arrive, par exemple, qu’une chanson trouvée en Savoie offre des analogies peu connues avec une autre précédemment trouvée dans une province éloignée, nous signalerons ces analogies, mais sans insister longuement, et surtout sans chercher à recommencer des confrontations déjà faites par plusieurs auteurs.
Nous insisterons plus volontiers quand les rapprochements porteront sur les chansons des pays limitrophes, Bresse et Bugey, Lyonnais, Vivarais, Provence, même, jusqu’à un certain point, la Suisse romande (pour laquelle les éléments de comparaison nous font un peu trop défaut). Nous apprendrons ainsi à connaître ce qui, dans l’ensemble de la Chanson populaire française, constitue le répertoire favori de cette vaste région, où le goût pour la chanson est très prononcé.
Le voisinage du Piémont nous incitera aussi à confronter les morceaux communs à l’un et à l’autre versant des Alpes, étude pour laquelle le recueil des Canti populari del Piemonte nous sera précieux.
Nous ne chercherons pas à résoudre ici des problèmes qui apparaissent toujours fort obscurs, bien que quelques vagues lueurs commencent à les éclairer, ceux par exemple, si passionnants en leur mystère, qui touchent aux origines de la production de l’art populaire. Peut-être nous y appliquerons-nous quelque jour: ce n’est pas le lieu, ce livre, simple rapport d’un témoin, tendant à un autre but, et n’ayant d’autre prétention que de fournir à l’étude générale qu’entreprendra l’avenir un aliment de plus.
J’ai adopté un classement conçu dans le même esprit que celui qu’avaient proposé les promoteurs de l’enquête de 1851, et dont j’avais moi-même suivi le principe dans mon Histoire de la Chanson populaire en France: basé sur l’observation des mœurs populaires, groupant les poèmes, non par des considérations de formes extérieures qui me paraissent d’une importance un peu restreinte, mais d’après leurs analogies de caractère et de sujet, il me semble logique et clair, procédant par des déductions qui rendent facile à suivre la pensée directrice de l’œuvre populaire.
Ayant souvent recueilli, au cours de mes recherches en Savoie et en Dauphiné, un très grand nombre de versions différentes des mêmes poésies, je n’ai pas craint d’en constituer parfois des textes critiques formés à l’aide de toutes les versions combinées, en ayant d’ailleurs grand soin de rapporter à la suite de ces textes les variantes négligées, et d’indiquer la provenance de toutes les versions, C’est ainsi déjà qu’avait procédé ouvertement M. Nigra, et j’ai tout lieu de croire que d’autres, qui ne l’ont point avoué, ont fait de même, par exemple Bujeaud, dont le recueil de Chansons populaires des provinces de l’Ouest reste un des plus estimés: ses textes, en général, sont trop purs pour que nous puissions douter qu’ils aient été émondés des scories dont la transmission orale recouvre toujours le diamant brut de la chanson. Au point où en sont parvenues nos études, les recueils de chansons populaires doivent avoir un peu un caractère d’anthologie, et, à moins d’une cause particulière, éliminer ce qui est trop fruste, trop fragmentaire et trop incomplet.
Ce procédé critique n’a rien de commun avec celui qui consiste à
«corriger» arbitrairement les chansons. Il n’a jamais été rien introduit dans celles qu’on va lire qui soit étranger à l’ensemble des textes recueillis, non plus qu’à la technique de la poésie populaire.
L’on sait que, suivant les règles de cette poésie, la rime est remplacée par l’assonance. Quant aux formes des vers et des strophes, généralement peu variées, elles sont basées sur quelques types connus, et assez simples. Nos textes sont si peu «corrigés» que, même au regard de ces règles, ils ne seront pas toujours irréprochables, soit que les chanteurs qui les ont transmis aient. décidément perdu le souvenir des formes originales, soit que les auteurs eux-mêmes ne se soient pas toujours souciés de la correction relative que leur imposaient les principes, ce qui pourrait bien être tout aussi vrai.
Les assonances feront souvent défaut; certaines strophes ou certains vers seront de longueur inégale: l’instinct populaire accommode avec la plus grande facilité les mélodies à ces sortes d’irrégularités, supprimant, ajoutant ou répétant des notes non seulement sans altérer gravement les formes musicales, mais trouvant parfois même dans ces anomalies l’occasion d’un accent imprévu et heureux.
En ce qui concerne la mesure des vers, les chanteurs ont, pour les ramener à la longueur voulue, des procédés de prononciation que réprouveraient avec énergie les maîtres de la prosodie classique, et que pourtant ils pratiquent avec le plus parfait naturel. Ces sortes de licences poétiques, propres à la Chanson populaire, peuvent être ramenées aux cas suivants:
1° Suppression des finales muettes. C’est le cas le plus fréquent. La poésie du XVIIe siècle l’admettait encore exceptionnellement pour certains mots. Exemples: Encor, Dieu vous gard’, grand’pénitence, quell’sont, ma têt’ couronné’, etc.
Cette suppression est générale lorsque l’e muet final suit une voyelle. Exemples: une joli’fille, une armé’, etc.
L’élision est de règle aux césures, comme elle l’est à la fin des vers féminins dans la versification littéraire, — ou du moins la syllabe muette ne compte pas dans le vers, tout en étant prononcée.
2° Suppression de la syllabe muette dans l’intérieur des mots. Exemples: Je frai, ils tomb’ront, etc.
3° Inversement, addition d’un e muet soit à la fin, soit dans l’intérieur des mots si la prononciation s’y prête. Exemple: Avec que, je me renderai, jassemin (jasmin), etc.
Ou bien encore, prononciation d’un e muet qui, régulièrement, ne doit pas l’être, soit au milieu des mots: «Cri-ë-ront», soit à la fin, comme «Dieu ay-ë l’âme» ; ou enfin suppression de l’élision, soit par l’addition d’une consonne: «Quatre-z-officiers», soit même sans cette intercalation: «Vain-cre — ou mourir, tris-te — et fâcheux».
4° Formation d’une diphtongue par deux voyelles qui forment régulièrement deux syllabes: ma-rier, na-tion, nua-ge, vio-lon, mu-si-cien, etc. Les trois mots «Il y a» sont généralement, dans le vers populaire contractés en une syllabe, par la suppression du pronom il et la prononciation en diphtongue de y-a (Y-a rien de si charmant, etc.). Notons bien que l’élision n’est jamais complète, que la voyelle élidée se prononce toujours; ainsi l’on ne dira pas: «T’en as menti», comme fait l’argot moderne, mais on prononcera: «Tu en» en réduisant ces deux syllabes à une seule.
5° Inversement, dédoublement d’une diphtongue: Pi-é-mont. Le cas est plus rare.
L’intercalation d’une consonne (touz) entre deux mots pour éviter l’hiatus, bien que ne modifiant pas la mesure du vers, est trop fréquente pour ne pas devoir être mentionnée ici: «Je reviendrai-z-un jour, — Il retourna-t-au régiment».
Une autre anomalie est celle qui consiste à remplacer deux vers d’un certain mètre par deux autres vers représentant le même total de syllabes, mais différemment coupés, — par exemple, au lieu de deux vers de huit syllabes, un de six et un de dix, s’adaptant exactement à la ligne mélodique. Quelquefois c’est seulement la muette placée après la césure qui, au lieu de s’élider, est reportée à l’hémistiche ou au vers suivant pour y former une syllabe: par exemple, dans la coupe suivante du décasyllabe procédant par 4 + 6:
J’ai fait l’amour — dedans le Dauphiné
A une bru — ne parfaite à mon gré.
Enfin nous n’insisterons pas sur l’usage, immodéré dans le vers populaire, de certaines chevilles particulières à la langue du peuple, comme les monosyllabes «ci, ce, en, dont», ou tout simplement les prépositions, conjonctions ou interjections bien connues de tous les versificateurs: «Oh! ah! et, mais», etc.
Je laisse aux philologues le soin d’étudier la raison d’être de ces diverses altérations de la langue, me bornant, ici comme ailleurs, à apporter mon témoignage et le simple résultat de mes observations.
La grande majorité des chansons populaires qu’on chante dans les Alpes françaises sont en français. Quelques-unes pourtant sont patoises. L’on a remarqué que les chansons patoises ont un caractère moins populaire que les chansons françaises et sont souvent des compositions écrites par des lettrés désireux d’imiter les poésies du peuple en empruntant son langage. L’observation n’est point inexacte, et des exemples nombreux ont pu la confirmer; mais il serait imprudent de la trop généraliser. Il est de certaines chansons patoises qui ont tous les caractères essentiels de la chanson populaire, les unes représentant la production du pays même (telles sont, dans nos provinces alpestres, les chansons à danser du sud du Dauphiné), d’autres, simples adaptations de poésies venues d’ailleurs. Sauf quelques rares exceptions motivées (portant à peu près exclusivement sur des morceaux de caractère historique), je n’ai admis dans ce recueil que des chansons rentrant dans ces deux catégories.
J’ai dit précédemment quel précieux concours, pour l’établissement de ces textes patois j’ai trouvé chez M. A. Devaux, professeur à la Faculté catholique des Lettres de Lyon: je lui renouvelle ici l’expression de toute ma gratitude.
Quant à la musique, il est, je pense, superflu de dire que j’ai mis tous mes soins à la noter. Quelque intérêt qu’ait par elle-même la poésie populaire, il est bien évident que la chanson n’est rien sans la mélodie, ou du moins qu’elle n’est qu’une chose inerte et tronquée, un oiseau sans ailes, un corps sans tête ou sans âme. Je donne donc la musique de toutes les chansons que j’ai recueillies moi-même; pour les poésies trouvées dans des cahiers ou celles que des correspondants m’ont envoyées sans y pouvoir joindre ce complément nécessaire, je n’en ai tiré parti que dans les cas où elles présentaient un intérêt exceptionnel.
Fréquemment, ai-je dit, j’ai trouvé des variantes nombreuses d’une même chanson. Je puis assurer que jamais toutes ces variantes ne se chantaient sur le même air, même que jamais deux ne se sont trouvées absolument identiques au point de vue musical. C’est que la mélodie, bien plus encore que la poésie, est chose fluide et impalpable. Sous la plus légère influence, elle se transforme radicalement: une simple altération à la tonalité ou au mouvement peut lui donner une physionomie si nouvelle que l’analyse la plus subtile se trouve parfois impuissante à en dégager la substance primitive. Le peuple est un admirable symphoniste, par l’art incomparable avec lequel il sait varier ses thèmes et leur donner tour à tour des expressions diverses. Au fond, les mélodies populaires, comme les poésies, pourraient être réduites à un nombre de types relativement restreint; mais, en raison de la moindre précision de la matière il serait plus difficile encore de déterminer ces thèmes générateurs. Combien pourtant il serait intéressant de surprendre à travers ces modifications incessantes le secret de la participation du peuple à l’élaboration musicale des chansons, dire en quels cas il s’est borné à transformer des mélodies préexistantes, en quels autres il en a créé de nouvelles, soit sur des vers nouveaux, soit sur d’anciennes paroles, comme tels compositeurs ont remis en musique certaines poésies favorites de Victor Hugo, ou de Gœthe, ou de Métastase, que d’autres avaient. traitées avant eux! Ici encore il nous faut dire que ce n’est pas le lieu de traiter une question si obscure. Bornons-nous donc à constater que si parfois, entre les variantes d’une même chanson recueillie sur différents points, il m’a été possible de distinguer un type mélodique commun, plus souvent encore, même ce type retrouvé et adopté, il restait d’autres formes, très différentes et parfois fort heureuses. Il était impossible de surcharger outre mesure ce livre de notations: plus de deux cent cinquante airs notés sont plus que suffisants pour faire connaître le génie musical propre aux habitants des régions alpestres; mais je n’ai pris aucun parti absolu à cet égard, si ce n’est celui de m’inspirer des circonstances, de façon que, lorsqu’elles m’ont paru l’exiger, j’ai pu donner pour un seul et même morceau la transcription de plusieurs mélodies.
J’ai aussi, très discrètement, fait suivre les notations qui se sont trouvées particulièrement intéressantes, de commentaires concernant la tonalité, les formes rythmiques, et toutes autres particularités caractéristiques de la mélodie populaire.
Afin de mettre en relief les qualités inhérentes à certains chants, je me suis permis d’en harmoniser un très petit nombre, — cela d’ailleurs à titre tout exceptionnel, et sans pour cela omettre de les conserver à leur place dans leur primitive nudité.
La généralité de ces airs apparaîtra peut-être un peu monotone: ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a reconnu que l’accent de la mélodie populaire est essentiellement mélancolique, et nos chansons alpestres ne failliront pas à la règle. Du moins ont-elles, en leur rusticité, le charme pénétrant dont est imprégné tout ce qui émane directement de la nature, et, dans l’ensemble, elles donneront une idée très fidèle de la Chanson populaire française.
Les vallées alpestres resteront sans doute silencieuses, et bientôt peut-être le souvenir des chants d’autrefois en aura disparu. Qu’au moins ce livre en rappelle la mémoire aux temps à venir, et dise ce qu’ont été ces chansons, qui, pendant des siècles, furent pour les humbles une source de consolation et de réconfort, et la seule jouissance d’art qu’ils aient jamais connue.
JULIEN TIERSOT.