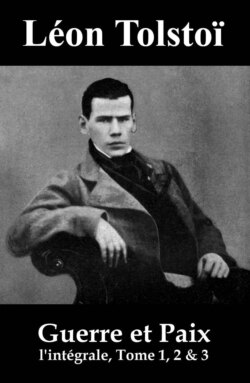Читать книгу Guerre et Paix (l'intégrale, Tome 1, 2 & 3) - León Tolstoi - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XVI
ОглавлениеC’était la vérité. Pierre n’avait pas eu le loisir de se choisir encore une carrière, par suite de son renvoi de Pétersbourg à Moscou pour ses folies tapageuses. L’histoire racontée chez les Rostow était authentique. Il avait, de concert avec ses camarades, attaché l’officier de police sur le dos de l’ourson!
De retour depuis peu de jours, il s’était arrêté chez son père, comme d’habitude. Il supposait avec raison que son aventure devait être connue et que l’entourage féminin du comte, toujours hostile à son égard, ne manquerait pas de le monter contre lui. Malgré tout, il se rendit le jour même de son arrivée dans l’appartement de son père et s’arrêta, chemin faisant, dans le salon où se tenaient habituellement les princesses, pour leur dire bonjour. Deux d’entre elles faisaient de la tapisserie à un grand métier, tandis que la troisième, l’aînée, leur faisait une lecture à haute voix.
Son maintien était sévère, sa personne soignée, mais la longueur de son buste sautait aux yeux: c’était celle qui avait feint d’ignorer la présence d’Anna Mikhaïlovna. Les cadettes, toutes deux fort jolies, ne se distinguaient l’une de l’autre que par un grain de beauté, qui était placé chez l’une juste au-dessus de la lèvre et qui la rendait fort séduisante. Pierre fut reçu comme un pestiféré. L’aînée interrompit sa lecture et fixa sur lui en silence des regards effrayés; la seconde, celle qui était privée du grain de beauté, suivit son exemple; la troisième, moqueuse et gaie, se pencha sur son ouvrage pour cacher de son mieux le sourire provoqué par la scène qui allait se jouer et qu’elle prévoyait. Elle piqua son aiguille dans le canevas et fit semblant d’examiner le dessin, en étouffant un éclat de rire.
«Bonjour, ma cousine, dit Pierre, vous ne me reconnaissez pas?
— Je ne vous reconnais que trop bien, trop bien!
— Comment va le comte? Puis-je le voir? Demanda Pierre avec sa gaucherie habituelle, mais sans témoigner d’embarras.
— Le comte souffre moralement et physiquement, et vous avez pris soin d’augmenter chez lui les souffrances de l’âme.
— Puis-je voir le comte? Répéta Pierre.
— Oh! Si vous voulez le tuer, le tuer définitivement, oui, vous le pouvez. Olga, va voir si le bouillon est prêt pour l’oncle; c’est le moment,» ajouta-t-elle, pour faire comprendre à Pierre qu’elles étaient uniquement occupées à soigner leur oncle, tandis que lui, il ne pensait évidemment qu’à lui être désagréable.
Olga sortit. Pierre attendit un instant, et, après avoir examiné les deux sœurs:
«Si c’est ainsi, dit-il en les saluant, je retourne chez moi, et vous me ferez savoir quand ce sera possible.»
Il s’en alla, et la petite princesse au grain de beauté accompagna sa retraite d’un long éclat de rire.
Le prince Basile arriva le lendemain et s’installa dans la maison du comte. Il fit venir Pierre:
«Mon cher, lui dit-il, si vous vous conduisez ici comme à Pétersbourg, vous finirez très mal: c’est tout ce que je puis vous dire. Le comte est dangereusement malade; il est inutile que vous le voyiez.»
À partir de ce moment, on ne s’inquiéta plus de Pierre, qui passait ses journées tout seul dans sa chambre du second étage.
Lorsque Boris entra chez lui, Pierre marchait à grands pas, s’arrêtait dans les coins de l’appartement, menaçant la muraille de son poing fermé, comme s’il voulait percer d’un coup d’épée un ennemi invisible, lançant des regards furieux par-dessus ses lunettes et recommençant sa promenade en haussant les épaules avec force gestes et paroles entrecoupées.
«L’Angleterre a vécu! Disait-il en fronçant les sourcils et en dirigeant son index vers un personnage imaginaire. M. Pitt, traître à la nation et au droit des gens, est condamné à…»
Il n’eut pas le temps de prononcer l’arrêt dicté par Napoléon, représenté en ce moment par Pierre. Il avait déjà traversé la Manche et pris Londres d’assaut, lorsqu’il vit entrer un jeune et charmant officier, à la tournure élégante. Il s’arrêta court. Pierre avait laissé Boris âgé de quatorze ans et ne se le rappelait plus; malgré cela, il lui tendit la main en lui souriant amicalement, par suite de sa bienveillance naturelle.
«Vous ne m’avez pas oublié? Dit Boris, répondant à ce sourire. Je suis venu avec ma mère voir le comte, mais on dit qu’il est malade.
— Oui, on le dit; on ne lui laisse pas une minute de repos,» reprit Pierre, qui se demandait à part lui quel était ce jeune homme.
Boris voyait bien qu’il ne le reconnaissait pas; mais, trouvant qu’il était inutile de se nommer et n’éprouvant d’ailleurs aucun embarras, il le regardait dans le blanc des yeux.
«Le comte Rostow vous invite à venir dîner chez lui aujourd’hui, dit-il après un silence prolongé, qui commençait à devenir pénible pour Pierre.
— Ah! Le comte Rostow, s’écria Pierre joyeusement; alors vous êtes son fils Élie. Figurez-vous que je ne vous reconnaissais pas. Vous rappelez-vous nos promenades aux montagnes des Oiseaux en compagnie de MmeJacquot, il y a de cela longtemps?
— Vous vous trompez, reprit Boris sans se presser et en souriant d’un air assuré et moqueur. Je suis Boris, le fils de la princesse Droubetzkoï. Le comte Rostow s’appelle Élie et son fils Nicolas, et je n’ai jamais connu de MmeJacquot.»
Pierre secoua la tête et promena ses mains autour de lui, comme s’il voulait chasser des cousins ou des abeilles.
«Ah! Dieu! Est-ce possible? J’aurai tout confondu; j’ai tant de parents à Moscou… Vous êtes Boris, … oui, c’est bien cela… enfin c’est débrouillé! Voyons, que pensez-vous de l’expédition de Boulogne? Les Anglais auront du fil à retordre, si Napoléon parvient seulement à traverser le détroit. Je crois l’entreprise possible, … pourvu que Villeneuve se conduise bien.»
Boris, qui ne lisait pas les journaux, ne savait rien de l’expédition et entendait prononcer le nom de Villeneuve pour la première fois.
«Ici, à Moscou, les dîners et les commérages nous occupent bien autrement que la politique, répondit-il d’un air toujours moqueur: je n’en sais absolument rien et je n’y pense jamais! Il n’est question en ville que de vous et du comte.»
Pierre sourit de son bon sourire, tout en ayant l’air de craindre que son interlocuteur ne laissât échapper quelque parole indiscrète; mais Boris s’exprimait d’un ton sec et précis sans le quitter des yeux.
«Moscou n’a pas autre chose à faire; chacun veut savoir à qui le comte léguera sa fortune, et qui sait s’il ne nous enterrera pas tous? Pour ma part, je le lui souhaite de tout cœur!
— Oui, c’est très pénible, très pénible, balbutia Pierre, qui continuait à redouter une question délicate pour lui.
— Et vous devez croire, reprit Boris en rougissant légèrement, mais en conservant son maintien réservé, que chacun cherche également à obtenir une obole du millionnaire…
— Nous y voilà! Pensa Pierre.
— Et je tiens justement à vous dire, pour éviter tout malentendu, que vous vous tromperiez singulièrement en nous mettant, ma mère et moi, au nombre de ces gens-là. Votre père est très riche, tandis que nous sommes très pauvres; c’est pourquoi je ne l’ai jamais considéré comme un parent. Ni ma mère, ni moi, ne lui demanderons rien et n’accepterons jamais rien de lui!»
Pierre fut quelque temps avant de comprendre; tout à coup il saisit vivement, et gauchement comme toujours, la main de Boris, et rougissant de confusion et de honte:
«Est-ce possible? S’écria-t-il, peut-on croire que je… ou que d’autres…?
— Je suis bien aise de vous l’avoir dit; excusez-moi. Si cela vous a été désagréable, je n’ai pas eu l’intention de vous offenser, continua Boris en rassurant Pierre, car les rôles étaient intervertis. J’ai pour principe d’être franc… Mais que dois-je répondre? Viendrez-vous dîner chez les Rostow?…»
Et Boris, s’étant ainsi délivré d’un lourd fardeau et tiré d’une fausse situation en les passant à un autre, était redevenu charmant comme d’habitude.
«Écoutez-moi, dit Pierre tranquillisé, vous êtes un homme étonnant. Ce que vous venez de faire est bien, très bien! Vous ne méconnaissez pas, c’est naturel… il y a si longtemps que nous ne nous étions vus… encore enfants… Donc, vous auriez pu supposer… je vous comprends très bien; je ne l’aurais pas fait, je n’en aurais pas eu le courage, mais tout de même c’est parfait. Je suis enchanté d’avoir fait votre connaissance. C’est vraiment étrange, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, vous avez pu supposer que je… et il se mit à rire. – Enfin nous nous connaîtrons mieux, n’est-ce pas? Je vous en prie…» et il lui serra la main. Savez-vous que je n’ai pas vu le comte? Il ne m’a pas fait demander… il me fait de la peine comme homme, mais que faire?… Ainsi, vous croyez sérieusement que Napoléon aura le temps de faire passer la mer à son armée?»
Et Pierre se mit à développer les avantages et les désavantages de l’expédition de Boulogne.
Il en était là lorsqu’un domestique vint prévenir Boris que sa mère montait en voiture; il prit congé de Pierre, qui lui promit, en lui serrant amicalement la main, d’aller dîner chez les Rostow. Il se promena longtemps encore dans sa chambre, mais cette fois sans s’escrimer contre des ennemis imaginaires; il souriait et se sentait pris, sans doute à cause de sa grande jeunesse et de son complet isolement, d’une tendresse sans cause pour ce jeune homme intelligent et sympathique, et bien décidé à faire plus ample connaissance avec lui.
Le prince Basile reconduisait la princesse, qui cachait dans son mouchoir son visage baigné de larmes.
«C’est affreux, c’est affreux, murmurait-elle, mais malgré tout je remplirai mon devoir jusqu’au bout. Je reviendrai pour le veiller; on ne peut pas le laisser ainsi…, chaque seconde est précieuse. Je ne comprends pas ce que ses nièces attendent. Dieu aidant, je trouverai peut-être moyen de le préparer… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne!
— Adieu, ma chère,» répondit négligemment le prince Basile.
«Ah! Son état est terrible, dit la mère à son fils, à peine assise dans sa voiture; il ne reconnaît personne.
— Je ne puis, ma mère, me rendre compte de la nature de ses rapports avec Pierre.
— Le testament dévoilera tout, mon ami, et notre sort en dépendra également.
— Mais qu’est-ce qui vous fait supposer qu’il nous laissera quelque chose?
— Ah! Mon enfant, il est si riche, et nous sommes si pauvres!
— Cette raison ne me paraît pas suffisante, je vous l’avoue, maman…
— Mon Dieu, mon Dieu, qu’il est malade!» répétait la princesse.