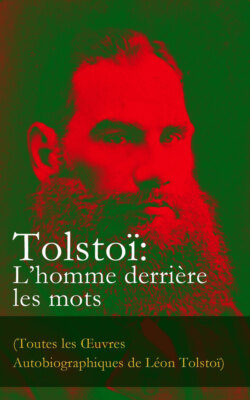Читать книгу Tolstoï: L'homme derrière les mots (Toutes les Œuvres Autobiographiques de Léon Tolstoï) - León Tolstoi - Страница 55
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XLIX - NOTRE CERCLE DE FAMILLE
ОглавлениеTable des matières
Papa était rarement à la maison ce printemps. En revanche, quand par hasard il ne sortait pas, il était d’une gaieté remarquable. Il tapotait sur le piano ses airs favoris, faisait ses petits yeux tendres et inventait sur nous tous, y compris Mimi, des plaisanteries en ce genre: le prince héritier de Géorgie avait aperçu Mimi à la promenade et il en était devenu tellement amoureux, qu’il avait adressé une demande de divorce au Synode; j’étais nommé secrétaire de notre ambassadeur à Vienne, etc. Papa nous annonçait ces nouvelles avec le plus grand sérieux. Il faisait peur à Catherine avec des araignées. Il était très aimable pour nos amis, Doubkof et Nékhlioudof. Il ne cessait de raconter à tout le monde ses projets pour l’année suivante. Ses projets changeaient tous les jours et se contrariaient les uns les autres, mais ils étaient si séduisants, que nous les écoulions attentivement et que Lioubotchka, ouvrant de grands yeux, regardait fixement les lèvres de papa, de peur de perdre un mot. Tantôt il annonçait l’intention de nous laisser à Moscou, à l’Université, et d’aller passer deux ans en Italie avec Lioubotchka; tantôt d’acheter une propriété en Crimée, au bord de la mer Noire, et de s’y rendre tous les étés; tantôt de nous emmener tous à Pétersbourg, etc.
Ce redoublement de gaieté à part; il s’était opéré chez papa, dans les derniers temps, un changement qui m’étonnait beaucoup. Il s’était fait faire un costume à la mode: frac olive, pantalons à sous-pieds, redingote-pardessus longue (il était très bien avec sa redingote), et, quand il allait dans, le monde, il sentait très bon, surtout quand il allait chez une certaine dame dont Mimi ne parlait qu’avec de grands soupirs et en faisant des figures qui signifiaient clairement: « Pauvres orphelins! Malheureuse passion! Il est heureux qu’elle ne soit pas là! » Je savais par Kolia (papa ne nous parlait jamais de ces choses-là) qu’il avait été particulièrement heureux au jeu cet hiver. Il avait gagné une somme énorme, qu’il avait placée en bons du Mont-de-piété, et il était décidé à ne plus jouer de tout le printemps. C’était probablement la crainte de ne pas pouvoir se retenir qui lui donnait si grande envie de partir le plus tôt possible pour la campagne. Il avait même résolu de s’en aller aussitôt Pâques à Petrovskoë, avec les filles, sans attendre mon entrée à l’Université. Je devais aller le rejoindre plus tard avec Volodia.
Pendant tout cet hiver, Volodia et Doubkof furent inséparables (il commençait à y avoir du froid entre eux et Dmitri). Leurs grands plaisirs, autant que je pouvais le deviner par les bouts de conversation que j’entendais, consistaient à boire énormément de Champagne, à passer en traîneau sous les fenêtres d’une demoiselle dont ils étaient tous les deux amoureux et à se faire vis-à-vis dans de vrais bals — pas des bals d’enfants. Cette dernière circonstance nous séparait beaucoup, mon frère et moi. Nous avions de l’affection l’un pour l’autre, mais il y a une trop grande distance entre un écolier qui prend encore des leçons et un jeune homme qui va aux vrais bals: nous ne pouvions pas nous résoudre à échanger nos idées.
Catherine était tout à fait grande fille et lisait beaucoup de romans. L’idée qu’elle se marierait peut-être bientôt ne me paraissait plus une plaisanterie. Bien que Volodia, de son côté, fût tout à fait un jeune homme, ils ne s’entendaient pas; ils avaient même l’air de se dédaigner mutuellement. En général, quand Catherine se trouvait seule à la maison, elle ne faisait rien du tout, hors lire des romans, et la plupart du temps elle s’ennuyait. Dès qu’il y avait des visites, elle s’animait, faisait des frais et jouait de la prunelle si drôlement que je ne pouvais absolument pas comprendre ce qu’elle voulait exprimer. Ce ne fut que plus tard que, lui ayant entendu dire que la seule coquetterie permise aux jeunes filles est la coquetterie des yeux, je m’expliquai ces singulières grimaces, qui, au surplus, paraissaient n’étonner que moi.
Lioubotchka avait des robes presque longues, de sorte que ses gros pieds de canard étaient presque cachés; mais elle était toujours aussi pleurnicheuse. Son rêve n’était plus d’épouser un hussard, mais un ténor ou un pianiste, et, dans cette pensée, elle s’occupait assidûment de musique.
Saint-Jérôme, sachant qu’on ne le garderait pas après mes examens, s’était trouvé une place chez un comte, et il nous regardait depuis lors avec un certain mépris. Il était rarement à la maison, fumait des cigarettes, ce qui, à cette époque, était le comble de l’élégance, et sifflotait perpétuellement des airs guillerets.
Mimi devenait de plus en plus aigrie. Du jour où nous avions commencé à devenir grands, elle avait eu l’air de ne plus attendre rien de bon, de rien ni de personne.
Je ne trouvai dans la salle à manger, en descendant dîner, que Mimi, Catherine, Lioubotchka et Saint-Jérôme. Papa était sorti, Volodia préparait son examen avec des camarades et avait dit de lui apporter à dîner dans sa chambre. Dans les derniers temps, Mimi présidait généralement le repas, ce qui en avait ôté presque tout le charme. Aucun de nous n’avait le moindre respect pour Mimi et le dîner n’était plus, comme au temps de maman ou de grand’mère, une espèce de cérémonie réunissant toute la famille à une heure fixe et divisant la journée en deux parties. Nous nous permettions d’être en retard, d’arriver au second plat, de boire le vin dans nos grands verres (Saint-Jérôme nous donnait l’exemple), de nous vautrer sur nos chaises, de nous lever avant la fin, et autres licences du même genre. Le dîner avait cessé dès lors d’être la joyeuse solennité domestique de jadis. Du temps de Petrovskoë, un peu avant deux heures, nous étions tous dans le salon, lavés et habillés, et nous bavardions gaiement en attendant l’heure. Au moment précis où l’horloge de l’office se préparait, par un bruit enroué, à sonner deux heures, Phoca entrait à pas lents, la serviette sous le bras, l’air digne et un peu sévère. Il annonçait d’une voix sonore et traînante: « Le dîner est servi! » et tout le monde se dirigeait vers la salle à manger avec des figures épanouies, les grandes personnes devant, les enfants derrière. C’était un froufrou de jupons empesés, un craquement de bottes et de souliers, un murmure de voix, et chacun gagnait sa place.
Le dîner était aussi une solennité à Moscou, du temps où, debout autour de la table, nous attendions grand’mère en causant à voix basse. Gavrilo était allé lui annoncer que le dîner était servi. La porte s’ouvrait, on entendait un bruissement de robe, des pieds qui traînaient, et grand’mère paraissait, courbée, de travers, coiffée d’un bonnet avec des rubans d’un lilas extraordinaire, souriante ou sombre, selon l’état de sa santé. Gavrilo se précipite vers son fauteuil, il se fait un bruit de chaises, vous sentez courir dans votre dos un léger frisson annonçant la faim, vous dépliez votre serviette raide et encore humide, vous mangez une bouchée de pain et vous regardez avec avidité, joie et impatience, en vous frottant les mains sous la table, les assiettées de soupe fumante que le maître d’hôtel remplit en observant le rang, l’âge et les intentions de grand’mère.
Je n’éprouvais plus alors, en venant me mettre à table, ni plaisir ni émotion.
Les bavardages de Mimi, de Saint-Jérôme et des filles m’avaient inspiré, pendant un temps, un mépris profond que je ne cherchais pas à cacher, surtout en ce qui concernait ma sœur et Catherine: c’étaient des commérages sur les vilaines bottes du maître de russe, sur les robes à volants des princesses Kornakof et autres sujets du même intérêt. Aujourd’hui, leurs caquets ne parvenaient pas à me faire sortir de ma disposition d’esprit vertueuse. J’étais d’une douceur rare. Je souriais, j’écoutais d’un air aimable, je demandais poliment de me passer le kvass, je donnais raison à Saint-Jérôme quand il me reprenait à table sous prétexte que « je puis » est plus élégant en français que « je peux ». Je dois cependant avouer qu’il me fut un peu désagréable que personne n’eût l’air de remarquer ma douceur et ma vertu.
Après le dîner, Lioubotchka me montra un papier sur lequel elle avait inscrit tous ses péchés. Je trouvai que l’idée était excellente, mais qu’il valait encore mieux inscrire ses péchés dans son âme et que « tout ça n’était pas ça ».
« Pourquoi, pas ça? Me demanda Lioubotchka.
— C’est une bonne idée, mais… Tu ne me comprendrais pas…… »
Je montai dans ma chambre en disant à Saint-Jérôme que j’allais travailler. En réalité, je voulais profiter de ce qu’il me restait encore une heure et demie avant l’arrivée de notre confesseur pour dresser la liste des choses que j’aurais à faire et des devoirs que j’aurais à remplir jusqu’au jour de ma mort, et pour mettre par écrit le but de ma vie, ainsi que les règles de conduite dont je comptais ne plus jamais m’écarter.