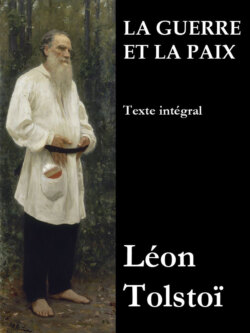Читать книгу La Guerre et la Paix (Texte intégral) - Лев Толстой, Leo Tolstoy, León Tolstoi - Страница 28
XXIII
ОглавлениеPierre connaissait parfaitement cette grande chambre, divisée par des colonnes formant alcôve et toute tapissée d’étoffes à l’orientale. Derrière les colonnes, on voyait un grand lit en bois d’acajou, très élevé, garni de lourds rideaux, et, de l’autre, la niche vitrée contenant les saintes images, qui était éclairée comme une église pendant l’office divin. Dans un large fauteuil à la Voltaire placé devant elles, le comte Besoukhow, avec sa grande et majestueuse figure, et enveloppé jusqu’à la ceinture d’une couverture de soie, était à demi couché sur des oreillers d’une blancheur immaculée. Une crinière de cheveux gris, semblable à celle d’un lion, et des rides fortement accusées faisaient ressortir son beau et noble visage au teint de cire. Ses deux mains, grandes et fortes, gisaient inanimées sur la couverture. Entre l’index et le pouce de la main droite, on avait placé un cierge, que retenait un vieux serviteur penché au-dessus du fauteuil. Les prêtres et les diacres, avec leurs longs cheveux descendant sur les épaules, et leurs riches habits sacerdotaux, officiaient autour de lui avec une lenteur solennelle, tenant à la main des cierges allumés. Au second plan, les deux nièces cadettes, leurs mouchoirs sur les yeux, s’effaçaient derrière le visage impassible de Catiche, leur sœur aînée, qui paraissait craindre, si elle avait porté ailleurs son regard rivé aux saintes images, de ne plus rester maîtresse de ses sentiments. Une tristesse calme et une expression de pardon sans réserve se lisaient sur les traits de la princesse Droubetzkoï, qui était restée appuyée à la porte, à côté de la dame inconnue. Le prince Basile, en face d’elle, à deux pas du mourant, un cierge dans la main gauche, se tenait accoudé sur le dossier sculpté d’une chaise recouverte de velours, et levait les yeux au ciel chaque fois que de sa main droite il se touchait le front en se signant. Son visage était empreint d’une piété résignée et d’un abandon complet à la volonté du Très-Haut.
«Malheur à vous qui n’êtes pas à la hauteur de mes sentiments!» avait-il l’air de dire.
Derrière lui étaient groupés les médecins et les serviteurs de la maison, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, comme à l’église. Tous se taisaient et se signaient. On n’entendait que la voix des officiants et le chant plein et continu du chœur. Parfois, un des assistants soupirait ou changeait de pose.
Tout à coup, la princesse Droubetzkoï traversa la chambre de l’air assuré d’une personne qui a la conscience de ce qu’elle fait, et offrit un cierge à Pierre.
Il l’alluma, et, distrait par ses propres réflexions, il se signa de la main qui le tenait.
Sophie, la cadette des princesses, celle-là même qui avait un grain de beauté sur la joue, le regarda en souriant, replongea sa figure dans son mouchoir et resta quelques instants la figure cachée. Puis, après avoir jeté un second coup d’œil sur Pierre, elle se sentit incapable de garder plus longtemps son sérieux et se retira derrière une des colonnes. Au milieu de la cérémonie, les voix se turent soudain: les prêtres se dirent quelques mots à l’oreille; le vieux serviteur qui soutenait la main du comte se redressa et se tourna vers les dames. Anna Mikhaïlovna s’avança aussitôt, et, se penchant au-dessus du moribond, elle appela à elle, d’un geste et sans le regarder, le docteur Lorrain, qui, adossé à une colonne, témoignait, par sa tenue respectueuse, qu’il comprenait et approuvait, malgré sa qualité d’étranger et la différence de religion, toute l’importance du sacrement administré. Il s’approcha doucement et souleva de ses doigts fluets la main étendue sur la couverture; il en chercha le pouls en se détournant, et s’absorba dans ses calculs. On s’agita autour de lui, on mouilla les lèvres du mourant avec un cordial, chacun reprit sa place, et la cérémonie continua. Pendant cette interruption, Pierre, qui avait suivi les mouvements du prince Basile, l’avait vu quitter sa chaise, rejoindre l’aînée des nièces et se diriger avec elle vers le fond de l’alcôve, puis passer près du grand lit à rideaux et disparaître par une petite porte dérobée.
L’office n’était pas terminé, qu’ils avaient déjà repris leurs places. Cette circonstance n’éveilla pas la curiosité de Pierre, car il était convaincu ce soir-là que tout ce qu’il voyait faire était indispensable et naturel. Les chants cessèrent et la voix du prêtre, qui présentait au mourant ses respectueuses félicitations, se fit entendre; mais le mourant gisait toujours inanimé! Les allées et venues recommencèrent à ses côtés; on marchait, on chuchotait, et le chuchotement de la princesse Droubetzkoï dominait les autres. Pierre l’entendit qui disait:
«Il faut absolument le reporter dans son lit, autrement il sera impossible de…»
Les médecins, les princesses et les domestiques entourèrent le comte, qui se trouva ainsi caché aux yeux de Pierre, et cependant cette tête jaunie, avec sa forêt de cheveux, était toujours présente à ses yeux depuis son entrée. Il devina, aux précautions qu’on prenait, qu’on le soulevait pour le transporter.
«Empoigne donc mon bras, tu vas le laisser tomber, dit un domestique effrayé…
— Par en bas!… vite!… encore un!» disait un autre.
Et, à entendre les respirations oppressées et les pas précipités des porteurs, on devinait le poids qui les accablait. Ils frôlèrent le jeune homme, et il put apercevoir pendant une seconde, au milieu d’un fouillis de têtes inclinées, la poitrine élevée et puissante du mourant, ses épaules à découvert et sa tête de lion à crinière bouclée. Cette tête, avec son front extraordinairement large, ses pommettes saillantes, sa bouche bien découpée, son regard froid et imposant, n’était pas encore défigurée par les approches de la mort; c’était bien la même que Pierre avait vue trois mois auparavant, lorsque son père l’avait envoyé à Pétersbourg. Mais aujourd’hui elle se balançait inerte, selon la marche inégale des porteurs, et son regard atone ne s’arrêtait sur rien.
Après quelques minutes de confusion autour du lit, les serviteurs se retirèrent. Anna Mikhaïlovna toucha légèrement Pierre du bout du doigt et lui dit:
«Venez!»
Il obéit. On avait donné au malade, à demi soulevé et soutenu par une pile de coussins, une pose apprêtée, en rapport avec le sacrement qu’il venait de recevoir. Ses mains étaient étalées sur le taffetas vert de la couverture, et il regardait droit devant lui, de ce regard vague et perdu dans l’espace, qu’aucun homme ne saurait ni définir ni comprendre; n’avait-il rien à dire ou avait-il à dire beaucoup? Pierre s’arrêta près du lit, ne sachant que faire; il interrogea des yeux son guide, qui, d’un mouvement imperceptible, lui indiqua la main du mourant, en lui faisant signe d’y appliquer un baiser. Pierre se pencha avec précaution pour ne pas toucher à la couverture, et ses lèvres effleurèrent la main large et charnue du comte.
Pas un muscle ne tressaillit sur cette main, pas une contraction ne parut sur ce visage, et rien, rien ne répondit à cet attouchement. Pierre, indécis, reporta ses yeux sur la princesse, qui lui fit signe de s’asseoir dans le fauteuil, au pied du lit. Il s’assit sans la quitter du regard; elle baissa la tête affirmativement. Plus sûr de son fait, il reprit sa pose de statue égyptienne, et, visiblement embarrassé de sa gaucherie habituelle, il faisait de sérieux efforts pour occuper le moins de place possible, les regards fixés sur les traits de l’agonisant. Anna Mikhaïlovna ne le perdait pas de vue non plus, convaincue de l’importance de cette dernière et touchante entrevue du fils et du père.
Deux minutes, qui parurent un siècle à Pierre, s’étaient à peine écoulées, lorsque la figure du comte fut subitement et violemment agitée par une convulsion, et sa bouche, rejetée de côté, laissa passer un râle rauque et sourd. Ce fut pour Pierre le premier avertissement d’une fin prochaine; la princesse Droubetzkoï épiait les yeux du mourant pour en deviner les désirs: elle porta son doigt tour à tour sur Pierre, sur la tisane, sur le prince Basile, sur la couverture… tout fut inutile, et un éclair d’impatience sembla briller dans ce regard éteint, qui essayait d’attirer l’attention du valet de chambre immobile au chevet de sa couche.
«Il demande à être retourné,» murmura ce dernier, qui se mit en devoir de le changer de position.
Pierre voulut l’aider, et ils venaient d’y réussir, quand une des mains du comte retomba lourdement en arrière, malgré les vains efforts du malade pour la ramener à lui.
S’aperçut-il de l’expression d’effroi qui se peignit sur la figure bouleversée de Pierre à la vue de ce membre frappé de paralysie, ou quelque autre pensée traversa-t-elle son cerveau? Qui peut le dire? Car il regarda à son tour ce bras désobéissant, le visage terrifié de son fils, et un sourire terne, décoloré, étrange à cette heure, voltigea sur ses lèvres. On aurait dit qu’il répondait, par une compassion ironique, à cette destruction envahissante et graduelle de ses forces.
Ce sourire inattendu fit mal à Pierre: il fut saisi d’une crampe à la poitrine, il lui vint un chatouillement dans le gosier, et les larmes lui montèrent aux yeux.
Le malade, qu’on avait recouché du côté de la muraille, poussa un profond soupir.
«Il s’est assoupi, dit Anna Mikhaïlovna à une des nièces qui revenait à son poste. Allons!…»
Et Pierre la suivit.