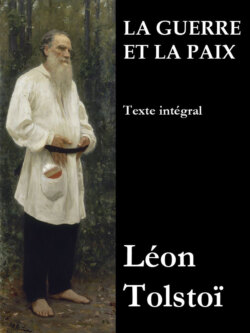Читать книгу La Guerre et la Paix (Texte intégral) - Лев Толстой, Leo Tolstoy, León Tolstoi - Страница 35
I
ОглавлениеL’armée russe occupait, en octobre 1805, un certain nombre de villes et de villages de l’archiduché d’Autriche. On y voyait arriver chaque jour de nouveaux régiments, dont le séjour pesait lourdement sur le pays et sur ses habitants. Ces forces, toujours croissantes, se concentraient autour de la forteresse de Braunau, quartier général du commandant en chef Koutouzow.
C’était le 11 octobre, et un régiment d’infanterie, fraîchement arrivé, s’était arrêté à un demi-mille de la ville. Il n’avait rien emprunté dans son aspect à la localité étrangère qui lui servait de cadre. Malgré les vergers, les murs en pierre, les toits en tuile qui l’entouraient et les montagnes qui se dessinaient à l’horizon, il était bien toujours le type d’un régiment russe, se préparant dans son pays pour l’inspection de son chef.
L’ordre du jour qui annonçait l’inspection lui était parvenu la veille, à la dernière étape; mais comme la rédaction présentait quelque obscurité, le chef du régiment avait été obligé d’assembler le conseil des chefs de bataillon, pour décider de la tenue exigée en cette occasion. Devait-on se mettre en tenue de campagne ou en grande tenue? On opina pour la dernière alternative; mieux valait montrer trop de zèle que trop peu. Les soldats se mirent à l’œuvre: malgré les trente verstes qu’ils venaient de parcourir, pas un ne ferma l’œil de la nuit, tout fut raccommodé et nettoyé.
Les aides de camp et les chefs de compagnie comptaient leurs soldats, formaient les rangs, et, quand le jour fut venu, leurs regards charmés purent s’arrêter sur une masse compacte de 2000 hommes bien serrés et bien alignés, à la place de la foule débraillée de la veille. Chacun était à son poste et savait ce qu’il avait à faire: pas un bouton, pas une petite courroie ne manquait, tout reluisait et étincelait au soleil.
Tout était donc en ordre, et le général en chef pouvait sans crainte passer en revue chacun des soldats, car sa chemise était blanche, et son havresac contenait le nombre d’objets réglementaire. Un seul détail laissait à désirer: c’était la chaussure, qui s’en allait en lambeaux; le régiment avait, il est vrai, fourni ses mille verstes, et les intendances du pays faisaient la sourde oreille aux constantes réclamations du chef de régiment pour en obtenir la matière première nécessaire à la confection des bottes. Ce chef était un gros général d’un âge avancé, d’un tempérament sanguin, avec des épaules carrées, des sourcils et des favoris grisonnants. Son uniforme neuf et brillant laissait voir toutefois quelques traces inévitables d’un séjour prolongé dans le porte-manteau; ses lourdes épaulettes lui élevaient les épaules jusqu’au ciel; il se promenait devant le front en se dandinant, le corps légèrement incliné en avant, avec l’air satisfait d’un homme qui vient d’accomplir un acte solennel. Il était fier de son régiment, auquel son âme appartenait tout entière; sa démarche trahissait peut-être bien encore d’autres préoccupations, car, en dehors de ses soucis militaires, les intérêts du bien-être général, et le beau sexe en particulier, occupaient une large place dans son cœur.
«Eh bien, mon cher Michel Dmitriévitch,» dit-il en s’adressant à un chef de bataillon qui s’avançait en souriant d’un air également heureux… «Rude besogne cette nuit… hein? Pas mal ficelé notre régiment!… Il n’est pas des derniers… hein?» Le commandant eut l’air de goûter cette plaisanterie de son chef et se mit à rire.
«Certainement… On ne nous aurait pas renvoyés du Champ de Mars.
— Qu’y a-t-il?» s’écria le général, qui venait d’apercevoir deux cavaliers, un aide de camp et un cosaque, arrivant par la grand’route qui menait à la ville et sur laquelle de distance en distance étaient échelonnés des fantassins en vedette. Le premier, qui était envoyé du quartier général pour expliquer l’ordre du jour de la veille, annonça que la volonté du général en chef était que le régiment se présentât devant lui en tenue de campagne et sans préparatifs d’aucune sorte. Un membre du conseil de guerre (Hofkriegsrath) était arrivé la veille de Vienne pour engager Koutouzow à rejoindre au plus vite l’armée de l’archiduc Ferdinand et de Mack; cette proposition n’était pas du goût du général en chef, qui y faisait une vive opposition, et, comme preuve à l’appui, il tenait à faire constater par l’Autrichien lui-même en quel triste état se trouvaient les troupes russes après leur longue marche.
L’aide de camp, qui ignorait ces détails, se borna à dire que le général en chef serait très mécontent s’il ne trouvait pas le régiment en tenue de campagne. À ces mots, le pauvre général baissa la tête, haussa silencieusement les épaules et se tordit les mains de désespoir:
«Nous voilà bien! Quand je vous le disais, Michel Dmitriévitch… tenue de campagne, donc en capotes, ajouta-t-il en s’adressant avec humeur au commandant de bataillon… – Ah! Mon Dieu! Messieurs les chefs de bataillon, s’écria-t-il d’une voix habituée au commandement et il avança d’un pas… Messieurs les sergents-majors!… Son Excellence sera-t-elle bientôt ici? Demanda-t-il avec une respectueuse déférence à l’aide de camp.
— Dans une heure, je pense.
— Aurons-nous seulement le temps de changer de tenue?
— Je l’ignore, mon général…» Et le chef de régiment s’approcha des rangs et donna ses ordres. Les commandants de bataillon se mirent à courir, les sergents-majors à s’agiter, et en une seconde les carrés, jusqu’alors immobiles et silencieux, se rompirent et se dispersèrent. Ce ne fut plus que le bourdonnement confus d’une foule en mouvement: les soldats se précipitaient dans tous les sens, chargeaient leurs havresacs sur leurs épaules et, élevant leurs capotes en l’air par-dessus leur tête, en enfilaient les manches à la hâte.
«Qu’est-ce que cela? Qu’est-ce que c’est que cela? S’écria le général. – Commandant de la troisième compagnie!
— De la troisième compagnie!… Le général demande le commandant de la troisième compagnie! Répétèrent plusieurs voix, et l’aide de camp se précipita à la recherche du retardataire. L’excès de zèle et l’effarement de chacun avaient si bien troublé toutes les têtes, que l’on avait fini par crier: La compagnie demande le général! Lorsque ces appels réitérés parvinrent enfin aux oreilles de l’absent, un homme d’un certain âge; il était incapable de courir, mais il franchissait pourtant au petit trot, sur la pointe de ses pieds mal équilibrés, la distance qui le séparait de son chef. On voyait bien vite que le vieux capitaine était inquiet comme un écolier qui prévoit une question à laquelle il ne saura pas répondre. Sur son nez empourpré pointaient des taches dues à l’intempérance; sa bouche tremblait d’émotion, il soufflait et ralentissait le pas à mesure qu’il avançait et que le commandant l’examinait des pieds à la tête:
«Vous flanquez donc des fourreaux à vos soldats? Qu’est-ce que cela signifie! Lui dit-il, en montrant du doigt un soldat de la troisième compagnie, dont la capote de drap tranchait sur le reste par sa couleur. Où vous cachiez-vous donc, on attend le général en chef et vous quittez votre poste, hein? Je vous apprendrai à habiller vos soldats de la sorte le jour d’une revue!»
Le vieux capitaine ne quittait pas des yeux son chef, et, de plus en plus ahuri, pressait ses deux doigts contre la visière de son shako, comme si ce geste devait le sauver.
«Eh bien, vous ne répondez pas? Et celui-là que vous avez déguisé en Hongrois, qui est-il?
— Votre Excellence…
— Eh bien, quoi? Vous aurez beau me répéter sur tous les tons: Votre Excellence, et après? Savez-vous ce que cela veut dire: Votre Excellence?
— Votre Excellence, c’est Dologhow, celui qui a été dégradé, balbutia le capitaine.
— Dégradé? Donc il n’est pas maréchal pour se permettre… il est soldat, et un soldat doit être habillé selon l’ordonnance.
— Votre Excellence elle-même l’a autorisé à s’habiller ainsi pendant la marche.
— Autorisé, autorisé, c’est toujours ainsi avec vous, jeunes gens, répliqua le commandant en se calmant un peu… on vous dit une chose et vous… eh bien, quoi?… et s’échauffant de nouveau: Habillez vos hommes convenablement, voilà!»
Et, se retournant vers l’envoyé de Koutouzow, il continua son inspection, satisfait de sa petite scène, et cherchant un prétexte à une nouvelle explosion. Le hausse-col d’un officier lui paraissant suspect, il tança vertement l’officier; puis, l’alignement du premier rang de la troisième compagnie manquant de rectitude, il s’adressa d’une voix agitée à Dologhow, qui était vêtu d’une capote d’un drap gris bleuâtre:
«Où est ton pied? Où est ton pied?»
Dologhow retira tout doucement son pied et fixa son regard vif et hardi sur le général.
«Pourquoi cette capote bleue? À bas! Sergent-major, qu’on déshabille cet homme…
— Mon devoir, général, lui répliqua Dologhow en l’interrompant, est de remplir les ordres que je reçois, mais je ne suis point forcé de supporter les…
— Pas un mot dans les rangs, pas un!
— Je ne suis pas forcé, reprit Dologhow à haute voix, de supporter les injures…»
Et les regards du chef du régiment et ceux du soldat se croisèrent.
Le général se tut en tiraillant avec colère son écharpe:
«Veuillez changer d’habit,» lui dit-il.
Et il se détourna.