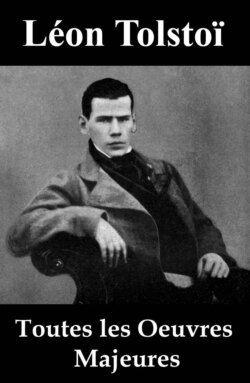Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Léon Tolstoï - León Tolstoi - Страница 140
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIV
ОглавлениеLe 31 décembre 1809, il y avait un grand bal chez un personnage considérable du temps de Catherine. Le corps diplomatique y était invité, et l’Empereur même avait promis d’y venir.
Une brillante illumination éclairait de mille feux la façade de l’hôtel, qui était situé sur le quai Anglais. L’entrée était tendue de drap rouge, et depuis les gendarmes jusqu’aux officiers et au grand-maître de police, tous attendaient sur le trottoir. Les voitures arrivaient et repartaient, et la file des laquais en livrée, de gala et des chasseurs aux plumets multicolores se succédait sans interruption. Les portières s’ouvraient, les lourds marchepieds s’abaissaient avec bruit; militaires et civils en grand uniforme, chamarrés de cordons et de décorations, en descendaient, et les dames, en robe de satin, enveloppées dans leurs manteaux d’hermine, franchissaient à la hâte et sans bruit le passage recouvert de drap rouge.
Dès qu’un nouvel équipage s’arrêtait, un murmure courait par la foule, qui se découvrait: «Est-ce l’Empereur?… Non, c’est un ministre… un prince étranger… un ambassadeur, tu vois bien le plumet,» se disait-on. Et un individu, mieux habillé que ceux qui l’entouraient, leur nommait à haute voix les arrivants et semblait les connaître tous.
Le tiers des invités était déjà réuni, que chez les Rostow on en était encore à se presser et à donner aux toilettes le dernier coup de main. Que de préparatifs n’avait-on pas faits, que de craintes n’avait-on pas eues, à cause de ce bal! Recevrait-on une invitation? Les robes seraient-elles prêtes à temps? Tout s’arrangerait-il à leur gré?
La vieille demoiselle d’honneur, Marie Ignatievna Péronnsky, jaune et maigre, parente et amie de la comtesse, et de plus, le chaperon attitré de nos provinciaux dans le grand monde, devait les accompagner, et il était convenu qu’on irait la chercher à dix heures chez elle, au palais de la Tauride; mais dix heures venaient de sonner, et les demoiselles n’étaient pas encore prêtes.
C’était le premier grand bal de Natacha; aussi ce jour-là, levée dès huit heures, avait-elle passé la journée, dans une activité fiévreuse; tous ses efforts n’avaient qu’un but: c’était qu’elles fussent habillées toutes les trois dans la perfection, labeur difficile, dont on lui avait laissé toute la responsabilité. La comtesse avait une robe de velours massaca, tandis que de légères toilettes de tulle, garnies de roses mousseuses, et doublées de taffetas rose, étaient destinées aux jeunes filles, uniformément coiffées à la grecque.
Le plus important était fait: elles s’étaient parfumé et poudré le visage, le cou, les mains, sans oublier les oreilles; les bas de soie à jour étaient soigneusement tendus sur leurs petits pieds, chaussés de souliers de satin blanc, et l’on mettait la dernière main à leur coiffure. Sonia avait même déjà passé sa robe et se tenait debout au milieu de leur chambre, attachant un dernier ruban à son corsage et pressant de son doigt, jusqu’à se faire mal, l’épingle récalcitrante qui grinçait en perçant le ruban. Natacha, l’œil à tout, assise devant la psyché, un léger peignoir jeté sur ses épaules maigres, était en retard:
«Pas ainsi, pas ainsi. Sonia! Dit-elle en lui faisant brusquement tourner la tête et en saisissant ses cheveux, que la femme de chambre n’avait pas eu le temps de lâcher. Viens ici!» Sonia s’agenouilla, pendant que Natacha lui posait le nœud à sa façon.
«Mais, mademoiselle, il m’est impossible… dit la femme de chambre.
— C’est bien, c’est bien!… Voilà, Sonia…, comme cela!…
— Serez-vous bientôt prêtes? Leur cria la comtesse du fond de sa chambre. Il va être bientôt dix heures!
— Tout de suite, tout de suite, maman! Et vous?
— Je n’ai que ma toque à mettre.
— Pas sans moi, vous ne saurez pas la mettre!
— Mais il est dix heures!»
Dix heures et demie était l’heure fixée pour leur entrée au bal, et cependant Natacha n’était pas habillée, et il fallait encore aller au palais de la Tauride chercher la vieille demoiselle d’honneur.
Une fois coiffée, Natacha, dont la jupe courte laissait voir les petits pieds chaussés de leurs souliers de bal, s’élança vers Sonia, l’examina, et, se précipitant dans la pièce voisine, y saisit la toque de sa mère, la lui posa sur la tête, l’ajusta, et, appliquant un rapide baiser sur ses cheveux gris, courut presser les deux femmes de chambre, qui, tranchant le fil de leurs dents, s’occupaient à raccourcir le dessous trop long de sa robe, tandis qu’une troisième, la bouche pleine d’épingles, allait et venait de la comtesse à Sonia, et qu’une quatrième tenait à bras tendus la vaporeuse toilette de tulle.
«Mavroucha, plus vite, ma bonne!
— Passez-moi le dé, mademoiselle.
— Aurez-vous bientôt fini? Demanda le comte sur le seuil de la porte. Voici des parfums, la vieille Péronnsky est sur le gril!
— C’est fait, mademoiselle, dit la femme de chambre en relevant bien haut la robe, qu’elle secoua en soufflant dessus, comme pour en constater la légèreté et la blancheur immaculée.
— Papa, n’entre pas, n’entre pas! S’écria Natacha en passant sa tête dans ce nuage de tulle. Sonia, ferme la porte!» Une seconde après, le vieux comte fut admis; lui aussi s’était fait beau; parfumé et pommadé comme un jeune homme, il portait l’habit gros bleu, la culotte courte et des souliers à boucles: «Papa, comme tu es bien! Tu es charmant! Lui dit Natacha pendant qu’elle l’examinait dans tous les sens.
— Un moment, mademoiselle, permettez, disait la femme de chambre agenouillée, tout occupée à égaliser les jupons et à manœuvrer adroitement avec sa langue un paquet d’épingles qu’elle faisait passer d’un coin de sa bouche à l’autre.
— C’est désespérant, s’écria Sonia, qui suivait de l’œil tous ses mouvements; le jupon est trop long, trop long!»
Natacha, s’éloignant de la psyché pour se voir plus à l’aise, en convint aussi.
«Je vous assure, mademoiselle, que la robe n’est pas trop longue, dit piteusement Mavroucha, qui se traînait à quatre pattes à sa suite.
— Positivement, elle est trop longue, mais nous allons faufiler un ourlet,» assura Douniacha avec autorité.
Et, tirant aussitôt l’aiguille qu’elle avait piquée dans le fichu croisé sur sa poitrine, elle recommença à coudre.
À ce moment, la comtesse, en robe de velours, sa toque sur la tête, entra timidement dans la chambre.
«Oh! Qu’elle est belle!… Elle vous enfonce toutes!» s’écria le vieux comte en s’avançant pour l’embrasser; mais, de crainte de voir sa toilette froissée, elle l’écarta doucement en rougissant comme une jeune fille.
«Maman, la toque plus de côté, je vais vous l’épingler…»
Et d’un bond Natacha se jeta sur sa mère, en déchirant par ce brusque mouvement, à la grande consternation des ouvrières qui n’avaient pu la suivre, le tissu aérien qui l’enveloppait.
«Ah, mon Dieu! Vrai, ce n’est pas ma faute!
— Ce n’est rien, reprit Douniacha résolument; on n’y verra rien!
— Oh! Mes beautés, mes reines! S’écria la vieille bonne, qui était entrée à pas de loup pour les admirer… et Sonia aussi… quelles beautés!»
Enfin, à dix heures un quart, on monta en voiture, et on se dirigea vers la Tauride.
Malgré son âge et sa laideur, MllePéronnsky avait passé par les mêmes procédés de toilette, avec moins de hâte, il est vrai, vu sa grande habitude; sa vieille personne, bichonnée, parfumée et vêtue d’une robe de satin jaune ornée du chiffre de demoiselle d’honneur, excitait également l’enthousiasme de sa femme de chambre. Elle était prête et accorda de grands éloges aux toilettes de la mère et des filles. Enfin, après force compliments, ces dames, tout en prenant bien soin de leurs robes et de leurs coiffures, s’installèrent dans leurs équipages respectifs.