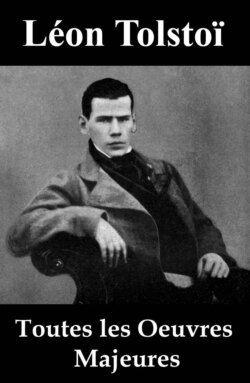Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Léon Tolstoï - León Tolstoi - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеChacun rentra chez soi, et, à part Anatole, qui s’endormit aussitôt, personne ne ferma l’œil de longtemps.
«Sera-t-il vraiment mon mari, cet homme si beau, si bon, surtout si bon!» pensait la princesse Marie.
Et elle éprouvait une terreur qui n’était pas dans sa nature: elle avait peur de se retourner, de bouger; il lui semblait que quelqu’un se tenait là, dans ce coin sombre, derrière le paravent, et ce quelqu’un était le diable, ce quelqu’un était cet homme au front blanc, aux sourcils noirs, aux lèvres vermeilles!
Elle appela sa femme de chambre, et la pria de passer la nuit auprès d’elle.
MlleBourrienne arpenta longtemps le jardin d’hiver, attendant vainement aussi quelqu’un, souriant à quelqu’un, et s’émouvant parfois aux paroles de sa «pauvre mère», qui lui reprochait sa chute.
La petite princesse grondait sa femme de chambre: son lit était mal fait: elle ne pouvait s’y coucher d’aucune façon; tout lui était lourd et incommode… c’était son fardeau qui la gênait. Il la gênait d’autant plus ce soir, que la présence d’Anatole l’avait reportée à une époque où, vive et légère, elle n’avait aucun souci: assise, en camisole et en bonnet de nuit, dans un fauteuil, pour la troisième fois elle faisait refaire son lit et retourner les matelas par sa femme de chambre endormie.
«Je t’avais bien dit qu’il n’y avait que des creux et des bosses; tu comprends bien que je n’aurais pas mieux demandé que de dormir? Ainsi ce n’est pas ma faute,» disait-elle du ton boudeur d’un enfant qui va pleurer.
Le vieux prince ne dormait pas non plus. Tikhone, à travers son sommeil, l’entendait marcher et s’ébrouer; il lui semblait que sa dignité avait été offensée, et cette offense était d’autant plus vive, qu’elle ne se rapportait pas à lui, mais à sa fille, à sa fille qu’il aimait plus que lui-même. Il avait beau se dire qu’il prendrait son temps pour décider quelle serait dans cette affaire la ligne de conduite à suivre, une ligne de conduite selon la justice et l’équité, ses réflexions ne faisaient que l’irriter davantage:
«Elle a tout oublié pour le premier venu, tout, jusqu’à son père… et la voilà qui court en haut, qui se coiffe et qui fait des grâces, et qui ne ressemble plus à elle-même! Et la voilà enchantée d’abandonner son père, et pourtant elle savait que je le remarquerais! Frr… frr… frr… Est-ce que je ne vois pas que cet imbécile ne regarde que la Bourrienne?… Il faut que je la chasse! Et pas un brin de fierté pour le comprendre; si elle n’en a pas pour elle, qu’elle en ait pour moi! Il faudra lui montrer que ce bellâtre ne pense qu’à la Bourrienne. Pas de fierté!… je le lui dirai!»
Dire à sa fille qu’elle se faisait des illusions et qu’Anatole s’occupait de la Française était, il le savait bien, le plus sûr moyen de froisser son amour-propre. Sa cause serait gagnée; en d’autres termes, son désir de garder sa fille serait satisfait. Cette idée le calma, et il appela Tikhone pour se faire déshabiller.
«C’est le diable qui les a envoyés,» se disait-il pendant que Tikhone passait la chemise de nuit sur ce vieux corps parcheminé, dont la poitrine était couverte d’une épaisse toison de poils gris.
«Je ne les ai pas invités, et les voilà qui me dérangent mon existence, et il me reste si peu de temps à vivre… Au diable!»
Tikhone était habitué à entendre le prince parler tout haut; aussi reçut-il d’un visage impassible le coup d’œil furibond qui émergeait de la chemise.
«Sont-ils couchés?»
Tikhone, comme tous les valets de chambre bien appris, devinait d’instinct la direction des pensées de son maître:
«Ils se sont couchés et ont éteint leurs lumières, Excellence.
— Bien nécessaire, bien nécessaire,» marmotta le vieux.
Et, glissant ses pieds dans ses pantoufles, et endossant sa robe de chambre, il alla s’étendre sur le divan qui lui servait de lit.
Quoique peu de paroles eussent été échangées entre Anatole et MlleBourrienne, ils s’étaient parfaitement compris; quant à la partie du roman qui précédait l’apparition de «ma pauvre mère», ils sentaient qu’ils avaient beaucoup de choses à se dire en secret; aussi, dès le lendemain matin, cherchèrent-il les occasions d’un tête-à-tête, et ils se rencontrèrent inopinément dans le jardin d’hiver, pendant que la princesse Marie descendait, plus morte que vive, pour se rendre chez son père à l’heure habituelle. Il lui semblait que non seulement chacun savait que son sort allait se décider dans la journée, mais qu’elle-même y était toute disposée. Elle lisait cela sur la figure de Tikhone, sur celle du valet de chambre du prince Basile, qu’elle croisa dans le corridor, portant de l’eau chaude à son maître, et qui lui fit un profond salut.
Le vieux prince, ce matin-là, se montra plein de bienveillance et d’aménité pour sa fille; elle connaissait depuis longtemps cette façon d’agir, qui n’empêchait pas ses mains sèches de se crisper de colère contre elle pour un problème d’arithmétique qu’elle ne saisissait pas assez vite, et qui le poussait à se lever, à s’éloigner d’elle et à répéter à plusieurs reprises les mêmes paroles d’une voix sourde et contenue.
Il entama le sujet qui le préoccupait, sans la tutoyer:
«On m’a fait une proposition qui vous concerne, lui dit-il en souriant d’un sourire forcé; vous aurez probablement deviné que le prince Basile n’a pas amené ici son élève (c’est ainsi qu’il appelait Anatole, sans trop savoir pourquoi) pour mes beaux yeux; vous connaissez mes principes: c’est pour cela que je vous parle en ce moment.
— Comment dois-je vous comprendre, mon père? Dit la princesse, pâlissant et rougissant tour à tour.
— Comment comprendre? S’écria le vieux en s’échauffant. Le prince Basile te trouve à son goût comme belle-fille et il te fait la proposition au nom de son élève: c’est clair! Comment comprendre? C’est à toi que je le demande.
— Je ne sais pas, mon père, ce que vous… murmura la princesse.
— Moi, moi, je n’ai rien à y voir, laissez-moi donc de côté, ce n’est pas moi qui me marie!… Que voulez-vous?… c’est là ce qu’il me serait agréable d’apprendre?»
La princesse devina que son père ne voyait pas ce mariage d’un bon œil, mais elle se dit aussitôt que c’était le moment ou jamais de décider de son sort. Elle baissa les yeux pour ne pas voir ce regard qui lui ôtait toute faculté de penser et devant lequel elle était habituée à plier:
«Je ne désire qu’une chose: agir selon votre volonté, mais s’il m’était permis d’exprimer mon désir…
— Parfait! S’écria le prince en l’interrompant: il te prendra avec la dot et il y accrochera MlleBourrienne; c’est elle qui sera sa femme, et toi…»
Il s’arrêta en voyant l’impression que ses paroles produisaient sur sa fille; elle baissait la tête, et elle était prête à fondre en larmes.
«Voyons, voyons, je plaisante. Souviens-toi d’une chose, princesse, mes principes reconnaissent à une jeune fille le droit de choisir. Tu es libre, mais n’oublie pas que le bonheur de toute ta vie dépend du parti que tu vas prendre… je ne parle pas de moi.
— Mais je ne sais, mon père…
— Je n’en parle pas; quant à lui, il épousera qui on voudra; mais toi, tu es libre: va dans ta chambre, réfléchis, et apporte-moi ta réponse dans une heure; tu auras à te prononcer devant lui. Je sais bien, tu vas prier, je ne t’en empêche pas; prie, tu ferais mieux de réfléchir pourtant; va!… Oui ou non, oui ou non, oui ou non!» criait-il pendant que sa fille s’éloignait chancelante, car son sort était décidé et décidé pour son bonheur.
Mais l’allusion de son père à MlleBourrienne était terrible; à la supposer fausse, elle n’y pouvait penser de sang-froid. Elle retournait chez elle par le jardin d’hiver, lorsque la voix si connue de MlleBourrienne la tira de son trouble. Elle leva les yeux et vit à deux pas d’elle Anatole qui embrassait la jeune Française, en lui parlant à l’oreille. La figure d’Anatole exprimait les sentiments violents qui l’agitaient, quand il se retourna vers la princesse, oubliant son bras autour de la taille de la jolie fille.
«Qui est là? Que me veut-on?» semblait-il dire.
La princesse Marie s’était arrêtée pétrifiée, les regardant sans comprendre. MlleBourrienne poussa un cri et s’enfuit. Anatole salua la princesse avec un sourire fanfaron, et haussant les épaules, il se dirigea vers la porte qui conduisait à son appartement.
Une heure plus tard, Tikhone, qui avait été envoyé prévenir la princesse Marie, lui annonça qu’on l’attendait, et que le prince Basile était là. Il la trouva dans sa chambre, assise sur le canapé, passant doucement la main sur les cheveux de MlleBourrienne, qui pleurait à chaudes larmes. Les doux yeux de la princesse Marie, pleins d’une pitié tendre et affectueuse, avaient retrouvé leur calme et leur lumineuse beauté.
«Non, princesse, je suis perdue à jamais dans votre cœur.
— Pourquoi donc? Je vous aime plus que jamais et je tâcherai de faire tout mon possible…, répondit la princesse Marie avec un triste sourire. Remettez-vous, mon amie, je vais aller trouver mon père.»
Le prince Basile, assis les jambes croisées, et tenant une tabatière dans sa main, simulait un profond attendrissement, qu’il paraissait s’efforcer de cacher sous un rire ému. À l’entrée de la princesse Marie, aspirant à la hâte une petite prise, il lui saisit les deux mains:
«Ah! Ma bonne, ma bonne, le sort de mon fils est entre vos mains. Décidez, ma bonne, ma chère, ma douce Marie, que j’ai toujours aimée comme ma fille.»
Il se détourna, car une larme venait en effet de poindre dans ses yeux.
«Frr… Frr…! Au nom de son élève et fils, le prince te demande si tu veux, oui ou non, devenir la femme du prince Anatole Kouraguine? Oui ou non, dis-le, s’écria-t-il; je me réserve ensuite le droit de faire connaître mon opinion… oui, mon opinion, rien que mon opinion, ajouta-t-il en répondant au regard suppliant du prince Basile… Eh bien! Oui ou non?
— Mon désir, mon père, est de ne jamais vous quitter, de ne jamais séparer mon existence de la vôtre. Je ne veux pas me marier, répondit la princesse Marie, en adressant un regard résolu de ses beaux yeux au prince Basile et à son père.
— Folies, bêtises, bêtises, bêtises!» s’écria le vieux prince, en attirant sa fille à lui, et en lui serrant la main avec une telle violence, qu’elle cria de douleur.
Le prince Basile se leva.
«Ma chère Marie, c’est un moment que je n’oublierai jamais; mais dites-moi, ne nous donnerez-vous pas un peu d’espérance? Ne pourra-t-il toucher votre cœur si bon, si généreux? Je ne vous demande qu’un seul mot: peut-être?
— Prince, j’ai dit ce que mon cœur m’a dicté, je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait, mais je ne serai jamais la femme de votre fils!
— Voilà qui est terminé, mon cher; très content de te voir, très content. Retourne chez toi, princesse… Très content, très content,» répéta le vieux prince, en embrassant le prince Basile.
«Je suis appelée à un autre bonheur, se disait la princesse Marie, je serai heureuse en me dévouant et en faisant le bonheur d’autrui, et, quoi qu’il m’en coûte, je n’abandonnerai pas la pauvre Amélie. Elle l’aime si passionnément et s’en repent si amèrement. Je ferai tout pour faciliter son mariage avec lui. S’il manque de fortune, je lui en donnerai à elle, et je prierai mon père et André d’y consentir!… Je me réjouirais tant de la voir sa femme, elle si triste, si seule, si abandonnée!… Comme elle doit l’aimer pour s’être oubliée ainsi! Qui sait? J’aurais peut-être agi de même!»