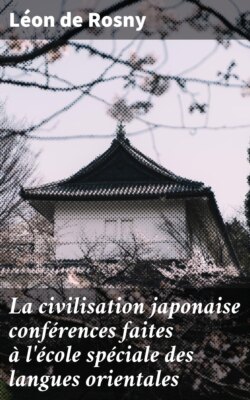Читать книгу La civilisation japonaise conférences faites à l'école spéciale des langues orientales - Léon de Rosny - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
PLACE DU JAPON
DANS
LA CLASSIFICATION ETHNOGRAPHIQUE DE LâASIE
ОглавлениеTable des matières
L me paraît utile, au début des études que nous allons entreprendre, de jeter un coup dâÅil rapide sur les principales divisions ethnographiques que les progrès de la science ont permis dâétablir au sein de ce vaste continent dâAsie, dont les Japonais occupent la zone la plus orientale.
Les premiers essais de classement des populations asiatiques sont dus aux orientalistes. Ces essais ont projeté de vives lumières sur le problème, mais elles ne lâont point résolu, parce que les orientalistes, au lieu de se préoccuper de tous les caractères des races et des nationalités, se sont à peu près exclusivement attachés à un seul de ces caractères, celui qui résulte de la comparaison des langues.
Les orientalistes ont fait, dâailleurs, ce qui a été fait à peu près pour tous les genres de classification scientifique. En botanique, par exemple, à lâépoque de Tournefort, on attachait une importance exceptionnelle à la forme de la corolle; Linné, le grand Linné, ne portait guère son attention que sur les organes sexuels des végétaux. La classification ne pouvait être définitivement acceptée que lorsquâavec les Jussieu, les familles de plantes ont été fondées sur lâensemble de leurs caractères physiologiques.
Il devait en être de même pour la classification des peuples. Lâaffinité des langues peut certainement nous révéler des liens de parenté entre nations; mais ces affinités sont souvent plus apparentes que réelles. Les peuples vaincus ont parfois adopté la langue de leurs vainqueurs, sans que pour cela il y ait eu, entre les uns et les autres, le moindre degré de consanguinité, la moindre communauté dâorigine. La colonisation a souvent transporté fort loin lâidiome dâune nation maritime, et lâa fait accepter par des tribus on ne peut plus étrangères les unes aux autres. Nous parlons en Europe des langues dont le sanscrit est un des types les plus anciens; mais, sâil est établi quâil existe une famille de langues aryennes ou indo-européennes, personne nâoserait plus soutenir aujourdâhui quâil existât une famille ethnographique aryenne et indo-européenne. Au premier coup dâÅil, on reconnaît lâabîme qui sépare le Scandinave aux cheveux blonds et au teint rosé, de lâIndien aux cheveux noirs et au teint basané. Personne, non plus, ne voudrait soutenir que les naturels des îles de lâOcéanie, où lâanglais est devenu lâidiome prédominant, aient des titres quelconques de parenté avec les habitants de la fraîche Albion.
Les caractères anthropologiques, dâordinaire plus persistants que les caractères linguistiques, sont à eux seuls également insuffisants pour établir une classification ethnographique solide. Le métissage a, dans tous les temps et sous tous les climats, profondément altéré les caractères ethniques. Il nâest point possible de répartir dans deux familles différentes les Samoièdes qui habitent le versant oriental de lâOural et ceux qui vivent sur le versant occidental de cette montagne. Les uns cependant appartiennent, au moins par la couleur de la peau, à la race Jaune, tandis que les autres font partie de la race Blanche.
Lorsque lâhistoire ne nous fait pas défaut, câest à lâhistoire que nous devons emprunter les données fondamentales de la classification des peuples. Lorsque lâhistoire manque, alors, mais alors seulement, nous devons recourir, pour reconstituer des origines ethniques sans annales écrites, à la comparaison anthropologique des types, aux affinités grammaticales et lexicographiques des langues, à la critique des traditions et à lâexégèse religieuse, aux formes et à lâesprit de la littérature, comme aux manifestations de lâart, et demander à ces sources diverses dâinformation les rudiments du problème que nous nous donnons la mission de résoudre, ou tout au moins dâéclaircir ou dâélaborer[5].
Trois grandes divisions nous sont signalées tout dâabord dans le vaste domaine de la civilisation asiatique.
La première et la moins étendue est occupée par les Sémites qui habitent surtout le sud de lâAsie-Mineure, sur les deux rives de lâEuphrate et du Tigre, la péninsule dâArabie, la côte nord-est du golfe Persique et quelques îlots, provenant pour la plupart de migrations israélites et musulmanes, au cÅur et au sud-est de lâAsie.
La seconde division est peuplée par les Hindo Iraniens, dont les linguistes ont formé le rameau oriental de leur grande famille aryenne, famille dans laquelle ils ont incorporé la plupart des populations de lâEurope. Le foyer primitif de ce groupe ne doit pas être placé, comme on le fait trop souvent, dans la péninsule même de lâHindoustan, mais au nord-ouest de cette péninsule. Les Aryens ne sont, dans lâInde, que des conquérants, superposés sur les Dravidiens autochtones, aujourdâhui refoulés vers la pointe sud de la presquâîle Cis-Gangétique et à Ceylan.
La troisième division, qui comprend une foule de nations diverses, a été considérée par quelques auteurs comme le domaine dâun prétendu groupe dit des Touraniens. Jadis, on aurait avoué simplement son ignorance au sujet de ces nations; et, sur la carte ethnographique de lâAsie, on se serait borné à une mention vague, telle que «populations non encore classées». Aujourdâhui, on a honte de dire quâon ne connaît pas encore le monde tout entier: on aime mieux débiter des erreurs que dâavoir la modestie de se taire.
Je me propose de mâétendre un peu sur cette prétendue famille touranienne; car câest, en somme, celle qui doit nous intéresser le plus ici, puisque les Japonais devront être compris dans ce troisième groupe des populations asiatiques.
Du moment où il sâagit de désigner une idée nouvelle, et, dans lâespèce, une nouvelle circonscription ethnographique, il est presque toujours nécessaire de créer un mot nouveau. Le choix heureux de ce mot nâest pas tellement indifférent pour le progrès de la science, quâil ne vaille la peine de le chercher avec le plus grand soin. Lâemprunt à la Genèse des noms de Japhétiques, Sémitiques et Chamitiques, pour servir à la classification des races humaines, a poussé lâethnographie dans des ornières dont il est bien difficile de la faire sortir. Je craindrais, pour ma part, que la dénomination de Touranien, si elle était définitivement acceptée, entraînât la science des nations dans des erreurs bien autrement funestes encore. Dâabord, cette dénomination manque non-seulement de précision, mais, par suite du sens que les linguistes lui attribuent aujourdâhui, elle signifie deux choses très différentes. Touran, pour les Perses de lâantiquité, nâa jamais été la désignation dâun peuple particulier; autant vaudrait admettre, comme terme de classification, les noms de Refaïm et de Zomzommin donnés aux populations à demi-sauvages que les Sémites rencontrèrent à leur arrivée dans la région biblique où ils se sont établis. Pour les linguistes, au contraire, il faut entendre par Touraniens à peu près tous les peuples asiatiques qui ne sont ni Aryens, ni Sémites. Dans les tableaux quâon publie journellement pour la classification de ces peuples, je vois figurer côte à côte les Finnois, les Hongrois et les Turcs, dont les affinités paraissent certaines, les populations que M. Beauvois a réunies sous le nom de Nord-Atlaïques, les populations Mongoliques, les Mandchoux, les Coréens, les Japonais, parfois même les Chinois, les Malays, câest-à -dire les Océaniens et les Dravidiens. Or, comme la parenté de ces derniers peuples avec les Nord-Altaïens,—possible, je le veux bien,—est encore loin dâavoir été établie dâune manière scientifique, le nom de Touranien nâest guère plus explicite, suivant moi, que le mot terra incognita, sur nos vieilles cartes géographiques. Et, si lâintention des ethnographes était de faire usage dâune dénomination générale pour tous les peuples asiatiques que nos connaissances ne nous permettent pas encore de classer sérieusement, je préférerais de beaucoup le nom dâAnaryens (non Aryens), que M. Oppert a employé dans ses premiers travaux sur lâécriture cunéiforme du second système. Les Aryens, sur lesquels repose la constitution de la grande famille linguistique successivement appelée indo-germanique, indo-européenne et aryenne, forment en effet le seul groupe considérable des peuples de lâAsie dont la parenté ait été définitivement établie, sinon au point de vue de lâanthropologie, au moins en raison des affinités de leurs idiomes respectifs. Le procédé par voie dâexclusion ne saurait donc, en ce cas, nuire à la clarté de la doctrine, et, provisoirement, je préfère adopter la dénomination dâAnaryens, pour les peuples sur lesquels je dois fixer votre attention.
Le groupe des peuples anaryens de lâAsie, dont lâunité nâa pas encore été établie par la science, comprend plusieurs familles, sur lesquelles vous me permettrez de vous dire quelques mots.
La famille Oural-Altaïque sâétend depuis la mer Baltique et la région des Carpathes à lâouest, jusquâaux limites orientales de la Sibérie à lâest.
Cette famille se subdivise en quatre rameaux principaux:
Le rameau septentrional comprend les Finnois et les Lapons au nord de lâEurope;—les Samoïèdes répandus au nord-est de la Russie et au nord-ouest de la Sibérie;—les Siriænes, au nord et à lâouest de la rivière Kama;—les Wogoules, entre la Kama et les monts Ourals, dâune part, et sur la rive gauche de lâObi, de lâautre;—les Ostiaks, des deux côtés de lâIénisseï.
Le rameau occidental se compose des Hongrois, répartis dans de nombreux îlots, situés dans la région du Danube et de deux de ses affluents, la Theiss et le Maros.
Le rameau méridional comprend les Turcs qui occupent, en Europe, non point la contrée connue en géographie sous le nom dâEmpire Ottoman, mais seulement quelques îlots disséminés çà et là dans cette contrée; lâAsie-Mineure, à lâexception de la zone maritime occupée surtout par des colonies helléniques; et une vaste étendue de territoire au nord de la Caspienne et de lâAral, prolongé jusquâaux versants occidentaux du Petit-Altaï. Il faut rattacher à ce rameau, les Iakoutes, habitants des deux rives de la Léna et dâune partie de la rive droite de lâIndighirka, ainsi que de lâembouchure de ce fleuve, où ils vivent côte à côte avec les Toungouses et les Youkaghirs.
Le rameau oriental, enfin, se compose des Youkaghirs, des Koriaks et des Kamtchadales.
La famille Tartare comprend les rameaux suivants:
Le rameau Kalmouk-Volgaïen, composé de tribus Euleuts ou Kalmouks, au nord-ouest de la mer Caspienne, sur les rives du Volga, sâétendant à lâouest non loin des rives du Don, et formant plusieurs îlots dans la partie sud-ouest de la Russie dâEurope; et le rameau Altaïen, comprenant les Kalmouks répandus dans la région du lac Dzaïsang;
Le rameau Baïkalien, comprenant les Bouriæts de la région du lac Baïkal;
Le rameau Mongolique, composé de plus de deux millions et demi de Tatares-Mongols, habitant le nord de la Chine, depuis le lac Dzaïsang et les monts Kouën-lun à lâouest, jusquâau territoire occupé par les Mandchoux à lâest;
Le rameau Toungouse comprenant les Toungouses, chasseurs et pasteurs, errant surtout dans le bassin de la Léna et sur les rivages de lâOcéan Glacial, au-delà de la limite des terres boisées, en face de lâarchipel inhabité de la Nouvelle-Sibérie, et à lâembouchure de la rivière Kolima:—les Lamoutes, pêcheurs, sur les rivages occidentaux de la mer dâOckostk;—les Mandchoux, sur les bords du fleuve Amoûr, principalement sur sa rive droite.
La famille Dravidienne, composée des anciennes populations autochtones de lâInde, aujourdâhui refoulées dans la partie méridionale de cette péninsule et dont les langues paraissent avoir des affinités avec les idiomes tartares, se compose des rameaux suivants:
Le rameau septentrional, composant les Télinga ou Télougou, dans la région du Dékhan;
Le rameau occidental, formé des Indiens Karnataka, à lâouest des précédents,—et des Indiens Toulou, au sud;
Le rameau méridional, formé des Indiens Malayalam, sur la côte de Malabar;
Enfin, le rameau oriental, formé du peuple Tamoul, qui occupe la côte de Coromandel et la pointe septentrionale de lâîle de Ceylan.
En dehors de ces familles à peu près définies, nous trouvons encore, dans le vaste groupe des anaryens, plusieurs nations dâune importance considérable, dont la situation ethnographique nâa pas été reconnue jusquâà présent dâune façon satisfaisante et qui, par ce fait, semblent former autant de familles distinctes, savoir:
La famille Sinique, composée des Chinois, implantés, environ trente siècles avant notre ère, sur le territoire occupé primitivement par les Miaotze, les Leao, les Pan-hou-tchoung, les Man, et autres populations autochtones; des Cantonais et des Hokkiénais, habitants des côtes orientales de la Chine, qui parlent un dialecte dans lequel on retrouve de nombreuses traces dâarchaïsme;
La famille Tibétaine, qui est répandue dans le petit Tibet, le Ladakh, le Tibet, le Népâl, le Bhotan, dans la partie sud-ouest de la province chinoise du Ssetchouen, et dans quelques îlots situés dans les provinces du Kouang-si, du Koueitcheou et au nord-ouest de la province du Kouang-toung;
La famille Annamite, comprenant les populations du Tong kin et de la Cochinchine;
La famille Thaï, composée des Siamois.
Je vous demande la permission de ne pas mâoccuper des Barmans et des Cambogiens, dont la situation ethnographique est encore difficile à déterminer, et qui, en tout cas, paraissent étrangers au groupe de peuples que nous avons, en ce moment, la mission dâétudier ensemble.
Les affinités plus ou moins nombreuses que lâon peut constater entre ces peuples, sont tantôt des affinités anthropologiques, tantôt des affinités linguistiques.
Vous connaissez tous le type chinois, et, pour lâinstant, je ne parle de ce type quâau point de vue de ses caractères reconnaissables par le premier venu. Vous connaissez peut-être un peu moins le type mongol et le type japonais, ou plutôt vous devez bien souvent confondre ceux-ci et celui-là . Câest quâil existe, en effet, entre ces types, des traits de la plus étonnante ressemblance. Si vous avez vu des Samoïèdes, des Ostiaks, des Tougouses, des Mandchoux, des Annamites, des Siamois, que sais-je, des indigènes dâà peu près toute la zone centrale et sud-orientale de lâAsie, vous avez dû vous trouver porté à la même confusion. Il nâest pas nécessaire de sortir dâEurope pour rencontrer ces individus aux cheveux noirs, à la face large et aplatie, aux yeux bridés, aux pommettes saillantes, aux lèvres épaisses, à la barbe rare, autant de caractères frappants sâil en fût; il ne faut pas même aller jusquâà Kazan: à Moscou, dans tout le cÅur de la Russie, et même à Pétersbourg, cette ville finno-allemande, vous rencontrez, à chaque instant, le type sui generis dont je viens de vous rappeler les principaux traits.
Au premier abord, il y a donc une présomption pour croire à lâexistence dâune grande famille, composée de tant de nations non pas précisément douées dâun type identique, mais dâun type fortement marqué du stigmate de la parenté:
.....Facies non omnibus una,
Nec diversa tamen; qualem decet esse sororum.
Les affinités linguistiques sont naturellement moins faciles à reconnaître. Les vocabulaires de ces peuples nâoffraient, aux yeux des philologues de la première moitié de ce siècle, que de rares homogénéités, et la tendance était de croire à un ensemble de familles de langues essentiellement différentes les unes des autres. Il faut dire que ce nâest guère que depuis une vingtaine dâannées, que plusieurs des idiomes les plus importants de ce groupe ont été étudiés dâune façon approfondie. En outre, les formes archaïques du chinois, idiome considérable par son antiquité et par son développement, étaient à peu près complètement ignorées. Les caractères fondamentaux des mots chinois étaient peut-être plus difficiles à reconnaître que ceux des racines des autres langues, par suite de la forme monosyllabique et uniconsonnaire de ces mots. On comparait de la sorte gratuitement, avec le vocabulaire de toutes sortes dâidiomes de lâAsie Centrale, les monosyllabes des dialectes de Péking et de Nanking, qui sont ceux qui ont subi avec le temps les plus graves altérations. La reconstitution de la langue chinoise antique nous a signalé notamment lâexistence ancienne de thèmes bilitères, câest-à -dire de racines composées dâune voyelle intercalée entre deux consonnes, racines analogues aux racines primitives des langues sémitiques et des langues aryennes[6]. Ces thèmes bilitères ont été dâune valeur sans pareille pour arriver à des rapprochements dâune rigueur philologique incontestable: ils ont permis de constater des affinités certaines et jusquâalors inaperçues entre les glossaires chinois, japonais, mandchou, mongol, etc.
Des affinités certaines, je le répète, ont été constatées par ce moyen; mais ces affinités sont encore insuffisantes pour donner lieu à de larges déductions. Des rapports de vocabulaires ont même été signalés entre des rameaux bien autrement éloignés. Le turc et le japonais, par exemple, possèdent des mots dont la ressemblance est certainement de nature à faire réfléchir les linguistes. Quelques rapprochements ont été tentés aussi avec le magyar, langue sÅur du finnois et du turc, et le tibétain, langue apparentée au mongol, et dans une proportion non encore déterminée, au chinois[7]. Le coréen possède enfin des désinences de déclinaison et de conjugaison semblables à celles du japonais[8].
Mais ce qui est bien autrement important que ces assimilations sporadiques de mots et de vocables, câest lâunité du système grammatical qui caractérise lâensemble des langues du groupe sur lequel jâappelle, en ce moment, votre attention. Cette unité est telle, quâune phrase turque, par exemple, peut généralement se traduire en japonais sans quâun seul mot ou particule occupe, dans une de ces deux langues, une place différente de celle quâil occupe dans lâautre. Et remarquez que la grammaire japonaise se distingue de la grammaire des langues aryennes et des langues sémitiques, par une syntaxe essentiellement originale. Dans cette langue, comme en mantchou, en tibétain et en turc, la construction phraséologique est rigoureusement inverse. En japonais, comme en turc, pour dire: «jâai vu hier le gouverneur chassant sur les bords du Coïk avec ses chiens», on construira: hesterno-die Coici littore-suo-in, canibus-sui cum, Alepi præfectum-suum vidi;—en mandchou, comme en japonais, pour dire «habitant de la ville de Nazareth, dans la province de Galilée», on construira: Galileæ provinciæ Nazareth vocatam civitatem incolens; en tibétain, comme en japonais, pour dire: «As-tu vu ma (bien-aimée) appelée Yidpâro?», on construira: mea Yidpâro sic vocata te a prospecta fuitne?
Dans toutes ces langues, le qualificatif, quelquâil soit, adjectif ou adverbe, précède le mot qualifié. Pour dire: «les hommes de la haute montagne, on construira, alti montis homines.—Le régime direct précède le verbe; pour dire: «il a vu la pierre dans la montagne,» on construira, montis interiore-in lapidem vidit.—Les particules de condition sont des postfixes; en dâautres termes, au lieu et place de nos prépositions, nous trouvons des postpositions.—Enfin, pour donner encore un exemple de similitude syntactique, je rappellerai la manière dâexprimer le comparatif par une simple règle de position, avec le concours de la postposition de lâablatif, jointe à lâobjet aux dépens duquel est faite la comparaison[9].
Quelques noms de peuples, compris dans les groupes que jâai énumérés tout à lâheure, sollicitent également lâattention. La dénomination dâOugriens, donnée aux peuples de lâOural, vient de lâostiak ôgor «haut»; elle pourrait bien être la même que celle de Mogol ou Mongol, bien que ce dernier nom soit expliqué comme signifiant «brave et fier»[10]. Le correspondant turc de ôgor est ioughor et ouighor, qui, à son tour, rappelle le nom des Ouigours. Dâautre part, le nom de Vogoules et celui des Ungari ou Hongrois, ont été rattachés à cette même racine ostiake Ogor[11]. Enfin, on nous donne le nom de Moger, nom dont on ignore le sens[12], comme la plus ancienne appellation des Magyars ou Hongrois: ce nom renferme les trois consonnes radicales du mot Mogol, car on sait que lâl et lâr se permutent sans cesse dans les idiomes de lâAsie moyenne, idiomes qui ne possèdent quelquefois quâune seule de ces deux articulations semi-voyellaires. Ces étymologies, que je vous donne pour ce quâelles peuvent valoir, ne sont cependant pas plus impossibles que celle qui rapproche le nom Sames des Lapons, de celui des Finnois, dont le pays est appelé Suom-i.
Des affinités anthropologiques et linguistiques dont je viens de vous entretenir, que pouvons-nous déduire?—Non point encore une certitude au sujet de lâorigine des Japonais et de leur parenté avec les nations de la terre ferme, mais du moins des arguments de nature à consolider une hypothèse, suivant laquelle les Japonais seraient une émigration du continent asiatique. Si cette hypothèse doit être un jour établie dâune manière rigoureusement scientifique, il est hors de doute que la date de cette migration sera reportée à une époque fort ancienne, et sans doute antérieure à la fondation des grands empires historiques de lâAsie Centrale et Orientale. Si, cependant, la critique historique admettait pour cette migration le siècle de lâarrivée au Japon de Zin-mou, premier mikado de cet archipel, câest-à -dire le VIIe siècle avant notre ère, il ne faudrait pas trouver une objection contre cette doctrine dans le silence des historiens chinois au sujet de ce grand mouvement ethnique. Lâavénement de Zin-mou et son établissement dans le palais de Kasiva-bara, 660 ans avant notre ère, sont antérieurs dâun siècle à la naissance de Confucius. Or lâhistoire rapporte que câest à ce célèbre moraliste que la Chine doit la possession de ses annales primitives, reconstituées par ses soins à lâaide des documents conservés dans les archives impériales des Tcheou. Si lâon étudie, dâune part, dans quelles conditions difficiles Confucius put réaliser cette Åuvre gigantesque dâérudition, et, dâautre part, si lâon tient compte du parti pris par ce philosophe de ne livrer à la postérité que ce que lâhistoire ancienne de son pays pouvait offrir de bons exemples à ses compatriotes pour les moraliser et leur faire accepter ses enseignements, on ne sâétonnera point quâil ait négligé de recueillir les données quâon pouvait avoir, à son époque, sur lâémigration de Zin-mou.
Dans lâhypothèse que nous examinons, cette émigration serait venue dâun grand foyer de civilisation anaryenne, car Zin-mou nâapparaît point au Nippon comme un chef de sauvages ou de barbares, mais bien comme le prince dâune nation polie et déjà avancée en civilisation. Ce foyer, où le trouver, si ce nâest en Chine? A moins que nous nous décidions à lâaller chercher chez ce peuple anaryen auquel M. Oppert attribue lâinvention de lâécriture cunéiforme.
Lâidentité à peu près absolue du système de lâécriture cunéiforme anaryenne et du système de lâécriture japonaise viendrait, au besoin, à lâappui de cette audacieuse théorie. Il est, en effet, très singulier de trouver chez deux peuples étrangers lâun à lâautre une invention aussi compliquée, aussi originale que le système de lâécriture cunéiforme anaryenne et de lâécriture japonaise[13]. Des signes figuratifs, employés tantôt avec la valeur de lâobjet quâils représentent, tantôt avec une valeur purement phonétique; des signes polyphones, câest-à -dire susceptibles dâêtre lus de plusieurs manières différentes, suivant le contexte de la phrase; des mots écrits partie en caractères idéographiques, partie en caractères phonétiques; tant de procédés graphiques employés simultanément et dans les mêmes conditions chez deux peuples, ont à coup sûr quelque chose dâétonnant, dâénigmatique, qui provoque malgré soi dans lâesprit lâhypothèse dâune origine commune. Cette hypothèse, je vous conseille de ne lâaccueillir quâavec réserve, comme on doit accueillir une hypothèse non encore démontrée. Dans lâobscur dédale des origines ethniques, il faut envisager en même temps toutes les possibilités et se défier de toutes les vraisemblances.
Je me résume: les Japonais sont des étrangers dans lâarchipel quâils habitent aujourdâhui. Leur provenance du continent asiatique est peu douteuse, mais la route de leurs migrations primitives, que divers ordres de faits font entrevoir sur la carte dâAsie, est encore environnée de ténèbres et de mystères. Ils ne sont point venus dâOcéanie, comme lâont supposé quelques ethnographes, encore moins dâAmérique: le sang mongolique coule dans leurs veines, lâesprit tartare a procédé à la formation de leur grammaire, et probablement aussi de leur vocabulaire. Leurs aptitudes civilisatrices, le caractère chercheur, inquiet de leur génie national, ne permet point de les croire Chinois dâorigine, à moins que les effets du métissage aient produit en eux une prodigieuse transformation intellectuelle.