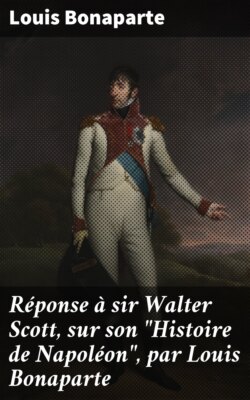Читать книгу Réponse à sir Walter Scott, sur son "Histoire de Napoléon", par Louis Bonaparte - Louis Bonaparte - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TOME III,
ОглавлениеTable des matières
JE n’ai pu me dissimuler les mauvaises intentions de l’auteur, en voyant que dans un ouvrage dont le but est de faire connaître la vie de Napoléon, on ne commence à parler de lui qu’au troisième volume. Il est évident que l’on a voulu rattacher le nom de Napoléon aux excès et aux horreurs de la révolution, auxquels non-seulement il fut étranger, mais qu’il a comprimés. L’on a voulu aussi augmenter et exagérer les excès et les horreurs de la révolution, par un sentimeut d’inimitié contre la France, aussi injuste qu’ingénéreux.
Un but encore visible est celui de vouloir faire passer Napoléon comme étranger à la France.
En effet, si telles n’étaient pas les intentions de l’auteur, pourquoi cette obstination à écrire le nom de famille de Napoléon, Buonaparte, au lieu de Bonaparte, ainsi qu’il est consacré par une vieille habitude?
Certainement, la lettre O n’est ni plus ni moins noble ou française que la lettre U; mais c’est pour imprimer un caractère d’étrangeté à Napoléon, et séparer sa gloire de celle de la France.
La nation italienne est assez glorieuse pour que l’on fût fier de lui appartenir, principalement quand on tire son origine de ce beau pays; mais quand on est né sous les lois françaises, que l’on a grandi sur son sol, que l’on n’a connu les pays étrangers, et même la belle Italie, qu’avec les légions victorieuses de la France, il est par trop ridicule de recevoir d’un auteur anglais un brevet d’étranger.
Une observation n’a pu m’échapper à ce sujet: c’est que, tout en convenant que Napoléon avait droit d’orthographier son nom comme il le voulait, l’auteur l’écrit comme cela n’est pas d’usage dans notre famille.
On trouvera une méchante intention semblable à l’article du siège de Toulon, où, pour atténuer la gloire de ce premier exploit de Napoléon, l’auteur le fait participer aux horreurs qui suivirent la prise; chose que depuis trente ans nul libelliste n’avait encore imaginée. Cela est d’autant plus remarquable, qu’il dit lui-même, à la suite de cette calomnie, qu’elle est sans fondement: pourquoi donc la consigne-t il dans son livre? Cela peut-il avoir un autre but que de noircir la renommée de celui dont il se dit l’historien?
Sans doute qu’un auteur n’est pas responsable du peu de mérite de son livre; chacun ne peut donner que ce qu’il a: mais c’est peu respecter le public, c’est peu se respecter soi-même, que de ne pas se donner la peine de vérifier les assertions que l’on avance. Mais ces sortes d’ouvrages sont des spéculations commerciales sur l’avide curiosité des lecteurs, qui produisent d’autant plus qu’elles contiennent un plus grand nombre de méchancetés et de calomnies. Sans doute la vie de Napoléon, par Walter Scott, est de ce nombre; sans cela, comment la concevoir!!
On trouve à la page 5 du tome III, que Lucien n’était guères inférieur à son frère en talens et en ambition. Quant à l’ambition, l’auteur dément lui-même cette observation, lorsqu’il fait connaître que Lucien refusa les honneurs que Napoléon lui offrait, à condition que son second mariage ne serait pas reconnu; et quant aux talens, je me tiens assuré que Lucien lui-même, malgré l’éloquence et l’esprit qui le distinguent, n’a jamais songé à entrer en rivalité avec son frère. Mais, après avoir essayé de donner un titre d’étrangeté à l’homme que les Français choisirent pour leur empereur, après avoir essayé de rabaisser ses grandes actions, on va jusqu’à vouloir lui ôter la supériorité même dans sa famille. Je me crois donc obligé de déclarer ici, moi, frère de l’empereur Napoléon, que c’est dans sa famille qu’il commença à exercer la plus grande supériorité, non pas lorsque la gloire et le pouvoir l’eurent élevé, mais même dès son adolescence.
L’auteur affecte de nommer les soldats français des premières années de la révolution Sans-culottes et Carmagnoles, et c’est se montrer à la fois injuste et peu au fait de l’état des choses. S’il avait mieux étudié la composition des armées à cette époque, il aurait connu que les armées françaises formées des jeunes gens mis en réquisition, étaient composées du sang le plus pur de la nation; qu’il n’était pas rare de trouver dans ses rangs des fils et des frères des victimes de la fureur révolutionnaire.
Tome III, page 14. — «Quoique d’origine italienne, il » n’avait pas de goût pour les beaux-arts,» dit Walter Scott.
J’ose croire que même en Angleterre, il trouvera peu de personnes de son avis. N’est-ce pas se jouer de la crédulité de ses lecteurs, que d’avancer une telle assertion? Celui qui enrichit son pays de la plus brillante collection des chefs d’ œuvre de l’antiquité; celui qui, durant tout son règne, provoqua des chefs-d’œuvre insignes et récompensa les artistes avec une magnificence inouïe; celui qui établit les prix décennaux, et donna plus d’étendue à l’exposition des produits de l’industrie nationale; celui qui éleva dans Paris les monumens que sir Walter Scott n’a pu s’empêcher de voir dans son court voyage dans cette capitale; celui qui fit construire les routes prodigieuses qui traversent les Alpes, n’avait pas de goût pour les beaux arts!!!
On peut adresser un tel jugement à la postérité; mais s’il y parvient, ce ne sera qu’à la honte de son auteur.
Tome III, page 23. — «Napoléon était en Corse avec un
» congé, lorsque ces événemens arrivèrent (la trahison du
» vieux-général Paoli), et quoiqu’il eût été déjà lié d’amitié
» avec Paoli, et qu’il y eût même quelque relation de parenté
» entre eux, etc.»
Il n’existait pas la moindre parenté entre notre famille et celle de Paoli. Mon père, Charles Bonaparte, avait été lié d’amitié avec Paoli, qu’il aida dans la défense de l’île. Napoléon ne pouvait connaître Paoli, puisqu’il était né après le départ de celui-ci pour l’Angleterre. Ce n’est pas le parti de la Convention que Napoléon embrassa, mais le parti de la France, celui de sa patrie, contre l’ennemi. Les factions corses, dont Walter Scott parle, n’étaient autre chose que des insurgés soulevés par les Anglais et par Paoli, qui, ayant reçu du gouvernement le commandement de cette division militaire de la France, se servit de son autorité pour livrer le pays à l’Angleterre.
Après le mauvais succès de l’expédition de Sardaigne, commandée par l’amiral Truguet et le vieux général Casabianca, dans laquelle Napoléon avait un commandement séparé, Paoli tenta vainement d’ébranler la fidélité de celui-ci, qui s’empressa de se joindre aux commissaires du gouvernement, Lacombe Saint-Michel et Saliceti; c’est avec eux qu’il tenta de chasser les insurgés d’Ajaccio; n’ayant pu y réussir, il rentra à son régiment, celui de Grenoble, qui se trouvait alors à l’armée d’Italie, au quartier-général à Nice.
Il est également faux que Masseria, et non Masserio, l’un des compagnons de Paoli, fût parent de Napoléon; il nous était entièrement étranger.
Tome III, page 25. — «Napoléon et son frère Lucien, qui
» s’étaient fait remarquer comme partisans de la France,
» furent condamnés au bannissement; et madame Bonaparte,
» avec ses trois filles et Jérôme, encore enfant, s’embarqua
» et se retira d’abord à Nice, et ensuite à Marseille, etc.»
Ces détails ne sont pas exacts; ceux que j’ai donnés dans les documens sur la Hollande sont parfaitement justes, et l’on doit y ajouter foi, puisque, quoique enfant, j’étais avec ma mère à cette époque, que je la suivis en Provence, et demeurai avec elle jusqu’après la prise de Toulon, que j’embrassai la carrière militaire.
Ce n’est point Lucien qui accompagna Napoléon, mais Joseph: Lucien était alors à Marseille avec l’ambassadeur Semonville qu’il devait accompagner à Constantinople. Jérôme, à peine âgé de sept ans, et Caroline, âgée de huit, demeurèrent à Ajaccio, et ne furent ramenés auprès de nous que quelque temps après, tandis que j’étais avec ma mère, de même que mon oncle l’archidiacre Fesch, depuis cardinal.
Je ne rapporte ces petites inexactitudes que pour rétablir les choses comme elles sont réellement.
Tome III, page 25. — «Depuis cet événement, Napoléon
» n’a jamais revu la Corse.»
Cela est faux, puisqu’il débarqua à Ajaccio au retour d’Égypte, et y demeura plusieurs jours avant d’arriver à Fréjus.
Quelque puériles que soient ces observations, elles prouvent cependant le peu de soin que l’auteur a pris de la vérité en compilant son ouvrage.
Il est dit (page 33) que Napoléon fut protégé par son compatriote, le député à la Convention, Saliceti, qui avait voté la mort du roi; et cela est si faux, que c’est ce député qui, avec ses collègues, Albite et Ricord, fit arrêter Napoléon au quartier-général de Nice, et lui fit subir une arrestation de plusieurs jours, pendant lesquels on visita tous ses papiers, qu’on ne lui restitua qu’après en avoir fait le dépouillement.
L’auteur prend si peu de soin de s’informer de la vérité, qu’il dit qu’après la prise de Toulon, Napoléon fut confirmé dans son grade provisoire de chef de bataillon, et employé à ce titre à l’armée d’Italie, tandis qu’il était chef de bataillon ou lieutenant-colonel au quatrième régiment d’artillerie, celui de Grenoble, en arrivant au siége de Toulon, et qu’après la prise il fut promu au grade de général de brigade d’artillerie, commandant en chef celle de l’armée d’Italie. C’est en cette qualité qu’il fit l’inspection des côtes et les arma, et non par suite d’une commission reçue de la Convention.
Tome III, page 57. — «En mai 1795, il, vint à Paris
» pour solliciter de l’emploi dans son arme. Il se trouva
» dénué d’amis et dans l’indigence dans cette ville dont
» il devait bientôt devenir le chef suprême. Quelques per-
» sonnes cependant l’assistèrent, parmi lesquelles fut le
» célèbre acteur Talma, qu’il avait connu tandis qu’il.
» était encore à l’École militaire, etc.»
Tout ce passage est de la plus grande fausseté. Napoléon ne vint pas à Paris pour solliciter de l’emploi, mais pour se rendre à l’armée de l’Ouest, où on l’avait fait passer comme commandant de l’artillerie, destination qui lui déplaisait fort et qu’il espérait faire changer: mais il trouva, il est vrai, peu de dispositions favorables pour lui dans le député Aubry, chargé des affaires militaires, à cause de la grande jeunesse de Napoléon et de la sévérité des réglemens de l’artillerie sur l’ancienneté. Non-seulement on se refusa à ses désirs, mais on ne lui conserva pas même le commandement de l’artillerie de l’armée de l’Ouest, et on le fit passer dans la ligne avec son grade de général de brigade. Cela parut un outrage à Napoléon, qui refusa et demeura à Paris sans emploi: mais il jouissait de son traitement d’officier général non employé, et il avait auprès de lui trois officiers, Junot, Marmont et moi. Il est vrai que Marmont le quitta bientôt après pour rejoindre son régiment à l’armée du Rhin; mais Junot demeura toujours auprès de lui; et quant à moi, je fus envoyé, à cause de mon extrême jeunesse, à l’école d’artillerie de Châlons, et c’est lui qui pourvoyait à toutes les dépenses qui m’étaient relatives.
Napoléon n’a connu Talma qu’à cette époque, puisque, quand il était aux écoles militaires, il était impossible qu’un élève pût fréquenter des acteurs. Il était dans les mœurs du temps, en 1795, non-seulement d’admettre les acteurs dans la société, mais même de les fêter, comme pour les dédommager de leur abaissement antérieur. C’est dans la société d’alors que Napoléon a connu Talma; mais il est impossible que les services d’argent dont on parle aient pu avoir lieu, à moins que ce ne fût en sens inverse.
Tome III, page 59. — «Bonaparte avait en lui quelque
» chose du caractère de son pays natal: il n’oubliait ni un
» bienfait ni une injure.»
Cela est faux, nul ne fut jamais moins vindicatif que Napoléon: il accueillit, caressa, avança ses ennemis; et c’est peut-être à son trop de confiance que sont dues les trahisons dont il tomba victime.
Les plaisanteries qu’on lit plus bas sur le dessein qu’on prête à Napoléon de passer en Turquie, sont aussi fausses que ridicules et de mauvais goût. S’il n’avait point toujours nourri dans son sein un ardent patriotisme pour la France, quelle plus belle occasion aurait-il pu trouver que celle qui lui avait été offerte par le général Paoli lors de la trahison de celui-ci?
Tome III, page 86. — Le propos trivial que Walter Scott prête à Barras lorsque l’on nomma Napoléon, pour commander au 13 vendémiaire est une insigne fausseté, et je le prouve: On dit que Barras, s’adressant à Carnot et à Tallien, leur dit: «J’ai l’homme qui vous manque; c’est
» un petit officier corse qui ne fera pas tant
» de façons.»
Or, depuis plusieurs mois Napoléon, non employé activement, travaillait au comité militaire, et connaissait parfaitement Carnot et Tallien qu’il voyait journellement; comment donc Barras aurait-il pu leur adresser le propos qu’on lui prête?
S’il fallait de nouvelles preuves de l’esprit calomnieux et diffamatoire qui a dicté la prétendue histoire de Walter Scott, on les trouverait aisément dans le passage qui termine le chapitre II, page 100 du troisième volume. Il y est dit que la dot de la première épouse de Napoléon fut le commandement de l’armée d’Italie, platitude relevée de plusieurs libelles du temps. Il y est dit encore qu’il se hâta d’aller voir sa famille qui était à Marseille, pour se montrer comme un favori de la fortune dans une ville qu’il avait abandonnée peu de temp sauparavant, à peu près comme un aventurier indigent. Or, cet aventurier indigent, en quittant Marseille, était couvert de gloire par la prise de Toulon, et plus récemment par la campagne durant laquelle Saorgio avait été pris, et la bataille del Cairo gagnée: il se montrait à Marseille comme commandant en chef de l’artillerie d’Italie. Il partait, il est vrai, et quittait sa place, mais pour en occuper une autre équivalente à l’armée de l’Ouest; et le nouveau travail qui motivait ce changement portait, à l’article de Napoléon, l’observation suivante: «Jeune officier de la plus
» grande distinction, à qui l’on doit la prise
» de Toulon.»
Il ne doit pas être impossible de se procurer un exemplaire du travail militaire de cette époque, imprimé à un grand nombre d’exemplaires, qui ne peuvent être disparus entièrement.
A la page 147, tome III, l’auteur se raille des proclamations de Napoléon, en même temps qu’il injurie le caractère des soldats français; et il faut plaindre, sans s’étonner, l’auteur de tant de romans de son aveuglement et de son manque de goût; mais qu’il s’adresse à des lecteurs français ou à des lecteurs anglais, je doute qu’il puisse les convaincre que l’éloquence et les guerriers qui firent tant de grandes choses, n’aient pas été dans le chemin du grand et du beau.
Tome III, page 171. — «La seconde victime fut le duc
» de Modène, etc.»
Sir Walter Scott traite de victimes les princes d’Italie avec lesquels l’armée française eut à faire; mais loin que cette expression soit juste, Napoléon leur rendit un grand service en signant des traités avec eux, puisque par-là il assurait leur existence politique, dans un temps où elle était si fort menacée par le système et les instructions du gouvernement, comme par l’effervescence qui régnait dans les différentes contrées d’Italie.
Les contributions en argent et en objets d’arts auxquelles ces princes furent soumis, n’étaient pas des sacrifices qui pussent balancer la perte de leur existence politique.
Il n’en est pas un d’eux qui n’ait reçu le traité qui le concernait, comme un bienfait et avec une joie réelle.
L’auteur dit que le motif qui porta Napoléon à recevoir une partie des contributions en objets d’arts est plus facile à deviner qu’à justifier ( tome III, page 176); mais il me permettra de penser à mon tour que l’un est aussi facile que l’autre.
En effet, les objets d’arts sont des trophées de la victoire: les anciens traînaient à leur char les captifs, et même les captifs couronnés; les Barbares prenaient ou détruisaient tout dans les pays vaincus. Les Français, sous Napoléon, furent plus généreux en préférant les objets d’arts.
L’auteur fait dire à cette occasion à Napoléon, lorsque ses officiers l’engageaient à céder le saint Jérôme du Corrège pour la somme de deux millions de francs: Cet argent serait bientôt dépensé, mais le Corrège sera pendant des siècles un ornement pour la ville de Paris, et inspirera la production de nouveaux chefs-d’œuvre.
Voilà pourtant celui que l’auteur accusait tantôt de n’avoir aucun goût pour les beaux-arts!!!
Est-il donc si difficile à l’auteur, d’après cette réponse, de justifier le motif qui fit préférer les objets d’arts par Napoléon? Ce motif est trop grand et trop louable pour avoir besoin d’être justifié : si l’auteur ne l’a pas deviné, c’est que non-seulement il ne l’a pas voulu, mais qu’il a tâché, au contraire, de le dénaturer; de même que, par la qualification d’agent dévoué du Directoire, qu’il donne à Napoléon, et que celui-ci dément dans tout le cours du livre de Walter Scott, il prouve l’aveuglement ou la mauvaise foi de la haine.
Tome 111, page 309. — «Le vainqueur enfin des meilleurs
» généraux de l’Europe, lui qui, quelques mois auparavant,
» simple soldat de fortune, cherchait de l’emploi plutôt
» pour subsister que pour parvenir au pouvoir et à la
» gloire, etc.»
Quelque répugnance que j’aie à revenir sur ces plates et fausses invectives, il faut cependant exprimer l’opinion qu’elles font naître, en contenant le dégoût et le mépris qu’elles inspirent.
Qu’est-ce que Walter Scott entend par soldat de fortune? On appelait ainsi en France, avant la révolution, ceux qui étaient parvenus au commandement, en commençant par être simples soldats; et l’on a vu, d’après l’exposé même de l’auteur, que la carrière militaire de Napoléon n’avait pas commencé ainsi, qu’il fut appelé par sa naissance et par les plus brillantes études à prendre rang parmi les officiers du corps distingué de l’artillerie. Que l’on appelle en Angleterre soldats de fortune ceux qui se placent au service de la Compagnie des Indes pour aller battre sans peine des peuplades ignorantes, et s’enrichir sans peine de leurs dépouilles ou de leurs trafics, cela se conçoit aisément; mais cette expression de soldat de fortune ne peut s’appliquer à Napoléon, à moins qu’elle ne veuille signifier qu’il ne dut son avancement qu’à ses succès militaires; et certes, dans ce cas, l’injure que lui adresse l’auteur est loin de porter coup.
Quant à l’état dans lequel Napoléon se trouvait quelques mois auparavant, l’auteur n’ignore pas qu’il était général en chef de l’armée de l’intérieur, à Paris, et que peu de temps avant il avait commandé ces guerriers auxquels l’auteur donne les sobriquets de Carmagnoles et de Sans-culottes, mais qui cependant, en petit nombre, et avec quelques canons, chassèrent de la rade de Toulon les flottes combinées d’Angleterre et d’Espagne, après avoir détruit leur armée de terre, enlevé à la pointe de l’épée les forts que la trahison avait livrés à l’armée anglaise, et fait prisonnier le général Ohara, commandant en chef de cette armée. C’est en vain que l’auteur voudrait appliquer ce passage au court intervalle que Napoléon passa sans commandement à Paris. J’ai déjà dit que sa détresse à cette époque est de toute fausseté. Quoiqu’il fût sans commandement, il ne conserva pas moins son grade et le traitement d’officier général.
Il était appelé et consulté au comité de la guerre, et c’est à la haute opinion qu’il donna aux membres de ce comité, de son génie et de son grand caractère si bien prouvé au siège de Toulon, qu’il dut le commandement au 13 vendémiaire, et ensuite celui de l’armée d’Italie.
Tome III, page 321. — Le saint Bonaventure Bonaparte dont il est question ici, est le bienheureux Bonaventure Bonaparte, dont j’ai moi-même reconnu le corps, à mon passage à Bologne, le 3 septembre 1817, dans la chapelle de Saint-Jérôme, appartenant à la famille Ghisilieri, dans l’église de Sainte-Marie de la Vita.
APPENDICE DU TOME III.
Page 427. — Le comte Pozzo di Borgo était un homme de mérite de la ville d’Ajaccio, qui fréquentait journellement la maison Bonaparte; mais il n’en était nullement parent. A l’époque de la trahison de Paoli, Pozzo di Borgo émigra d’abord en Angleterre, et ensuite en Russie.
Le prétendu bannissement de Corse de la famille Bonaparte est une fable. La Corse, depuis vingt-cinq ans, appartenait à la France. Paoli lui-même avait reçu du gouvernement le commandement militaire de la Corse: qui donc aurait eu le droit de bannir la famille Bonaparte? Elle quitta la ville d’Ajaccio, et la Corse entière, uniquement à cause de la reddition de l’île aux ennemis, et se retira d’abord à la Valette, près de Toulon, et ensuite à Marseille.
Tome III, pages 434 et 435. — «Il (Napoléon) engagea
» M. Joly à venir le voir à Auxonne, pour traiter avec lui
» de l’impression de cet ouvrage: Histoire politique, civile
» et militaire de la Corse. M. Joly s’y rendit en effet.
» Il trouva le futur empereur dans une petite chambre
» presque nue, ayant pour tout meuble un mauvais lit
» sans rideaux, une table placée dans l’embrasure d’une
» fenêtre, et chargée de livres et de papiers, et deux chaises.
» Son frère Louis, auquel il enseignait les mathématiques,
» était couché sur un mauvais matelas, dans un cabinet
» voisin. M. Joly et l’auteur convinrent du prix pour
» l’impression de l’ouvrage; mais Napoléon ne savait alors
» s’il devait quitter Auxonne ou y rester. Peu de temps
» après, il fut envoyé à Toulon, premier point de départ
» de sa carrière extraordinaire.... M. Joly rapporte que
» les ornemens d’église de l’aumônier du régiment, qui
» venait d’être supprimé, avaient été déposés chez Napoléon
» par les autres officiers. Il les fit voir à son hôte, et il
» parla des cérémonies de la religion sans indécence, mais
» pourtant aussi sans respect: Si vous n’avez pas entendu
» la messe aujourd’hui, je puis vous la dire. Telles furent
» les expressions dont il se servit en parlant à M. Joly.»
Ce passage contient presque autant de faussetés que de lignes: je me souviens très-bien qu’à cause de moi l’on donna à mon frere un quartier plus commode et plus ample qu’aux autres officiers de son grade. L’ameublement ne pouvait être ni meilleur ni moindre que celui des autres officiers, puisque tous étaient casernés, et par conséquent logés et meublés par l’État. Je me souviens que j’avais une très-bonne chambre et un très-bon lit. Mon frère dirigeait mes études, mais j’avais les maîtres nécessaires, même de littérature.
Cette phrase: Napoléon ne savait pas s’il devait quitter Auxonne ou y rester, semblerait vouloir indiquer qu’il était indécis s’il suivrait l’exemple de plusieurs de ses camarades qui émigrèrent. L’indécision n’était pas dans son caractère, et jamais il n’hésita sur le parti qu’il devait suivre. Ce n’est pas, comme on le dit, peu de temps après cela qu’il fut envoyé à Toulon; peu de temps après cela, une promotion le fit passer au régiment de Grenoble, en garnison à Valence, et je l’y suivis. De là il se rendit en semestre en Corse, pour se préparer à entrer en campagne, et je l’y suivis encore; mais pendant son semestre, il fut élu lieutenant-colonel dans un régiment d’infanterie de nouvelle levée, sans perdre son rang dans l’artillerie de ligne, en conséquence des lois militaires du temps, faites pour encourager les officiers de la ligne à entrer dans les nouvelles troupes. Je restai dans ma famille. Au retour de l’expédition de Sardaigne, et après la trahison de Paoli, Napoléon vint rejoindre son régiment (le 4me d’artillerie) à Nice, et ma famille se retira d’abord à la Valette, près de Toulon, et ensuite à Marseille, ainsi que cela a été dit.
C’est après cela que Napoléon fut choisi pour faire la visite des différens arsenaux, et y former un équipage de siège, indispensable à l’armée; et c’est au retour de cette mission seulement, et à son passage par Marseille, qu’il fut mis en réquisition pour remplacer, à l’armée de Toulon, le général Donmartin, commandant de l’artillerie du siège, qui venait d’être grièvement blessé.
J’ignore ce qu’on rapporte des propos de Napoléon relatifs aux ornemens d’église; mais je puis affirmer qu’à cette époque ce fut par ses exhortations et ses soins que je fis ma première communion.
C’est lui qui me fit donner l’instruction et les préparations nécessaires, par un digne ecclésiastique, le frère de madame de Pillon, vieille dame très-considérée, où toute la société d’Auxonne se réunissait le soir.
J’étais enfant à cette époque; mais comme je me souviens parfaitement de tout ce que je rapporte, je me souviendrais également d’avoir vu les ornemens dont on parle, et des propos que l’on prête à mon frère, si tout cela était vrai, puisque je me souviens très-bien que j’allais à la messe les dimanches et jours de fête, avec tout le régiment réuni en corps.