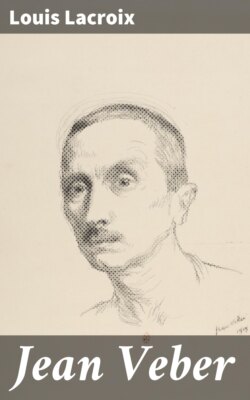Читать книгу Jean Veber - Louis LaCroix - Страница 3
ОглавлениеLe dessinateur satirique
Néanmoins ce n’est pas par la peinture que le nom de Jean Veber se répandra tout d’abord. Certes le Saint-Sébastien, le Saint-Siméon Stylite, les Vierges folles avaient de précieuses qualités. Mais dans la cohue du Salon des Champs-Elysées, ces toiles, quoique de grandes dimensions, passeront presque inaperçues ou seront goûtées seulement de quelques-uns. C’est par les dessins publiés dans certains journaux fort répandus que le public s’habituera très vite à lire la signature, réelle ou imagée , de notre ami. Sur des textes extrêmement spirituels de son frère Pierre, Jean Veber publiera en effet dans Le Journal des dessins fantaisistes, gais souvent, cruels parfois, mais toujours d’une verve endiablée qui vont chaque semaine propager son talent de dessinateur et être de plus en plus impatiemment attendus. Ces dessins se rapporteront toujours à l’actualité. Ils mettront en scène d’étonnantes parodies de faits réels et surtout des personnages littéraires, artistiques et politiques dont Jean Veber déformera les visages, sans altérer jamais leur ressemblance profonde et avec une verve bouffonne dont le trait incisif ne sera que difficilement égalé. Et ce qui donnera à ces amusantes chroniques, tantôt signées The Veber’s, tantôt Sharp’s Brothers, un attrait tout particulier, c’est que les deux frères se mettront en scène presque constamment et que leurs deux silhouettes apparaîtront toujours en culs-de-lampes, variant sans cesse leurs étranges et inimitables facéties. On retrouve dans ces pages brillantes la fine observation d’un Hogarth, la truculence d’un Rowlandson et de temps à autre, la vision macabre d’un Goya, le tout assaisonné de bonne et saine gaîté française.
Il ne resterait quasi rien de ces feuilles volantes si les deux frères Veber n’avaient eu l’excellente idée d’en sauvegarder quelques-unes en les réunissant en deux séries qui ont paru, la premère en 1895, chez Emile Testard (celui-là même qui publia l’Edition Nationale des œuvres de Victor Hugo) et la seconde en 1896, chez l’éditeur Simonis Empis. Ce sont deux volumes in-8°, bien présentés et imprimés sous de curieuses couvertures illustrées représentant les deux frères. Un amateur toulousain en a réuni deux exemplaires sur japon sous une même reliure signée Bretault et les a fait précéder d’une aquarelle originale de Jean Veber exécutée spécialement pour leur servir de frontispice. L’artiste a représenté la Satire nue, les mains aux hanches, tenant le fouet allégorique. Elle est très crâne d’allure, jeune, jolie et très spirituellement enlevée. Derrière elle, Jean s’apprête à dessiner tandis que Pierre sourit déjà à l’idée de quelque espièglerie nouvelle.
Le même amateur possède également l’original du portrait d’Alphonse XIII qui parut au Rire, en 1897, dans le Musée des Souverains où collaborèrent Veber, Léandre et Cadel. Veber a représenté «L’Enfant Martyr » ployant sous le poids du manteau royal et de ses bras malingres s’efforçant de tenir sur sa tête une énorme couronne d’or. A ses pieds, traîne le sceptre dont la hampe est le porte-crayon de l’artiste. Le beau dessin, rehaussé de quelques touches discrètes d’aquarelle, a. été légèrement traité dans une coulée d’encre de Chine qui, à elle seule, forme le vêtement du roi. La tête est grosse, le visage inquiet et légèrement simiesque, l’œil fixe et apeuré. La prophétie de Veber ne s’est pas réalisée puisque Alphonse XIII, après tant d’années, porte sa couronne sans peur et même avec allégresse. Mais l’œuvre a une expression nerveuse qui ne s’oublie pas. Quand l’image parut dans le Rire, elle y fit grand bruit. L’ambassade et la colonie espagnoles de Paris s’en émurent. Mais il était trop tard. Afin de pallier le mauvais effet produit, Veber, l’année suivante, donna au même périodique une nouvelle interprétation d’Alphonse XIII. Sous la forme d’une vierge sculptée à la proue d’un navire, il montra la reine Christine, symbolisant Notre-Dame-des-Tempêtes, tenant son fils entre ses bras et affrontant de nuit la mer en courroux sous la grande lanterne de vigie .
Les autres souverains furent plus malmenés par Veber qu’Alphonse XIII, en particulier Abdul-Hamid aux mains pleines de sang, écoutant les conseils que lui donne à l’oreille la Mort sans merci. Mais c’est avec Guillaume II que l’artiste fit ses deux plus fameuses planches. Dans le numéro du 10 juillet 1897, il le représenta rivé à un clou par les cheveux. C’était le clou de l’Exposition de 1900. On se rappellera que certains journaux avaient prêté à l’empreur Guillaume II l’intention de visiter l’Exposition. La seconde planche, parue le 13 novembre de la même année nous le fait voir en grand uniforme, crucifié sur une épée dont la garde est une furie. Ce dessin servit de couverture au livre de Maurice Leudet paru chez Juven, intitulé Guillaume II intime.
La censure finit par s’inquiéter et parvint à interdire le portrait du pape Léon XIII, non pas que Veber ait voulu être irrévérencieux envers le saint homme, bien loin de là, mais parce que la lourde cage entre les barreaux de laquelle le pape passait un nez à la Cyrano pouvait inquiéter la susceptibilité et des Italiens et des catholiques. D’ailleurs peu rassuré sur le sort de ce dessin — admirable pourtant — Veber m’avait demandé de le porter moi-même aux bureaux du Rire et de l’y laisser sans attendre de réponse... Il parut cependant, mais quelque temps après, dans un album qui réunissait la série des portraits de Léandre, de Cadel et de Veber. Cet album doit être introuvable aujourd’hui. Je ne l’ai vu en effet mentionné nulle part. Il en avait été tiré plusieurs exemplaires sur japon.
Le talent satirique de Jean Veber était donc connu et apprécié de tous. Cependant il n’avait pas encore dit son dernier mot. Il fallut attendre le numéro du Rire du 26 novembre 1898 et celui de l’Assiette au beurre du 28 septembre 1901 pour que son nom conquît la grande célébrité. Le numéro du Rire, dont Pierre Veber signa le texte porte comme titre: «Tournée Guillaume II: 15 jours en Turquie, Palestine, Jérusalem et les Lieux Saints. Celui de l’Assiette au beurre retrace la vie douloureuse des femmes et des enfants Boërs dans les camps de concentration du Transwaal, lors de la fameuse guerre. L’un et l’autre furent tirés à des miliers d’exemplaires qui s’éparpillèrent dans le monde entier. Le premier tirage des «Camps de concentration» est encore très recherché, mais ne se trouve pas facilement. «L’impudique Albion (B)» relevant ses jupes, y étale un postérieur énorme qui n’est autre que la tête joufflue et barbue d’Edouard VII. Par ordre de la censure, cette tête fut recouverte d’un jupon bleu de roi dans les nombreuses éditions qui suivirent. Jamais le fouet vengeur n’a été manié avec plus de vigueur ni la satire n’a nulle part enfoncé le fer rouge avec tant d’à-propos. La double page de «la Chasse aux Arméniens» donnée à Guillaume II par Abdul-Hamid, la visite de Guillaume au Harem, l’épique «foudre de guerre», l’extraordinaire et impudique Albion sont des pages dignes de l’art profond et magnifique de Daumier. Quant à la grande aquarelle qui a pour titre «L’Epave» et où l’on voit la jeune reine Wilhelmine couvrant de son manteau le corps nu de Kruger échoué sur une plage hollandaise, c’est un morceau qu’il est impossible d’oublier. La bonté native de Jean Veber s’y révèle, ainsi que l’ampleur magistrale de son dessin. Le grand corps à demi enseveli dans le sable et dont la tête exsangue a une si douloureuse gravité fait contraste avec la grâce magnifique-parée de la mignonne enfant royale et son geste vraiment exquis. Il y a là ainsi que le disait France à propos de Zola «un moment de la conscience humaine».