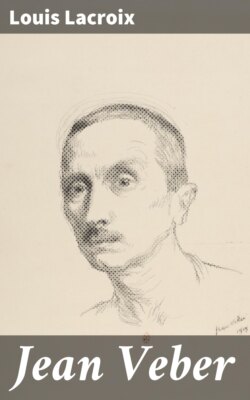Читать книгу Jean Veber - Louis LaCroix - Страница 4
ОглавлениеL’illustrateur fantaisiste
Le satirique, chez Jean Veber, n’est venu qu’après le fantaisiste, mais l’un et l’autre ont vécu en bonne intelligence et sont allés de compagnie pendant près de quarante ans. Bien que Veber fantaisiste soit moins connu du grand public, je crois qu’il survivra au satirique parce que les rêves sont les amis des hommes de tous les temps et que l’artiste s’est exprimé dans les siens avec une joie et une candeur délicieuses. Il a créé, avec un métier toujours divers et ingénieux, un Petit monde charmant d’êtres irréels qui ont fait le sujet de peintures, de lithos, de décorations murales, de tapisseries et de dessins d’illustrations. Ces derniers ne sont pas très nombreux, mais de bien rare qualité. Ils se résument à quatre livres, à deux séries de planches en vue d’éditions qui n’ont pas paru, à plusieurs couvertures en couleurs et croquis à la plume pour des recueils de chroniques et des pièces de théâtre de son frère Pierre, pour les fameux «Mimes» de son ami Marcel Schwob et des vers de Victor Litschfousse, à quatre estampes pour une partition célèbre, enfin à une tête de vierge en extase qui orne une prière de l’abbé Perreyre, mise en musique par Edmond Missa.
La première en date de toutes ces publications est un livre que je n’ai rencontré qu’une fois sur les nombreux catalogues de librairie que je reçois. Ce livre porte la date de 1893 et est intitulé «Djèta et Maknem», esquisse philosophique. Il a paru chez l’éditeur Emile Testard et le nom de son auteur est P. Selk, pseudonyme de Madame Simon. Je possède l’exemplaire de l’éditeur, ainsi qu’en témoignent la dédicace reconnaissante et manuscrite de l’auteur et deux lettres de Jean Veber. Emile Testard méritait cette dédicace, car cet ouvrage a été très bien conçu et exécuté. Cette esquisse philosophique n’est en sommé qu’un poème en prose divisé en dix chants, qui dit en une langue cadencée, souple et élégante, l’équilibre humain du Bien et du Mal. Pour chaque chant, Veber a dessiné une lettre ornée et un cul-de-lampe. Les lettres ornées seules sont en couleurs et rehaussées d’or. Traitées comme des enluminures elles sont si fraîches de coloris et d’un arrangement décoratif si heureux qu’elles semblent avoir été peintes sur l’exemplaire même (C). De minuscules personnages, faits avec une adresse exquise se marient à ces lettres et forment ainsi de petites compositions d’un goût très raffiné. Ce goût se retrouve dans le frontispice et les culs-de-lampe, mais surtout dans l’ornementation de la couverture en parchemin blanc qui présente, avec les trois mots du titre, les visages des deux héroïnes du livre, peints sur un fond d’or et qu’un souple et symbolique lézard encadre. Cet aimable ouvrage, imprimé avec soin par Hérissey, d’Evreux, et présenté avec goût, mérite d’être classé dans une bibliothèque de choix. Le format est agréable, l’aspect extérieur fort plaisant. Puis, quand on l’ouvre, il y a à glaner dans le texte qui certes n’est pas indifférent et surtout dans les images qui sont infiniment précieuses. Que de livres aussi recherchés dont on ne pourrait en dire autant!
L’année suivante, c’est-à-dire en 1894, Veber fit quatre planches en couleurs pour la partition de Thaïs. Il était l’ami d’Anatole France et avait suivi près de lui, à l’Académie Nationale, les répétitions de l’Opéra de Massenet. France toujours voluptueux, était ravi de voir de près Sibyl Sanderson et les Demoiselles du Corps de Ballet. Bien que sensible à la beauté, comme tous les artistes, Veber les regardait aussi mais le moine Athanaël l’intéressait davantage. Dans sa figure émaciée, fiévreuse, lui-même se retrouvait. Elle ressemblait étrangement à la sienne. Aussi enlumina-t-il quatre images sur fond d’or, hiératiques et somptueuses, dans lesquelles il se mit en scène. Mais son interprétation du moine Athanaël était, sauf le visage, une interprétation fantaisiste. On le voit, tantôt versant de grosses larmes de sang, tantôt douloureusement prostré et en prières pour fuir l’apparition sensuelle ou bien l’œil hagard devant Erôs qui le tente ou encore impassible malgré le Démon qui veut lui voler son cœur. Et dans l’une et dans l’autre de ces images, aussi belles que les plus belles enluminures, quel sens merveilleux de l’harmonie décorative et quelle originalité de vision! C’est une suite que le génie de Veber, servi par un métier serré et sensible tout ensemble, a faite avec une évidente joie.
Quelques toutes petites estampes, fort rares aussi, sont celles que Veber dessina, les premières en 1896 pour une édition des «Fleurs du Mal» qui n’a jamais paru, les autres, un an plus tard, pour un roman qui causa un certain tapage dans le monde des lettres: «Nichina » d’Hugues Rebell. Pour le Baudelaire, il n’y a qu’un fronstispice et deux planches, mais qui n’ont aucun rapport avec les enluminures de «Djéta» et de «Thaïs». C’est une suite d’une facture large et nerveuse, premiers essais de Veber dans un genre où sa griffe marquera inoubliablement. Le frontispice en noir qui représente le poète entouré de fantômes et assis à sa table de travail, éclairée par une lampe à abat-jour, est une composition un peu lourde peut-être, mais dans laquelle le visage de Baudelaire est fortement évoqué et rendu. Il y a beaucoup d’air et une agréable silhouette dans «La jeune fille marchant au bord de la mer» qui illustre «le beau navire» :
Quand tu vas balayant l’air de ta jupe large; Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le
Chargé de toile, et va roulant [large, Suivant un rythme doux, et paresseux, et lent.
Mais à mon gré, la plus curieuse des trois et celle dans laquelle éclate la personnalité de l’artiste, c’est la planche en couleurs de la femme géante, couchée sur un tertre et étalant entre deux bouquets de pins sa grasse nudité.
On se rappelle les vers du poète:
... Parcourir à loisir ses magnifiques formes; Ramper sur le versant de ses genoux énormes, Et parfois en été, quand les soleils malsains, Lasse, la font s’étendre à travers la campagne, Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins Comme un hameau paisible au pied de la montagne.
L’artiste a établi un dessin d’une rare plénitude et une litho d’une grande séduction. Cette femme nue plantureuse et dans cette pose alanguie, que de fois Veber va en reproduire le thème voluptueux!...
La suite de «la Nichina» comporte cinq Petites illustrations dont trois sont d’une saveur exceptionnelle. Les deux sur chine, charmantes en vérité, ont des noirs veioutés se détachant sur fond bistre. Mais les trois sur japon, rehaussées de discrètes couleurs, je les considère comme de petites estampes d’un raffinement extrême. Les sujets certes ne peuvent pas être mis devant tous les yeux, celui du viol surtout qui est lugubre dans son réalisme. Les deux derniers, s’ils sont vifs, sont aussi plaisants à souhait. Comme on regrette, en les regardant, que Veber n’ait Pas illustré Rabelais, ni surtout Brantôme! Il avait l’intelligence la plus souple et la plus pénétrante, un métier gras et onctueux et quel joli esprit de peintre lettré ! Dans les marges de mes épreuves de «la Nichina», Veber s’est amusé à crayonner de légers et rapide croquis parmi lesquels il a fait son propre visage maigre et maladif, ouvrant, sur la scène du viol, de grands yeux stupéfaits!
Veber eut illustré Poë et Hoffmann au même titre que Rabelais et Brantôme ainsi qu’en témoignent les dessins qu’il fit en 1899 pour un conte de Jean-Louis Renaud, «L’Homme aux poupées» paru chez Floury en édition de luxe — et dont Charlotte Wiehe joua à Paris d’abord, puis en Europe, la pantomine que le musicien Bérény en avait tirée et qu’un film Pathé popularisa. Veber fit pour la jolie édition Floury une suite de dix-huit dessins infiniment curieux et très poussés. Placés dans le même cadre et formant un ensemble fort attrayant, les originaux de ces dessins sont à Toulouse depuis trente ans et l’Amateur qui les possède n’a jamais cessé de jouir de leur attirante étrangeté. Ils sont faits d’esprit autant que de matière vivante, avec des lignes solides et des contours enveloppés. On y sent la main d’un coloriste.
Mais l’ouvrage le plus importantt qu’ait illustré Jean Veber, est celui que Félix Duquesnel a intitulé «Contes des dix mille et deux nuits» paru chez Flammarion en in-4°, après avoir été publié dans L’Illustration. C’est une œuvre qui apparente Jean Veber à Gustave Doré, bien que sa personnalité n’y perde rien de son éclat. Une bouffonnerie entraînante s’y allie de la première à la dernière page à un dessin vif, incisif, qui a un mouvement extraordinaire. On sent que j’artiste s’est fait une fête d’orner de dessins ce livre très amusant qui se prêtait au génie d’un grand artiste. Ces aventures comiques, tragiques, galantes, racontées avec une flamme communicative, ont donné à Veber l’occasion d’exercer sa verve intarissable. A chaque page il s’est surpassé. Je conseille à tous les bibliophiles qui ne connaissent pas ce livre de le rechercher, non seulement sur chine ou sur japon, mais sur papier ordinaire. C’est un des plus délicieux qui soient. Il est réussi d’un bout à l’autre. «La raccommodeur de cervelles», «Togrul, le videur de poètes», «Morgoul le laveur de M’orts», «La forêt des pavots», «L’Illusion», «Les Aventures singulières du Beau Nourrédin, de la douce Morgiane et de la Princesse Aniza», autant de contes parmi lesquels Veber a fait surgir tout un monde de géants, de spectres, de nègres hideux, de types d’une drôlerie incroyable. C’est un des chefs-d’ œuvre de l’illustration française.
La veille du jour de l’an 1903, je reçus de Mme Jean Veber, un livre qu’elle avait écrit pour ses enfants. Il est intitulé «Ardant le Chevelu» et parsemé des plus belles images que peuvent rêver les tout petits. De très vives couleurs et de l’or surtout — cet or dont Veber a usé si souvent et avec tant d’adresse — décorent royalement les pages de ce merveilleux récit où l’on voit un pauvre bûcheron, aux cheveux roux ardent, arrivant un beau jour, après bien des aventures, à épouser une princesse des contes de fées. Jamais cadeau ne m’a été plus agréable. J’en ai bien souvent regardé les dessins somptueux et en le feuilletant tout à l’heure encore, j’y ai pris un plaisir auquel cette fois, s’est mêlée, hélas! une grande tristesse...