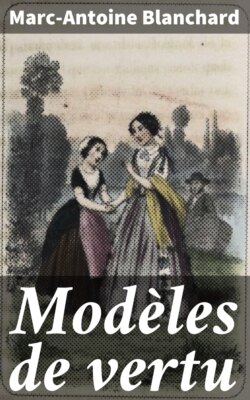Читать книгу Modèles de vertu - Marc-Antoine Blanchard - Страница 4
ОглавлениеLA DEMANDE EN GRACE.
Près de Saint-Benoist, village situé dans le département de l’Indre, s’élevait le château d’un baron excessivement riche. Ce baron était propriétaire de terres immenses, de fermes, de maisons, de forêts, le tout d’un magnifique rapport. Étant très-riche, une foule d’ouvriers travaillaient sur ses domaines, et il les employait moins pour augmenter ses revenus que pour les faire arriver eux-mêmes par le travail à l’aisance, quelquefois même à la fortune. Aussi tous ne cessaient-ils de dire que tant qu’ils auraient de l’ouvrage au château, ils étaient certains de ne pas manquer.
Cependant ce bien qui arrivait à la plupart des habitants de la commune, n’était pas fait par le baron en personne, mais bien par l’excitation et l’entremise d’un intendant, homme d’une probité très-grande, le premier des serviteurs par la fidélité et le dévouement. Cet intendant n’avait jamais été laboureur, cependant il était devenu très-fort en agriculture à force d’observations et d’expérience. Il connaissait parfaitement le sol qui convient à telle ou telle semence; celles qui doivent se succéder pour mieux fructifier, le parti qu’on peut tirer de chaque espèce d’arbre. En même temps qu’il était cultivateur habile, il était donc homme bon, serviable et généreux. Quelque pauvre ou quelque artisan dans la gêne s’adressait-il à la bienveillance du baron; celui-ci faisait appeler l’intendant et lui demandait ce qu’il devait faire. L’intendant, qui connaissait presque tout le monde, n’avait qu’à répondre: — C’est un infortuné qui mérite votre libéralité, monsieur le baron, sa conduite est bonne, ses mœurs sont. honnêtes, vos bienfaits ne tomberont pas sur un ingrat. Le secours était généreusement accordé ; et le malheureux, élevant ses regards vers le ciel, les rabaissait pleins de reconnaissance sur le baron et sur son digne intendant. Ceux qui étaient laborieux et honnêtes étaient certains d’être secourus; mais ceux d’une conduite mauvaise, qui cherchaient à détourner les autres de leurs devoirs, blâmés et accablés de reproches, étaient certains de se voir contraints d’aller étaler ailleurs leur honte et leur fainéantise.
Le baron avait conservé l’habitude des grands seigneurs d’autrefois et qui ne mérite pas moins d’éloges. Tous les samedis, depuis neuf heures du matin jusqu’à midi, il faisait ouvrir les portes de son château et recevait tous les pauvres qui se présentaient. Il les interrogeait, les questionnait, s’informait des causes de leur pauvreté, leur donnait des conseils, des secours, s’étudiait à distinguer ceux qui lui paraissaient dignes de ses bienfaits et de sa protection, et ne manquait jamais de les renvoyer tous, jeunes et vieux, femmes, hommes et enfants, avec l’oubli momentané de leurs peines et de leurs maux.
De même qu’au temps des patriarches le père de famille partageait les dons du ciel à ses nombreux enfants, à ses serviteurs; de même le baron se réjouissait en voyant régner autour de lui la joie, l’aisance et le contentement.
L’amour de ses fermiers, des ouvriers, l’estime et le respect de tous, embellissaient ses vieux jours; mais le plus cher objet de sa tendresse, celui qui contribuait surtout à son bonheur et réchauffait son cœur d’un feu toujours nouveau, était la douce, l’aimable Euphrasie, la plus belle des demoiselles de tout le canton.
Privé de bonne heure d’une épouse chérie, le baron avait longtemps pleuré sa perte; mais la tendresse paternelle avait enfin calmé dans son âme la douleur conjugale. Retrouvant dans sa fille l’image embellie de cette épouse tant regrettée, il avait bientôt senti aux larmes du désespoir succéder celles de la tendresse et de l’admiration.
Dans nos prés, dans nos jardins brillent mille fleurs d’un éclat différent; mais aucune d’elles n’ose le disputer à la rose. La province avait aussi mille petites filles d’une beauté admirable; mais elle n’en possédait aucune qui pût rivaliser avec Euphrasie. Dès qu’elle paraissait en public, la mère la plus tendre se voyait contrainte de lui donner la supériorité même sur sa fille chérie.
Le philosophe Athénien Socrate prétendait qu’un beau corps renferme ordinairement une belle âme, cela n’est pas toujours vrai; mais il est certain que l’âme d’Euphrasie était aussi belle que son corps. Elle joignait en outre aux dons de la nature tout ce que peut y ajouter l’éducation surveillée par un père tendre et éclairé.
Ce ne sont pas seulement les livres, mais bien les conseils des parents qui forment le cœur des enfants à la vertu, par conséquent au bonheur. Et puis il faut aux bons soins qu’on leur donne ajouter ceux de la Providence qui les a fait naître; c’est elle surtout qui les forme tendres, sensés, respectueux.
Le moyen le plus sûr de connaître le cœur d’une jeune personne, est d’observer ses occupations habituelles. Je vais dire comment Euphrasie, qui était la fille d’un baron, employait sa journée. Si ce détail parait ennuyeux aux demoiselles étourdies et volages; si l’une prétend qu’il y a de quoi périr d’ennui à rester des journées entières dans sa chambre, sans aller dans le monde; si une autre pense qu’il est affreux de passer ainsi son temps dans des occupations modestes, je soutiendrai que ces jeunes filles n’ont pas pour elles la raison.
Aussitôt que les premiers rayons de l’aurore chassaient devant eux les ombres de la nuit, et que les feux du soleil venaient dorer la terre, Euphrasie quittait sans regret le sommeil, ses longues paupières se soulevaient sans peine, ses beaux yeux se portaient vers le ciel, et souriante elle dirigeait les premiers élans de sa pensée vers Dieu. Debout à sa fenêtre, elle épiait le réveil de la nature, et admirait le sommet des collines qui s’illuminait de clartés flamboyantes. Puis elle jetait ses regards d’un côté sur les sinuosités de la rivière qui serpentait en bas de la colline, de l’autre sur les chaumières répandues çà et là dans la plaine, d’où le cultivateur sortait gaiement pour aller, par sa présence et par son travail, donner à la fois le mouvement et la vie aux champs.
Tous ces objets portaient dans l’âme d’Euphrasie une joie tranquille, une joie pure comme elle, et sa prière montait au ciel.
Puis elle volait près du baron pour l’embrasser et recueillir sur son front le baiser paternel.
Le baron pleurait de joie en voyant sa fille acquérir tant de perfections. Quand il la considérait, habile, laborieuse, prendre son ouvrage et venir s’asseoir à côté de lui, les expressions lui manquaient pour témoigner au ciel sa reconnaissance. Arrêtant ses regards sur elle, il ne semblait occupé que de son bonheur et de son avenir.
Celui qui plante un arbre ou un rosier considère chaque matin avec plaisir les fruits de l’arbre ou la rose du rosier, et dit: Voilà l’arbre que j’ai planté, c’est moi qui l’ai soigné, qui l’ai élevé. Avec quels transports donc un père ne voit-il pas grandir et se former sous ses yeux un enfant chéri!
Euphrasie avait douze ans. Les prairies se couvraient de fleurs et de verdure; l’alouette commençait à chanter, et la fille du baron se promenait un matin au bord de la forêt, quand elle entend des voix d’hommes qui se disputent. Elle avance, écoute et reconnaît la voix de l’intendant qui reproche à un ouvrier sa négligence et sa paresse; l’ouvrier, au lieu de se soumettre et de s’excuser, répond avec insolence; puis enfin la voix de l’intendant qui chasse l’ouvrier et lui retire tout travail.
Cette dispute avait fait une impression pénible dans le cœur d’Euphrasie. Huit jours après, elle était assise à sa fenêtre, quand elle vit un épervier poursuivre une fauvette, puis un corbeau s’élancer au secours de la fauvette et poursuivre à son tour l’épervier; presque en même temps apparut derrière le mur de clôture une jeune et gentille fille qui promenait ses regards autour d’elle et semblait chercher quelqu’ un. En apercevant Euphrasie, une larme vint mouiller sa paupière, et elle s’arrêta, la tête inclinée sous la fenêtre.
— Petite fille, lui dit Euphrasie, désirez-vous parler à quelque personne du château?
— Oui, mademoiselle, répond timidement la gentille enfant; je désirerais parler à monsieur l’intendant.
— Que lui voulez-vous?
— Je voudrais le prier de pardonner à mon père et d’appeler sur nous les bontés de monsieur le baron.
— Qu’est-ce que votre père a fait?
— Monsieur l’intendant l’a renvoyé parce qu’il n’était pas exact à son travail; mais il m’envoie dire qu’il travaillera désormais de tout son cœur; qu’il contentera monsieur l’intendant, qu’il ne lui arrivera plus de répondre mal. Si vous vouliez venir avec moi, mademoiselle, auprès de monsieur votre père, vous qui êtes sa fille, mon père aurait sa grâce, et mes frères et moi ne courrions plus le risque de manquer de pain.
La chère petite priait avec tant d’ingénuité, de grâce; ses yeux étaient si suppliants, qu’Euphrasie, qui avait dans le cœur une commisération très-grande, n’eut pas la moindre peine à se décider à l’accompagner.
Elles rentrèrent ensemble au château. L’intendant était enfermé avec monsieur le baron. Il était allé lui raconter comment il avait été obligé de sévir contre un des ouvriers de la forêt dont la conduite était mauvaise et les paroles insolentes.
Euphrasie, accompagnée de la petite, frappe à la porte, entre et va sauter au cou de son père.
— Quelle est cette enfant, dit le baron en apercevant la mignonne paysanne?
— C’est une charmante fille qui vient demander pardon pour son père.
— Quel est votre père, ma petite? reprit le baron.
— Mon père s’appelle Nicolot, répond timidement l’enfant, il est bûcheron dans la forêt.
— Est-ce celui dont vous venez de vous plaindre, monsieur l’intendant? dit en fronçant le sourcil le baron.
— Lui-même, monsieur.
Le baron s’adressant alors à la jeune fille:
— Ma chère enfant, votre père oublie ses devoirs; il oublie surtout le respect qu’il doit à ceux qui lui donnent du travail et le font vivre. Est-ce lui qui vous a chargée de venir ici?
— Oui, monsieur; il m’a dit de vous dire qu’il ne le ferait plus et qu’il serait plein de respect pour monsieur l’intendant.
— Votre père possède-t-il quelque chose, quelque maison, quelque champ?
— Il n’a rien, monsieur le baron, il ne possède absolument rien.
— Il n’avait donc que son métier de bûcheron pour vous faire vivre?
— Que lui!
— Et il s’exposait à le perdre et à enlever à ses enfants tout moyen d’existence. Ma chère petite, quels que soient les torts d’un père, ses enfants doivent l’aimer et le respecter. C’est parce que vous aimez bien le vôtre que nous allons lui accorder sa grâce. Il faut cependant avant tout que monsieur l’intendant y consente, car c’est lui qu’il a offensé.
— Si c’est votre désir, monsieur le baron, j’y consens bien volontiers, dit l’intendant.
—Allez donc, mon enfant, annoncez à votre père qu’il peut aller reprendre son travail dans la forêt; mais n’oubliez pas de lui dire qu’il cesse de nous mécontenter.
— Merci, messieurs, et la gentille paysanne fit une grande révérence en se retirant.
Euphrasie, contente, la conduisit jusqu’à la porte du château, et promit d’aller la voir dans la forêt.
En effet, quelques jours après elle s’y rendit. La petite, qui ne quittait point son père de peur qu’il n’eût envie d’abandonner son travail, était auprès de lui. Elle avait un grand sarrau blanc et ramassait des menues branches d’arbres pour en faire des fagots. Aussitôt qu’elle aperçut Euphrasie, elle courut au-devant d’elle et lui présenta ses respects.
A la reconnaissance que sa fille témoignait à la demoiselle, le bûcheron reconnut celle qui avait intercédé pour lui auprès de l’intendant. Quittant son large chapeau de feutre, il s’avance respectueusement la tête découverte.
— Je vous remercie, mademoiselle, dit-il, d’avoir eu la bonté de conduire ma fille auprès de monsieur votre père. Il m’a pardonné ; toute ma vie je vous serai reconnaissant.
En effet, la conduite du bûcheron fut dans la suite irréprochable. Pourtant, s’il n’avait pas eu une petite fille intelligente et courageuse, qui avait compris qu’il fallait aller demander sa grâce quand il avait manqué à ses devoirs, il aurait pu persévérer dans le mal et être très-malheureux. Ce qui prouve que les enfants, en bien des circonstances, peuvent faire le bonheur de leurs parents.