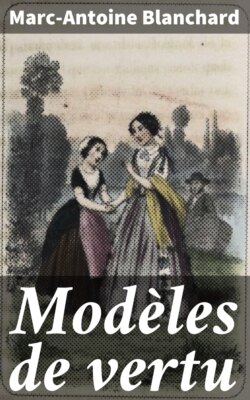Читать книгу Modèles de vertu - Marc-Antoine Blanchard - Страница 7
LA TEMPÊTE A LA COTE.
ОглавлениеDans la Basse-Normandie, sur le bord de la mer, est un village d’une cinquantaine de feux, habité en grande partie par des pêcheurs et des marins. Je dis en grande partie, parce que sur le flanc de la colline, qui est en arrière du village, s’élèvent quelques maisons d’assez belle apparence, appartenant soit à des bourgeois, soit à des agriculteurs.
Parmi ces maisons, il y en avait une habitée par un ancien négociant appelé Derville. Madame Derville, jeune et jolie femme, est assise dans un large fauteuil près du perron de sa demeure et regarde de temps en temps vers la porte du jardin. Ses traits annoncent l’anxiété et l’inquiétude. Elle reste ainsi près d’une demi-heure toujours triste, toujours tourmentée; puis enfin, ne pouvant résister à l’agitation qui la gagne, elle appelle sa servante.
Une jeune fille ayant le costume des paysannes, accourt à sa voix.
— Avez-vous vu Gustave ce matin, lui dit madame Derville?
— Monsieur Gustave s’est levé de bonne heure, répond la fille, et sitôt qu’il a été levé, il s’est mis au travail avec ses livres; puis il est parti dans les champs et s’est dirigé du côté de la mer.
— Il ne revient pas, reprit la mère. Pourtant, c’est l’heure à laquelle il a coutume de rentrer.
En cet instant, la petite porte du jardin s’ouvrit et Gustave parut.
Gustave avait quatorze ans, sa constitution était frêle, ses traits étaient beaux, réguliers, mais très-pâles. Ses yeux doux et brillants étaient remplis d’une expression de rêverie distraite; sa physionomie était mélancolique, sa mise négligée.
Dès qu’il aperçut sa mère, il alla droit à elle, l’embrassa avec une grande tendresse et s’assit sur un banc de bois auprès d’elle.
— Tu es fatigué, Gustave, lui dit la dame? Pourquoi sortir ainsi, si tes promenades te lassent? Pourquoi passer des heures entières dans les champs?
— Il faisait si beau, maman, au lever de l’aurore, que je n’ai pu m’empêcher d’aller dans la prairie. Des milliers de pâquerettes parsèment le bord des chemins. Les arbres commencent à se couvrir de leur vert feuillage, le calice des fleurs s’ouvre aux doux rayons du soleil, les oiseaux font retentir l’air de leurs chants joyeux, l’industrieuse abeille butine de fleur en fleur; le cœur semble renaître, quand on voit toutes ces merveilles, et l’on se sent sous un charme divin.
Des qu’il aperçut sa mère, il alla droit a elle &&.a p.
— Les œuvres du Très-Haut, je le sais, sont admirables; mais pourquoi ne les considères-tu pas ici, près de notre demeure? Tu vas aussi au bord de la mer t’asseoir sur les rochers et passer des heures entières à regarder les flots.
— Oh! maman, c’est si beau la mer! C’est si beau l’Océan immense, l’horizon sans fin! Ah! quand je vois un navire fendre majestueusement les ondes avec toutes ses voiles déployées, quand je le vois disparaître à perte de vue, j’envie le sort de ceux qui sont à son bord et qui vont explorer de lointains rivages. Je voudrais comme eux visiter les différents peuples du monde; aller là où le soleil se lève, là où il se couche; je voudrais être marin.
— Mon cher Gustave, tu as toujours ton idée; cette idée riante pour toi et si pénible pour ta mère. Quand tu es absent un seul jour, je suis inquiète, tourmentée; crois-tu donc que je pourrais vivre si je te savais exposé aux périls constants de la mer?
— Ces dangers de la mer fortifient le corps et donnent de l’énergie à l’âme, reprend Gustave. Quand je passe seulement quelques heures sur la rive, il me semble que l’air qui vient de l’Océan immense rafraîchit ma poitrine, il me semble que si j’étais marin je serais mieux portant et plus fort. N’est-il donc pas des mères qui voient partir leurs enfants sans douleur, avec courage?
— Gustave, je ne blâme pas ces mères; mais je n’ai pas leur force de caractère. Pour désirer ainsi me quitter, tu ne crains donc pas, toi, que je t’accuse de n’avoir aucune affection pour moi?
— Ne pas t’aimer, petite mère! Oh! si, je t’aime! Et l’enfant se mit à l’embrasser de nouveau.
Et la mère et l’enfant rentrèrent à la maison; et la mère demeurait attristée parce que son enfant voulait la quitter et se faire marin.
Gustave se mit au travail et demeura tranquille tout le jour; mais vers le soir, il descend au jardin, passe derrière des touffes d’arbustes, s’arrête à chaque instant, écoutant si nul bruit ne se fait entendre et si sa mère ne l’appelle pas. Puis, n’entendant rien, gagne la petite porte, l’ouvre, et prenant un sentier qui longe le mur, descend dans la direction de la mer.
Suivant l’impulsion de son cœur et de sa nature, il s’abandonnait en marchant à des rêveries vagues. Ses pensées ressemblaient à celles qui nous agitent pendant un léger songe, se succédant dans son esprit presque à son insu, disparaissant ensuite comme la fumée qui se perd dans les cieux et ne laisse aucune trace après elle. Marchant toujours, il se trouva près de la chaumière d’un pêcheur. Enfoncé dans ses réflexions, il allait dépasser cette chaumière, quand arrivé devant la porte, il entendit le son d’une voix qui paraissait prier avec douleur. Craignant de troubler une âme pieuse, qui sans doute épanchait ses chagrins dans le sein de Dieu, il s’arrêta. Il reconnut bientôt que cette voix était celle d’un vieillard. Ce vieillard était assis près du seuil de sa chaumière, regardant tristement l’horizon où s’amoncelaient des nuages rouges et noirs. Ce que Gustave avait pris pour une prière était des gémissements qui s’échappaient de temps en temps de son cœur oppressé. Il paraissait accablé d’une affliction que ses cheveux blancs et ses vêtements pauvres rendaient encore plus touchante.
Gustave s’arrêta immobile, subjugué par l’aspect de cette douleur muette.
Il n’y a pas sur la terre de spectacle plus attendrissant que celui d’un homme de cœur qui a lutté avec courage contre le sort et qui, succombant sous le poids de son infortune et de son impuissance, se met à pleurer. Quand on voit les yeux austères d’un vieillard se mouiller de larmes, on sent la fragilité des choses de ce monde et on plaint la triste humanité.
— Voilà l’orage qui se prépare, disait-il, et mon pauvre enfant est sur la mer. Il voit ces nuages où va s’allumer la foudre, et il pense à sa chaumière, il pense peut-être à moi! J’ai pris un soin infini de son enfance; j’ai tout fait pour lui conserver la vie, et le voilà sur mer chaque jour menacé de la mort. Un enfant ne sait pas quelles inquiétudes, quels tourments il cause à ses père et mère! Mon cher fils! où est le temps où, innocent enfant, tu jouais sur mes genoux, et où je te faisais admirer le soleil resplendissant qui n’est que l’ombre de la gloire de l’Éternel. Où est le temps où je t’exerçais à lever des fardeaux, à raccommoder mes filets, à conduire ma barque. Voulant t’épargner les périls de la vie de marin, je te destinais à une autre existence. Tu avais la santé, un cœur pur, une âme honnête, des bras vigoureux; ces biens t’auraient suffi comme ils ont suffi à ton père. Aurais-je cru alors que tu m’aurais abandonné quand j’étais dans le besoin, lorsque les ans et les infirmités me rendaient ta présence nécessaire, et que tu aurais pu me payer des soins que j’ai donnés à ton enfance. Pourquoi, quand on est ensemble, rompre soi-même les liens qui nous tiennent étroitement unis? Si c’est la volonté de Dieu, que cette volonté s’accomplisse! Il veut que chaque homme sur cette terre ait ses tribulations.
— Bon vieillard, lui dit-il, qui peut chagriner votre âme? pourquoi pleurez-vous ainsi!
Le vieillard releva la tête et parut s’éveiller d’un songe pénible. Longtemps ses regards se reposèrent sur le jeune homme, comme cherchant à reconnaître qui il était.
Tout-à-coup, du revers de sa forte main il essuya les pleurs qui coulaient sur son visage.
— Je ne murmure point, dit-il, de la mesure des maux qui m’a été départie; je n’ai guère connu toute ma vie que les chagrins. Mes jours de bonheur furent courts. La fleur de ma jeunesse a été flétrie comme ia fleur exposée à un soleil trop ardent, et le poids de mon âge s’est doublé du poids de mes peines. Si mon cœur est aujourd’hui déchiré, c’est que j’avais un fils et que je ne l’ai plus. Je l’avais élevé au sein de la pauvreté, mais on s’aime tout de même quand on est pauvre, et la faveur du ciel était avec nous. Il grandit laborieux, sage, plein de courage. J’étais heureux dans l’avenir et j’étais fier de mon enfant. Aujourd’ hui je n’ai plus ni orgueil ni espérance, mon fils est à bord d’un bâtiment qui parcourt les mers. Il s’est fait marin, il a voulu partir, il m’a quitté ! N’est-ce pas que c’est mal à un enfant de quitter ainsi son père? Voyez-vous ces nuages sombres qui montent, s’amoncellent et se rangent dans les cieux comme des armées en bataille. C’est la tempête qui s’annonce, une tempête terrible. Bientôt le tonnerre grondera, les flots se soulèveront et le bâtiment qui porte mon enfant sera secoué comme une coquille de noix sur les vagues mugissantes. Oh! si je le savais englouti au fond des ondes amères sans espérance de le revoir jamais! Cette pensée est horrible?
— Cette pensée est désolante, bon vieillard, ne l’entretenez pas dans votre âme; prenez plutôt courage. Il n’est pas bon de s’abandonner ainsi au désespoir.
Gustave n’avait pas fini de prononcer ces paroles, qu’il vit des gens effarés qui couraient au rivage. Un bâtiment venait d’être signalé. Parti il y avait deux mois, il revenait au port et faisait les plus grands efforts pour arriver et se mettre à l’abri avant l’orage; mais le vent était si contraire, qu’if ne pouvait aborder. Bientôt on le vit larguer ses voiles et jeter ses ancres. Ce bâtiment était celui sur lequel était embarqué le fils du vieillard.
Il appartenait à un armateur de Granville, et l’équipage était en partie composé de marins du village, où ils avaient leurs pères, leurs femmes, leurs enfants, toute leur famille; de sorte que tant par affection que par intérêt, on éprouvait pour ce navire une inquiétude plus qu’ordinaire.
En moins d’une heure, la mer devint si houleuse, qu’aucune barque n’osait se lancer au large sans craindre qu’il ne lui arrivât malheur.
Le premier éclair qui sillonna les nues fut comme le signal de la lutte des éléments. Les nuages étaient noirs, sombres, bas; les vagues étaient larges, lourdes, pesantes. L’ouragan se déclara terrible. On eût dit que le Dieu des tempêtes voulait bouleverser l’atmosphère et montrer sa puissance en remplissant le rivage de terreur.
La pluie tombait par torrents, les flots mugissants faisaient un bruit épouvantable; le tonnerre retentissait avec fracas dans les cieux. Les infortunés habitants, l’effroi dans le cœur, le visage pâle, allaient, venaient, s’interrogeaient et montaient sur les hauteurs pour regarder le pauvre navire secoué en tous sens au milieu de ce bouleversement.
C’était un spectacle navrant que de voir les femmes des matelots, relevant leurs jupons sur leurs têtes, pour se garantir de la pluie, courir avec leurs enfants pleurant et désolés.
On ne pouvait s’empêcher de se sentir le cœur déchiré et d’être dans la consternation la plus grande, en voyant dans un si terrible péril tant de braves gens que nulle puissance humaine ne pouvait secourir.
Cependant le ciel continuait à être obscurci, le vent à gronder, la pluie à battre avec violence.
Sur le flanc de la colline était une chaîne de rochers qui s’élevaient à pic et dominaient la mer. Dans ces rochers étaient creusées des habitations de pêcheurs. Devant ces habitations était un rassemblement de femmes et d’enfants. Les familles des malheureux marins en formaient la plus grande partie, et à chaque nouvelle violence du vent, les mères tiraient leurs enfants à elles comme si elles eussent vu la main d’un ennemi prête à les frapper.
Trois ou quatre jeunes filles retirées un peu à l’écart formaient un groupe séparé. Elles étaient tristement prosternées, leur cou de cygne allongé du côté de la mer. Elles semblaient des anges descendus du ciel pour implorer le Dieu de la tempête en faveur des pauvres mortels.
Derrière elles était le vieillard qui avait prié Gustave de l’aider à se traîner sur la côte, et qui, à genoux, les mains appuyées sur un bâton, était plongé dans une douleur morne. Gustave, la tête nue, les cheveux en désordre, droit et immobile comme une statue de marbre, était debout à côté du vieillard.
Trois petits enfants, dont l’aîné n’avait pas huit ans, se tenant par la main, suivaient le sentier qui passait devant les cabanes.
— Où allez-vous, mes pauvres petits, leur dit Gustave? Pourquoi n’êtes-vous pas avec votre mère?
— Nous n’avons pas de mère, répond l’aîné. Notre père est matelot sur le navire signalé, et nous venons voir si papa va descendre à la côte; nous voudrions l’embrasser.
Et se rapprochant les uns des autres pour se garantir des rafales du vent, ils restèrent à côté de Gustave.
Quand la nuit fut tout-à-fait venue, les uns retournèrent chez eux, les autres restèrent sur le rivage. Presque toutes les femmes passèrent cette nuit en proie à l’agonie du désespoir. Des feux étaient allumés sur la côte. Autour de ces feux gisaient une foule de malheureux en pleurs.
Dès que l’aurore commença à poindre, le vent diminua de violence et passa vers le Nord. Tous les yeux se dirigeaient vers la mer et cherchaient à percer l’obscurité qui régnait encore.
Hélas! le bâtiment n’était plus sur les flots. Il était échoué sur un rocher à peu. de distance de la côte, sans mâts, sans cordages, à demi-brisé, et les vagues furieuses qui le frappaient successivement semblaient empressées d’achever sa destruction.
Des chaloupes et des barques furent mises à la mer. On recueillit ceux qui avaient échappé au naufrage et qui s’étaient accrochés soit aux débris du navire, soit aux aspérités du roc. Tous avaient cruellement souffert, et c’était un spectacle lamentable que de voir les femmes, les enfants se jeter dans les bras les uns des autres tous en pleurs.
Cependant les parents de Gustave avaient été dans une inquiétude mortelle en ne le voyant pas rentrer la veille. La tempête, en s’étendant sur la côte, avait brisé les toits, déraciné les arbres, ils craignaient que leur enfant, surpris par l’orage sur quelque rocher n’eût été soit jeté à la mer, soit perdu et sans force dans quelque antre désert.
Ils avaient erré dans les solitudes où il avait coutume de se rendre; mais ils ne l’avaient point rencontré. Sitôt l’aurore, ils se mirent de nouveau à sa recherche et se dirigèrent vers la plage où le bâtiment avait échoué. La foule commençait à se mettre en marche, et ils l’aperçurent soutenant un jeune marin qui marchait avec peine, accompagné d’un vieillard.
Ils se précipitèrent à sa rencontre. Sa mère n’avait point la force de lui parler.
— C’est toi, lui dit son père! Mon cher fils, tu nous as fait passer une nuit terrible. Ta mère et moi avons bien souffert.
— Je vous demande pardon, mon père et ma mère; je vous en prie, pardonnez-moi. J’ai rencontré ce bon vieillard qui avait son jeune fils sur le bâtiment qui a fait naufrage. Sa douleur était si grande, il aimait tant ce iils, que je n’ai pu résister au désir de lui venir en aide. J’ai passé la nuit avec le vieillard, et je ramène son fils!... Aurais-je pu rester à la maison en sécurité et tranquille quand tant de braves gens couraient le risque de perdre la vie!
Le vieillard aux cheveux blancs se tenait la tête découverte, et ses yeux humides de larmes exprimaient la reconnaissance et semblaient implorer l’indulgence du père.
— Mon cher enfant, reprend le monsieur, je n’ai pas le courage de te blâmer devant ce vieillard et en songeant au désastre qui afflige tout le village. Dans ces circonstances fâcheuses, tu as fait ce que tu as pu pour te rendre utile. Les enfants méritent moins de reproches quand, pour s’excuser, ils mettent en avant une bonne action.
La mère s’approcha alors, sa figure était inondée de larmes.
— Gustave, lui dit-elle, as-tu encore envie de fuir la maison paternelle et d’être marin?
— Non, ma mère, j’y renonce, non par crainte ou par faiblesse, mais par dévouement et par amour. Je ne vous quitterai jamais sans votre volonté.
— Et moi, dit le jeune marin, je promets aussi de rester auprès de mon père, de l’aider, de le secourir dans sa vieillesse, de me dévouer comme un bon fils doit être dévoué à son père. Mon Dieu! que serait-il devenu si vous ne m’aviez pas conservé la vie et sauvé des flots?