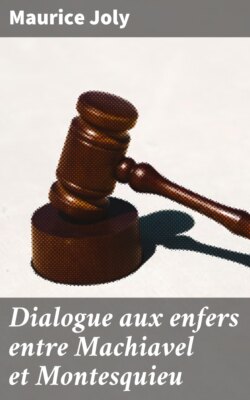Читать книгу Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu - Maurice Joly - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PREMIER DIALOGUE.
ОглавлениеTable des matières
MACHIAVEL.
Sur les bords de cette plage déserte, on m'a dit que je rencontrerais l'ombre du grand Montesquieu. Est-ce elle-même qui est devant moi?
MONTESQUIEU.
Le nom de Grand n'appartient ici à personne, ô Machiavel! Mais je suis celui que vous cherchez.
MACHIAVEL.
Parmi les personnages illustres dont les ombres peuplent le séjour des ténèbres, il n'en est point que j'aie plus souhaité de rencontrer que Montesquieu. Refoulé dans ces espaces inconnus par la migration des âmes, je rends grâces au hasard qui me met enfin en présence de l'auteur de l'Esprit des lois.
MONTESQUIEU.
L'ancien secrétaire d'État de la République florentine n'a point encore oublié le langage des cours. Mais que peuvent avoir à échanger ceux qui ont franchi ces sombres rivages, si ce n'est des angoisses et des regrets?
MACHIAVEL.
Est-ce le philosophe, est-ce l'homme d'État qui parle ainsi? Qu'importe la mort pour ceux qui ont vécu par la pensée, puisque la pensée ne meurt pas? Je ne connais pas, quant à moi, de condition plus tolérable que celle qui nous est faite ici jusqu'au jour du jugement dernier. Être délivré des soins et des soucis de la vie matérielle, vivre dans le domaine de la raison pure, pouvoir s'entretenir avec les grands hommes qui ont rempli l'univers du bruit de leur nom; suivre de loin les révolutions des États, la chute et la transformation des empires, méditer sur leurs constitutions nouvelles, sur les changements apportés dans les moeurs et dans les idées des peuples de l'Europe, sur les progrès de leur civilisation, dans la politique, dans les arts, dans l'industrie, comme dans la sphère des idées philosophiques, quel théâtre pour la pensée! Que de sujets d'étonnement! que de points de vue nouveaux! Que de révélations inouïes! Que de merveilles, s'il faut en croire les ombres qui descendent ici! La mort est pour nous comme une retraite profonde où nous achevons de recueillir les leçons de l'histoire et les titres de l'humanité. Le néant lui-même n'a pu briser tous les liens qui nous rattachent à la terre, car la postérité s'entretient encore de ceux qui, comme vous, ont imprimé de grands mouvements à l'esprit humain. Vos principes politiques règnent, à l'heure qu'il est, sur près de la moitié de l'Europe; et si quelqu'un peut être affranchi de la crainte en effectuant le sombre passage qui conduit à l'enfer ou au ciel, qui le peut mieux que celui qui se présente avec des titres de gloire si purs devant la justice éternelle?
MONTESQUIEU.
Vous ne parlez point de vous, Machiavel; c'est trop de modestie, quand on laisse après soi l'immense renommée de l'auteur du Traité du Prince.
MACHIAVEL.
Je crois comprendre l'ironie qui se cache sous vos paroles. Le grand publiciste français me jugerait-il donc comme la foule qui ne connaît de moi que mon nom et un aveugle préjugé? Ce livre m'a fait une renommée fatale, je le sais: il m'a rendu responsable de toutes les tyrannies; il m'a attiré la malédiction des peuples qui ont personnifié en moi leur haine pour le despotisme; il a empoisonné mes derniers jours, et la réprobation de la postérité semble m'avoir suivi jusqu'ici. Qu'ai-je fait pourtant? Pendant quinze ans j'ai servi ma patrie qui était une République; j'ai conspiré pour son indépendance, et je l'ai défendue sans relâche contre Louis XII, contre les Espagnols, contre Jules II, contre Borgia lui-même qui, sans moi, l'eût étouffée. Je l'ai protégée contre les intrigues sanglantes qui se croisaient dans tous les sens autour d'elle, combattant par la diplomatie comme un autre eût combattu par l'épée; traitant, négociant, nouant ou rompant les fils suivant les intérêts de la République, qui se trouvait alors écrasée entre les grandes puissances, et que la guerre ballottait comme un esquif. Et ce n'était pas un gouvernement oppresseur ou autocratique que nous soutenions à Florence; c'étaient des institutions populaires. Étais-je de ceux que l'on a vus changer avec la fortune? Les bourreaux des Médicis ont su me trouver après la chute de Soderini. Élevé avec la liberté, j'ai succombé avec elle; j'ai vécu dans la proscription sans que le regard d'un prince daignât se tourner vers moi. Je suis mort pauvre et oublié. Voilà ma vie, et voilà les crimes qui m'ont valu l'ingratitude de ma patrie, la haine de la postérité. Le ciel, peut-être, sera plus juste envers moi.
MONTESQUIEU.
Je savais tout cela, Machiavel, et c'est pour cette raison que je n'ai jamais pu comprendre comment le patriote florentin, comment le serviteur d'une République s'était fait le fondateur de cette sombre école qui vous a donné pour disciples toutes les têtes couronnées, mais qui est propre à justifier les plus grands forfaits de la tyrannie.
MACHIAVEL.
Et si je vous disais que ce livre n'a été qu'une fantaisie de diplomate; qu'il n'était point destiné à l'impression; qu'il a reçu une publicité à laquelle l'auteur est resté étranger; qu'il a été conçu sous l'influence d'idées qui étaient alors communes à toutes les principautés italiennes avides de s'agrandir aux dépens l'une de l'autre, et dirigées par une politique astucieuse dans laquelle le plus perfide était réputé le plus habile ...
MONTESQUIEU.
Est-ce vraiment là votre pensée? Puisque vous me parlez avec cette franchise, je puis vous avouer que c'était la mienne, et que je partageais à cet égard l'opinion de plusieurs de ceux qui connaissaient votre vie et avaient lu attentivement vos ouvrages. Oui, oui, Machiavel, et cet aveu vous honore, vous n'avez pas dit alors ce que vous pensiez, ou vous ne l'avez dit que sous l'empire de sentiments personnels qui ont troublé pour un moment votre haute raison.
MACHIAVEL.
C'est ce qui vous trompe, Montesquieu, à l'exemple de ceux qui en ont jugé comme vous. Mon seul crime a été de dire la vérité aux peuples comme aux rois; non pas la vérité morale, mais la vérité politique; non pas la vérité telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est, telle qu'elle sera toujours. Ce n'est pas moi qui suis le fondateur de la doctrine dont on m'attribue la paternité; c'est le coeur humain. Le Machiavélisme est antérieur à Machiavel.
Moïse, Sésostris, Salomon, Lysandre, Philippe et Alexandre de Macédoine, Agathocle, Romulus, Tarquin, Jules César, Auguste et même Néron, Charlemagne, Théodoric, Clovis, Hugues Capet, Louis XI, Gonzalve de Cordoue, César Borgia, voilà les ancêtres de mes doctrines. J'en passe, et des meilleurs, sans parler, bien entendu, de ceux qui sont venus après moi, dont la liste serait longue, et auxquels le Traité du Prince n'a rien appris que ce qu'ils savaient déjà, par la pratique du pouvoir. Qui m'a rendu dans votre temps un plus éclatant hommage que Frédéric II? Il me réfutait la plume à la main dans l'intérêt de sa popularité et en politique il appliquait rigoureusement mes doctrines.
Par quel inexplicable travers de l'esprit humain m'a-t-on fait un grief de ce que j'ai écrit dans cet ouvrage? Autant vaudrait reprocher au savant de rechercher les causes physiques qui amènent la chute des corps qui nous blessent en tombant; au médecin de décrire les maladies, au chimiste de faire l'histoire des poisons, au moraliste de peindre les vices, à l'historien d'écrire l'histoire.
MONTESQUIEU.
Oh! Machiavel, que Socrate n'est-il ici pour démêler le sophisme qui se cache dans vos paroles! Si peu apte que la nature m'ait fait à la discussion, il ne m'est guère difficile de vous répondre: vous comparez au poison et à la maladie les maux engendrés par l'esprit de domination, d'astuce et de violence; et ce sont ces maladies que vos écrits enseignent le moyen de communiquer aux États, ce sont ces poisons que vous apprenez à distiller. Quand le savant, quand le médecin, quand le moraliste, recherchent le mal, ce n'est pas pour enseigner à le propager; c'est pour le guérir. Or, c'est ce que votre livre ne fait pas; mais peu m'importe, et je n'en suis pas moins désarmé. Du moment où vous n'érigez pas le despotisme en principe, du moment où vous le considérez vous-même comme un mal, il me semble que par cela seul vous le condamnez, et sur ce point tout au moins nous pouvons être d'accord.
MACHIAVEL.
Nous ne le sommes point, Montesquieu, car vous n'avez pas compris toute ma pensée; je vous ai prêté le flanc par une comparaison dont il était trop facile de triompher. L'ironie de Socrate, elle-même, ne m'inquiéterait pas, car ce n'était qu'un sophiste qui se servait, plus habilement que les autres, d'un instrument faux, la logomachie. Ce n'est pas votre école et ce n'est pas la mienne: laissons donc les mots et les comparaisons pour nous en tenir aux idées. Voici comment je formule mon système, et je doute que vous l'ébranliez, car il ne se compose que de déductions de faits moraux et politiques d'une vérité éternelle: L'instinct mauvais chez l'homme est plus puissant que le bon. L'homme a plus d'entraînement vers le mal que vers le bien; la crainte et la force ont sur lui plus d'empire que la raison. Je ne m'arrête point à démontrer de telles vérités; il n'y a eu chez vous que la coterie écervelée du baron d'Holbach, dont J.-J. Rousseau fut le grand-prêtre et Diderot l'apôtre, pour avoir pu les contredire. Les hommes aspirent tous à la domination, et il n'en est point qui ne fût oppresseur, s'il le pouvait; tous ou presque tous sont prêts à sacrifier les droits d'autrui à leurs intérêts.
Qui contient entre eux ces animaux dévorants qu'on appelle les hommes? A l'origine des sociétés, c'est la force brutale et sans frein; plus tard, c'est la loi, c'est-à-dire encore la force, réglée par des formes. Vous avez consulté toutes les sources de l'histoire; partout la force apparaît avant le droit.
La liberté politique n'est qu'une idée relative; la nécessité de vivre est ce qui domine les États comme les individus.
Sous certaines latitudes de l'Europe, il y a des peuples incapables de modération dans l'exercice de la liberté. Si la liberté s'y prolonge, elle se transforme en licence; la guerre civile ou sociale arrive, et l'État est perdu, soit qu'il se fractionne et se démembre par l'effet de ses propres convulsions, soit que ses divisions le rendent la proie de l'étranger. Dans des conditions pareilles, les peuples préfèrent le despotisme à l'anarchie; ont-ils tort?
Les États une fois constitués ont deux sortes d'ennemis: les ennemis du dedans et les ennemis du dehors. Quelles armes emploieront-ils en guerre contre les étrangers? Les deux généraux ennemis se communiqueront-ils réciproquement leurs plans de campagne pour se mettre mutuellement en état de se défendre? S'interdiront-ils les attaques nocturnes, les pièges, les embuscades, les batailles en nombre de troupes inégal? Non, sans doute, n'est-ce pas? et de pareils combattants apprêteraient à rire. Et ces pièges, ces artifices, toute cette stratégie indispensable à la guerre, vous ne voulez pas qu'on l'emploie contre les ennemis du dedans, contre les factieux? Sans doute, on y mettra moins de rigueur; mais, au fond, les règles seront les mêmes. Est-il possible de conduire par la raison pure des masses violentes qui ne se meuvent que par des sentiments, des passions et des préjugés?
Que la direction des affaires soit confiée à un autocrate, à une oligarchie ou au peuple lui-même, aucune guerre, aucune négociation, aucune réforme intérieure, ne pourra réussir, sans le secours de ces combinaisons que vous paraissez réprouver, mais que vous auriez été obligé d'employer vous-même si le roi de France vous eût chargé de la moindre affaire d'État.
Réprobation puérile que celle qui a frappé le Traité du Prince! Est-ce que la politique a rien à démêler avec la morale? Avez-vous jamais vu un seul État se conduire d'après les principes qui régissent la morale privée? Mais toute guerre serait un crime, même quand elle aurait une cause juste; toute conquête n'ayant d'autre mobile que la gloire, serait un forfait; tout traité dans lequel une puissance aurait fait pencher la balance de son côté, serait une indigne tromperie; toute usurpation du pouvoir souverain serait un acte qui mériterait la mort. Rien ne serait légitime que ce qui serait fondé sur le droit! mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le maintiens, même en présence de l'histoire contemporaine: tous les pouvoirs souverains ont eu la force pour origine, ou, ce qui est la même chose, la négation du droit. Est-ce à dire que je le proscris? Non; mais je le regarde comme d'une application extrêmement limitée, tant dans les rapports des nations entre elles que dans les rapports des gouvernants avec les gouvernés.
Ce mot de droit lui-même, d'ailleurs, ne voyez-vous pas qu'il est d'un vague infini? Où commence-t-il, où finit-il? Quand le droit existera-t-il, et quand n'existera-t-il pas? Je prends des exemples. Voici un État: la mauvaise organisation des pouvoirs publics, la turbulence de la démocratie, l'impuissance des lois contre les factieux, le désordre qui règne partout, vont le précipiter dans la ruine. Un homme hardi s'élance des rangs de l'aristocratie ou du sein du peuple; il brise tous les pouvoirs constitués; il met la main sur les lois, il remanie toutes les institutions, et il donne vingt ans de paix à son pays. Avait-il le droit de faire ce qu'il a fait?
Pisistrate s'empare de la citadelle par un coup de main, et prépare le siècle de Périclès. Brutus viole la Constitution monarchique de Rome, expulse les Tarquins, et fonde à coups de poignard une république dont la grandeur est le plus imposant spectacle qui ait été donné à l'univers. Mais la lutte entre le patriciat et la plèbe, qui, tant qu'elle a été contenue, a fait la vitalité de la République, en amène la dissolution, et tout va périr. César et Auguste apparaissent; ce sont encore des violateurs; mais l'empire romain qui a succédé à la République, grâce à eux, dure autant qu'elle, et ne succombe qu'en couvrant le monde entier de ses débris. Eh bien, le droit était-il avec ces hommes audacieux? Non, selon vous. Et cependant la postérité les a couverts de gloire; en réalité, ils ont servi et sauvé leur pays; ils en ont prolongé l'existence à travers les siècles. Vous voyez bien que dans les États le principe du droit est dominé par celui de l'intérêt, et ce qui se dégage de ces considérations, c'est que le bien peut sortir du mal; qu'on arrive au bien par le mal, comme on guérit par le poison, comme on sauve la vie par le tranchant du fer. Je me suis moins préoccupé de ce qui est bon et moral que de ce qui est utile et nécessaire; j'ai pris les sociétés telles qu'elles sont, et j'ai donné des règles en conséquence.
Abstraitement parlant, la violence et l'astuce sont-elles un mal? Oui; mais il faudra bien les employer pour gouverner les hommes, tant que les hommes ne seront pas des anges.
Tout est bon ou mauvais, suivant l'usage qu'on en fait et le fruit que l'on en tire; la fin justifie les moyens: et maintenant si vous me demandez pourquoi, moi républicain, je donne partout la préférence au gouvernement absolu, je vous dirai que, témoin dans ma patrie de l'inconstance et de la lâcheté de la populace, de son goût inné pour la servitude, de son incapacité à concevoir et à respecter les conditions de la vie libre; c'est à mes yeux une force aveugle qui se dissout tôt ou tard, si elle n'est dans la main d'un seul homme; je réponds que le peuple, livré à lui-même, ne saura que se détruire; qu'il ne saura jamais administrer, ni juger, ni faire la guerre. Je vous dirai que la Grèce n'a brillé que dans les éclipses de la liberté; que sans le despotisme de l'aristocratie romaine, et que, plus tard, sans le despotisme des empereurs, l'éclatante civilisation de l'Europe ne se fût jamais développée.
Chercherai-je mes exemples dans les États modernes? Ils sont si frappants et si nombreux que je prendrai les premiers venus.
Sous quelles institutions et sous quels hommes les républiques italiennes ont-elles brillé? Avec quels souverains l'Espagne, la France, l'Allemagne, ont-elles constitué leur puissance? Sous les Léon X, les Jules II, les Philippe II, les Barberousse, les Louis XIV, les Napoléon, tous hommes à la main terrible, et posée plus souvent sur la garde de leurs épées que sur la charte de leurs États.
Mais je m'étonne d'avoir parlé si longtemps pour convaincre l'illustre écrivain qui m'écoute. Une partie de ces idées n'est-elle pas, si je suis bien informé, dans l'Esprit des lois? Ce discours a-t-il blessé l'homme grave et froid qui a médité, sans passion, sur les problèmes de la politique? Les encyclopédistes n'étaient pas des Catons: l'auteur des Lettres Persanes n'était pas un saint, ni même un dévot bien fervent. Notre école, qu'on dit immorale, était peut-être plus attachée au vrai Dieu que les philosophes du XVIIIe siècle.
MONTESQUIEU.
Vos dernières paroles me trouvent sans colère, Machiavel, et je vous ai écouté avec attention. Voulez-vous m'entendre, et me laisserez-vous en user à votre égard avec la même liberté?
MACHIAVEL.
Je me tiens pour muet, et j'écoute dans un respectueux silence celui que l'on a appelé le législateur des nations.