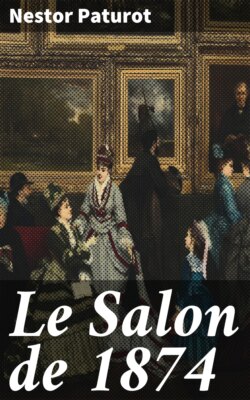Читать книгу Le Salon de 1874 - Nestor Paturot - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VISITE GÉNÉRALE DES VINGT-QUATRE SALONS DE PEINTURE
ОглавлениеLa modestie est un défaut. — Un sixième membre du jury. — Le Septennat complet. — La justice de Brutus. — Considérations sur le jury. — L’entrée du saint des saints. — Réclamations pour les pastels. — Mlle Jacquemart. — Le Rouge et le Noir. — De près et de loin. —Daphnis et Chloé, de Français. — Les trois Bonnat. —Ranvier, Bouguereau, Dupray, de Neuville. — Le temps passé. — Revue à vol d’oiseau. — Manet. — Le temps! la place!
Mon cher directeur,
Eh bien! je crois que vous avez bien fait d’accepter mon offre.
Vous allez dire que je ne suis pas modeste; vous avez peut-être raison, et, de mon côté, je ne crois pas avoir tort; car la modestie, qui peut être parfois une qualité, est plus souvent — je suis arrivé un peu tard à le reconnaître — un défaut!
La modestie sied à la moyenne de l’humanité qui ne s’élève pas au-dessus de la moyenne des qualités que cette humanité comporte.
Mais il ne faut pas que la modestie soit un prétexte pour enrayer les bonnes dispositions de ceux qui ont en eux l’étoffe voulue pour dépasser cette moyenne, et conséquemment pour l’élever.
Et cependant, c’est ce qui arrive malheureusement trop souvent.
Combien de gens pleins de valeur n’osent pas se lancer, parce qu’ils ont le sentiment que cette valeur peut encore être dépassée; et, d’un autre côté, parce qu’ils voient la foule se grouper autour d’hommes au verbe haut, qui étalent avec assurance les plus grandes stupidités, et dont l’effronterie arrache à cette foule des applaudissements.
L’audace de ces préférés de la Fortune tient à ce qu’ils n’ont pas le sentiment de leur infériorité, et à ce qu’ils sont les premiers à admirer les inepties qu’ils débitent avec une superbe assurance.
Audaces fortuna juvat: Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet adage si singulièrement mis le plus souvent en pratique.
Mais me voilà de nouveau emporté par la digression.
Excusez-moi, je reviens de suite à mon sujet.
Ce n’est pas parce que je manque moi-même de modestie que je viens de vous dire que je ne suis pas modeste. Ce serait, en présence de la déclaration de principe que je viens de vous faire, me ranger dans la catégorie de ces bêtas infatués de leur vanité et de leur sottise, dont je viens de vous parler, et vous ne supposez pas que telle soit mon intention.
Ce qui me permet d’afficher mon immodestie, c’est, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire dans ma première lettre, que je ne parle pas au nom d’une simple individualité ; je ne suis pas un; je suis une double trinité, presque une septennité — le chiffre à la mode — et je ne dis pas qu’une addition jugée nécessaire n’autorisera point avant peu cette dernière dénomination.
En réalité, je ne suis, ou nous ne sommes qu’une quinquennité ; vous vous souvenez de mon oncle Emile le savant, de mon cousin Joseph l’amateur de militaires, de batailles, de chevaux, etc., de mon neveu Jules, le fin connaisseur, et de Mme Nestor Paturot, notre Minerve, notre déesse de la raison. Et de cinq bien comptés et bien à compter, auxquels à l’occasion, lorsqu’il se présentera de beaux tas de choux, de beaux spécimens de navets et de carottes ou de merveilleux portraits de melons et de citrouilles, s’adjoindra notre réaliste, dont je vous parlais l’autre jour, Rose, ma grosse cuisinière, l’admiratrice — ce qui prouve qu’elle n’est pas déjà si bête — de M. Vollon et de ses chaudrons si bien réussis. Cinq et un font six; mais comme le terme de sexennité me semble beaucoup moins agréable et en tout cas beaucoup moins de circonstance que celui de septennité, je vous demande la permission de réserver une septième place dans notre association coopérative créée pour vous servir.
D’après tout ce qui précède, vous voyez que si la modestie était dans mon caractère personnel, il ne me serait pas permis de m’en parer, en cette circonstance, sans faire injure à mes collaborateurs.
Donc, pas de modestie! et en avant une juste, saine, intelligente et impartiale critique du Salon de 1874.
Sachez donc, monsieur le directeur, qu’après la réception de votre aimable, — et permettez-moi d’ajouter, de votre intelligente lettre, — j’ai convoqué tous les membres de l’individualité collective chargée par cette lettre de rendre compte du prochain Salon.
Tous ont répondu à mon appel! et après que la présidence de la réunion eût été décernée, à l’unanimité, à l’excellente et judicieuse Mme Paturot, j’ai ouvert la séance par un petit speech qui a fait, je ne vous le cacherai pas, une profonde sensation sur les intelligents collaborateurs que je me suis adjoint.
Je leur ai rappelé l’histoire de Brutus, condamnant, sans sourciller, ses deux fils à mort.
Et je leur ai dit: «Eussé-je un ou plusieurs fils parmi les exposants, je les condamnerais de même, si leur œuvre était indigne!»
Des signes non équivoques et unanimes d’approbation m’ont prouvé que mes collaborateurs étaient à la hauteur de ma grandeur d’âme, et qu’au besoin ils sauraient accomplir le même sacrifice que celui que je me déclarais prêt à faire.
L’impartialité la plus complète doit être, en effet, notre règle suprême; et les plus grands noms, ceux qu’on est habitué à considérer comme au-dessus de toute critique, ne seront pas exempts de notre examen, et à l’abri de nos observations.
A l’unanimité, nous avons été d’avis que le plus grand attrait de notre tâche consistera à découvrir, parmi les nouveaux venus, ceux dont les qualités, fussent-elles encore incomplètes, nous permettront de signaler un des futurs maîtres de l’art. Dieu veuille que la prochaine exposition en soit pavée!
Je pourrais bien, pour entrer dès aujourd’hui en matière, vous parler des sévérités du jury, contre lesquelles les protestations ne manquent pas plus cette année que les années précédentes, malgré les remaniements que le nouveau directeur des Beaux-Arts, M. de Chennevières, a apportés à la réglementation de ce jury.
Tant qu’il y aura un jury, il y aura des mécontents, et des sévérités plus ou moins justifiées.
Les membres du jury ne sont-ils pas des hommes comme tout ce qui possède deux pieds et deux mains et comme les exposants eux-mêmes?
Comment pourraient-ils être à l’abri des erreurs que tout homme ou toute collection d’hommes peut commettre?
Ce qui appartient à l’humanité subit des influences dont quelques-unes ont des causes apparentes, et dont d’autres sont la conséquence de dispositions générales indéfinissables, résultante des diverses espèces de mal’aria morale agissant sur les esprits de la même manière que le choléra agit sur les corps.
Qu’il pleuve à torrents et que les membres du jury, après avoir été trempés et crottés, comme des barbets, pour arriver au palais de l’Exposition, grelottant sous les voûtes froides; ou bien qu’une chaleur tropicale et étouffante les y couvre de sueur et de poussière, il est bien difficile que quelques-uns des tableaux ayant la mauvaise chance de passer sous leurs yeux dans ces conditions détestables, ne se ressentent pas de l’état grincheux dans lequel ces malencontreuses conditions atmosphériques les auront plongés.
Cela doit arriver sous tous les régimes et quelle que soit la composition du jury.
Et puis, il y a une question farouche et inexorable,
La question de place!
Etant donnée une étendue pouvant contenir deux mille tableaux environ, comment le Jury pourrait-il en installer sept mille?
Il y a là une responsabilité préalable engagée; celle du gouvernement, qui doit protection à tous les artistes, et qui ne doit pas se tirer d’affaire en laissant rejeter sur les rigueurs du jury les récriminations qui ont le droit de s’élever jusqu’à lui, gouvernement.
Il est vrai que le jury de l’Exposition des Beaux-Arts aurait, pour se mettre à couvert, le droit de protester contre cette difficulté matérielle où il est d’accomplir sa mission, en ne s’inquiétant que de la valeur réelle des œuvres soumises à son examen, et en n’ayant pas pour seule préoccupation de ne point dépasser dans ses admissions un chiffre véritablement insuffisant.
Ces difficultés ont déjà, paraît-il, éloigné du jury bon nombre de ceux qui comptaient parmi les juges les plus compétents, et parmi ceux qui s’inquiétaient le plus des intérêts de la corporation des artistes.
Ils n’ont pas voulu assumer plus longtemps la responsabilité d’un tel état de choses, et se trouver, malgré leur entière bonne volonté et leur ardent désir d’être utiles à leurs confrères, exposés à des accusations tout à fait imméritées.
Aussi en a-t-on vu un certain nombre qui ont demandé à ce que leur nom fût effacé de la liste des candidats du jury.
Je me suis laissé dire que cette dislocation des anciens éléments dont se formait le jury a été et est pour quelque chose dans le mal dont se plaignait, avec trop de raison à mon avis, la meilleure partie des refusés.
Jadis, il y avait une tradition qui se transmettait de jury en jury; il y avait une espèce de règle qui présidait à ses décisions.
Autrefois, l’Institut figurait pour une part dans ce jury. Sans regretter ce temps, il est permis de regretter la règle de conduite qui présidait aux travaux que cette portion immuable du jury lui transmettait.
Si ceux-là pouvaient être accusés de représenter l’école du passé, ou, comme on le disait, l’école vieillotte, l’opposition qui se formait contre eux avait pour effet de protéger et même de mettre en avant l’école la plus jeune, la plus ardente, la plus aventureuse.
Dans ce temps-là on n’aurait pas refusé, comme on le fait aujourd’hui, M. Manet, et les peintres de l’école réaliste.
Les réalistes auraient trouvé, au sein du jury, d’ardents défenseurs, nous ne saurions le révoquer en doute; et ils en auraient trouvé en assez grand nombre pour que le public, qui, après tout, est le grand jury, fût appelé à se prononcer.
Aujourd’hui, il y a une telle variété d’écoles, une telle concurrence, tant d’origines diverses que les jeunes peintres, ceux auxquels l’avenir appartient sont mis en suspicion, exposés à une foule de hasards et d’impressions variables qui n’existaient pas, quand, à côté des membres de l’Institut, défenseurs de certains principes, se trouvait une opposition — toujours nécessaire, car sans elle rien n’avance, — qui prenait chaleureusement la défense de tout ce que les représentants des anciennes écoles se montraient trop enclins à proscrire et à condamner.
Il y a quelque temps, le choix du jury se faisait par le suffrage universel, c’est-à-dire par tous les artistes exposants.
Cette année, le suffrage universel est remplacé par le suffrage des privilégiés.
Il est vrai que ces privilégiés sont ceux qui ont obtenu leurs priviléges sur le champ de bataille, et qui, après avoir conquis, dans les expositions précédentes, le droit de ne plus eux-mêmes être soumis à l’examen du jury, viennent de voir ce droit transformé en celui de fournir exclusivement les membres du jury actuel.
Cela peut paraître extraordinaire, lorsqu’on se souvient que le marquis de Chennevières, le directeur actuel des Beaux-Arts, a fait ses premières armes sous l’empire, au beau temps du suffrage universel.
Mais on dit que M. de Chennevières a des idées plus libérales encore que celles-là, et qu’il voudrait des expositions entièrement libres, à la condition d’avoir à côté de ces expositions où l’ivraie croîtrait près du bon grain, des expositions où le bon grain seul serait admis.
S’il en est ainsi, il n’y aurait pas de chicane à faire à M. de Chennevières, pour un régime qui n’est que transitoire et qui n’est qu’un purgatoire momentané par lequel les artistes doivent passer avant d’arriver au Paradis que M. de Chennevières leur prépare.
Mais le temps presse. Nous sommes arrivés au 30 avril; c’est demain, 1er mai, que l’Exposition doit ouvrir, et il faut, à tout prix, dussé-je me transformer en mouche, que je pénètre dans le temple sacré, afin de donner aux premiers visiteurs un aperçu d’ensemble et de leur fournir un guide pour leur première pérégrination.
Je suis arrivé à mes fins, et, grâce à ma bonne mine, j’ai pu passer sans exciter la colère des nombreux cerbères qui défendent aux profanes l’entrée du saint des saints.
Tant que l’heure n’a pas sonné où les simples mortels peuvent être admis, il faut en effet appartenir non-seulement à la classe des artistes, mais encore des artistes admis eux-mêmes aux honneurs de l’Exposition pour avoir le droit de s’introduire dans le tabernacle sans être exposé à se voir foudroyé.
La foudre se traduit, pour les simples humains, en pots de vernis qui vous tombent sur la tête ou en flots de thérébentine qui vous suffoquent.
C’est, en effet, l’heure du vernissage général, et il faut avoir un pied d’artiste pour circuler au milieu des échafaudages et des échelles qui barricadent chacune des salles.
Il faut avoir la marque de l’art sur le front pour ne pas être exposé à toute espèce d’infortunes du genre de celles qui assaillent, lorsque l’on passe sous l’équateur, le navigateur qui n’a pas encore passé cette ligne redoutable.
Donc, pour l’amour des lecteurs du National, j’ai affronté aujourd’hui ce danger, et j’ai passé la ligne artistique avec tous les honneurs de la guerre.
C’est vous dire que le rédacteur auquel vous avez ouvert vos colonnes est réellement digne de l’honneur que vous lui avez fait.
Mais, assez de digressions: entrons en matière.
Je vais d’abord dire ce qui m’a le plus frappé dans cette première et rapide visite; puis ensuite j’indiquerai, salle par salle, les tableaux dignes d’attirer l’attention des visiteurs, soit par leur mérite, soit par leur étrangeté, soit par l’intérêt ou l’excentricité des sujets qu’ils représentent.
On comprendra que mon travail, fait avec la rapidité que je viens de dire, doive renfermer plus d’une lacune.
Je demande particulièrement pardon aux artistes dont les mérites m’auraient échappé dans cette course précipitée.
Je prie également mes lecteurs de ne pas trop se récrier si, dans les visites qu’ils feront à l’Exposition, ils découvrent des morceaux dignes d’intérêt que j’aurais négligés.
Ce que je veux constater tout d’abord, c’est que l’ensemble de l’Exposition est des plus satisfaisants, et dénote un progrès marqué dans le niveau de l’Art en France.
Il faudrait s’arrêter devant tous les tableaux; il faudrait les désigner presque tous à l’attention du public.
Même en se montrant difficile, on ne peut faire un grand nombre de pas sans être obligé de faire une station.
Comme toutes les salles, y compris le Grand Salon carré, ne sont disposées que sous le régime de l’ordre alphabétique, il s’en suit que l’intérêt est distribué d’une façon à peu près égale dans chacun des vingt-quatre salons qui composent l’exposition.
En dehors de ces salons, il y a les salons consacrés à la gravure, à la photographie, aux pastels, aux aquarelles.
Les sculptures dont je ne m’occuperai pas maintenant, parce qu’elles seules méritent un compte rendu spécial, sont, suivant l’usage, réparties dans le jardin du palais de l’Industrie.
Mais je ne veux pas quitter les expositions accessoires sans protester contre la manière dont pastels, dessins au crayon noir et aquarelles sont confondus.
Il résulte de cette discordance une arlequinade qui nuit à chaque genre et à chaque sujet; il est certain qu’un pastel d’une teinte blonde et douce est complétement écrasé s’il se trouve entre un vigoureux dessin au crayon noir et une aquarelle chaudement teintée.
Et, par le fait de ce voisinage, dessins et aquarelles paraissent, de leur côté, durs et poussés outre mesure à l’effet.
Si je fais cette observation en ce moment, c’est qu’elle s’applique également à un trop grand nombre de tableaux qui perdent énormément de leur effet et de leur importance dans le tohu - bohu bigarré qui résulte de la nécessité de les accoler les uns aux autres.
A ce point de vue, le Salon donne une idée imparfaite de la valeur de chaque tableau, et il faut que ceux que l’on distingue aient des mérites exceptionnels pour se faire remarquer à travers ce bariolage.
Il y a un panneau de la salle n° 15, sur lequel je demande la permission de m’arrêter un instant, parce qu’il m’a, en effet, arrêté lui-même, par un effet de ce genre.
Ce qui apparaît tout d’abord dans ce panneau, ce sont deux grands portraits exécutés par Mlle Zélie Jacquemart. L’un, d’une jeune femme en robe de satin rouge, et l’autre d’un jeune homme en jaquette de velours noir.
Je reviendrai à l’occasion sur ces deux portraits, dont je ne veux vous dire en passant que ceci, c’est que la vie y déborde; on y voit le sang circuler dans les veines sous le satin de la peau.
Eh bien! entre ces deux grands portraits qui attiraient mon regard, je voyais quelque chose d’incolore et d’effacé qui me paraissait souffrir de ce voisinage de satin rouge et de velours noir.
Il me semblait que ce n’était qu’une esquisse imparfaite sur laquelle le peintre n’avait pas eu le temps de déployer toutes les richesses de sa palette.
En m’approchant, je reconnus mon erreur.
C’était au contraire la chose la plus suave, la plus délicieuse et la plus achevée qui se puisse voir!
Figurez-vous une plage sur le bord de la mer; une plage fréquentée par une pléiade de gracieuses baigneuses et d’élégants baigneurs prenant, après le bain de mer, un véritable bain de soleil. Les rayons de celui-ci sont tellement ardents qu’ils pâlissent encore les couleurs tendres et chatoyantes des costumes légers dont sont revêtus les unes et les autres.
Le ciel est bleu tendre.
La mer est d’un bleu encore plus adouci, et le sable de la plage est blond.
Sur cette plage s’étale, dans les positions les plus variées, un essaim de jeunes femmes aux traits les plus fins et les plus délicatement rendus, au milieu desquelles se trouvent, avec quelques jeunes hommes, un bon gros curé à la ligure malicieuse qui paraît penser à tout autre chose qu’à la confession, tandis que, tout autour d’eux, des fissets et des fillettes ramassent des coquillages, pêchent des petits poissons ou bien lancent sur les flots de petits bateaux.
Vous voyez d’ici l’effet blafard et déteint que fait cette délicieuse toile, signée Kaemmerer, entre la robe de satin rouge éclatant qui se trouve à sa gauche et la jaquette de velours d’un noir d’ébène qui se trouve à sa droite.
Et pour compléter la chose, au-dessus de cette toile est posé un magnifique cadre contenant un splendide spécimen de chemiserie: chemises, cols et manchettes, le tout d’une blancheur telle et si éblouissante qu’on ne voit plus la figure qui les porte, tout à fait obscurcie par l’éclat de cette lingerie éclatante, sortie des mains d’une blanchisseuse émérite, dont on cherche l’adresse aux côtés du cadre.
Mais me voilà encore loin de mon programme!
Revenons donc bien vite à la désignation des toiles qui m’ont le plus frappé.
Vous allez croire que je veux imiter celui dont je tiens la place en ce moment, et que d’ailleurs on ne saurait trop prendre pour modèle; je veux parler de cet inimitable maître en l’art de sainement juger et de dire harmonieusement, Théodore de Banville. Il y a deux ans, il commençait sa description du Salon de 1872, en parlant avec un enthousiasme bien naturel de l’effet qu’avait produit sur lui le magnifique paysage de Français, portant le titre de Daphnis et Chloé.
Je ne sais quel nom doit donner, cette année, à son nouveau paysage cet artiste aux doigts déliés, cet amant de la belle nature; mais son tableau, dans le genre de celui qu’il avait exposé il y a deux ans, est une merveille qui dépasse encore cette merveille qu’avait si bien décrite Théodore de Banville. C’est un véritable Eden de feuillages et de fleurs, arrosé par une eau d’une transparence et d’une limpidité dont la vue rafraîchit et captive.
Aux bord de cette eau se trouvent deux femmes nues, à la chevelure flottante, et dont les épaules et le torse sont rendus de façon à délier le pinceau des maîtres les plus renommés dans la peinture académique et dans la peinture de genre.
Français a fait la une œuvre où il s’est montré à la hauteur des plus célèbres dans tous les genres. Ce beau tableau occupe le milieu du grand salon carré de droite, portant le numéro 11.
Après Français, il faut citer Bonnat, qui a envoyé au Salon un Christ en croix, destiné à la cour d’assises de Paris. Ce christ est remarquable surtout par la manière dont tous les muscles sont rendus et éclairés, en laissant apparaître l’ossature. La tête laisse peut-être à désirer au point de vue de la noblesse.
A côté de cela, Bonnat a deux autres tableaux: trois petites filles turques, véritables petits bijoux; puis une Italienne, tenant devant elle un enfant nu, tableau non moins plein de charme, de vie et de couleur.
Une des œuvres les plus remarquables est un Prométhée de Ranvier, grande et vigoureuse composition d’un immense effet et d’une exécution supérieure. L’artiste a choisi le moment où Hercule tue le vautour en présence des océanides représentées sous les traits de l’Alsace et de la Lorraine.
Deux tableaux de Bouguereau, les Italiennes à la fontaine, et la Mère aux deux enfants, attirent les regards des amateurs de riche coloris.
Mais deux toiles captivent tout particulièrement l’attention du public: c’est d’abord une toile de Dupray, représentant une Reconnaissance en avant du Bourget. L’amiral commandant s’est porté en avant pour faire une reconnaissance. Mais le temps est sombre; il fait du brouillard, et les hommes qui ont mis pied à terre pour n’être pas gelés sur leur monture, vont et viennent dans le but de se réchauffer.
Le spectateur a devant lui l’amiral et son état-major, dont les regards cherchent à percer le brouillard et à percevoir dans le lointain les mouvements de l’ennemi.
Ce tableau est saisissant de vérité, et on ne peut pas le regarder sans se sentir pris d’une vive émotion au souvenir de nos souffrances et de nos douleurs.
Il en est de même du tableau de Neuville qui représente un combat entre une troupe de gardes mobiles, placés le long d’un remblai de chemin de fer, et des Prussiens échelonnés de l’autre côté sur une colline qui surplombe.
Les chefs ont peine à modérer l’ardeur de la jeune milice qui cherche à escalader le talus, et qui tombe frappée par les balles ennemies, à mesure que l’un de ceux qui la composent dépasse le talus protecteur.
C’est encore là un des tableaux devant lesquels on s’arrête, et où l’on reste dans une silencieuse contemplation.
Parmi les tableaux hors ligne, il faut encore citer un grand paysage de Busson, les Ruines du château de Lavardin, près Montoire, et les tableaux de Carolus Duran, dont deux ont le tort de chercher leur effet dans les fonds verts, comme l’Enfant voué au bleu le cherchait dans l’abus du bleu. Quant au troisième, une Femme nue, le peintre a voulu faire le pendant de la Source, d’Ingres; mais il n’y est pas arrivé tout à fait.
Je ne saurais terminer cette nomenclature incomplète, je le crains, des beautés exceptionnelles du Salon, sans parler d’un nouveau chaudron de M. Vollon, accompagné de superbes poissons de mer, dont le peintre n’a pu rendre aussi fidèlement la fraîcheur qu’en assistant lui-même à leur prise.
Il y a encore, parmi les excellentes choses du Salon, des natures mortes de Desgoffe, un champ de blé avec d’étincelants bouquets de coquelicots de Kreyder, les trois toiles de Gérôme, l’Eminence grise, Molière et Corneille et le Grand Frédéric jouant de la flûte.
Une des merveilles du Salon, à mon avis, est une petite toile de Firmin Girard, représentant Une Promenade au temps de Louis XIII dans un parc, par un temps d’automne. On entend les feuilles mortes craquer sous les pas des promeneurs, dont toutes les têtes sont d’une expression saisissante.
Il y a d’abord un premier groupe composé d’un jeune seigneur et d’une jeune personne qui semble sa fiancée. Viennent un peu plus loin les grands parents, qui semblent d’avis que tout marche pour le mieux. Puis, sur le perron de la maison, tout au fond, on voit encore les domestiques réduits à l’état de lilliputiens et dont les têtes curieuses attendent le résultat de cette promenade qui, paraît-il, doit être décisif.
Mais le temps me presse, et la place me marque. Je me vois contraint de finir par une sèche nomenclature des tableaux qui m’ont frappé plus particulièrement dans la course rapide que j’ai faite à travers toutes les salles.
Dans la SALLE N° 1, voir la Mer Méditerranée, d’Appian; un paysage de Beauvriès; le Capitaine Fracasse, d’Edmond André ; Paysage méditerranéen, de Viollet-le-Duc; le Char de la Moisson, de Veyrassat.
Dans la SALLE N° 2, les Tortues au Harem, de Beyle, tableau plein de lumière, de vie, de grâce, de couleur et d’éclat.
Un tableau d’Emile Breton, peint à la façon de Corot, et demandant, comme les tableaux de ce maître, à être vu de très loin.
Une Bretonne contemplant la mer lointaine, par Jules Breton. Ce qui surprend dans cette toile, c’est la position un peu trop réaliste dans laquelle le peintre a placé celle à qui il donne la poétique occupation de contempler au loin le mouvement des flots.
Un Paysage de Bidaud.
L’Introduction du Crabe, amusante et jolie peinture de Burgest.
La Plage, d’Allongé, bel effet de mer montante, où le spectateur croit que la vague va lui mouiller les pieds.
Un Paysage agreste et très réussi de Benouville.
Le Peloton de laine, de Berne-Bellecour, qu’une jeune fille pelotonne en baissant les yeux, tandis qu’un jeune officier tient l’écheveau; scène très morale qui se passe en présence des grands parents, et qui est un prélude de la demande en mariage.
La Femme noyée d’Antigna.
Dans le SALON N° 3, un Portrait de Bonne-Grâce, le Christ de Bonnat, une Judith de Blanchard, la Ferme de Bouché, les Trois petites filles de Bonnat, les Moutons de Brissot, les Nains de Beaumont; un magnifique cadre contenant un superbe Effet de soleil couchant, par Emile Breton; le Mariage de Georges Dandin, par Georges Balloin; un vigoureux Paysage d’Auguste Bonheur; le Mariage alsacien, de Brion; un Panier de fleurs, de Rivan; la Glissade de la cuisinière et du poulet rôti, par Deboucheville; un Portrait de femme, par Berne-Bellecour; Le Gué, de John Lewis Brown; Un village dans la neige, de Jules Breton.
Dans le SALON N° 4, Pêches, Prunes et Groseilles, d’Eugène Claudin. On voudrait avoir des greffes des arbres qui produisent d’aussi beaux fruits et particulièrement des arbustes d’où proviennent de si belles groseilles!
Le Paysage de Busson, éclatant d’effet de lumière; une Cour de ferme, d’Albert Aublet; les Italiennes à la fontaine, de Bouguereau; un magnifique tableau de nature morte, où de superbes roses sont surmontées par de longues branches d’oseilles sauvages en fleurs, par Chapotin; la Poste aux Chiens, de Pierre Billet; la Famille du Cardinal, de Baron; l’Ecole des Frères, de Bonvin; le Chasseur sous bois, de Berthelin.
Dans la SALLE N° 5, le Défilé, d’Emile Bayard; les Vaches à l’abreuvoir, de Belly.
Dans la SALLE N° 6, (grand salon), le Portrait du maréchal de Mac-Mahon, par Princeteau.
Le tableau de Henry Dupray, représentant la Scène aux avant-postes du siége de Paris; deux Paysages de Corot; Une Marche en avant, de Protais; Un Régiment de cuirassiers arrêté au milieu d’une rue tortueuse par une barricade, de Detaille; les Pommes, de Compte Callix; le Trouvère, de Coëssin. La Bacchanale, de Prun; le Lavement des pieds au couvent par Pils; les Pêcheuses élégantes, par Castiglione; les Carpes de Fontainebleau, par P. Comte.
Dans la SALLE N° 7, la Duchesse de Luynes et ses enfants, par Cabanel; Un Fourré, de Xavier de Cock; Vaches sous bois, de Coignard; une Marine, de Clays; David vainqueur de Goliath, de Ch. Delaunay; un paysage antique, de de Curzon; les Marionnettes, de Cortazzo, dont les mouvements singuliers font chuchotter deux jeunes femmes; un Saint Jean-Baptiste, de Cabanel.
Dans le SALON N° 9: un Cimetière de village, de Daliphard; trois beaux Portraits, de Dubufe; le Portrait de Legouvé faisant une lecture, par Delaunay; Nature morte, de Claude. Ah! que tout cela est donc vrai, et comme j’aurais bien, moi qui n’avais pas encore déjeuné à deux heures, goûté à ces huîtres fraîches et appétissantes, à ce homard, à cette brioche, à ce raisin, à ces prunes, à ces pêches, et comme j’aurais vidé de bon cœur ce verre de vin couleur de soleil; mais passons. Ceci n’est pas pour de vulgaires consommateurs... Un Corot admirable à voir de l’autre bout de la salle: Vaches à l’abreuvoir, de Xavier de Cock; une Chaumière enguirlandée de roses et de vigne-vierge, de Georges Dieterle; la Ronde devant le retour de la moisson, de Xavier de Cock; une Mer toute étincelante de soleil, par Maurice Courant.
Dans le même Salon: le Glacier, de Gustave Doré ; les Trois Italiennes, de deConninck: passez vite devant elles; si vous vous y arrêtiez, elles vous séduiraient avec leurs œillades et avec les fleurs qu’elles vous jettent au nez; un Bouquet de crysanthème jaune, d’une couleur éclatante; on est tout surpris de trouver ces fleurs de temps de neige et de gelée, à côté de raisins et de pêches non moins saisissants de vérité ; mais le peintre, Dubourg, est un habile homme qui sait faire fleurir ses fleurs et mûrir ses fruits en toutes saisons; les Coquelicots, de Daubigny; la Mare aux bœufs, paysage vigoureux de Victor Dupré. Dans ce salon, se trouve un grand tableau de Gustave Doré, les Arènes après le martyre des chrétiens livrés aux bêtes, grand effet d’apothéose avec flammes de Bengale un peu trop vertes.
Dans le SALON N° 10: un Paysage, de Jules Dupré à la Jules Dupré, on ne peut pas en faire un meilleur éloge; les Petites Italiennes, de de Conninck; le Marché aux huîtres, d’Eugène Fayen, où sur moins d’un mètre, le peintre a fait figurer plus de cent barques et plus de mille personnages; la Chasse au Faucon, d’Eugène Fromentin; Splendeur et Misère, tableau en deux actes et deux portraits, par Ernest Duez.
Dans le SALON N° 11: Un Mariage sous Louis XVI, par Goupil; Deux jeunes femmes se rafraîchissant, de Tony Faron; le Retour de la pêche au fanion, par Fayen-Perrin; deux petits tableaux miniatures, par Eugène Feyen. Le beau tableau de Français se trouve dans ce salon, ainsi qu’un second du même peintre, dans lequel son talent brille sous un autre aspect.
C’est dans ce salon que se trouvent aussi les trois toiles de Gérôme. Ne pas oublier les Petits Chats de Lambert.
Dans le SALON N° 12, les Cendres, toile magistrale de Glaize; le Concert de famille, par Fix; les Cartes biseautées, par Gide; la Chercheuse de puces et la Cuisine, d’Armand Leleux; Après le départ des maîtres, les Domestiques prenant le café, excellentes expresssions, bon coloris, par Grollerin; Effet de neige, de Gagorffett.
Dans le SALON N° 13, Les Bûcherons, effet d’automne, par Hanoteau; La Promenade dans le Parc, très fine peinture, par Firmin Girard, que j’ai signalé déjà parmi les meilleurs tableaux du Salon; le Musée d’antiques, par Ferrandis; une Madeleine, de Henner, belle pénitente, mais bien froide. On sent que la pénitence produit son effet et refroidit les ardeurs de l’ex-pécheresse. Une Judith, de Genty.
Dans le SALON N° 14, Portrait de M. Thiers, par Heaty; une Judith de grand caractère et de grand coloris, par Gironde; un Paysage, par Japy; Les Coquelicots, de Kreyder; la Pêche à la ligne, de Firmin Gérard; la Neige, de Gibbon; une Rue de Constantinople, de Hagemann; Sainte-Anne d’Auray, par Jundt.
Dans le SALON N° 15: C’est dans ce Salon que se trouvent les deux portraits de Mlle Jacquemart, accompagnés comme je l’ai dit en commençant. Conduire dans ce Salon les petites filles qui ne sont pas sages et les petits garçons qui ne veulent pas apprendre à lire, pour leur montrer la Hotte de Croquemitaine, dans laquelle M. Lobrichon a placé bon nombre d’enfants qui voudraient bien être ailleurs que là ; l’Interrogatoire du Saint-Office, par Claudius Jacquand.
Dans le SALON N° 16, Portrait de Louis Veuillot, par Emile Lafont. Le rédacteur en chef de l’Univers a une lèvre tout à la fois ironique et voluptueuse, et ses mains semblent gonflées tout autant de malice que de graisse. Cette peinture est cotonneuse, mais expressive. L’Assassinat de Lepelletier, par M. Leblank; une Boucherie italienne, d’Edm. Lebel, avec la madone et la chandelle obligatoires; un frais Paysage, de Lambinais; Marchande dans le Harem, par E. Giraud; les Deux Esclaves et le Faucon, de Lerolle (très chaude et très énergique peinture, couleurs éclatantes, dessin hardi); la Visite à la Ferme, de Gouby (les dames du château ont mis pied à terre pour donner du sucre aux poulains; les oies regardent ce spectacle d’un air étonné); la Fileuse, de la Landelle; un Paysage oriental, de Laurens; la Visite chez la Nourrice, de Louis Lassalle; un Bouquet, d’Adolphe Leleux; le Mariage protestant, d’Armand Leleux.
Dans le SALON N° 17, qu’est-ce que ce n° 1,142? A l’œil morne et terne du sujet, au cordon rouge qu’il porte en sautoir et au bouquet de violettes, ce portrait me semble plus appartenir à la politique qu’aux beaux-arts.
Quel affreux spectacle: Un ignoble sultan africain, à la peau huileuse, aux lèvres proéminentes, au regard concupiscent, se délecte et ouvre les bras et les mains comme pour saisir sa proie, en entendant les chants d’une esclave blanche agenouillée au bas de son divan, et dont les regards, en même temps que les idées, se portent do tout autre côté que de celui de ce hideux personnage.
C’est un tableau bien dessiné, d’une couleur éclatante, et rempli d’expression, et qui doit porter ce titre: Concupiscence et Résignation. Le Soir au Hameau, par Legat; le Marché de Blois, par Emile Le Borne; l’Eau lustrale, belle composition peinte à Rome par Hector Leroux.
Dans le SALON N° 18, un beau tableau: Fleurs, armures et tapis, de Leclerc, et un autre qui pourrait lui faire pendant: Bouquets champêtres, coquelicots et marguerites, de Lemaire; un curieux Coin de Salon, de Lassalle; les Plumeurs d’oies, de Liébermat; trois tableaux de Meissonnier fils: le Jardin des Moines, la Marchand fripier et la Lecture à la Cour; les Rôdeurs de Nuit, de Munskacsy, et le Mont-de-Piété, du même, deux grands tableaux à effet; la Leçon de tambour, par Ch. Moreau; la Foi en l’avenir de l’Alsacienne, par Morton.
Dans le SALON N° 19, MM. du tiers avant la séance royale du 23 juin, par Lucien Mélingue. Parmi les députés laissés à la pluie, l’on remarque Mirabeau, Pétion, Barnave, Robespierre, Sieyès, Target, Malouet, Bailly, etc. La Mer diaprée par le Soleil couchant, de Mazure; le Juif errant, de Gaston Mélingue; la Marée montante, de Mesdeil; Phœbé, de Machard (le croissant de la lune est formé de l’arc de la déesse); la Sortie du Bal masqué (bal du grand monde) d’Adrien Moreau.
Dans le SALON N° 20, le Dîner à l’hôtel du Lion-d’Or, de Jules Noël; le très remarqué et très remarquable Combat des gardes mobiles, de A. de Neufville; les Ramasseurs de varech, du même.
Dans le SALON N° 21, une Vue de Venise le soir, avec bel effet de lumière, par A. Rosier; Mandoline et Tambour de basque, par Richler (de la couleur et de la grâce autant que l’on peut en vouloir); Paysage rustique, par Léon Richet; la Petite Moissonneuse, de Perrault; les Anes sous bois, de Palizzi; les Lapins sous bois, de Pelouse; le Regard sur Metz, de Protais.
Dans le SALON N° 22, le Prométhée, de Ranvier; Fleurs, de D. Roger; le Troupeau et la Neige, de Schenck, avec son pendant: Moutons et Agneaux; l’Odalisque couchée, de Saint-Pierre.
Dans le SALON N° 23, les Arracheuses de pommes de terre, de Sadée; le Retour de l’église, de Schlesinger; la Fête du village, de Salmson; la Batelière, de Scherzinberger; l’Effet de la lecture (deux jeunes femmes endormies), par Toulmouche; une jolie Etude sous bois, de Gabriel Thurner; Danse espagnole, par Hullman; les Deux dragons, de Valcker; la Jolie blanchisseuse, par Emile Saintain. — On en mangerait. — Voulez-vous vous taire, monsieur Jules! La Jolie veuve, de M. Emile Saintain. — On en mang.... —Vous êtes donc incorrigible, monsieur mon neveu? La Jolie jardinière, d’Emile Saintain. —On en m... — Décidément, monsieur Jules, j’assemblerai le conseil, pour savoir si vous devez être maintenu dans nos rangs. Ville hollandaise au bord de l’eau et par un temps de neige, par Van Hier; la Fuite en Egypte, de Tesler; l’Ecole, de Truphène, tableau très remarquable par la vérité de toutes ces têtes; l’Atelier de couturières, de Vrayer; le Baiser par dessus la barrière, de Serrure.
Dans le SALON N° 24, le Chariot au bois, de Veyrassat; la Mère contant au curé le péché de sa fille, par Vibert; les Baigneuses, de Zubert; le Coffret de noces, de Werzy, délicat et délicieux petit tableau; deux beaux tableaux d’Animaux, par Van Marck; le Chaudron et les Poissons, de Wollon.
Pour un homme affamé, je ne puis rester sur un meilleur sujet. Et sur ce, je vous tire ma révérence; car, pour une journée, en voilà une! Mais ne comptez plus sur pareille aubaine, ou peut-être sur pareil ennui; si vous le pensez, ayez la charité de ne pas le dire, je ne procéderai plus, à l’avenir, qu’à petite dose.
P. S. A propos, j’oubliais de vous dire un mot au moins de la sculpture. Elle est à la hauteur de la peinture.
Pour aujourd’hui, je ne mentionnerai que trois œuvres qui feront sensation: le Narcisse, de Dubois, l’auteur du Chanteur florentin; le Gloria victis, groupe de Mercier, et le Buste de Vitet, par Chapus.
Dans le SALON N° 19, j’ai oublié de signaler le seul tableau de Manet qui ait trouvé grâce devant le jury; c’est une peinture à grands traits, naïve en même temps que mystérieuse, et d’une grande originalité. J’en ai oublié encore bien d’autres, je m’en aperçois; mais la place! mais le temps! Je réparerai ces omissions.