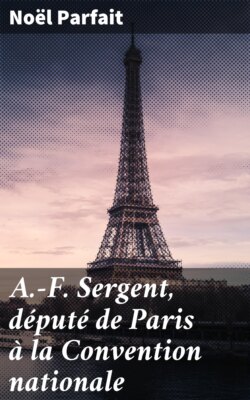Читать книгу A.-F. Sergent, député de Paris à la Convention nationale - Noel Parfait - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеTable des matières
Mon intention n’est point de raconter en détail les combats et les victoires populaires auxquels Sergent prit sa glorieuse part. Je n’écris pas l’histoire: je rassemble des notes pour les historiens; encore sont-elles destinées simplement à leur faire juger le caractère d’un homme, et non celui d’une époque.
La patriotique énergie et le courage civil dont Sergent fit preuve dès les premiers jours de la Révolution; sa parole sonore, chaleureuse, abondante, sinon toujours correcte, lui méritèrent, après le 14 juillet, d’être porté au nombre des électeurs du district Mauconseil, qu’il habitait depuis son arrivée à Paris. Il fut en même temps nommé président de ce district. Un peu plus tard, il y remplit les fonctions — alors confondues et gratuites — de juge de paix et de commissaire de police; car il ne recherchait pas l’agitation pour elle-même ni dans un but d’intérêt personnel: mû par des idées généreuses, il tournait toute son activité vers leur application. C’est ainsi qu’il créa, dans ce populeux quartier Mauconseil, le premier bureau de bienfaisance, philanthropique institution que tous les autres quartiers s’empressèrent d’imiter, et qui s’est heureusement perpétuée jusqu’à ce jour.
Une intrigue électorale enleva cependant à Sergent les fonctions qu’il honorait. On avait répandu contre lui des écrits diffamatoires; il attaqua ses calomniateurs devant le tribunal du Châtelet, plaida lui-même sa propre cause et la gagna. Les auteurs des libelles furent condamnés à lui faire une réparation publique; ils durent verser, en outre, une somme de 200 livres dans la caisse du bureau de bienfaisance, et le jugement, rendu sous la présidence de d’Ambray, fut affiché à deux mille exemplaires. — Il est bon de remarquer qu’à cette époque la preuve des faits et les débats contradictoires étaient admis en matière de diffamation.
Le district de Saint-Jacques- l’Hôpital vengea mieux encore le patriote calomnié, en le choisissant pour son président. — Ce fut au nom de ce district que, en août 1790, Sergent se porta le défenseur de trente-six cavaliers du régiment de Royal-Champagne auprès de l’Assemblée constituante et du pouvoir exécutif. Ces militaires, à la suite d’une manifestation patriotique qui avait eu lieu à Hesdin, où ils tenaient garnison, s’étaient vu congédier, sans jugement ni enquête, avec des cartouches infamantes; et le sous-lieutenant Davoust, — depuis maréchal de France et prince d’Eckmühl, — s’étant prononcé hautement contre cet acte arbitraire, avait été, sur une lettre de cachet, enfermé dans la citadelle d’Arras. Par. ses actives démarches, et après une lutte de cinq mois, le président du district de Saint-Jacques parvint à obtenir de l’Assemblée constituante un décret qui relevait les trente-six cavaliers de la dégradation qu’on leur avait injustement fait subir. — A cette occasion, et pour tâcher de l’intéresser à ses protégés, Sergent avait été voir Robespierre, sous la recommandation de Pétion, député du bailliage de Chartres. C’était la première fois qu’ils se parlaient, ce devait être aussi la dernière. La froideur du tribun, qui n’éprouvait que de l’antipathie pour les militaires, comme s’il eût prévu qu’un soldat dût étouffer un jour la Révolution; sa morgue, ses dédains rendirent l’entretien si âcre, que Sergent se retira profondément blessé ; et jamais par la suite, quoiqu’il ait toujours siégé sur les bancs de la Montagne, il n’échangea une parole avec Robespierre. «Cet homme avait une tête, dit-il dans ses mémoires, mais il n’avait pas un cœur.» Sergent eût-il, du reste, oublié sa rancune, qu’en plus d’une occasion l’acerbe Maximilien eût, comme on le verra, pris soin de la lui rappeler. Cela n’empêche pas que la plupart des écrivains, le confondant avec son ami Panis, n’aient fait de lui le secrétaire intime et le seïde aveugle de Robespierre.
Vers la fin de 1790, Sergent fut élu secrétaire de la société des Jacobins, dont il avait été l’un des premiers affiliés, et devint président de la section du Théâtre-Français, autrement dite des Cordeliers. Resté artiste au fond de l’âme, bien qu’il eût, pour la politique, abandonné son burin, il provoqua et fut chargé de présenter à l’Assemblée nationale une adresse tendante à obtenir la libre publication des ouvrages d’art. — Enfin, dans les premiers mois de 1791, les électeurs de la section qu’il présidait le nommèrent officier municipal, et ses collègues de la Commune, ayant bientôt pu apprécier ses qualités administratives et son infatigable activité, lui confièrent le département de la police. On lui adjoignit Panis, Perron et Vignier. A peine investi de cette magistrature importante, dont la mauvaise santé de Panis et l’incapacité des deux autres administrateurs firent retomber sur lui tout le poids, son premier soin fut de rendre le séjour des prisons moins cruel aux malheureux qu’on y entassait déjà ; la première pensée de cet homme, que tous les biographes ont dépeint comme un terroriste farouche, fut une pensée de justice et d’humanité. Il ordonna la suppression des cachots souterrains de la Conciergerie, du Châtelet, de la Force; fit agrandir le préau de l’Abbaye, percer des fenêtres, assainir partout les cabanons; imposa des tarifs aux guichetiers, qui rançonnaient les détenus, et, dans un but de moralité que l’on a compris plus tard, ne cessa de réclamer une prison particulière pour les enfants et les adultes. Ce sont là des faits avérés, incontestables. J’ai sous les yeux le brouillon d’un rapport qu’il présenta, en 1792, au directoire du département sur le régime des prisons de Paris, et sur les améliorations qu’il jugeait utile d’y apporter; c’est d’un bout à l’autre l’œuvre d’un cœur généreux, d’un esprit philosophe; et si son étendue ne me forçait d’en remettre à un autre lieu la publication, ce serait la réponse la plus péremptoire que je pusse faire aux détracteurs de Sergent 5.
On sait combien la tâche des magistrats de police fut difficile et pénible pendant cette période de troubles qui vit le renouvellement de la législature, la fuite du roi et son arrestation à Varennes, les émeutes causées par la disette, et la déclaration de guerre aux puissances coalisées. Si Panis et Sergent n’y suffirent pas toujours, ce ne fut point le zèle qui leur manqua, ce furent les moyens qui leur échappèrent. — L’histoire impute à leur administration, de connivence avec la municipalité, les événements du 20 juin 1792. Il est au moins certain que la Commune fit peu d’efforts pour les prévenir; mais je n’entreprendrai point d’examiner sa conduite, de la condamner ou de l’absoudre. Ce grand acte politique est un de ceux qui appellent naturellement la controverse, et qu’on peut laisser débattre à l’opinion. Si pourtant il me fallait justifier Sergent de la part qu’il prit à la journée du 20 juin, je dirais que lui, plus que tout autre, par la nature de ses fonctions, était en éveil sur lés projets contre-révolutionnaires de la cour; que plusieurs agents secrets du château, parmi lesquels se trouvait Lacroix (d’Anet), avaient tenté même de le faire entrer dans ces projets, et qu’il lui était permis de regarder comme utile une manifestation populaire qui viendrait y apporter obstacle. Dans tous les cas, aucun des témoins entendus par suite de l’enquête qu’ordonna le Département ne déclara que Sergent fût au nombre des officiers municipaux qu’on avait vus, ce jour-là, guidant le peuple aux Tuileries 6. — Il n’y arriva, en effet, qu’avec Pétion, pour protéger les jours du roi. Et voici le prix qu’il reçut de ce service: le lendemain 21 juin, vers huit heures du soir, le maire de Paris, mandé au château par Louis XVI, allait lui rendre compte de l’état de la ville, accompagné de Sergent et d’un autre officier municipal. Au moment où ils traversaient la cour du Carrousel, remplie de troupes, quelques gardes nationaux du bataillon royaliste des Filles-Saint-Thomas invectivèrent Sergent, et l’un d’eux, l’arrêtant au passage, lui arracha violemment son écharpe. Les officiers du bataillon adressèrent aussitôt des excuses au fonctionnaire outragé, et l’invitèrent à leur désigner le coupable; le conseil du département enjoignit lui-même au procureur-syndic de porter l’affaire devant les tribunaux, mais l’intervention du ministère fit cesser toutes poursuites... Tels sont les faits dans leur exactitude. Ils prouvent peut-être que l’irritation des esprits était grande de part et d’autre, et que les provocateurs ne manquaient point du côté de la cour; mais, à coup sûr, ils ne prouvent rien contre Sergent, et je m’étonne qu’on ait pu lui en faire un grief 7.
L’entretien que Pétion et les officiers municipaux chargés de la police eurent avec Louis XVI, le soir du 21 juin, est connu de tout le monde: on sait quelles paroles amères et peu dignes de la majesté royale la colère dicta au monarque imprudent. Cette circonstance, au dire même de Sergent, acheva de le convaincre de l’impossibilité, depuis longtemps reconnue par d’autres, de concilier jamais les prétentions du peuple et celles de la royauté. Aussi la journée du 10 août le trouva-t-elle tout prêt à se lever et à combattre. — Il dut au courage qu’il montra à la tête des sections armées d’être maintenu dans ses doubles fonctions d’officier municipal et d’administrateur de police, par le comité insurrectionnel qui s’était organisé à l’Hôtel-de-Ville. Ces fonctions acquirent même une importance nouvelle, en ce que les magistrats de police, réduits à deux seulement, furent adjoints au conseil de surveillance de la Commune, et chargés de le présider à tour de rôle.
En sa qualité d’artiste, Sergent avait de plus la mission, importante alors, et qui échut par la suite à David, de régler les fêtes et les cérémonies nationales; et, chose singulière! lui, qu’on accusa plus tard du vol d’un misérable bijou, ne fut jamais soupçonné d’avoir rien soustrait des sommes considérables que l’on mettait pour ces occasions entre ses mains! Il apporta toujours, en effet, dans l’accomplissement de sa tâche un rare désintéressement, et il y déploya toutes les ressources d’un esprit ingénieux et poétique. Ce fut lui qui, par exemple, arrêta les dispositions de l’imposante cérémonie funèbre exécutée dans le jardin des Tuileries en l’honneur des citoyens morts au combat du 10 août, que l’on appelait alors le massacre de la Saint-Laurent. Il avait précédemment organisé deux fédérations, et, ce qui peut être regardé comme plus méritoire, donné le plan du cérémonial à suivre pour proclamer solennellement le danger de la patrie, et provoquer les engagements volontaires. Tous les historiens s’accordent à reconnaître que l’appareil dramatique et saisissant dont fut entourée l’exécution de cette grande mesure nationale ne contribua pas peu à la rendre féconde. M. de Lamartine en a retracé les détails dans un style si éclatant, que j’ose à peine en parler après lui; mais, pour l’honneur de Sergent, je ne puis m’en-pêcher de le faire.
Tout était combiné de manière à exalter les esprits en frappant vivement les sens 8. Afin de trouver le peuple tout porté hors de ses ateliers, l’ordonnateur de la cérémonie, d’accord avec le conseil communal, l’avait fixée au dimanche 22 juillet 1792. Dès l’aube du jour, Paris s’éveilla au triple et formidable bruit du canon, des tambours et du tocsin. — La population entière fit irruption dans les rues. — A neuf heures du matin, tous les officiers municipaux, ceints de l’écharpe et le sabre au côté, partirent à cheval de la place de l’Hôtel-de-Ville, et se divisèrent en deux troupes qui prirent des directions différentes. Chacune de ces divisions était précédée et suivie d’un peloton d’artilleurs traînant leurs pièces, et de nombreux détachements de gardes nationales. Au-dessus des rangs, comme au fronton de tous les monuments publics, flottait une bannière aux trois couleurs, où était écrit: Citoyens! la Patrie est en danger! — Huit immenses amphithéâtres, d’un goût sévère et antique, avaient été dressés sur les places principales de la ville. Les bataillons de la garde nationale formaient un large cercle à l’entour; au pied se tenaient les canonniers. Une tente ornée de banderoles, chargée de guirlandes de feuillage et de couronnes de chêne occupait l’arrière-plan de l’estrade; de chaque côté s’élevaient des pyramides de boulets, des trophées d’armes et des faisceaux de piques et de drapeaux tricolores; enfin, une table posée au milieu sur deux tambours servait à recevoir les enrôlements volontaires. Les officiers municipaux, et les notables qui les assistaient dans cette solennité, suffisaient à peine à la tâche. Par les deux escaliers latéraux conduisant à la plate-forme, on voyait monter incessamment, au son de la musique militaire, de jeunes citoyens à qui les bravos de la foule donnaient des imitateurs enthousiastes; et, d’heure en heure, les salves de l’artillerie des quarante-huit sections venaient ébranler le sol, comme pour en faire jaillir de nouveaux défenseurs...
Au bout de huit jours, Paris envoyait au camp de Soissons une première armée de quinze mille hommes 9!
C’est à regret qu’après cette page sublime de notre histoire, je me vois forcé d’en rappeler une bien lugubre. — J’arrive aux journées de septembre. — Mais ici la matière devient si grave, qu’en continuant de résumer les faits, je craindrais quelque infidélité de ma plume. Je vais emprunter celle de Sergent, et le laisser un instant parler lui-même.