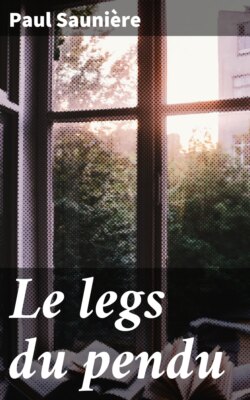Читать книгу Le legs du pendu - Paul Saunière - Страница 4
I
LA TENTATION DE ROGER
ОглавлениеM. Voisin était un vieil industriel, âgé de soixante ans passés, qui s’était donné dix fois plus de mal pour manger sa fortune que d’autres n’en prennent pour l’augmenter.
Il appartenait à cette classe de chercheurs et de théoriciens, qui ne savent jamais se contenter de ce qu’ils ont entre les mains.
Il avait pris dans sa vie plus de trente brevets et avait dépensé chaque fois pour lancer l’invention récente tout l’argent que lui rapportait son usine de produits chimiques. Jusqu’ici, pas une de ces inventions n’avait réussi, et pourtant il ne se décourageait pas encore. Il venait de trouver autre chose!
Malheureusement, tout se ressentait autour de lui de cette extrême versatilité d’esprit. Son usine, moins surveillée qu’elle n’aurait dû l’être, ne rapportait déjà plus les mêmes bénéfices que par le passé; les bâtiments étaient en mauvais état, les machines ne marchaient pas, et avaient besoin de réparations indispensables.
M. Voisin ne s’en apercevait pas. Depuis si longtemps il vivait au milieu de ces murs noircis, le bruit plus ou moins régulier des machines lui était si familier, qu’il ne s’était pas aperçu que tous ces objets vieillissaient, pas plus qu’il ne s’apercevait qu’il avait vieilli lui-même.
Tout entier au nouveau plan qu’il élaborait, il avait résolu de vendre son usine et de consacrer à cette dernière invention la somme qu’il en retirerait.
C’était une folie assurément; car non-seulement il n’avait pas mis de côté un rouge liard pour ses vieux jours, mais il avait une fille de dix-huit ans et demi, en âge d’être mariée par conséquent, et à laquelle il n’avait pas la plus petite dot à donner.
Or, M. Voisin ne s’était pas fait illusion à cet égard.
–Ce qu’il me faudrait, s’était-il dit, ce serait un gendre connaissant à fond la fabrication de mes produits, qui m’apporterait une somme de deux ou trois cent mille francs, et à qui j’abandonnerais la plus-value en guise de dot, ce qui constituerait à Antoinette un avoir fort respectable.
En effet, l’usine valait encore au bas mot quatre cent mille francs.
–De cette façon, poursuivait M. Voisin, j’aurais trois cent mille francs à moi, bien liquides, à l’aide desquels je lancerais une nouvelle affaire,–sans compter une foule d’autres, que je rumine déjà, et qui me feront dix fois millionnaire en deux ans.
Cependant, il faut bien le dire, cette combinaison l’absorbait moins encore que les chimères qu’il poursuivait, et quoiqu’il en eût parfois touché deux mots à Antoinette, il ne s’occupait pas du tout de trouver le gendre qu’il avait rêvé.
Antoinette y songeait, elle; mais où trouver un mari qui réunît toutes les qualités voulues?
Elle avait perdu sa mère à l’âge de trois ans. Depuis cette époque, elle avait été abandonnée par son père aux soins de ses domestiques.
Elle n’avait jamais quitté la maison paternelle, c’est vrai, M. Voisin, dont elle était la fille unique, n’avait voulu à aucun prix se séparer d’elle pour la mettre en pension.
–Je lui donnerai tous les maîtres qu’elle demandera, avait-il dit; mais je ne veux pas qu’elle me quitte. J’entends me réserver le droit de la surveiller.
Sans doute il y était fermement résolu; mais quelle surveillance pouvait exercer sur son enfant cet homme, que réclamaient à toute heure, non-seulement les exigences de son industrie, mais encore les caprices sans cesse renouvelés d’une imagination maladive?
; Antoinette eut tous les maîtres désirables, mais ne travailla jamais.
–A quoi ça sert-il de se fourrer tout plein de choses comme ça dans la tête? lui disaient les domestiques. Allez donc dans le jardin, courez au grand air, manbrez bien, buvez sec, dormez la grasse matinée, puisque vos moyens vous le permettent, vous ne vous en portez bez que mieux.
Et Antoinette suivait à la lettre les recommandations eles domestiques, qui lui plaisaient infiniment mieux rue les réprimandes aigres-douces de ses professeurs.
De temps en temps, quand ses loisirs le lui permetaient, M. Voisin essayait de l’interroger et s’apercevait iien que sa fille ne faisait aucuns progrès; mais elle était si jeune. Et puis elle était si câline, si rusée... Elle savait si habilement détourner la conversation!
Quand son père lui parlait enseignement, elle lui répondait invention. Elle lui demandait-ce qu’était devenue sa dernière découverte. Une fois lancé sur ce terrain, le cher utopiste s’en donnait à cœur joie. Il oubliait bientôt les sévérités auxquelles il venait de se décider pour punir l’espiègle petite fille. Et il allait... il allait... jusqu’à ce que voyant Antoinette bâiller à se décrocher la mâchoire, il la renvoyait avec une petite tape sur la joue, en disant:
–Allons, en voilà assez pour aujourd’hui, va t’amuser.
La madrée enfant ne demandait que cela. Elle s’envolait, comme l’oiseau à qui l’on vient d’ouvrir la porte de sa cage. Elle allait dans le jardin, bâtissait des maisons, faisait des tranchées dans les allées, rognait, taillait, coupait à tort et à travers, si bien que le jardinier se désolait et venait se plaindre à son maître, les larmes aux yeux, des ravages qu’exerçait l’enfant terrible.
–Bah! cela se passera, disait M. Voisin. Console toi, mon vieil André. Il faut bien que les enfants s’amusent.
Il est facile de concevoir en quel état rentrait Antoi nette à la suite de ces escapades.
La femme de chambre la changeait de vêtements e lui disait:
–Allez toujours, mademoiselle, vous n’userez jamai tout le savon de la blanchisseuse.
Elevée dans de pareils principes, habituée, encouragée même à ne faire que ses volontés, on voit d’ici comment Antoinette grandit. A quinze ans, elle ne sa vait rien. Notions de morale ou de piété, tout lui étai inconnu. Le peu de catéchisme qu’elle avait appris pou faire sa première communion n’avait laissé en elle aucun vestige. Rien ne la modérait, ne la retenait, que son caprice.
Ne pouvant plus se traîner dans le jardin, elle acheta pour se distraire, un pistolet de salon d’abord, puis une carabine, et fit une guerre impitoyable aux oiseaux, aux mulots surtout.
Cette fois, le jardinier se pâmait d’aise. Grâce à l’adresse d’Antoinette, les plus beaux fruits se prélassaient : sur les espaliers, protégés des rongeurs par le coup d’œil sûr de la jeune fille.
Cette passion ne fut pas de longue durée. Il lui prit alors des fantaisies de littérature.
Comme elle n’avait rien appris, elle ne pouvait lire, sans dormir, un ouvrage sérieux. Un jour qu’elle sommeillait doucement, tenant encore à la main le livre qui l’avait magnétisée, Rose entra.
Rose, c’était sa femme de chambre.
Au bruit qu’elle fit, Antoinette se réveilla.
–Ah! c’est toi, dit-elle. Tant mieux! ce maudit livre m’avait endormie.
–Aussi, fit Rose, pourquoi lisez-vous des livres semblables? Ceux que j’ai sont bien plus amusants. Je vous réponds qu’ils ne vous endormiraient pas.
–Vraiment? Eh bien! prête-les moi.
––Ah! non, par exemple! Si monsieur vous les voyait dans les mains, il serait capable de me renvoyer.
–C’est donc bien vilain?
–Paul de Kock! C’est très-amusant, au contraire; seulement c’est un peu... un peu... croustilleux. Mais ajouta-t-elle vivement, ne croyez pas que ce soient de mauvais livres, mademoiselle! Tout le monde les lit.
–Alors, si tout le monde les lit, pourquoi ne les rais-j e pas?
–Pour ma part je n’y vois pas d’inconvénient, ma demoiselle; mais votre père...
–Eh! mon père n’en saura rien, n’aie pas peur. par hasard il les trouve, je lui dirai que j’ai acheté ce livres au hasard... sans savoir pourquoi ni comment.
–Vous me le promettez?
–Sur mon honneur!
–Alors, ce soir, avant de vous mettre au lit, je vous en apporterai un.
Le soir même, Hose remit à sa jeune maîtresse u roman intitulé: La pucelle de Belleville.
–Tiens! c’est gentil ce titre-là, fit Antoinette, qu avait entendu parler de la Pucelle d’Orléans. Est-ce qu ça ressemble à l’histoire de Jeanne d’Arc?
–Pas tout à fait, répondit Rose en souriant.
Antoinette prit le livre dès qu’elle fut couchée, et n s’endormit pas.
Après ce volume-là elle en dévora un second, puis un troisième; puis toute la série y passa. Son innocence fit comme la série.
Depuis ce moment, elle s’adonna presque exclusive ment à la lecture des romans, choisissant de préférence ceux dont le titre promettait à sa curiosité des révélations malsaines.
A dix-huit ans, elle en était arrivée à éteindre presque entièrement l’esprit au profit de la chair. Elle était gourmande, sensuelle, avide d’émotions, piquée par une tarentule inexplicable, qui allumait parfois dans ses yeux des lueurs soudaines et qui lui donnait le frisson de la tête aux pieds.
Elle cachait habilement cette bibliothèque de choix dans un meuble dont elle seule avait la clef, de sorte que son père, toujours préoccupé, ne découvrit jamais cette contrebande effrénée.
Qu’on ajoute à ces dispositions d’esprit, celles d’un tempérament robuste, d’une constitution vigoureuse, et l’on se figurera quelle femme promettait d’être Antoinette.
! Elle n’était pas belle dans la pure acception du mot. Elle était belle fille seulement.
Des cheveux noirs, épais, un peu crépus et ondulant naturellement, surmontaient un large front, que terminaient deux sourcils nettement arqués. Au-dessus d’un petit nez rond, aux narines un peu trop larges, mais d’une excessive mobilité se dessinait une jolie bouche, bien fraîche, bien rose, aux lèvres bien pleines, et qui faisait voir en riant deux rangées de petites dents irréprochablement alignées.
Au milieu d’un menton gracieusement arrondi, on apercevait une fossette assez profonde. Enfin ses grands yeux noirs, légèrement voilés par de longs cils, mais expressifs, langoureux ou passionnés tour à tour, achevaient de donner à sa physionomie un cachet de sensualité qui ne pouvait échapper à l’œil du moias clairvoyant observateur.
Le col était fort, bien planté sur de larges épaules, qui s’effaçaient pour mieux laisser voir les contours d’une gorge ferme et ronde. La taille, flexible et hardiment cambrée, faisait ressortir voluptueusement les formes accusées qui la dessinaient.
Les mains n’étaient pas laides. C’étaient celles d’une désœuvrée qui avait tout le temps de les soigner, mais elles n’avaient pas l’élégance aristocratique d’une femme de race. De même le pied, ni trop petit ni trop grand, était un peu plat, et ne se cambrait pas, comme la taille sous le corset, dans la bottine de chevreau qui l’emprisonnait étroitement.
Antoinette était donc une nature robuste, un peu commune, mal élevée, volontaire, pervertie déjà par des lectures toujours dangeureuses à un âge aussi tendre. Seulement elle avait de la jeunesse, de l’éclat, de la malice, de la gaieté, et le sourire qui errait presque toujours sur ses jolies lèvres avait une grâce qui empêchait de s’arrêter trop longuement sur les petites imperfections que nous avons signalées.
Le jour où, pour déférer à l’invitation qu’il avait reçue, Roger se présenta vers six heures à la porte de la maison particulière qu’habitait M. Voisin, celui-ci n’était pas encore de retour.
Rose le fit entrer, lui ouvrit la porte du jardin, en lui disant que Mlle Antoinette s’y trouvait et se ferait un plaisir de le recevoir.
Roger s’aventura donc dans le jardin et distingua bientôt, en effet, la jeune tille, habillée comme une ingénue d’une robe de mousseline blanche, mais d’une mousseline si transparente qu’elle permettait d’admirer à loisir tout ce qu’elle avait la prétention de vouloir cacher.
Dès la première page de ce récit, Antoinette entre en scène. Si peu question qu’il soit d’elle dans la dispute qui s’élève entre Roger et Germain, on devine qu’elle est entre eux un sujet de discorde.
En effet, si l’on s’en souvient, Germain se plaignait avec une certaine amertume qu’Antoinette, chaque fois qu’elle venait à l’atelier, regardât avec trop de persistance le cabinet vitré dans lequel, entouré de ses livres, se tenait Roger.
C’était par défiance, croyait Germain.
Le croyait-il réellement, ou cherchait-il à s’abuser lui-même sur la véritable signification de ces regards? Peut-être.
Dans tous les cas, les ouvriers ne partageaient pas son avis.
Antoinette, en effet, avait voulu faire de la popularité dans la petite république que présidait son père.
Un beau jour, la fantaisie lui avait pris de parcourir les ateliers, chose qu’elle n’avait jamais faite qu’une fois, alors qu’elle était toute petite et que son père la conduisait par la main.
Si jeune qu’elle fût à cette époque, il lui était resté de cette première visite une impression profonde.
Dans son jeune cerveau une comparaison effrayante s’était alors établie entre sa petite taille, son extrême faiblesse, et le volume gigantesque des machines, la profondeur et la largeur des cuves au fond desquelles fermentaient les acides, et la dimension des cornues où se condensaient les cristaux. Il lui était donc resté dans la mémoire une impression assez semblable à celle que dut ressentir Gulliver quand il débarqua à Brobdingnag, dans le pays des Géants.
En refaisant, à douze ou treize ans de distance, cette visite qui était restée gravée si profondément dans son esprit, elle se figurait sans doute ressentir les mêmes étonnements.
Ce fut presque une déception qu’elle éprouva. Elle ne s’expliqua pas du premier coup par quel phénomène bizarre toutes choses avaient repris à ses yeux leurs véritables proportions. Comme elle se retirait, profondément désappointée, elle se trouva face à face avec Roger, qui regagnait la pièce qui lui était affectée, et qu’elle avait vu dix ou douze fois déjà, alors qu’il traversait les cours ou qu’il venait prendre les ordres de M. Voisin.
–Mademoiselle, lui dit-il en riant, l’entrée des ateliers est sévèrement interdite au public; vous avez enfreint la consigne, vous êtes à l’amende.
–A l’amende de quoi? demanda-t-elle.
–D’une dizaine de bouteilles de vin, que vous ferez vider par les ouvriers, si vous voulez; ce qui leur permettra de boire pour la première fois à votre santé.
Antoinette trouva l’idée originale et, comme Germain, qui lui avait servi de guide, se trouvait encore à ses côtés, elle lui donna l’ordre d’aller chercher les dix bouteilles de vin à la maison.
Germain ne pouvait guère se soustraire à cette prière, faite de la voix la plus gracieuse du monde; mais il sortit en jetant un regard furieux sur Roger qui, le premier, avait eu cette excellente idée.
Un quart d’heure après, les trente ouvriers de l’usine étaient réunis autour d’une cuve renversée, dont ils avaient fait une table, et buvaient à la santé de la patronne.
–Ce n’est pas à ma santé qu’il faut boire, mes amis, répondit-elle, car je n’avais pas songé à vous faire cette surprise: c’est à celle de M. Roger, qui m’en a suggéré la pensée.
–A la santé de M. Roger! crièrent docilement les ouvriers.
Et ils le firent d’autant plus volontiers qu’ils aimaient beaucoup ce jeune homme. Si peu de relations qu’ils eussent avec lui, ils avaient été maintes fois à même d’apprécier son extrême douceur et son exquise urbanité,–ce à quoi l’ouvrier est plus particulièrement sensible qu’on ne le croit.
Le mouvement que cette scène avait occasionné avait été une distraction pour Antoinette. Elle était revenue plusieurs fois. Si, à chacune de ses visites, elle ne se faisait pas accompagner par un panier de dix bouteilles, elle s’exécutait de temps à autre avec trop de grâce pour que sa présence ne fut pas désirée.
Chaque fois qu’elle était venue, elle avait trouvé Roger dans son cabinet. Il s’était levé à son arrivée et à sa sortie pour la saluer, puis il avait repris sa place et s’était remis au travail.
Ce manège durait depuis deux mois environ, au moment où survint l’aventure du pendu.
Les ouvriers n’avaient pas été sans faire des commentaires à propos de ces visites fréquentes et soudaines. Comme Germain, ils avaient remarqué qu’Antoinette regardait beaucoup le cabinet vitré, devant lequel elle avait soin de passer et de repasser plusieurs fois.
Loin de s’imaginer, comme Germain, que ce fût par défiance que la jeune fille agissait de la sorte, ils avaient cru au contraire que M. Roger ne lui déplaisait pas, et ils en avaient été ravis, car ils n’avaient pas manqué de remarquer aussi que Germain Cassut faisait beaucoup de frais pour recevoir Antoinette et déployait envers el! e toutes les ressources de son amabilité.
Or, ils aimaient beaucoup Roger et il détestaient cordialement Germain.
Plusieurs raisons militaient en faveur de ces deux sentiments. D’abord Roger s’était toujours montré très-affable avec les ouvriers, tandis que Germain, le contre-maître, avait sur eux la haute-main, leur distribuait l’ouvrage, leur infligeait les amendes, etc.
Cependant tout cela n’aurait rien été si Germain avait usé de ses droits dans une sage mesure, car dans toutes les usines du monde il y a des contre-maîtres jouissant exactement de privilèges identiques; mais Cassut était autoritaire, tyrannique, souvent injuste, ce que l’ouvrier ne pardonne pas.
Sentant instinctivement la préférence que Roger avait conquise, Germain en avait conçu une jalousie farouche. Il ne pouvait pas se venger de ce rival qui, loin d’être sous ses ordres, échappait au contraire à sa taquine surveillance, et occupait dans l’usine un poste plus condérable et plus considéré que le sien.
De cette jalousie était née une sombre colère, qui n’attendait que l’occasion d’éclater, et dont le bois de Verneuil avait été le premier témoin.
Depuis ce moment, il est vrai, les manières de Germain s’étaient infiniment radoucies. S’il avait eu pour Antoinette les mêmes prévenances que par le passé, au point de montrer ostensiblement l’inclination qu’il avait pour elle, il avait témoigné envers Roger beaucoup de déférence et voilé sa jalousie d’un masque d’hypocrisie assez habile.
Personne pourtant n’en avait été dupe: pas plus Roger que les ouvriers, ni qu’Antoinette.
Aussi, peu à peu, ne pouvant pas tolérer publiquement les assiduités ridicules de Germain, la jeune fille avait renoncé à venir dans l’atelier.
Elle avait alors adopté une autre tactique.
De temps en temps, elle prenait son père à partie et lui adressait des questions dans le genre de celles-ci:
–Es-tu content de l’employé que M. Dalbrègue t’a recommandé? Fait-il bien son service? Est-il toujours exact? A-t-il de l’intelligence? Est-il bien élevé?
–Oui, répondait invariablement M. Voisin.
–Alors, pourquoi ne pas l’encourager et lui montrer que tu es satisfait? dit enfin Antoinette, après avoir pendant quinze jours préparé l’assaut.
–Je ne demanderais pas mieux, fit M. Voisin; mais que veux-tu que je fasse? J’y ai bien songé, malheureusement je ne suis pas assez riche.
–Oh! il y a bien d’autres moyens, dit négligemment la jeune fille,–moyens auxquels ce jeune homme serait peut-être plus sensible encore.
Lesquels?
–Que sais-je, moi? Lui montrer un peu plus de bienveillance, l’inviter à dîner de temps en temps, le traiter en ami plus qu’en employé.
–Tu as raison, fit vivement son père. Comment n’en ai-je pas eu la pensée! En effet, cela ferait plaisir à M. Dalbrègue.
–Eh bien! afin de ne pas le déranger de ses occupations, invite-le à dîner pour un jour où l’on ne sait que faire... un dimanche, par exemple.
–C’est juste et je vais de ce pas.
–Bien, mais ne va pas lui dire que c’est moi qui t’en ai donné l’idée.
–Il n’y a pas de danger!
Sur-le-champ, en effet, M. Voisin était allé trouver Roger, et, après l’avoir félicité du zèle et de la ponctualité dont il faisait preuve, l’avait prié de venir dîner avec lui le dimanche suivant.
Roger avait accepté avec empressement.
Antoinette avait raison. Rien ne pouvait flatter plus agréablement l’amour-propre du jeune employé que cette marque de courtoise sympathie.
Depuis trois ans qu’il était dans la maison, c’était à peu près la première fois que M. Voisin lui témoignait ostensiblement sa satisfaction. Or, on a beau ne remplir son devoir que pour obéir à sa conscience, on n’est pas fâché que les autres s’en aperçoivent et nous en soient reconnaissants.
Roger avait été invité pour six heures et demie précises. Il crut faire acte de politesse en n’arrivant pas uniquement au moment de se mettre à table.
Mais il n’y avait pas de dimanches pour l’infatigable M. Voisin. Tout occupé de son invention nouvelle, il était toujours par monts et par vaux, à la recherche d’applications imprévues, de procédés inconnus, d’instruments perfectionnés, de sorte qu’il n’avait pas un instant de repos.
Il était parti pour Paris après déjeuner, en disant qu’il reviendrait par le train de cinq heures vingt-cinq, ou de cinq heures cinquante, et, comme il faut plus d’une heure pour faire le trajet de Paris à Meulan, il ne pouvait pas être de retour avant sept heures au plus tôt.
En voyant arriver Roger, Antoinette se leva et se chargea d’excuser son père. Ensuite elle fit parcourir le jardin à son invité, lui montra ses richesses, et fut fort étonnée de voir qu’en matière de fleurs et de fruits Roger s’y connaissait beaucoup mieux qu’elle.
Elle ne put s’empêcher d’en manifester son étonnement.
–Cela n’a rien de surprenant, mademoiselle, dit Roger. J’ai toujours habité la campagne. Depuis mon enfance j’ai eu à ma disposition, hiver comme été, le jardin de M. Dalbrègue, si bien qu’à moins d’être absolument indifférent à ce que j’avais sous les yeux, il m’était impossible de ne pas suivre avec intérêt les mille et une transformations de la nature.
–Je vous fais mon compliment, monsieur, car j’ai eu les mêmes facilités que vous et je ne vous cache pas que je n’en ai pas tiré grand profit.
–Ah! c’est que notre situation est bien différente, mademoiselle. J’étais pauvre et j’avais besoin d’apprendre pour gagner ma vie plus tard, tandis que vous...
–Je suis riche, allez-vous dire, interrompit Antoinette. Eh bien!non, monsieur, détrompez-vous, je ne le suis pas. Savez-vous en quoi consiste la fortune de mon père?
–Jamais, mademoiselle, je ne me serais permis de pousser l’indiscrétion jusqu’à...
–Il n’y a pas d’indiscrétion, monsieur. Tout le monde sait que si mon pauvre père n’était pas possédé de la monomanie de l’invention, nous serions riches, en effet; mais on n’ignore pas davantage qu’il ne possède rien que cette usine. Encore est-elle fort délabrée et aurait-elle grand besoin de réparations.
–C’est vrai, mademoiselle; mais, dans l’état ou elle est, elle n’en représente pas moins une fortune.
–A combien l’estimez-vous donc?
–Mais, mademoiselle... balbutia Roger hésitant.
–Oh! parlez sans crainte, monsieur. Vous voyez que je ne me prive pas de dire la vérité.
–Eh bien! je crois qu’elle vautau moins quatre cent mille francs.
–Ah! c’est votre avis? fit Antoinette avec une visible satisfaction.
–Oui, mademoiselle. Elle en vaudrait cinq ou six cent mille si elle était en bon état...
–Je sais, je sais... dit vivement la jeune fille, mais elle ne l’est pas. Eh bien! monsieur, telle qu’elle est, mon père donnerait cette usine pour deux cent mille francs!
En disant ces mots, elle regarda hardiment en face Roger, qui demeurait littéralement pétrifié de surprise.
–Vous paraissez très étonné de ce que je vous dis là, reprit Antoinette, et pourtant c’est mon père, lui-même, qui, plusieurs fois, m’en a fait l’aveu.
–Alors, je n’y comprends rien, mademoiselle.
–Il est vrai que je ne vous ai pas tout dit, continua la jeune fille, un peu troublée, si résolue qu’elle fût à aller jusqu’au bout.
–A la bonne heure! fit naïvement Roger.
Ils étaient assis sous une tonnelle que la vigne vierge, le jasmin et la clématite recouvraient d’une épaisse couche de verdure. Quoiqu’il fit grand jour encore, le soleil baissait à l’horizon; de sorte que la tonnelle était plongée maintenant dans une demi-obscurité qui semblait provoquer les confidences.
Assis sur un des bancs renversés qui ornent actuellement tous les squares de Paris, Roger pouvait contempler de près la magnifique créature qui se trouvait à ses côtés. Sous la mousseline indiscrète qui recouvrait ses bras et ses épaules, il apercevait une peau fine, mate, satinée, et la naissance d’une gorge blanche et ferme, dont la pose renversée d’Antoinette faisait saillir les splendeurs.
Si calme que fût Roger d’ordinaire, il n’avait pas d’yeux pour ne pas voir. Il ne pouvait donc pas s’empêcher d’admirer la beauté de cette carnation, la voluptueuse richesse de cette nature plantureuse, qui étalait devant lui avec une feinte naïveté tant d’inappréciables trésors.
Antoinette devinait tout ce qui se passait en lui, en vertu de ce don spécial que possèdent les femmes de tout voir sans rien regarder.
–Ah! fit-elle en riant, toutes les médailles ont leur revers.
Comment? demanda Roger.
–Oui. Celui qui prendrait l’usine de M. Voisin pour deux cent mille francs serait obligé de prendre sa fille par-dessus le marché.
–Ah! je comprends! fit Roger. En effet, la combinaison serait avantageuse à tous les titres pour l’acquéreur.
Il croyait ne faire qu’un de ces compliments banals tels qu’on en débite chaque jour à une jeune fille.
Vous trouvez? dit Antoinette en baissant les yeux.
–Assurément, mademoiselle. Il ne s’agit que d’avoir les deux cent mille francs.
–Oh! ce n’est pas si difficile que vous paraissez le croire.
Roger la regarda. Que signifiaient ces paroles?
–Il est toujours difficile à quelqu’un qui n’a rien de se procurer une somme de cette importance, répliqua-t-il,
–Cela dépend, fit Antoinette,
–Sans doute. Il est certain qu’un homme dont les parents jouissent d’une assez belle fortune, peut, à la rigueur, escompter l’avenir et se procurer le capital nécessaire; mais pour celui qui n’a ni fortune, ni famille.
–Pour celui-là même, insista la jeune fille, il y a le chapitre des ressources imprévues.
Roger la regarda de nouveau. Décidément c’était bien à lui que s’adressaient ces propositions indirectes, puisque Antoinette semblait vouloir détruire une à une les objections qu’il soulevait.
–Mais, fit-il observer, qu’entendez-vous par ressources imprévues?
–Oh! c’est à l’infini, répondit-elle; mais, si vous le permettez, prenons un exemple entre mille.
–Voyons., dit curieusement Roger.
–Et tenez, parlons de l’aventure qui vous est arrivée il y a bientôt un an.
–Ah! celle du pendu.
–Précisément. Eh bien! n’est-ce pas, dans la véritable acception du mot, ce que l’on peut appeler le chapitre des ressources imprévues?
–Oh! tout à fait imprévues, c’est vrai.
–Vous voyez donc bien que ce n’est pas si difficile que vous le prétendiez tout à l’heure, car, si vous l’aviez voulu, vous aviez là deux cent mille francs qui vous tombaient du ciel.
Oui, mais vous savex bien, mademoiselle, que j’ai repoussé cette fortune avec horreur.
–Pas définitivement, monsieur.
–Sans rémission, mademoiselle.
–Vous vous trompez, monsieur. Je connais à fond cette histoire et je sais quel a été son dénoûment à cette époque. Or l’argent est encore entre les mains du parquet; il ne doit s’en dessaisir que dans neuf jours, et d’ici-là vous avez le temps de vous raviser. Le juge d’instruction vous l’a dit, souvenez-vous en bien.
–Je me le rappelle parfaitement, mademoiselle, mais rien ne me fera changer de résolution.
Elle eut un mouvement de dépit imperceptible, assez prononcé pourtant pour que Roger s’en aperçût. Il n’avait aucune raison pour se montrer brutal et grossier. Il essaya de la convaincre par d’autres arguments.
–D’ailleurs, reprit-il, alors même que je me raviserais, je ne pourrais prétendre qu’à la moitié de cette somme. Il est certain que Germain y a les mêmes droits que moi.
–Il y aurait matière à discussion, fit Antoinette. Je l’admets cependant; mais je ne considère pas ce partage comme un obstacle insurmontable. Cent mille francs, en beaux billets de banque, sont un chiffre bien capable d, e tenter un homme qui, comme mon père, est toujours à court d’argent. S’il se montrait trop rebelle, rien ne serait plus facile alors que de se procurer sur hypothèque le reste de la somme à laquelle il réduirait définitivement ses prétentions. En peu d’années, avec du travail et de l’économie, on rembourserait cet emprunt.
L’usine, vous le savez mieux que moi, rapporte tous les ans, si mal dirigée qu’elle soit et si incomplétement qu’elle fonctionne, une trentaine de mille francs nets; que serait-ce donc si elle tombait entre les mains d’un homme jeune, actif, laborieux, prudent et qui ne s’occuperait absolument que de cette affaire?
A ces mots, elle s’arrêta, confuse et rougissante.
–Mais pardon, fit-elle. L’exemple que j’avais choisi au hasard m’a entraînée plus loin que je ne me le figurais moi-même.
Elle se leva et fit jouer son éventail.
–C’est que je m’étais animée! dit-elle en se tournant vers Roger avec un sourire.
Il est certain qu’elle était charmante ainsi. Ses joues s’étaient colorées, ses yeux brillaient du plus vif éclat et le corail de ses jolies lèvres tranchait sur le pur émail de ses dents blanches.
Roger lui-même était un peu troublé. Il ne pouvait plus douter de la vérité. Antoinette lui avait nettement proposé d’acheter l’usine et de devenir son mari.
La situation devenait embarrassante.
Sans doute la jeune fille ne jugea pas nécessaire de pousser plus avant ses séductions, et ne voulut pas exiger une réponse immédiate, car, pour rompre la conversation, elle s’écria:
–Si nous allions au-devant de mon père!
Roger accepta la proposition avec empressement.
–Je suis à vos ordres, mademoiselle, dit-il.
Ils quittèrent la verte tonnelle, traversèrent le jardin et entrèrent dans la maison.
Déjà Antoinette avait posé sur sa tête un coquet chapeau de paille d’Italie, garni de fleurs des champs, quand la porte s’ouvrit et M. Voisin arriva, tout essoufflé.
–Tiens! nous allions au-devant de toi, lui dit sa fille.
–Pardonnez-moi, monsieur Roger, de vous avoir fait attendre si longtemps, balbutia M. Voisin, mais j’ai été retenu à Paris par des affaires importantes.
–Allons, à table! interrompit Antoinette. Tu t’excuseras plus tard. Est-ce que tout le monde ne te connaît pas bien? Il est sept heures passées, M. Roger doit mourir de faim.
Tout en disant ces mots, elle défaisait son chapeau et ouvrait la porte de la salle à manger.
Roger lui offrit son bras et prit place à ses côtés, en face de M. Voisin.
–A propos! dit le père d’Antoinette, j’ai rencontré dans le train M. Dalbrègue, qui revenait de Paris. Il paraît qu’il est définitivement installé dans sa maison de campagne depuis une huitaine de jours. Le saviez-vous?
–Oui, M. Dalbrègue m’a fait parvenir un mot il y a trois jours. Je suis même allé lui faire une visite aujourd’hui.
–Et vous ne l’avez pas trouvé, bien entendu?
–Non, je n’ai vu que Mlle Laurence.
–Sa fille, oui. Je ne l’ai pas vue depuis dix-huit mois. Il paraît que c’est une fort jolie personne.
–En effet, monsieur. Et non-seulement une fort jolie personne, mais une jeune fille sage, réservée, instruite, digne en tous points de l’estime et du respect de tous.
–Oh! mais... fit Antoinette, vous en parlez avec une chaleur...
Roger rougit légèrement.
–Je ne m’en cache pas, mademoiselle, j’ai pour elle une admiration sans bornes, tout comme je suis dévoué, corps et âme, à M. Dalbrègue. Je serais le plus ingrat des hommes si je n’étais pas pénétré d’une profonde reconnaissance envers ceux qui m’ont comblé de leurs bienfaits.
–Et vous parlez d’or, mon cher ami, dit M. Voisin, car si vous êtes aujourd’hui à même de gagner votre vie, c’est bien certainement à eux que vous le devez.
–Je ne saurais le proclamer assez haut, continua Roger d’une voix forte.
–Et Mlle Laurence vous a reçu? demanda Antoinette.
–Sans doute, répondit Roger. Ne suis-je pas, après son père, je ne dirai pas son plus vieil ami, mais sa plus vieille connaissance? Ne l’ai-je pas vue naître?
Antoinette ne répliqua pas, mais elle jeta sur le jeune commis un regard qui semblait vouloir fouiller au fond de sa pensée.
Roger n’était pas homme à baisser les yeux pour si peu, quand il s’agissait de ses bienfaiteurs. Il soutint ce regard avec une si noble franchise qu’Antoinette se détourna.
Le léger nuage qui avait obscurci son front se dissipa du reste assez promptement. Elle se montra enjouée, prévenante envers son hôte autant qu’il est possible de l’être.
Or, elle était charmante quand elle le voulait. Ses lectures lui avaient donné une expérience précoce, qu’elle savait dissimuler sous les apparences de la plus candide ingénuité.
Après le dîner, on revint sous la tonnelle, où le café était servi à côté d’une caisse d’excellents cigares.
M. Voisin, de son côté, fut excessivement aimable envers son commis. De nouveau il le félicita de son zèle et de son exactitude.
–Si ma nouvelle invention réussit, dit-il en finissant, j’augmente vos appointements d’un tiers, mon cher monsieur, car jamais la place que je vous ai confiée n’a été si bien remplie.
Roger ne put réprimer un sourire. Il savait à quel résultat aboutissaient en général les inventions du vieux chercheur.
Enfin, presque nécessairement, la conversation retomba sur l’aventure du pendu.
–Persistez-vous à refuser cette fortune? demanda M. Voisin.
–Jusqu’à présent, oui, monsieur.
–Je conçois très-bien le sentiment qui vous guide, répliqua son patron, mais je ne sais pas trop jusqu’à quel point, dans la situation où vous êtes, vous avez le droit de la refuser.
–Comment? fit Roger, tandis qu’Antoinette se penchait vivement en avant.
En effet, elle n’espérait pas trouver à point nommé, auprès de son père, un auxiliaire si puissant.
–Oh! je vous le dis comme je le pense, reprit M. Voisin. Vous ne savez pas ce que c’est que cent mille francs, mon pauvre ami! Vous ne vous figurez pas ce qu’une pareille somme représente de travail, de luttes, de déboires! Vous ne vous imaginez pas quel levier puissant un capital semblable représente dans l’industrie! Or, vous n’avez rien. Vous êtes, pour ainsi dire, condamné àvivre éternellement dans la position subalterne que vous occupez. Tant que vous êtes garçon, ces n’est rien; mais si vous vous mariez, si vous avez de la famille, voyez quel tort immense vous faites à vos enfants! Combien vous regretterez alors le scrupule qui vous arrête aujourd’hui! En principe, il est très-honorable, je ne dis pas non; mais il est puéril, croyez-moi, en raison des immenses satisfactions dont il vous prive. Aussi, si j’étais à votre place, je vous avoue que j’hésiterais longtemps avant de sacrifier mon avenir à un sentiment un peu exagéré peut-être de probité.
–Lui aussi! pensa Roger. Est-ce qu’il s’entendrait avec sa fille? Un homme comme lui!Non, ce n’est pas possible!
Roger pouvait à bon droit s’étonner d’entendre tomber de telles paroles de la bouche de M. Voisin.
La réputation du vieux manufacturier était en effet bien établie. Depuis trente ans qu’il habitait le pays et qu’il était à la tête de son usine, tout le monde avait été à même d’apprécier ses défauts et ses qualités. Or, on savait que le vieux chimiste était un rêveur, mais on savait aussi que c’était un parfait honnête homme.
Ce qu’on lui reprochait le plus sévèrement, ce n’était ni l’extrême versatilité de son esprit, ni l’imprévoyance avec laquelle il avait dissipé tout ce qu’il avait gagné, c’était la faiblesse impardonnable qu’il avait montrée envers sa fille.
L’ignorance d’Antoinette était un fait avéré pour tous ceux qui l’avaient approchée. Parmi ceux-là se trouvaient des observateurs, qui l’avaient étudiée de près et avaient été effrayés des instincts qui se révélaient en elle.
Elle était avec les hommes en général d’une familiarité souvent embarrassante, et laissait échapper des mots si étranges, qu’on se demandait s’ils étaient le résultat d’une perversité précoce ou d’une çandeur poussée à la limite de l’invraisemblable.
Il est vrai qu’elle avait perdu sa mère dès sa plus tendre enfance et que rien au monde ne peut remplacer une mère; mais combien d’autres jeunes filles avaient été dans la même situation qu’elle et, grâce à la vigilance paternelle, au choix des maîtres qu’elles avaient eus, étaient restées de simples et gracieuses personnes!
–Et tenez, disait-on à ce sujet, voyez la fille de M. Dalbrègue. N’a-t-elle pas été élevée absolument dans les mêmes conditions? Comme Antoinette, n’a-t-elle pas perdu sa mère à l’âge de trois ou quatre ans? Y a-t-il cependant une jeune fille plus modeste et plus accomplie?
L’exemple était concluant. Aussi toutes les riches familles d’alentour recherchaient Laurence; aucune ne recevait Antoinette.
M. Voisin s’en était bien aperçu. Mais le mal était sans remède. Qu’y faire d’abord? Un père n’a-t-il pas; pour son unique enfant toutes les indulgences? Ne s’aveugle-t-il pas sur ses imperfections tout autant que sur ses qualités?
Plus que personne, le vieux chimiste devait fermer les yeux. Toujours perdu dans les nuages, il voyait à peines ce qui choquait les autres et ne s’inquiétait pas de la solitude au sein de laquelle vivait sa fille. C’était avec) les yeux de la foi qu’il admirait Antoinette, et l’on sait que la foi exclut le raisonnement et la discussion.
Comment en vouloir à ce malheureux père d’une faute dont il n’avait pas conscience? Il était distrait, crédule, faible, sans doute, mais tenait-il scrupuleusement les engagements qu’il avait pris? Oui. L’avait-on jamais entendu dire du mal de qui que ce fût? Non. La fable de La Fontaine, qui fait tomber l’astrologue au fond d’un puits, ne dit pas qu’il fût un malhonnête homme.
Aussi Roger hésitait. Si les propositions d’Antoinette ne l’avaient pas ébranlé, les paroles de M. Voisin lui donnaient fort à penser.
Vers dix heures du soir, il se retira.
Antoinette l’accompagna jusqu’à la porte.
–Vous voyez que je ne suis pas seule de mon avis, lui dit-elle à demi-voix.
Roger ne répondit pas. Il s’inclina profondément et s’éloigna.
–Parbleu! je le sais bien qu’elle n’est pas seule de son avis, se disait-il en regagnant son logement. Assez d’autres personnes m’ont répété la même chose depuis bientôt un an, sans parler de ceux qui m’ont traité d’imbécile, de crétin et d’idiot. Auquel croire? Est-ce que décidément je ferais une sottise?
Il fit quelques pas avant de répondre au point d’interrogation qui terminait son monologue; puis, s’arrêtant brusquement:
–Non, non, mille fois non!s’écria-t-il. Tout mon être se révolte à la pensée de réclamer cette fortune. Je ne le ferai pas.
Il rentra chez lui, un peu plus calme. Pourtant, en dépit de la résolution dans laquelle il venait de s’affermir, les propositions singulières d’Antoinette se représentaient à sa pensée.
–Quels motifs la font agir? se demandait-il. Est-ce qu’elle a du goût pour moi? N’obéit-elle qu’à un simple calcul? Que m’importe après tout? Je ne l’aime pas, je ne l’aimerai jamais. D’aucune façon ce mariage ne peut donc s’accomplir. Ah! si c’était...
Il n’osa pas achever sa phrase.
–Je suis fou! murmura-t-il en haussant les épaules N’y pensons plus.
Le lendemain, il avait repris ses occupations. La semaine se passa sans incident. Le samedi soir, un heure avant qu’il quittât son bureau, il vit entrer M Dalbrègue.
Il se leva précipitamment pour lui offrir un siège.
–Ne te dérange pas, lui dit M. Dalbrègue, je ne m’arrête pas. En passant devant l’usine, je me suis rappelé que c’était demain dimanche et que tu étais libre ce jour-là. J’ai pensé que si tu n’avais riende mieux à faire, tu ne serais pas fâché de venir passer la journée à la maison.
–Comment! s’écria vivement Roger. Pouvez-vous croire, monsieur, que je ne déclinerais pas toute autre invitation pour accepter celle que vous me faites l’honneur de m’adresser!
–C’est précisément ce que je n’entends pas. Es-tu-libre ou non?
–Libre comme l’air, monsieur.
–Alors, c’est dit, fit M. Dalbrègue en lui tendant main. A demain. Et souviens-toi que nous déjeunons à onze heures.
Quoi qu’il fît pour s’opposer à ce que Roger quittât son bureau, celui-ci voulut absolument l’accompagner jusqu’à sa voiture.
Laurence y était.
–Venez-vous demain? lui cria-t-elle dès qu’elle l’aperçut.
–Oui, mademoiselle.
–A la bonne heure! fit-elle en lui envoyant de sa main finement gantée un petit salut amical.
M. Dalbrègue avait repris sa place et la voiture était déjà loin, que Roger la suivait encore du regard. Enfin sparut derrière un rideau d’arbres le long voile de ize blanche qui flottait sur le chapeau de Launce.
Roger poussa un long soupir et rentra.
Le lendemain, à dix heures et demie, il se présentait ez M. Dalbrègue.
Laurence était seule dans le salon quand le domestile introduisit Roger.
Ce salon était une idée de Laurence. Il formait une ste rotonde, percée de cinq larges fenêtres, devant chacune desquelles se trouvait une jardinière garnie de urs, qu’on renouvelait toutes les semaines.
De cette vaste pièce, que Laurence avait fait construire pendiculairement à la maison, on apercevait le jar
din tout entier, jardin qui ne mesurait pas moins d’un hectare, et dont, par suite de l’habile disposition des ssifs qui le composaient, on n’apercevait pas la
Cette pièce, entièrement tendue de perse blanche à grands ramages, et toute remplie du parfum des fleurs, fit d’une fraîcheur exquise. C’était celle qu’affectionit Laurence. C’était là qu’elle recevait ses amis.
En voyant entrer Roger, elle lui tendit franchement la in.
–Tiens! M. Dalbrègue n’est pas là? lit Roger.
–Non, il a été un peu indisposé cette nuit, mais je vu tout à l’heure; il va un peu mieux, je l’attends.
–Qu’a-t-il donc?
–Je ne sais, mais cet hiver, je vous l’ai dit, il a eu sque constamment des pesanteurs, des somnolences, it rien ne pouvait triompher. J’ai interrogé le docr, il ne m’a pas répondu; mais j’ai lu sur son visage inquiétude qui ne me présage rien de bon.
–Que dites-vous! s’écria Roger très agité.
–Je dis que j’ai peur.
–De quoi?
–Je n’en sais rien, mais j’ai peur.
–Espérons que vos craintes ne se réaliseront pas, mademoiselle... Et tenez... la preuve, c’est que voici M. Dalbrègue en personne...
En effet, la porte du salon s’ouvrit et M. Dalbrègue parut; mais Roger remarqua immédiatement combien la démarche du vieillard était lente et son pas pesant.
–Ah! te voilà, mon garçon, dit-il à Roger qui s’avançait lestement à sa rencontre. Tu es arrivé à propos, ma foi! Je veux prendre un peu l’air dans le jardin avant déjeuner, et, je ne sais comment cela se fait, je n’ai pas de jambes.
Roger s’empara de son bras et lui servit de guide.
–A la bonne heure! fit M. Dalbrègue qui pesa de tout son poids sur ce robuste point d’appui, voilà un bras comme il m’en faudrait un!
–Mais il est tout à votre service, monsieur, dit Roger.
–Tu plaisantes, sans doute? Et tes occupations?
–Je les quitterai.
–Ne t’en avise pas ou je te donne ma malédiction, riposta gaiement le vieillard. Ne faut-il pas que tu gagnes à ta vie?
–Et croyez-vous que ce ne serait pas la gagner ques de la consacrer à mon bienfaiteur?
–Ton bienfaiteur! Voilà un bien gros mot pour un peu de latin et de français que je t’ai fait apprendre....
–Sans compter vingt années de sollicitude paternelle, ajouta Roger.
–N’importe. Je te défends de quitter M. Voisin, dit M. Dalbrègue.
Il se tourna vers Laurence.
–C’est que ce maudit garnement-là serait capable le le faire comme il le dit, vois-tu! reprit-il. Il a une volonté... tu ne t’en fais pas une idée. Ainsi, cette hisoire de pendu... je gagerais qu’il est toujours aussi ntêté et qu’il ne veut pas...
–Et vous gagneriez, monsieur Dalbrègue, fit Ro-; er.
–C’est donc vrai? Tu persistes à repousser cette ortune?
–Oui, monsieur.
–Tu as tort, mon garçon, tu as tort.
–Quoi! vous aussi! s’écria Roger.
–Comment, moi aussi! On t’a donc déjà dit que tu vais tort?
–Cent fois, monsieur. Dimanche dernier encore, M. Voisin, chez qui je dînais...
–Eh bien! pourquoi ne l’écoutes-tu as? Il est de on conseil, M. Voisin; non pas pour lui, mais pour les utres. Il est certain qu’avec cette fortune, tu pourrais établir, te marier...
–Voyons, sérieusement, interrompit Roger, en le egardant en face, est-ce votre avis!
–Certainement.
–Soit! J’agirai comme vous me le conseillerez, je ous le jure! si vous me promettez de répondre franchelent à la question que je vais vous poser...
–Je t’en donne ma parole.
–Je ne suis plus Roger Montmaury, et vous n’êtes lus M. Dalbrègue, dit le jeune commis. Je suis M.X. vous êtes M. Z... Eh bien! répondez, monsieur Z..., i M.X... vous demandait la main de votre fille, la donneriez-vous à un homme enrichi de cet argent que vous m’engagez à revendiquer?
–Oh! non, se défendit vivement M. Dalbrègue; mais il ne s’agit pas de moi.
–Et pourquoi voudriez-vous qu’un autre fût moins scrupuleux que vous, ou que je prisse la fille du premier venu? Non. Vous avez prononcé, cher et vénéré bienfaiteur. N’en parlons plus, je vous en conjure.
–Mais, mon ami.
–Allons, père, interrompit Laurence en lui coupant la parole avec un baiser, tu as passé ton hiver à me dire que Roger se conduisait en honnête homme. Pourquoi veux-tu lui persuader le contraire maintenant?
M. Dalbrègue se mit à rire.
–Décidément, fit-il, on a toujours tort de parler devant les petites filles.
Roger adressa à Laurence un regard de profonde reconnaissance.