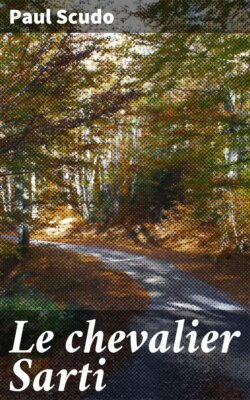Читать книгу Le chevalier Sarti - Paul Scudo - Страница 5
Оглавление«Vois-tu, Lorenzo! lui disait souvent cet aimable abbé, la musique ne s’apprend pas comme les matematiche. La voix est moins nécessaire pour bien chanter que le sentiment; et pour devenir un compositeur comme l’illustre Marcello ou le joyeux Buranello, il faut bien autre chose que de savoir écrire sur la cartella[11] quelques leçons de contre-point. Un grand poëte que tu ne connais pas encore, et qui s’appelait Horace, a prouvé que, pour faire de beaux vers ou de la bonne musique, il fallait le concours de la nature et du travail; ce qui veut dire que, sans la permission du bon Dieu, qui se révèle à nous par le sentiment,
C’est en vain qu’au Parnasse un téméraire auteur
Pense de l’art des vers atteindre la hauteur.»
«Ce serait vraiment trop commode, ajoutait un jour l’abbé Zamaria en effleurant de sa main les joues de Lorenzo, si l’on pouvait élever de jolis virtuoses comme toi, ainsi qu’on apprend à un papagallo à bégayer péniblement quelques mots confus. Non, non, me disait souvent mon maître le grand Benedetto Marcello, on ne va pas en paradis avec des coffres remplis de zecchini d’or, et, pour pénétrer dans le monde des belles choses, il faut être armé du rameau fatidique sans lequel on ne franchira jamais les rives éternelles. N’est-ce pas, signora Beata, que ces principes vous paraissent aussi vrais qu’à moi? Lorsqu’il s’agit des beaux-arts, et surtout de musique, l’opinion des femmes est très-importante à consulter.»
Beata répondit à cette interpellation par un sourire gracieux qui éclaira son beau visage d’un rayon lumineux. A ces causeries pleines de substance et d’incidents comiques succédaient des scènes plus animées, où l’abbé Zamaria donnait l’exemple, pour ainsi dire, des principes qu’il venait de développer. Il fallait le voir alors assis à son vieux clavecin, frappant de ses mains osseuses et jaunâtres sur un petit clavier qui ne dépassait pas cinq octaves, et dont les sons aigrelets ressemblaient à ceux d’une mandoline. «Allons, mon ami, disait-il à Lorenzo, chantons ensemble ce joli duo de Clari que tu as appris l’autre jour, et qui a pour objet l’éloge de la musique. Do, re, mi, che bella cosa che la musica! quelle belle chose que la musique! Sur ces paroles fort simples, l’abbé Clari a fait un morceau exquis, un canon à la sixte inférieure, d’une facture ingénieuse et savante. Tu n’as pas oublié, je l’espère, ce qu’on entend en musique par un canon? C’est une phrase plus ou moins longue, qui, après avoir été exposée par une voix, est reproduite par les autres jusqu’à la cadence qui forme le point d’arrêt; puis les phrases recommencent et se poursuivent ainsi jusqu’à la conclusion, comme un écho qui répète à des intervalles marqués le son qui l’a frappé. Il y a des canons à deux, à trois, à quatre et même à six parties. C’est une forme un peu vieillie aujourd’hui, qui était fort à la mode du temps de l’abbé Clari, vers la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce savant compositeur, dont l’imagination était remplie de grâce, est né à Pise en 1669. Il a été maître de chapelle à Pistoie, où il a publié en 1720 une nombreuse collection de duos et de trios avec un simple accompagnement de basse chiffrée qui sont des chefs-d’œuvre d’élégance. L’abbé Steffani, un nostro Veneziano, puisqu’il a vu le jour à Castelfranco, sur le territoire de la république, a imité avec bonheur la manière de l’abbé Clari; mais les duos de l’abbé Steffani, qui a vécu longtemps à Munich, puis à la cour de l’électeur de Brunswick, où il a connu Haendel, et qui est mort à Francfort en 1730, les duos de l’abbé Steffani, je suis forcé d’en convenir, ne valent pas ceux de l’abbé Clari, dont ils reproduisent les formes sans la grâce qui les caractérise. Allons, voyons, caro Lorenzo, attaque la première partie de soprano; moi, je chanterai celle de contralto: Do, re, mi, che bella cosa che la musica! do, re, mi, che bella cosa che la musica!»
Et l’abbé Zamaria, de sa voix chevrotante qui avait dû être jadis un ténor, s’animait, s’exaltait comme un enfant qui joue pour la première fois d’un instrument dont il ne connaissait pas la puissance.
«Bravo! Lorenzo, c’est cela; glisse rapidement sur cette syncope qui précède la conclusion du thème proposé; pas de sons de gorge, la voix pure et franche, mais sans efforts.... Do, re, mi, che bella cosa.... Oh! oui, la musique est une belle chose! s’écria l’abbé Zamaria après avoir achevé de chanter ce charmant duo, et en jetant par-dessus le clavecin la petite calotte de velours qui lui couvrait la tête. Va, mon cher enfant, tu as une organisation heureuse qui te rend digne de comprendre l’art admirable que nous aimons tous dans cette maison, et qui est le plus grand charme de la vie.»
Ces éloges adressés à Lorenzo par l’abbé Zamaria, qui n’en était pas prodigue, firent tressaillir le cœur de Beata, qui ne put comprimer entièrement l’émotion qu’elle ressentait. A mesure que Lorenzo grandissait et que son jeune esprit répondait aux soins dont il était l’objet, l’affection de Beata pour cet enfant que la fortune lui avait amené par la main grandissait aussi et remplissait son cœur d’une satisfaction pleine de charme, qui l’entraînait doucement vers un sentiment plus énergique dont elle ignorait la nature et la toute-puissance. Elle était tout simplement heureuse de voir s’épanouir cette jeune plante que Dieu avait commise à sa sollicitude; elle était heureuse de voir ses efforts couronnés de succès et de pouvoir se dire que son instinct ne l’avait pas trompée en lui inspirant la pensée de s’attacher le fils de Catarina Sarti. Cette adoption, qui avait été plutôt l’œuvre du hasard que le résultat d’une détermination préméditée, était d’ailleurs conforme aux habitudes de la haute aristocratie de Venise, qui aimait à étendre les rameaux de son autorité et à couvrir de sa protection tous ceux qui en réclamaient le bénéfice. Beata se laissait donc aller à son penchant sans se préoccuper de l’avenir et sans craindre que le sentiment confus qu’elle éprouvait pour Lorenzo pût jamais acquérir un caractère dangereux pour la sérénité de son âme. Fille d’un grand seigneur, fière de son nom et habituée dès l’enfance au respect qui était dû à l’illustration de sa famille, Beata ne pouvait s’alarmer de ces relations avec un jeune garçon qui avait quatre ans de moins qu’elle, et dont la naissance modeste eût été d’ailleurs un obstacle suffisant à des rêves impossibles. La différence de l’âge, bien plus sensible dans le Midi que dans le Nord, la distance que la fortune avait mise entre Beata et Lorenzo, distance qui, malgré l’altération des mœurs et l’affaiblissement des vieilles institutions, était encore plus respectée à Venise que dans aucun autre pays de l’Europe, toutes ces raisons, jointes au caractère de Beata et à la rare distinction de sa nature, ne lui permettaient point de s’inquiéter sur l’avenir d’un penchant qui se présentait sous les apparences d’une affection fraternelle. Aussi ne craignait-elle point d’avouer la joie que lui faisaient éprouver les succès de Lorenzo et de réclamer, avec une naïveté charmante, la part qui lui revenait dans son éducation. Elle l’avait entouré d’une sollicitude où se mêlait à son insu l’attraction mystérieuse des sexes, qui se fait toujours sentir, même entre les différents membres de la famille la plus chaste. Beata se disait tout bas, en voyant les rayons de la jeunesse effleurer le front de Lorenzo: «C’est moi qui l’ai fait ce qu’il est; c’est moi qui l’ai soustrait aux rigueurs d’une aveugle destinée! Il est mon œuvre, c’est l’écho de mon âme. S’il tient de sa mère la vie du corps, il me doit celle de l’esprit.»
C’est ainsi que Beata laissait échapper les premiers murmures de son cœur sans en approfondir la cause; c’est ainsi qu’elle voguait sur le courant facile qui l’entraînait, sans prendre garde aux dangers de la route. Bercée par des rêves charmants, les paupières mi-closes, elle écartait le jour qui aurait pu l’éveiller: il est si doux, le sommeil du matin! En grandissant sous la tutelle de Beata, Lorenzo, en effet, développait chaque jour les plus heureuses dispositions, qui le rendaient de plus en plus digne de l’intérêt de ses protecteurs. Docile, studieux et très-reconnaissant pour les soins qu’on lui prodiguait, son aimable caractère s’épanouissait sans efforts et semblait répondre à toutes les espérances qu’on avait conçues de lui. La musique, les langues et l’histoire formaient les principaux éléments de l’instruction qu’on lui avait donnée, et sur ce fond solide, qui ne pouvait que s’élargir avec le temps, l’imagination hardie de Lorenzo jetait les plus vives couleurs. Il se sentait heureux de vivre dans le milieu où l’avait conduit la fortune; il s’élançait dans la carrière qu’on lui avait ouverte avec une joie radieuse où se trahissait l’orgueil bien légitime d’une émancipation inespérée. Sa vive intelligence avait franchi presque sans douleur les obstacles de l’initiation, et il travaillait avec une telle ardeur, qu’on était souvent obligé de modérer son zèle.
La littérature française du XVIIIe siècle, qui était répandue dans toute l’Europe, et que l’abbé Zamaria lui avait fait connaître, commençait cependant à déposer dans l’esprit de Lorenzo quelques germes de ces doctrines nouvelles qui devaient soulever le monde et en changer les destinées. Les œuvres de Locke, de Condillac, de Voltaire, surtout celles de Rousseau, furent dévorées successivement et produisirent sur son imagination une fermentation que les pieux conseils de sa mère, qui venait souvent le visiter à la villa Cadolce, ne parvenaient pas toujours à calmer. Ce côté alarmant du caractère de Lorenzo, qui aurait pu briser en un instant l’édifice encore fragile de sa fortune, ne se révélait qu’à travers les lueurs d’une exaltation juvénile qui ne manquait point de grâce, et qui était plutôt de nature à charmer le regard attristé du vieux sénateur. Sans rien perdre du respect qu’il devait à ses protecteurs, sans oublier la distance qui le séparait de sa bienfaitrice, dont il était bien loin de soupçonner le sentiment tendre et voilé, Lorenzo était fier néanmoins d’avoir franchi le cercle fatal que le destin et les institutions humaines avaient tracé autour de son berceau. Avide de connaissances, il harcelait l’abbé Zamaria de mille questions qui annonçaient l’activité de son intelligence. Lorenzo était naïvement glorieux d’être entré dans ce monde enchanté, de parler la langue des patriciens, et de sentir quelque chose en lui qui le rapprochait de la race des demi-dieux. Tout souriait à ses désirs, tout s’aplanissait sous ses pas; il naviguait à pleines voiles, et son cœur débordait d’espérances infinies. Aussi comme il bénissait la main qui l’avait soulevé de terre! comme il adorait l’ange qui lui avait ouvert les portes du paradis!
La vie qu’on menait au palais Cadolce était remplie de nombreux incidents qui venaient varier presque chaque jour le plaisir de la villégiature. C’étaient de fréquentes réceptions des plus grands personnages de la terre ferme, des collations splendides, des concerts et de longues promenades, tantôt à pied, tantôt en carrosse, qui aboutissaient presque toujours à quelque habitation seigneuriale, où demeurait une famille de connaissance qu’on allait visiter. On faisait aussi de petits voyages dans les villes environnantes, à Bassano, à Trévise, à Vérone, à Vicence, et surtout à Padoue, où Marco Zeno était souvent entraîné par son vieil ami Foscarini, qui remplissait alors dans cette ville la charge de provéditeur. Dans ces excursions agréables, où Beata et Lorenzo avaient si souvent occasion de se rapprocher et de se communiquer les sensations que faisait naître en eux l’aspect de lieux inconnus, leur cœur trouvait un aliment nouveau à la passion naissante dont ils commençaient à sentir les atteintes. Si l’amour est le sentiment le plus profond et le plus impérieux de la nature humaine, si, comme l’oiseau fabuleux, il naît et se consume dans le mystère, sans qu’on ait pu découvrir encore ni le principe qui le fait vivre ni la cause qui le fait mourir, il est certain du moins que la variété des phénomènes qu’il rencontre sur son passage avive son ardeur et prolonge son illusion.
Lorsque Marco Zeno, accompagné de sa fille, de l’abbé Zamaria, de Lorenzo, de Tognina et d’une partie de sa maison, se rendait dans une ville voisine appartenant à la république, il fallait voir avec quelle prostration était reçu par les autorités et les populations empressées ce simple sénateur, qui semblait enfermer dans un pli de sa toge la destinée du moindre citoyen. Depuis l’antique Rome, jamais puissance politique n’avait su imprimer son autorité sur les peuples vaincus avec autant d’énergie que le gouvernement aristocratique de Venise. Un noble Vénitien, en quittant les lagunes où son influence était limitée par celle de ses confrères et de ses rivaux, devenait, dès qu’il posait le pied sur la terre conquise, un proconsul dont les plus grands seigneurs ambitionnaient la protection. Cette toute-puissance de l’autorité, qui n’excluait ni l’attachement pour la métropole ni le respect sincère pour ses institutions, n’était pas encore beaucoup affaiblie, malgré le travail des idées nouvelles et l’approche des temps difficiles. A son arrivée dans une ville, toutes les portes s’ouvraient devant Marco Zeno, qui n’avait qu’un mot à dire pour faciliter à l’abbé Zamaria l’accès des bibliothèques, des musées et de tous les établissements scientifiques, où celui-ci pouvait satisfaire amplement sa curiosité d’érudit. Aussi l’abbé usait-il largement de son crédit, et, suivi de Lorenzo, de Beata et de son inséparable amie Tognina, il ne manquait pas une occasion de montrer sa vaste instruction, qui charmait son auditoire en l’éclairant. On pense bien que la musique tenait une grande place dans les causeries savantes de l’abbé Zamaria, qui n’avait garde d’oublier une date ou un fait important de nature à flatter sa double passion de Vénitien et de mélomane.
En passant à Vicence et en visitant quelques-uns des admirables palais qui embellissent cette charmante ville, vraiment digne d’être le séjour d’un peuple de patriciens: «Toutes ces merveilles, dit l’abbé, qui s’adressait particulièrement à Lorenzo, dont l’attention naïve plaisait beaucoup au savant cicerone, toutes ces merveilles sont l’œuvre de Palladio, qui est né dans cette ville en 1518, et dont le génie grandiose et simple n’est pas sans quelque analogie avec le génie de Palestrina, son contemporain, le sublime restaurateur de la musique religieuse. Je te ferai sentir une autre fois toute la justesse de ce rapprochement que je ne puis qu’indiquer aujourd’hui, et je me contente seulement d’ajouter que c’est également dans cette même ville de Vicence qu’est né, en 1511, Nicolas Vicentino, savant musicien qui vécut à Rome, où il souleva, dans l’année 1551, une discussion qui partagea le monde savant en deux camps ennemis. Nicolas Vicentino, dont le caractère était fort irascible, prétendait que les genres diatonique, chromatique et enharmonique de l’ancienne musique des Grecs pouvaient être soumis à l’harmonie moderne, telle qu’elle existait au XVIe siècle. Pour donner plus d’évidence à sa démonstration, il fit construire un instrument auquel il donna le nom d’arcicembalo, qui contenait plusieurs claviers où se trouvaient reproduites les différentes échelles de la musique grecque avec les intervalles qui les caractérisaient. Cette question, qui a été si souvent débattue depuis, fut jugée au désavantage de Vicentino, qui fut condamné à payer deux écus d’or à son antagoniste Vicenzo Lusitano. Il n’en est pas moins vrai que Nicolas Vicentino a joui de son temps d’une très-grande renommée, puisqu’on a frappé plusieurs médailles en son honneur, dont une représente un orgue avec cette légende: Perfectæ musicæ divisionisque inventor.»
En visitant Padoue, que Lorenzo voyait pour la première fois, l’abbé Zamaria conduisit aussitôt ses joyeux disciples dans la vieille église de Saint-Antoine, dont la chapelle était l’une des plus renommées de l’Europe. Cette chapelle, richement dotée par la munificence de la république et la générosité de plusieurs nobles familles, était composée alors de quarante musiciens, huit violons, quatre altos, quatre contre-basses, quatre instruments à vent et seize chanteurs, parmi lesquels il y avait huit sopranistes. Le chœur contenait quatre grandes orgues dorées qu’on touchait alternativement et quelquefois toutes ensemble, ce qui produisait une sonorité immense qui couvrait les voix, au lieu de les accompagner. La chapelle du Santo, comme on dit à Padoue, avait été dirigée pendant un demi-siècle par le célèbre Tartini, violoniste du premier mérite, théoricien ingénieux, qui mourut dans cette ville, le 16 février 1770. Tartini était né à Pirano, en Istrie, d’une famille honorable, qui l’avait envoyé à l’université de Padoue pour y étudier la jurisprudence; mais la musique et une aventure romanesque qui faillit lui coûter la vie en décidèrent autrement, et firent de Tartini un des plus grands artistes de son temps. Il fonda à Padoue une école célèbre de violon, qui a fourni à l’Europe et surtout à la France les virtuoses les plus habiles, parmi lesquels on doit citer L. Nardini, Mme de Sirmen, Pagin et La Houssaye. Il a composé pour son instrument beaucoup de musique, et ses œuvres renferment de telles difficultés de mécanisme, qu’on ne les a guère surpassées de nos jours.
Tartini était à la fois maître de chapelle et premier violon solo de l’église Saint-Antoine, car il faut bien qu’on sache que depuis le commencement du XVIIe siècle, c’est-à-dire avant Corelli, l’usage s’était établi dans presque toute l’Italie de jouer des morceaux de violon dans les églises pendant l’office divin. Cette manière de louer Dieu doit paraître au moins singulière aux peuples du Nord, qui ne vont guère à l’église que pour y pleurer les plaisirs et les joies de ce monde. Les peuples du Midi, au contraire, et particulièrement les Italiens, considèrent le temple comme un lieu consacré au culte des sentiments aimables, et ils s’y rendent pour remercier la Providence de les avoir fait naître sur une terre ornée des plus divins trésors. Ils sont heureux de vivre, et c’est pourquoi ils offrent à l’auteur de toutes choses un cœur rempli de concerts et de bénédictions. Aussi la musique religieuse qu’on exécutait à la chapelle de Padoue n’avait-elle rien de la gravité touchante qui caractérise les admirables compositions de Palestrina et celles de l’école romaine en général; cela ressemblait un peu trop au style souriant et maniéré des tableaux de Tiepolo, qui sont en très-grand nombre dans l’église de Saint-Antoine.
C’était pendant la foire qui a lieu dans le mois de juin que Zeno et sa suite s’étaient rendus à Padoue; époque brillante où cette grande ville, ordinairement silencieuse, était remplie d’étrangers et surtout de Vénitiens qui venaient prendre part aux fêtes qui s’y donnaient pendant trois semaines. Le théâtre de Padoue était alors desservi par les plus célèbres virtuoses de l’Italie, qu’on y faisait venir à grands frais, et la chapelle déployait toutes ses pompes pour célébrer dignement la fête de son patron. Le jour où l’abbé Zamaria, le sénateur Zeno et le reste de la compagnie allèrent à l’église Saint-Antoine, tous les musiciens de la chapelle, sous la direction du P. Valotti, élève et successeur de Tartini, étaient réunis pour contribuer à l’éclat de l’office divin. Après un prélude sur les quatre grandes orgues, qui se répondirent en variant successivement le même thème, emprunté à une mélodie de plain-chant, on exécuta une messe avec accompagnement d’orchestre, de la composition du P. Valotti. Cette messe, d’un style un peu trop fleuri, n’était pas dépourvue de mérite, et se rapprochait beaucoup du style de la musique religieuse de Jomelli. Au milieu de la cérémonie, et après un chœur à quatre parties dont l’effet avait paru agréable, on vit apparaître à la tribune de l’une des orgues le violoniste Pasqualini, qui venait jouer une sonate di chiesa. Pasqualini était un gros homme d’une cinquantaine d’années, d’une taille ramassée, d’une figure joviale, qui reluisait sous sa large perruque poudrée à frimas, comme un de ces mascarons grimaçants dont se sert l’architecture pour varier la nudité des lignes. Pasqualini se mit en mesure d’attaquer son andante religioso avec l’emphase d’un buffo caricato. Lorsqu’il fut arrivé à la partie brillante de son morceau, où se trouvaient condensés tous les artifices du violon, les staccati, les effets de doubles cordes et les arpéges les plus étendus, Pasqualini se démenait comme un diable dans un bénitier, et à chaque coup d’archet qu’il donnait il s’échappait de sa perruque un nuage de poussière qui allait enfariner l’organiste et les chanteurs qui garnissaient la tribune. A cette scène, plus digne d’une comédie que de la gravité d’une cérémonie religieuse, l’abbé Zamaria ne put s’empêcher d’éclater de rire en disant tout bas à Lorenzo, qui était assis près de lui: «Voilà un vieux parrucconne qu’on devrait envoyer à la foire pour amuser les gens de la campagne; il y serait mieux à sa place que dans une église.»
Fort heureusement, après cet épisode burlesque, qui ne dura que quelques minutes, une voix suave, dont le caractère étrange frappa Lorenzo d’un grand étonnement, vint chanter un motet qui était mieux approprié à la circonstance. Jamais Lorenzo n’avait rien entendu de comparable à cette voix qui ressemblait à une voix de femme sans en avoir la limpidité. Il semblait interroger du regard l’abbé Zamaria, qui s’amusait beaucoup de son étonnement, dont il n’avait ni le temps ni la volonté de lui expliquer la cause. A mesure que le chanteur développait la puissance de son talent et que cette voix mystérieuse s’élevait dans les cordes supérieures, l’émotion remplaçait la surprise dans le cœur de Lorenzo, et cette émotion était partagée par Beata, dont l’oreille était cependant moins inaccoutumée à de pareils phénomènes. Le morceau que chantait le virtuose était d’un très-beau caractère; c’était un air à la fois religieux et pathétique qu’on attribuait à Stradella, compositeur et chanteur célèbre du XVIIe siècle, qui l’aurait écrit, s’il faut en croire un peu la légende, pour exprimer ses propres sentiments dans une circonstance bien connue de sa vie aventureuse. Lorsque le chanteur fut arrivé à la seconde partie du morceau qu’il interprétait, à cette belle phrase en sol majeur dont les notes lourdes et douloureuses semblent s’élever vers le ciel comme un cri de miséricorde longtemps retenu au fond du cœur, il fut si pathétique, il déploya une si grande manière de phraser, sa respiration était si bien ménagée, et il parut si pénétré des sentiments qu’il exprimait avec une si rare perfection de style, que Beata, malgré ses efforts pour dominer l’émotion qui la gagnait, ne put contenir de grosses larmes qui sillonnèrent son beau visage. Son âme, déjà riche par son propre fonds et plus riche encore par le souffle divin qui commençait à l’agiter, s’ouvrait au moindre contact, comme une fleur généreuse qui livre aux rayons du jour l’arome dont elle est remplie. C’est ainsi que la jeunesse prête volontiers aux premiers objets qui la captivent la vie surabondante qui est en elle; c’est ainsi que l’amour, qui est la jeunesse éternelle, couvre la nature de la poésie qui forme son essence, et qu’il croit entrevoir partout des horizons infinis qui ne sont bien souvent que le mirage de ses propres illusions. Quel est l’homme éclairé, quel est l’artiste devenu célèbre qui ne se rappelle avec bonheur la simple histoire, l’image naïve ou la mélodie rustique qui ont charmé son enfance et dont l’impression lui est restée ineffaçable, malgré tout ce que son goût a pu lui dire depuis contre ces bégayements de la muse populaire? Ces contrastes sont bien plus fréquents en musique que dans les autres arts, et tel grand compositeur qui remplit le monde du bruit de ses chefs-d’œuvre ne peut s’empêcher de rêver et de s’attendrir en écoutant le refrain plaintif qui lui apporte un souvenir du pays qui l’a vu naître.
L’illusion de Beata n’était pas tout à fait de la même nature, car le virtuose qui avait eu le pouvoir de lui arracher des larmes n’était rien moins que le fameux Guadagni, l’un des plus admirables sopranistes de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le chanteur favori de Gluck, qui avait composé pour lui le rôle d’Orfeo. Lorenzo, qui ne pouvait encore s’expliquer la nature de la voix que possédait Guadagni, et dont l’admiration pour le virtuose était mêlée d’une vague inquiétude, demanda à l’abbé Zamaria, en sortant de l’église Saint-Antoine:
«Maestro, comment s’appelle le chanteur que nous venons d’entendre, et quelle est cette voix qu’on dirait sortir de la bouche d’un ange?
—C’est un canarino, répondit l’abbé en riant, un oiseau rare qu’on élève à grands frais pour l’amusement des oisifs et des gentildonne, qui le préfèrent au rossignol des bois, parce qu’il est moins farouche et qu’il chante toute l’année. Du reste, tu auras le plaisir de le voir de près et de mieux apprécier son mérite, car Son Excellence m’a chargé de l’inviter à venir à la villa Cadolce.»
Bien que l’abbé Zamaria ne fût point un amateur très-passionné de peinture, cet art, qui a eu un si grand éclat à Venise, occupait dans son esprit et dans son patriotisme une place trop importante pour qu’il négligeât les occasions d’en admirer les chefs-d’œuvre, qui lui donnaient lieu à des rapprochements ingénieux. Aussi, avant de quitter Padoue, l’abbé voulut-il visiter la vieille église Dell’Arena, où se trouvent des fresques remarquables de Giotto, ce génie précurseur qui vint arracher la peinture au joug de la tradition hiératique. En examinant ces premiers linéaments d’un art qui a tant de rapports avec la musique, l’abbé Zamaria fit observer à ses auditeurs habituels qu’à l’époque où Giotto opérait la grande révolution que l’histoire lui attribue, l’art musical était encore dans les langes, comme on peut s’en convaincre par les écrits de Marchetto de Padoue, qui vivait à la fin du XIIIe siècle.
Pendant ces excursions aux environs de Cadolce, entreprises uniquement pour visiter quelques amis, le sénateur Zeno, toujours préoccupé du sort de la république, ne se laissait distraire par aucun incident vulgaire. Retenu sur la terre ferme depuis quelques années par l’affaiblissement de sa santé, il cherchait à utiliser le repos forcé que lui avaient imposé les médecins en surveillant le mouvement des esprits, en excitant la vigilance des magistrats contre les menées des novateurs, qui devenaient de jour en jour plus nombreux. En traversant les villes de Brescia, de Vérone, de Vicence, de Padoue, Zeno ne voyait que les hommes importants du pays, qu’il savait être dévoués à la domination de Venise. Il encourageait leur zèle, il cherchait à dissiper leurs craintes sur les événements fâcheux qui pouvaient survenir, et, comme un homme d’État habitué à contenir le secret de sa pensée, il ne laissait transpirer que ce qu’il croyait utile au but qu’il se proposait. Autour de ce personnage sombre et vénérable, dont aucune illusion ne pouvait fasciner le regard pénétrant, Beata, Lorenzo et l’abbé Zamaria lui-même s’agitaient comme des enfants qu’un rien amuse, et qui portent avec eux la lumière dont ils éclairent l’horizon qui les enchante. Malgré son âge, la sagacité de son esprit et sa vaste érudition, l’abbé Zamaria n’était guère qu’un artiste plus occupé des détails que du fond de la vie, et dont l’heureuse insouciance ne s’était jamais arrêtée devant des problèmes redoutables. Un vieux livre, un mur écroulé par le temps, et quelques pages de musique ignorées, étaient pour lui des objets bien autrement importants que la politique et ses vicissitudes. Était-il possible que Venise cessât jamais d’être la reine de l’Adriatique? Oserait-on porter la main sur ce nid d’alcyons qui flottait depuis tant de siècles sur la cime des flots amers? Non, non, les sinistres présages de Marco Zeno n’étaient pour l’abbé que des nuages sans consistance, qui passaient au-dessus de sa riante imagination sans obscurcir la limpidité de ses jours; si parfois il était amené à coordonner les faits de l’histoire et à voir une loi au-dessus des phénomènes qui en agitent la surface, c’était lorsqu’il voulait se rendre compte des progrès de l’art musical, afin de mieux en caractériser les périodes décisives. C’était le seul côté de son esprit par lequel il entrevoyait un plan, une certaine unité dans cette succession d’images rapides qui forment le spectacle de la vie.
Pour Lorenzo et Beata, que leur âge mettait à l’abri de ces tristes prévisions de l’avenir, ils étaient tout entiers sous le charme de l’heure présente et des belles choses qui s’offraient à leurs regards. Tout ce qu’ils voyaient, tout ce qu’ils entendaient, servait à développer le sentiment qui les attirait l’un vers l’autre, comme deux notes qu’une attraction secrète dispose à former un accord mystérieux. Ils s’ignoraient encore eux-mêmes; aucun incident extérieur n’était venu troubler leur sécurité, et, si Beata se méprenait sur la nature de l’affection que lui inspirait le fils de Catarina Sarti, Lorenzo était encore moins en état de comprendre quel ferment dangereux se mêlait à la vive reconnaissance qu’il éprouvait pour sa noble bienfaitrice. Ils s’enivraient tous deux de la séve de la jeunesse; ils écoutaient avec ravissement le concert de leur cœur sans en comprendre le sens, et les beautés de l’art aussi bien que les magnificences de la nature, qu’ils rencontraient sur leur passage, prolongeaient pour eux l’illusion bienheureuse de cet instant unique de la vie. Beata, qui trouvait un plaisir secret dans ces promenades qui amusaient son esprit et son cœur sans en troubler la sérénité, promenades qui étaient d’ailleurs favorables à la santé de son père, cherchait à les multiplier par des raisons plus ou moins ingénieuses, que Marco Zeno acceptait volontiers. En quittant Padoue, elle le décida à visiter dans les environs quelques amis, parmi lesquels se trouvait la famille Grimani, dont la villa était située sur la rive gauche du canal de la Brenta.
La vaste et magnifique plaine sur laquelle est assise la ville de Padoue, et qui descend par des pentes ménagées des Alpes tyroliennes à l’embouchure de la Brenta, forme l’un des plus beaux pays qu’il y ait au monde. Couverte d’une végétation vigoureuse, d’un nombre considérable de petites villes, de bourgs et de hameaux pittoresques qui semblent y avoir été semés par la main d’une muse, cette terre grasse et forte donne tout ce qu’on exige d’elle, et, au moindre souffle de l’activité humaine, elle s’épanouit avec amour en produisant des moissons miraculeuses. L’olivier, le citronnier, le figuier, le mûrier, des fruits de toute espèce, des vins généreux et divers, tout y vient en abondance et presque sans efforts. Dans ces campagnes lumineuses que rafraîchissent incessamment les brises qui s’élèvent des montagnes et celles qui traversent l’Adriatique, la vigne étale sa magnificence en festons élégants qui égayent le regard et enchantent le cœur. Le blé, le seigle, le maïs à la tige élancée, croissent sans entraves au milieu de ces champs fortunés, dont l’horizon est successivement resserré par des collines adoucies qui versent autour d’elles l’ombre et la fraîcheur. Des pâturages abondants, de nombreux troupeaux de moutons, de bœufs à la haute encolure, des fermes joyeuses, une population active, tout révèle la force et la fécondité de cette terre de promission. Je ne sais plus quel poëte de l’antiquité a dit que le printemps semble avoir fixé son séjour dans cette heureuse vallée, dont le paysage enchanteur faisait dire également à un empereur grec que, si on n’avait la certitude que le paradis terrestre était situé en Asie, on pourrait croire que c’est dans ce coin de la Vénétie que Dieu a placé sa première créature pour lui donner une idée de la félicité suprême. Tout y est si frais et si joyeux, la nature y est si féconde et si charmante, que les nombreux poëtes qu’a produits le dialecte de Padoue n’ont rien pu imaginer de plus beau que la réalité puissante qu’ils avaient sous les yeux. Tous ont chanté les plaisirs de la vie champêtre et les épisodes de l’économie domestique. C’est la ferme et sa gaieté bruyante, c’est la moisson avec ses guirlandes de bluets et de pavots, ce sont les vendangeurs joyeux, couronnés de pampres et bondissant dans la plaine au son d’un instrument rustique; c’est un rendez-vous au clair de la lune; c’est un baiser donné sous une treille parfumée. Tels sont les sujets qu’aiment à traiter les poëtes qui se sont produits dans le dialecte de Padoue. On dirait, à les entendre, une fête perpétuelle de la nature sans douleur, sans mystère et sans idéal.
Dans cette plaine magnifique, au milieu de cette riche végétation qui présente partout les riants aspects d’un jardin fabuleux, les nobles de Venise avaient fait construire des palais élégants, où l’on retrouvait toutes les somptuosités et toutes les délicatesses de la civilisation. Les peuples du Midi, particulièrement les Italiens, aiment à transporter aux champs les plaisirs et les illusions de la ville. Comme les Grecs et comme les Romains, dont ils procèdent, ils n’ont pas de la nature ce sentiment profond et religieux qu’elle inspire aux peuples du Nord. Ce sont les conquêtes de l’esprit, ce sont les joies et les voluptés de la vie qui excitent avant tout leur admiration et qui stimulent leur activité. Les bois, les prés, les eaux et la terre bien-aimée, ne sont, pour les races méridionales, que des éléments propres à embellir l’existence de l’homme, des jouets de sa fantaisie, qui ne s’élève guère au-dessus de l’horizon visible qui borne ses regards. Les races du Nord, au contraire, dans leurs courses vagabondes à travers les steppes immenses et les vastes forêts où elles ont si longtemps séjourné avant d’aborder la civilisation méridionale, semblent y avoir puisé une connaissance plus approfondie de la nature et de ses mystères sacrés. Aussi leur imagination toute lyrique se plaît-elle à reproduire les harmonies diverses du monde matériel, qui est pour elles le symbole d’un monde supérieur et infini. Les Vénitiens, dont le génie tenait à la fois du génie politique des Romains et de la molle élégance des peuples helléniques, avaient transformé la vie des champs en une fête de l’art; du fond des bois solitaires où ils allaient se réfugier pendant les fortes chaleurs de l’été, ils aimaient à entendre les éclats de rire et les concerts de la sociabilité.
En quittant la plaine de Padoue pour se rendre à Venise, on trouve le canal de la Brenta, qui forme comme un trait d’union entre la terre ferme et la mer Adriatique. Ce canal, qui parcourt un trajet de six lieues, et dont on suivait le courant facile sur des barques légères qu’on appelait des péotes, présentait, à la fin du siècle dernier, un coup d’œil vraiment enchanteur. Les deux rives de ce fleuve étaient garnies de maisons, de casini et de villas délicieuses, où l’aristocratie de Venise avait étalé toute sa magnificence. Construits par les plus célèbres architectes vénitiens de la Renaissance, tels que Sanmicheli, Sansovino, Scamozzi et surtout Palladio, ces palais, tous ornés de statuettes élégantes et joyeuses qui semblaient danser sur le toit comme les heures d’un jour sans nuages, s’épanouissaient au soleil de distance en distance jusqu’à l’entrée des lagunes, et formaient ainsi un horizon magique, au bout duquel on voyait surgir lentement du sein des ondes ce rêve de poésie qu’on appelle Venise. Les plus célèbres de ces villas qui se miraient dans les eaux de la Brenta étaient celle qui appartenait aux Foscarini, et, plus que toutes les autres, la villa Pisani, qui avait coûté plus de quatre millions de francs. Le jardin de cette habitation princière s’avançait en amphithéâtre jusqu’aux bords du canal, d’où les passagers pouvaient admirer les fleurs les plus rares, les citronniers, les grottes artificielles, les doux ombrages où venaient s’abriter les gentildonne au crépuscule du soir. Les rives de la Brenta ont été chantées par tous les poëtes, surtout par les poëtes populaires de Venise, qui leur avaient donné le nom si bien mérité de nouvelle Arcadie, l’Arcadia de’ tempi nostri!
La villa Grimani, où se rendaient Marco Zeno et sa suite, était située à une lieue de Padoue, sur la rive gauche de la Brenta, où le jardin, terminé par une balustrade de marbre blanc, venait aussi aboutir. Une charmille ombreuse régnait le long de cette balustrade, d’où l’on voyait passer les barques chargées de voyageurs qui allaient à Venise ou qui en revenaient. Attendu par la famille Grimani, Marco Zeno fut reconnu de loin, et tout le monde fut bientôt au bas de l’escalier, où vinrent aborder les deux péotes qui contenaient les visiteurs. La famille Grimani, une des plus illustres de la république, était depuis longtemps alliée à la famille Zeno. Un fils du sénateur Grimani, qui pouvait avoir vingt-cinq ans, laissait entrevoir la possibilité de resserrer encore davantage les intérêts des deux nobles familles. La réception fut cordiale et splendide. Beata, entourée par la nombreuse compagnie qui se trouvait réunie à la villa, fut entraînée à parcourir le jardin, qui était magnifique, pendant que les deux vieux sénateurs s’entretenaient des affaires de la république. Après le dîner, qui eut lieu dans une vaste galerie où l’on remarquait de belles fresques de Paul Véronèse, galerie qui ouvrait sur un parterre émaillé de fleurs, ayant pour horizon les rives de la Brenta, l’abbé Zamaria, dont la bonne humeur était toujours prête à déborder, éleva tout à coup sa voix flûtée au-dessus de ce bourdonnement général qui forme la péroraison d’un joyeux festin.
«Signori, dit-il, il me vient une singulière idée! En regardant le beau jardin qui est devant nous, en regardant ce fleuve qui enferme l’horizon, les villas somptueuses qui témoignent si hautement du goût et de la grandeur de notre chère patrie, je pense à ces populations errantes que les Barbares chassèrent devant eux comme un troupeau de moutons, et qui, vers le commencement du ve siècle, vinrent chercher un refuge sur les îlots solitaires de la mer Adriatique. Que diraient-ils, ces pères conscrits de Venise, s’ils voyaient aujourd’hui la ville miraculeuse dont ils ont été les fondateurs, et s’ils pouvaient apprécier les changements que le temps et la main de l’homme ont fait subir à ces campagnes de la Brenta, dont ils fuyaient les rives désolées? Les fictions des poëtes ont-elles jamais égalé le tableau qui se déroule sous nos yeux? et la Grèce, dans ses rêves enchantés, n’a-t-elle pas été surpassée par le génie de Venise, qui a fait des bords de la Brenta un séjour digne vraiment des dieux de l’Olympe?
—Très-bien dit, mon cher abbé, et très-bien pensé, répliqua d’une voix grave le sénateur Zeno. Tu rends à notre patrie la justice qui lui est due; mais il ne faut pas oublier d’ajouter que c’est l’aristocratie qui a fait la grandeur de Venise, comme c’est le sénat de Rome qui a créé la puissance de la ville éternelle. Rome et Venise, qui ont eu à peu près la même origine, puisque ce sont des fugitifs, des fuorusciti, qui en ont posé les premiers fondements, auront aussi, je le crains bien, la même destinée, et, le jour où la plèbe jalouse qui aspire au pouvoir aura triomphé des obstacles qu’on lui oppose, ce jour-là la république de Saint-Marc aura cessé d’exister. C’est ainsi que la plèbe romaine, ameutée par des tribuns factieux, a ruiné l’empire qu’avait édifié la sagesse des patriciens.
—Que Votre Excellence me pardonne si je ne partage pas ses tristes prévisions, ajouta bien vite l’abbé Zamaria, qui craignait de voir la conversation tourner au sérieux de la politique; malgré les bavardages de quelques chiachieroni, les bons citadins de Venise n’ont pas l’humeur assez sombre pour revendiquer un pouvoir dont ils seraient fort embarrassés. Pourvu qu’ils vivent en paix, qu’ils chantent et qu’ils vendent leurs drogues, que leur importe d’où vient la lumière qui les éclaire et la justice qui les protége? Ils sont vraiment trop sages pour vouloir perdre leur temps à siéger dans le grand conseil et s’occuper des affaires de la république au lieu de veiller à leur négoce. Panem et circenses, demandait la plèbe romaine; du pain, des spectacles et una chichera di cafè, voilà tout ce qu’il faut aussi au peuple de Venise.
—Bravo, signor abate! s’écria le chevalier Grimani, jeune homme de vingt-cinq ans qui se trouvait assis près de Beata, dont il était tout préoccupé. Je partage entièrement votre sécurité, et je ne crois pas que nous soyons arrivés à la fin du monde, parce qu’il plaît à quelques bilieux de murmurer tout bas contre le gouvernement della Signoria. N’est-il pas juste que la tête commande au corps et que il maestro di capella, pour me servir d’un exemple que vous approuverez sans doute, dirige l’œuvre qu’il a conçue à la sueur de son front? Il ferait beau voir i bottegaj de la place Saint-Marc deviser de la politique de l’Europe! Mais laissons là ces craintes vaines et occupons-nous d’un sujet plus intéressant. Le temps fuit, e tu fuggir lo lasci, mon cher abbé, sans penser que nous serions heureux d’entendre la voix de la signorina Beata, qu’on dit être admirable. Aussi bien voilà le soleil qui pâlit et Vesper qui s’approche, continua le brillant chevalier, dont l’esprit ne manquait ni de grâce ni de culture, et la musique est le complément nécessaire d’une journée heureuse comme celle qui vient de s’écouler.»
En prononçant ces derniers mots, le chevalier jeta un regard dérobé sur Beata, qui lui répondit silencieusement par une inclination de tête. On se leva de table, et les convives, disséminés en groupes divers que le hasard ou l’instinct avaient formés, commencèrent à se promener dans le jardin qui conduisait à la charmille par une pente adoucie. Beata, Tognina et le chevalier Grimani se perdirent dans une allée solitaire, tandis que Lorenzo, que l’abbé Zamaria tenait par la main, écoutait d’une oreille distraite les interminables discours de son maître, qui pérorait au milieu de cinq ou six personnes qui le suivaient en riant aux éclats. La nuit cependant commençait à surgir du sein de la terre et à couvrir l’horizon de ses ombres transparentes. La lune se dégageait lentement d’une atmosphère brumeuse qui l’enveloppait comme un voile de gaze parsemé d’étincelles d’or, et son disque projetait cette lumière douce et mystérieuse qui touche les cœurs les plus endurcis et poétise les intelligences les plus ternes. La noble compagnie, après avoir erré çà et là en sens divers, s’était réunie sous la charmille autour d’une table demi-circulaire, sur laquelle il y avait quelques livres et une mandoline, instrument à cordes de la famille du luth, alors très-répandu en Italie. A voir cet essaim de belles dames armées de grands éventails coloriés et illustrés de légendes pittoresques et galantes, dont elles jouaient avec coquetterie, vêtues de longues robes à ramages de couleurs vives et diverses, causant, riant et se laissant aller à cette variété de poses qui trahit le bien-être du corps et la gaieté de l’esprit, on eût dit une grande volière remplie d’oiseaux au plumage d’or, de pourpre et d’azur, qui s’égayent, au déclin du jour, par un bisbiglio mélodieux.
Il faisait une de ces nuits sereines qui évoquent la fantaisie des natures les plus avares et les font s’épanouir en dégageant la note mystérieuse que Dieu a déposée au fond de tous les cœurs. Une lumière blanche et discrète s’infiltrait à travers le feuillage épais de la charmille, et les ombres vacillantes qui enveloppaient la noble compagnie faisaient mieux ressortir la façade de la villa Grimani, qui s’élevait au fond du paysage, sur lequel se dessinaient les statuettes élégantes qui en formaient le couronnement. L’air était doux, l’onda placida e tranquilla, lorsque le chevalier manifesta de nouveau le désir d’entendre la signora Beata, qui, après en avoir conféré avec l’abbé Zamaria, se leva ainsi que Tognina, son amie. Placées l’une à côté de l’autre et regardant la Brenta par-dessus la balustrade qu’elles dominaient, ces deux jeunes filles se mirent à chanter un duo de Clari qu’elles savaient par cœur, et que l’abbé Zamaria accompagnait sur la mandoline. C’était un morceau agréable, un frais madrigal parfaitement choisi pour la circonstance, et dont la mélodie légère flottait à la surface de l’âme comme une fleur à la surface d’un lac paisible:
Cantando un di sedea
Laurinda al fonte.
«Un jour Laure chantait assise au bord d’une fontaine;» et ces paroles étaient emportées sur l’aile d’une phrase rapide que les deux voix répétaient tour à tour avec une extrême délicatesse. Arrivée à ce passage où Laure demande au zéphyr de «rafraîchir de son haleine l’air embrasé,» la voix de Beata fit ressortir avec un goût exquis cette modulation qui rend si bien l’affaissement qu’on éprouve pendant les fortes chaleurs de l’été; et, appuyant avec grâce sur la note de ré naturel qui ramène le motif au ton de la majeur, les deux voix recommencèrent leur charmant badinage, qu’on aurait pu comparer à une églogue de Virgile mise en musique par Cimarosa[12]. Ces deux jeunes filles aussi pures que les rayons de la lune qui les éclairait, debout en face d’une rivière dont les eaux limpides reflétaient leur image, chantant une mélodie suave que la brise disséminait comme un parfum dans l’espace, formaient un tableau qu’on ne voit qu’une fois dans la vie, et qui laisse dans l’imagination des souvenirs ineffaçables. Chaque note qui s’échappait de la bouche de Beata tombait dans le silence de la nuit comme une étoile d’or qui se détache de la voûte des cieux, et les deux voix, d’un timbre différent, se mariaient dans un accord harmonieux.
Un long silence succéda à ce morceau. Chacun semblait vouloir conserver le plus longtemps possible l’émotion exquise dont il était pénétré, lorsqu’on entendit au loin, sur le canal, un murmure de voix confuses. Les voix s’étant approchées de la villa Grimani, on reconnut que c’était une barque remplie d’ouvrières en soie qui retournaient à Venise après avoir achevé leur journée. Elles chantaient une mélodie populaire d’un accent mélancolique, dont les paroles, en dialecte vénitien, étaient la traduction libre d’une strophe de la Jérusalem délivrée[13]: «La fleur de la jeunesse ne dure qu’un instant et s’enfuit avec le jour qui passe. Le printemps reviendra, mais la jeunesse ne reviendra pas avec lui. Cueillons la rose de la vie qui perd si vite sa fraîcheur; aimons, aimons, tandis que nous pouvons être payés de retour.»
La barque glissa rapidement et disparut comme un rêve de bonheur.
La scène que nous venons de retracer avait produit sur Lorenzo une très-vive impression. La voix de Beata, l’élégance de sa personne, la familiarité avec laquelle le chevalier Grimani lui avait adressé la parole, avaient excité dans son cœur un sentiment de peine qu’il n’avait pas encore éprouvé. De retour à Cadolce, il n’y avait pas retrouvé la joie paisible d’autrefois. Une distraction involontaire venait traverser ses études, un malaise indéfinissable altérait son caractère, jusqu’alors si doux et si humble. Qu’éprouvait-il donc? Était-ce le tressaillement de la jeunesse, ou bien un levain de jalousie qui mêlait déjà son amertume aux espérances de la vie naissante? Se trouvait-il humilié de ne point appartenir à ce monde d’élite où il n’était admis que par une faveur généreuse, ou était-ce le premier éveil d’un sentiment exquis qui le remplissait tout à coup de son ivresse, comme une essence qui s’échappe brusquement du vase qui la contenait? Il y avait de tout cela dans le trouble qu’éprouvait le jeune Lorenzo, dont le caractère commençait à se dessiner. Il en est des sentiments comme des autres facultés de l’homme: après un sommeil plus ou moins long destiné par la nature à en favoriser la germination, il suffit de la moindre secousse pour les faire sortir de terre. Jamais Lorenzo ne s’était encore trouvé au milieu d’un si grand nombre de personnes distinguées. La vie qu’il avait menée jusqu’alors, studieuse et recueillie, ne lui avait laissé entrevoir que le côté favorable de sa position. L’affection presque paternelle que lui témoignait l’abbé Zamaria, l’intérêt tendre et discret qu’il inspirait à Beata, la bienveillance des subalternes l’avaient ébloui et lui avaient dérobé la réalité du monde et des choses. Jusqu’au vieux Bernabò, le camérier de Zeno, qui se plaisait à lui dire quelquefois: «Bravo, Lorenzo; continuez à bien étudier; Son Excellence est très-contente de vous!» Ce premier enchantement s’était un peu dissipé depuis la soirée mémorable passée aux bords de la Brenta. La vue du chevalier Grimani et sa contenance auprès de la signora avaient donné l’éveil à son esprit. C’était comme une pierre qu’on eût jetée au fond d’une source limpide, et qui va remuer la vase amoncelée dans ses profondeurs.
Pourquoi l’avait-on laissé entièrement de côté pendant cette soirée de délices? Personne n’avait paru s’inquiéter de sa présence, pas même la charmante Tognina, qui se plaisait d’ordinaire à le poursuivre de ses agaceries mutines; pas un regard ne s’était fixé sur lui, et la signora Beata, qui l’enveloppait toujours de sa sollicitude, avait paru ignorer qu’il fût là, tout près d’elle, au milieu de cette société ravie de sa grâce et de sa voix touchante. N’était-il donc dans la maison de Zeno qu’un objet de distraction, qu’un témoignage vivant de la munificence d’un grand seigneur, qu’on repousse dans l’ombre aussitôt que le cercle de l’intimité s’élargit? Telles étaient les questions que se faisait sourdement ce jeune homme, et qui remplissaient son cœur d’un trouble infini. Saturé de lectures diverses, qui n’avaient pas toujours été dirigées par un goût très-sévère, puisant à la fois dans les romans à la mode, dans les poëtes, surtout dans les philosophes français que l’abbé Zamaria livrait à sa curiosité, la pâture dont il était avide, l’esprit de Lorenzo laissait apercevoir les symptômes d’une activité inquiète et prompte à s’alarmer. C’était une imagination ardente qui se plaisait aux combinaisons romanesques, une sensibilité extrême qui fermentait et cherchait une issue, un cœur rempli de tendresse, qui, après avoir été longtemps contenu par le respect et le sommeil de l’adolescence, se réveillait tout à coup et s’épanchait bruyamment, comme pour s’assurer de sa propre vitalité. Rien n’est moins simple que la jeunesse; tous les germes de la vie future se trouvent entassés dans le cœur d’un enfant, et c’est avec ces premières sensations, confusément perçues, que la destinée ourdit sa toile. Aussi prenez bien garde, et ne vous oubliez pas devant ces regards mobiles qui semblent glisser sur toutes choses! ne laissez rien apercevoir d’impur ou d’équivoque à cette petite créature qui s’exerce à comprendre les phénomènes qui se déroulent devant elle. Guidée par l’instinct et par une intuition divine, elle saisira plus tard le sens caché de vos actes et de vos paroles; comme cette plaque de métal préparée par l’art pour y réfléchir la lumière, l’âme d’un enfant se laisse pénétrer par les accidents du monde extérieur, qui s’y incrustent pour ainsi dire, et y dessinent des images que le temps viendra dégager.
Lorenzo lisait enfin dans son propre cœur; il se sentait ému à l’aspect de Beata, et il comprenait le sens de cette émotion, dont il était effrayé. Oserait-il jamais avouer un sentiment si téméraire? Que dirait-on si l’on venait à découvrir que le fils de Catarina Sarti avait osé lever les yeux sur une noble fille de Venise, qui avait recueilli son enfance et sa pauvreté? Il fuyait les occasions de la voir; il était timide, interdit en sa présence, il balbutiait en répondant aux questions bienveillantes qu’elle lui adressait. Il recherchait la solitude et les livres qui pouvaient nourrir et accroître ses illusions. La nature, le paysage et ses beautés mystérieuses, qui sont inaccessibles au vulgaire, et qui ne se révèlent qu’aux yeux éclairés par le foyer intérieur du sentiment, parlaient à son imagination un langage nouveau. Tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il lisait et tout ce qu’il entendait, prenait la forme de l’objet aimable qui s’élevait dans son âme comme un astre radieux. Dans une telle disposition d’esprit, Lorenzo trouva sous sa main la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Ce livre fameux, qui a ému le XVIIIe siècle, et qui a été traduit dans toutes les langues de l’Europe, exerça sur l’imagination de ce jeune homme une action puissante. Le monde un peu factice que s’était créé Rousseau, ce mélange d’idéal et de réalité où les sentiments éternels du cœur humain se mêlent aux sophismes de l’esprit, où les discussions philosophiques entravent souvent l’épanchement de l’âme, où les caractères semblent plutôt la personnification de principes abstraits que des êtres pris dans la nature, tous ces défauts, qui ont été souvent relevés dans le roman de Jean-Jacques, n’empêcheront pas qu’il ne soit recherché et lu avec avidité par les organisations tendres et poétiques. On a beau faire, la jeunesse n’écoute point les sermons et se rit des froids pédagogues qui parlent de l’amour comme d’un poison dont ils n’ont pu goûter les délicieuses amertumes. Loin de se laisser effrayer par le danger qu’on lui signale, elle s’y précipite, et ce n’est qu’après s’être sauvée du naufrage qu’elle est disposée à entendre les avis qu’on lui a prodigués avant l’heure. C’est ainsi que chaque génération recommence le même voyage et chante l’éternelle chanson du renouveau. La jeunesse d’ailleurs n’est point accessible à la vérité pure et sans alliage. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est le spectacle de la grandeur morale aux prises avec le destin, c’est la lutte des sentiments contre les préjugés, c’est le triomphe de la passion sur l’égoïsme de famille. Telles sont aussi les qualités qui font de la Nouvelle Héloïse un livre d’un attrait singulier pour les cœurs tendres et les imaginations ardentes. Le caractère de Saint-Preux, sa position subalterne dans la famille de Julie, les moyens par lesquels il parvient à toucher son cœur, les obstacles qu’il rencontre, ces deux jeunes filles si étroitement unies et d’une tournure d’esprit si différente, les personnages secondaires qui se groupent autour des deux amants, les idées hardies que l’auteur soulève, l’admirable paysage où Rousseau a placé les rêves de son génie, tous ces détails de l’économie domestique et de la vie bourgeoise, où la musique et la poésie italienne occupent une si grande place, devaient frapper notre adolescent. Aussi se mit-il à dévorer ces pages éloquentes, qui semblaient traduire les émotions secrètes de son cœur. Il s’identifiait avec le héros dont il aurait voulu partager la destinée. Il le suivait dans les bosquets de Clarens, et se laissait conduire avec lui dans les bras de Julie, qui lui imprimait sur les lèvres le fatal et divin baiser. Tous les incidents de cette fable touchante, où Rousseau a esquissé comme un tableau de la société que pressentait son âme, excitaient d’autant plus l’intérêt de Lorenzo, qu’il y trouvait une certaine analogie avec sa propre situation dans la maison du sénateur.
Derrière le bois qui couronnait les hauteurs de la villa Cadolce, il y avait un petit chemin, un stradotto tortueux et solitaire, qui conduisait jusqu’au village de la Rosâ, et de l’autre extrémité allait aboutir à la grande route de Cittadella. Ce chemin était bordé d’un côté par le talus du parc et par un ruisseau qui en baignait les contours, et de l’autre côté par une haie vive, touffue et fort irrégulièrement plantée, qui déversait en tous sens sa riche végétation. Des rameaux d’aubépine et de mûrier sauvage s’échappaient de la haie, qui ne pouvait les contenir, et allaient s’entrelacer aux branches folles des arbres, formant ainsi une voûte de verdure qui préservait le chemin de l’ardeur du soleil. Une grande allée traversait le parc, et au fond de cette avenue on apercevait le toit de la villa, où les paons étalaient leur plumage d’or, remplissant les échos de leurs cris plaintifs.
Par une belle matinée de printemps, Lorenzo se promenait dans la grande allée du parc de la villa Cadolce. Le cœur rempli d’inquiétude et de cette fièvre de bonheur que donne la première atteinte du mal sacré, il avait quitté brusquement sa chambre, et marchait sans but devant lui, respirant à longs traits l’air fluide et chargé d’aromes que l’aurore répand autour d’elle, comme pour annoncer l’arrivée du jour. Les feuilles des arbres, encore trempées de rosée, jetaient mille reflets divers qui égayaient le regard et provoquaient une délicieuse sensation de fraîcheur. Les oiseaux babillaient dans les bocages, et du milieu de leur concert, toujours le même et pourtant toujours nouveau, s’élevaient quelques notes pénétrantes qui semblaient révéler une joie plus vive, une sensibilité plus exquise. Je ne sais quel poëte indien a dit que le langage des oiseaux fut compris un jour par un couple d’amants qui promenaient leur bonheur à l’ombre des forêts, et qu’ils parvinrent à s’entretenir avec les plus éloquents de ces chantres merveilleux. Cette fiction ingénieuse, comme toutes celles de la poésie primitive, renferme une observation profonde, et l’histoire touchante de Philomèle et de Progné nous offre, ainsi que toutes les métamorphoses de la fable antique, un témoignage de cette croyance universellement répandue, que l’amour est la source de la poésie, de la musique et de la science des choses divines.
Le soleil s’élevait sur l’horizon et commençait à traverser ces légers nuages du matin qui l’entourent comme une auréole. Une atmosphère déjà tiède, toute saturée de parfums, d’étincelles et de bruits joyeux, remplissait l’âme du jeune Lorenzo d’un bien-être ineffable. Arrivé au bout de la grande allée, il franchit le ruisseau qui servait de limite au parc, prit le chemin qui conduisait à la Rosâ, et se perdit sous des arceaux de verdure. La fleur blanche des cerisiers jonchait le chemin, et dans les éclaircies des buissons lumineux on voyait reluire et s’agiter des myriades d’insectes, de papillons et de timides fauvettes qui voltigeaient autour de leur couvée nouvelle. L’ombre, la fraîcheur et le silence conviaient à la rêverie, et laissaient errer l’esprit au milieu de ce pétillement sourd et mystérieux qui est la vie de la nature, et que le génie de Beethoven a pu seul reproduire dans la deuxième partie de la Symphonie pastorale. Lorenzo cheminait lentement, savourant en lui-même les plus douces espérances, lorsqu’une voix un peu fruste se fit entendre au loin. Trà, là là.... Et ce refrain, qui terminait une cantilène villageoise, se répandit dans les sinuosités du chemin comme la vibration prolongée d’un instrument rustique.
Après un instant de silence, la voix reprit son élan et fit entendre de nouveau les mêmes notes, là.... là, ... lesquelles, suspendues longtemps dans les airs, exhalèrent un parfum de gaieté franche et naïve qui fixa l’attention de Lorenzo, parce qu’il crut reconnaître la voix de Giacomo. C’était lui, en effet, qui s’en venait à califourchon sur un âne en chantant comme un bienheureux. «Eh! viva, il nostro caro Lorenzo! lui dit-il en l’apercevant. Qu’il y a longtemps qu’on ne vous a vu, per Bacco! et comme vous voilà grandi! Pourquoi donc oubliez-vous ainsi vos amis de La Rosâ, où nous parlons si souvent de vous? Hier encore je disais à Zina, que vous connaissez: «Que je voudrais voir ce brave Lorenzo depuis qu’il est devenu un bel signore et aussi savant, dit-on, que le curé de Cittadella!—Ah! répondit-elle, il ne pense guère à nous, povera gente; nous n’avons ni le langage ni les belles manières des cavalieri parmi lesquels il vit.»
—Vous me faites injure, mon cher Giacomo, en me prêtant de tels sentiments, répliqua vivement Lorenzo. Je ne suis point un signore, comme vous voulez bien le croire, et je suis loin d’avoir oublié les bonnes gens qui m’ont vu naître et qui ont entouré mon enfance d’une affection si cordiale.
—Il ne faut pas vous fâcher de mes paroles, répondit Giacomo avec bonhomie, car je ne pensais point à mal en vous rapportant les caquetages de cette mauvaise langue de Zina, qui vous aime bien pourtant, et qui est toute fière d’avoir été pour quelque chose dans votre bonheur. Vous rappelez-vous, caro Lorenzo, cette belle nuit de Noël où nous fûmes introduits pour la première fois à la villa Cadolce? Avec quelle présence d’esprit Zina répondit aux questions que lui faisait la signora sur votre compte! Dame!... il y a déjà quelques années de cela, et vous avez bien changé depuis lors, per Bacco! Vous voilà comme le fils de Son Excellence, et, puisqu’on a vu des rois épouser des bergères, pourquoi donc la fille du sénateur n’épouserait-elle pas....
—Est-ce que tu t’imagines, Giacomo, que les choses de ce monde se passent comme dans la belle histoire de Silvio et de Nisbé, que je t’ai entendu raconter si souvent? répondit Lorenzo en coupant brusquement la parole à son interlocuteur. Ce sont là des folies qu’il faut laisser dans les contes de nourrices où tu les as puisées. La signora Beata est trop grande dame pour penser à un pauvre garçon comme moi, sans autre avenir que la protection que lui accorde son père. La fille d’un sénateur de Venise est bien autrement difficile que la fille d’un roi, fût-elle née, comme la charmante Nisbé, du baiser d’une immortelle.
—Bah! bah! dit Giacomo, on a vu des choses moins surprenantes, et san Pietro e san Paolo disent positivement qu’il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Addio, signor Lorenzo, voilà le jour qui s’avance, et il faut que j’aille au marché de Cittadella. Au revoir, arri malandrino,» dit-il en frappant des deux talons sur sa piteuse monture, qui trottinait conformément au proverbe: Chi va piano, va sano.
Et Giacomo s’éloigna en lançant par-dessus les arbres son joyeux refrain, qui retentit dans les airs et s’éteignit peu à peu comme le frais gazouillement de l’alouette matinale «qui se balance dans l’espace, puis s’interrompt tout à coup pour s’écouter elle-même et jouir de la douceur de ses propres concerts.»
Qual lodoletta che ’n aere si spazia
Prima cantando, e poi tace contenta
Dell’ ultima dolcezza che la sazia[14].
Tout ému de la conversation qu’il venait d’avoir avec Giacomo, qui avait touché à la corde sensible de son cœur, Lorenzo, au lieu de poursuivre son chemin et d’aller à La Rosâ ainsi qu’il en avait l’intention, s’en retourna tristement au château. La matinée était déjà fort avancée, et le soleil radieux inondait la grande allée du parc de ses rayons pénétrants, qui faisaient rechercher les coins ombreux, propices au recueillement. Arrivé près du palais, il se détourna à main gauche et prit une petite allée transversale qui aboutissait à un bosquet où Beata avait l’habitude de se réfugier pendant certaines heures de la journée. Ce bosquet, entouré de bancs de repos, était formé par un taillis épais entremêlé d’arbres fruitiers de toute espèce, qui donnaient à ce réduit l’aspect d’un verger délicieux où l’utile se mêlait à l’agréable, conformément à la poétique de Palladio sur les maisons de plaisance. Un treillis tapissé de chèvrefeuille et de plantes grimpantes ne laissait pénétrer dans ce sanctuaire qu’une lumière attiédie, qui colorait le feuillage sans le traverser. Des statues représentant les muses avec leurs différents attributs longeaient l’avenue, au bout de laquelle le regard se reposait sur un parterre où des roses, des œillets et des citronniers encadraient un bassin de marbre que remplissait bruyamment un jet d’eau intarissable. Ce lieu semblait avoir été disposé pour convier aux doux épanchements de l’âme, pour évoquer cette fantaisie aimable qui est le rayonnement des natures bien douées. Contenue ainsi dans des limites qui la charmaient sans l’étonner, l’imagination satisfaite n’entrevoyait pas de plus vastes horizons ni un monde meilleur.
Lorenzo, qui s’avançait lentement vers le bosquet où il s’était trouvé tant de fois avec Beata, crut apercevoir à travers le feuillage les reflets d’une robe blanche qui le firent tressaillir. Il n’osait plus faire un pas, ses jambes tremblaient sous lui, et son cœur battait violemment dans sa poitrine. Il essaya de se raffermir et de passer à côté sans y jeter les yeux, feignant une indifférence et une tranquillité dont la passion s’enveloppe souvent pour mieux dissimuler sa faiblesse; mais il ne put aller plus loin et resta immobile derrière un bouquet de lilas qui, fort heureusement, le dérobait à la vue.
Quelle est donc cette mystérieuse puissance d’une première affection qui transfigure tout à coup l’objet aimé et l’enveloppe d’une atmosphère magique qui se communique à tout ce qui l’approche? Cette robe blanche, dont les reflets lointains font tressaillir Lorenzo, il l’avait vue bien souvent sans aucune émotion et sans se douter qu’elle pût jamais devenir pour lui un signe d’ineffables souvenirs. Maintenant il ne l’oubliera jamais, et jusqu’à son dernier soupir elle flottera devant ses yeux comme un symbole de sa jeunesse et de ses divines espérances. O savants qui ne croyez point aux miracles, pas même à ceux que Dieu accomplit chaque jour par vos mains, qu’est-ce donc que l’amour, si ce n’est un miracle permanent qui est aussi vieux que le cœur de l’homme?
Son trouble s’étant un peu calmé, Lorenzo regarda timidement à travers les interstices du treillis; il vit Beata et Tognina, qui causaient ensemble. Beata était vêtue en effet d’une robe blanche un peu traînante qui lui dessinait la taille, et un fichu de soie noire, jeté négligemment sur ses belles épaules, couvrait imparfaitement d’inappréciables trésors, en faisant ressortir l’éclat et la morbidesse de son teint. Une rose fixée au milieu du sein, deux boucles de cheveux qui descendaient sur son cou gracieux, donnaient à sa physionomie pleine de charme je ne sais quel air sérieux et attendri qui se combinait heureusement avec la gaieté du jour et la fraîcheur printanière du paysage. Elle tenait à la main une ombrelle de soie à ramages, qui la préservait de ces mille petits insectes qui tourbillonnent follement à la suite d’un rayon de soleil. Tognina, moins grande et plus vive dans ses allures, portait une robe à fond blanc varié d’arabesques aux couleurs saillantes, et sa belle chevelure noire était ornée d’une petite branche de jasmin qui s’inclinait sur l’oreille gauche. Ces deux jeunes filles, dont la mise révélait assez bien le caractère, formaient une de ces légères dissonances d’esprit et de mœurs avec lesquelles il semble que la nature se plaise à nouer les affections les plus douces et les plus durables. A les voir se promener ainsi nonchalamment au milieu d’un paysage enchanteur que l’art avait soumis à ses lois, ces deux charmantes personnes, dont l’ombre se dessinait par intervalles dans l’allée solitaire, où l’on n’entendait que le bruit de l’eau jaillissante, présentaient une scène exquise de la société polie dans un siècle de loisirs. Pour rendre toute la suavité d’un pareil tableau, pour exprimer l’harmonie qui résulte du contraste de deux femmes élégantes et bien nées, qui livrent à l’heure qui passe le secret de leurs cœurs, il faudrait la musique de Mozart, par exemple le duo du Mariage de Figaro entre la comtesse et Suzanne, lorsque, sur une phrase aussi transparente que le plus beau jour, elles chantent en badinant:
Che soave zefiretto
Questa sera spirerà!
«Sais-tu bien, ma chère, dit Tognina en jouant avec son éventail, que Lorenzo devient, ma foi, un beau garçon, et qu’il n’est plus permis de le traiter sans cérémonie?
—Je ne le sais que trop, répondit Beata avec un accent de tristesse.
—Je ne vois pas qu’il y ait lieu à prendre le deuil pour un fait aussi simple, répondit Tognina, et tu n’as pu croire que ton pupille resterait toujours un agneau de Pâques à la toison immaculée!
—Non, sans doute, répondit Beata, mais je vois arriver avec peine le moment où il faudra me séparer de lui.
—Te séparer de Lorenzo! et pourquoi donc? Tu es riche, fille unique, maîtresse de faire tout ce que tu veux: il faudrait être furieusement mélancolique pour gâter une si belle existence.
—Tu en parles bien à ton aise, chère Tognina, et tu ignores les difficultés de ma position. La fille d’un sénateur de Venise appartient d’abord à la république, et puis à sa famille, qui en disposent selon les intérêts de l’État ou les convenances de la société. Tu es cent fois plus libre que moi, et il y a des jours où j’envie le sort de Teresa, ma camériste, qui peut, du moins, suivre les inspirations de son cœur.
—On dirait, à t’entendre, que Lorenzo a pénétré fort avant dans le tien, répliqua Tognina avec malice. Après tout, où serait le mal que tu fusses touchée par les qualités d’un jeune homme que tu as élevé et qui a répondu à tes espérances? Tu n’as guère que quatre ans de plus que lui, et on surmonte bien des difficultés quand on aime, témoin l’histoire de la fameuse Bianca Capello.»
Sans répondre directement à cette dernière observation, qui touchait à la plus vive de ses préoccupations, Beata feignit de prendre le change et détourna la conversation sur un autre sujet. Les jeunes amies les plus intimes ne se laissent pas ravir sans défense le mot suprême qui résume leurs plus chères pensées, et ce n’est que par distraction ou par le besoin qu’elles éprouvent de se voir encouragées dans leurs sentiments qu’elles trahissent leur secret. Beata surtout était d’une grande réserve, et l’idée qu’elle avait de sa dignité la rendait très-circonspecte dans ses paroles. Après un instant de silence que Tognina se garda bien d’interrompre, Beata, entraînée malgré elle vers le sujet qui remplissait son cœur, ajouta négligemment:
«J’ai eu hier un long entretien avec mon oncle, dont tu sais l’affection pour Lorenzo.
—Eh bien! que t’a dit le saint abbé?
—Qu’il était temps de s’occuper de l’avenir de ce jeune homme, et qu’on ferait bien de l’envoyer à l’université de Padoue y terminer ses études. «Nous allons partir pour Venise, lui ai-je répondu, et là, nous prendrons un parti définitif.—Que ce soit le plus tôt possible, ma nièce,» a-t-il dit en m’étreignant doucement la main.»
Quelques jours après ce dialogue significatif, dont Lorenzo n’avait pu saisir que quelques mots sans suite, il y eut grande réception à la villa Cadolce. La famille Grimani était venue rendre visite au sénateur Zeno, et Guadagni se trouvait au nombre des invités. Le célèbre virtuose pouvait avoir alors soixante et quelques années. Après avoir parcouru l’Europe, après avoir visité successivement Paris, Londres, Lisbonne, Vienne, Munich, Berlin et les principales villes de l’Italie, en excitant partout la plus vive admiration, Gaetano Guadigni, qui était né à Lodi vers 1725, était venu se fixer à Padoue en 1777, où il s’était fait admettre parmi les chanteurs de la chapelle, et où il devait mourir en 1797. Sa voix, qui avait eu jadis le caractère et l’étendue d’un mezzo soprano d’une douceur extrême, avait perdu quelques notes dans le registre supérieur; mais l’âge avait épuré son goût, et sa grande manière de dire le récitatif et de chanter les morceaux expressifs en faisait encore le premier virtuose de son temps. On allait à Padoue tout exprès pour l’entendre, et il se montrait aussi facile au désir des dilettanti qu’il était magnifique dans l’usage qu’il faisait de sa grande fortune. Guadagni avait connu les plus illustres compositeurs du XVIIIe siècle. Il avait connu Haendel lors de son premier voyage en Angleterre, en 1749, et ce maître lui avait confié une partie dans l’exécution de ses deux grands oratorios, le Messie et Samson. Il avait eu aussi des relations avec Piccini, qui avait composé pour lui plusieurs opéras, et surtout avec Gluck, dont le mâle et vigoureux génie sut trouver des chants pleins de tendresse pour la voix exceptionnelle et le talent extraordinaire de son virtuose de prédilection. Doué d’une belle figure, comédien assez distingué pour avoir mérité les éloges de Garrick, qui lui donna même des conseils, musicien excellent, puisqu’il s’était composé plusieurs scènes qu’il intercalait souvent dans les opéras qui lui étaient confiés, Guadagni avait un caractère irascible, et il était quelquefois d’une insolence extrême envers les impressarii et les pauvres compositeurs sans renommée dont il daignait chanter la musique. Piccini, malgré l’extrême douceur de son caractère, sut imposer à Guadagni sa volonté, et jamais il ne lui permit de changer une note aux rôles qu’il lui confiait. Quant à Gluck, qui préludait déjà à la grande révolution qu’il devait opérer dans le drame lyrique, il n’était pas homme à souffrir qu’un chanteur osât modifier la pensée dont il était l’interprète.