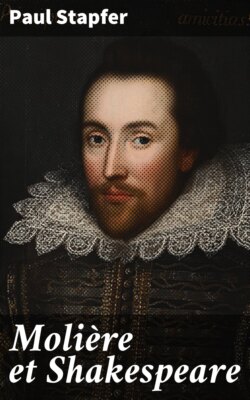Читать книгу Molière et Shakespeare - Paul Stapfer - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеUn apologiste allemand de Molière.—Des comédies de Shakespeare en général.—Universalité de Molière.—Les disputes de goût.—Shakespeare et Aristophane.—Shakespeare et Plante.—Shakespeare et Molière.
Molière, Shakespeare und die deutsche Kritik[1]: tel est le titre d'un volume in-octavo de cinq cents et quelques pages publié en 1869 à Leipzig par le docteur G. Humbert.—M. Rümelin, chef de la réaction anti-shakespearienne en Allemagne, avait opposé et préféré Schiller et Gœthe à Shakespeare; M. Humbert lui oppose et lui préfère Molière, pour lequel il professe un culte enthousiaste.
Comment n'aimerions-nous pas un si brave homme? Qui, en France, aurait le cœur assez dur pour lui dire que son livre est long, diffus, mal composé? Et, si l'on se croyait permis de critiquer la forme, oserait-on sans rougir faire des réserves sur le fond, avertir l'auteur qu'en prouvant trop il risque de prouver moins, qu'en attribuant à Molière toutes les perfections il tombe dans l'excès même reproché par lui aux shakespearomanes, et qu'il eût agi plus habilement dans l'intérêt de la cause s'il avait dédaigneusement laissé à l'adversaire quelques os à ronger?
Tout! M. Humbert admire tout,—jusqu'au discours de l'exempt à la fin du Tartuffe, jusqu'à la dissertation du frère d'Argan sur la vanité de la médecine, jusqu'aux sermons du sage Cléante en faveur de la modération! Il y a quelque chose de touchant dans son dévouement absolu à Molière. «Notre amour pour Molière, écrit-il dans sa préface, s'est renouvelé à chaque lecture que nous avons faite de ses œuvres; et cet amour (nous osons ajouter: notre amour pour la littérature française en général) pourrait malaisément nous être reproché, puisque nous le partageons avec Gœthe et plusieurs autres grands esprits de notre nation. Mais ce sentiment nous autorisait-il à parler avec irritation des contempteurs de Molière et de la littérature française? Non, sans doute, si ces derniers par leur conduite ne nous avaient provoqué à prendre un ton pareil; or c'est ce qu'ils ont fait, à tel point que nous aurions pu donner pour épigraphe à notre livre le mot fameux de Juvénal: «L'indignation fait ... le critique».
On excusera sans peine quelques vivacités d'expression dans l'ouvrage du docteur Humbert, si l'on veut tenir compte de l'agacement bien légitime que devait causer à un si chaud partisan de Molière la manie des critiques de son pays de lui préférer Shakespeare sur tous les points. La patience, la subtilité allemande s'appliquant avec piété à ce grand sujet, l'analyse du génie de Molière, devait trouver et mettre au jour une quantité de jolies idées, fraîches et neuves, qui ne sont pas encore tombées dans le domaine de la critique banale. Par exemple, M. Humbert ne consacre pas moins de cinquante-neuf grandes pages à cette question: convient-il d'appeler prosaïque le genre de Molière, par opposition au genre de la comédie shakespearienne qui serait seul poétique? Nous n'avons rien d'analogue en France, où l'on a renoncé depuis longtemps, comme à un sujet complètement épuisé, à toute étude esthétique des comédies de Molière, et où ce grand homme n'est plus, comme Shakespeare pour les Anglais, que l'objet d'une érudition aride et d'une curiosité purement matérielle. Dans l'ordre des recherches historiques, biographiques, philologiques, M. Humbert n'a pas la prétention d'apprendre la moindre chose à son lecteur; mais il nous fait assister à une grande bataille rangée d'idées et de doctrines. Comme il ne manque jamais de citer très au long les opinions qu'il combat, et comme il s'efface lui-même avec un empressement modeste derrière tous les maîtres dont la pensée est en harmonie avec la sienne, son livre est un répertoire commode de ce qui a été écrit en Allemagne de plus curieux et de plus profond sur Molière. Je compte mettre largement à contribution le volume de M. Humbert dans l'étude qui va suivre, et je commence le pillage en volant à l'auteur la meilleure moitié de son titre: «Molière et Shakespeare».
La première édition complète des œuvres de Shakespeare, l'in-folio de 1623, donne à quatorze pièces de son théâtre le nom de comédies. Les voici dans leur ordre: la Tempête, les Deux Amis de Vérone, les Joyeuses Bourgeoises de Windsor, Mesure pour mesure, la Comédie des méprises, Beaucoup de bruit pour rien, Peines d'amour perdues, le Songe dune nuit d'été, le Marchand de Venise, Comme il vous plaira, la Méchante Femme mise à la raison, Tout est bien qui finit bien, le Soir des Bois ou Ce que vous voudrez, le Conte d'hiver. Ce serait une naïveté d'avoir le moindre égard à cette classification; elle a été faite sans aucune critique. Qui ne sait que le mot comédie a souvent servi autrefois pour désigner indistinctement toute espèce de pièce de théâtre? C'était l'usage en Espagne au XVIe siècle, et encore au XVIIe en France. Aussi les commentateurs de Shakespeare ne se sont-ils point gênés pour refaire à leur idée la classification de 1623.
Gervinus réduit le nombre des comédies proprement dites à onze, par l'élimination du Marchand de Venise, de la Tempête et de Mesure pour mesure. Ulrici, au contraire, le porte jusqu'à seize, en y ajoutant deux pièces: Cymbeline et Troïlus et Cressida. M. Kreyssig, avec un discernement judicieux, sépare nettement du groupe des comédies cinq pièces qu'il appelle des drames, parce que ce sont de véritables tragédies dont le dénouement seul est heureux: ces cinq pièces sont les trois déjà retranchées par Gervinus, et en outre Cymbeline et le Conte d'hiver. M. Kreyssig aurait bien pu ranger parmi les drames au moins deux pièces encore: Tout est bien qui finit bien et les Deux Amis de Vérone, et, s'il lui avait plu de débaptiser aussi Beaucoup de bruit pour rien, ni le rôle brillant de Béatrice et de Benedict, ni les personnages grotesques de Dogberry et de la garde ne me feraient réclamer en faveur de cette pièce, assez tragique au fond, le nom de comédie.
D'ailleurs, toutes ces classifications relèvent du goût, c'est-à-dire de l'arbitraire. Pour qu'elles pussent être rigoureuses, il faudrait avoir d'abord défini avec certitude ce qu'est la comédie en soi; mais l'espoir de trouver une telle définition, comme je me propose de le démontrer plus loin, n'est qu'un leurre. Les poètes dramatiques font des ouvrages pour le théâtre, et ils se moquent bien de savoir dans quelle catégorie esthétique ces ouvrages doivent rentrer! Si l'on avait dit à Molière que ses deux chefs-d'œuvre, le Misanthrope et le Tartuffe, sortaient du domaine de la comédie pure et empiétaient sur celui de la tragédie, j'imagine que cette révélation l'aurait peu troublé; et Shakespeare a raillé la manie des classificateurs, lorsqu'il a fait dire au pédant Polonius présentant au prince Hamlet une troupe de comédiens: «Monseigneur, ce sont les meilleurs acteurs du monde pour la tragédie, la comédie, le drame historique, la pastorale, la comédie pastorale, la pastorale historique, la tragédie historique, la pastorale tragico-comico-historique, les pièces avec unité et les poèmes sans règles».
Il n'est guère possible d'analyser aucune pure comédie de Shakespeare, la plus grande valeur de ces œuvres légères consistant en général dans le charme poétique de la forme, c'est-à-dire dans un élément qui se dérobe au commentaire comme à la traduction. Ce sont, pour la plupart, moins des comédies de caractère ou meme d'intrigue que des comédies fantastiques, des féeries, dont le nœud est naturellement assez faible et où la psychologie est superficielle, comme il convient aux productions de ce genre. Le narré pur et simple de ces sortes de fables, tel que l'ont fait Charles Lamb et sa sœur dans leurs jolis Contes tirés de Shakespeare, ne peut intéresser que l'enfance. Commenter ces poèmes gracieux, où le génie glisse et se joue sans appuyer ni creuser jamais, serait une entreprise imprudente qui risquerait de faire rire à nos dépens les gens d'esprit, comme Henri Heine riait du docteur Samuel Johnson: «Le docteur Johnson, cette énorme cruche de porter, ce John Huit de l'érudition, ne savait pas pourquoi il éprouvait, en commentant le Songe d'une nuit d'été, tant de démangeaisons aux narines et une si forte envie d'éternuer; c'est que, pendant ce temps, la reine Mab exécutait sur son nez les plus drôles de cabrioles».
Des œuvres si délicates occupent je ne sais quelle région intermédiaire entre la poésie et la musique; elles n'ont pas été faites pour être profondément étudiées; et elles doivent être lues dans ces heures de rêverie où l'imagination se laisse aller au charme du vague, où sommeillent les facultés de l'esprit qui raisonnent et qui jugent.
Un moyen facile de rendre piquante l'analyse des comédies de Shakespeare serait d'en faire une critique rationnelle, en montrant sur combien de points elles choquent cet esprit raisonneur, auquel précisément nous refusons le droit de donner ici son avis et qui doit dormir pendant leur lecture: mais à quoi bon prouver que le poète n'a pas su atteindre un certain idéal de perfection qu'il ne s'est jamais proposé? Il ne voulait, avec ces charmants ouvrages, qu'amuser la fantaisie; il ne prétendait point satisfaire la raison. Un homme qui portait dans son cerveau le poids de tant de grandes tragédies pouvait apparemment, sans le congé de la critique, se délasser l'esprit à des œuvres moins fortes, et ce serait manquer lourdement de tact que de venir reprocher à l'auteur de Macbeth d'avoir négligé dans ses comédies les caractères et l'intrigue. Il faut, au contraire, s'émerveiller de ce que ces jeux du génie ont encore de puissant et d'original, de ce que ces productions moindres,
De toute autre valeur éternels monuments,
Ne sont d'Achille oisif que les amusements.
M. Humbert a fait, il est vrai, des comédies de Shakespeare une critique sévère qui, à la réserve de quelques excès de langage, est juste, spirituelle et utile; mais M. Humbert se trouvait placé dans de tout autres conditions que nous. Il avait à redresser le jugement de ses compatriotes égaré par les incroyables aberrations des Gervinus et des Ulrici. Ces critiques trop pénétrants avaient découvert dans les comédies du grand tragique de profondes intentions morales, des idées, comme ils disaient, dont le germe même n'a jamais existé que dans leur propre cerveau; ils considéraient son théâtre comique comme réunissant toutes les perfections, et au lieu de prendre le Songe d'une nuit d'été simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un charmant libretto d'opéra fantastique, ils prétendaient y voir le chef-d'œuvre de la comédie de caractère! M. Humbert a donc bien fait de montrer aux Allemands qu'il n'y a point de caractères dans le Songe d'une nuit d'été, non plus que dans les autres comédies féeriques de Shakespeare; qu'un solide aliment pour l'esprit, semblable à celui qu'offre le théâtre de Molière, manque en général aux productions de sa veine comique; que ses meilleures pièces en ce genre sont des fantaisies pures, et que le poète n'a jamais eu d'autre idée que d'amuser l'imagination des spectateurs par des aventures romanesques. En principe, ce n'est point Shakespeare que M. Humbert attaque dans son livre, c'est la superstition absurde des shakespearomanes; mais, comme il arrive inévitablement en pareil cas, le respect pour le dieu lui-même ne laisse pas de souffrir un peu des railleries lancées contre ses adorateurs indiscrets.
Semblable critique serait superflue et même tout à fait déplacée en France, où les comédies de Shakespeare ne sont point surfaites. Jamais les divagations d'outre-Rhin n'ont altéré la santé du goût français en matière de comédie. Nous qui avons l'honneur de compter dans notre littérature le plus grand de tous les poètes comiques, nous aurions mauvaise grâce à nous montrer avares d'éloges pour ceux des autres nations, et nous devons au contraire nous piquer de rendre à Shakespeare sur ce point quelque chose de mieux que la stricte justice.
Une pièce de son théâtre répond assez à l'idée que nous nous faisons en France de la comédie: c'est la Méchante Femme mise à la raison[2]. Ici l'élément fantastique est nul; l'action, pleine de verve et de gaieté naturelle, se développe raisonnablement et logiquement, et une idée morale d'une clarté parfaite s'en dégage à la fin. Par malheur, cette farce excellente ne saurait être comptée au nombre des richesses vraiment personnelles de Shakespeare sans injustice pour le poète antérieur qui lui en a fourni non seulement le sujet, mais presque toute l'ébauche et la première façon; elle n'est qu'un rifacimento. La Méchante Femme mise à la raison, par l'imitation des réalités de la vie bourgeoise, constitue une exception dans le théâtre comique de Shakespeare, ainsi que les Joyeuses Bourgeoises de Windsor. Ces deux pièces, les plus franchement comiques que le poète ait signées de son nom, sont aussi les moins propres à caractériser son génie. D'après une tradition qu'on a tout lieu de croire vraie, la farce des Joyeuses Bourgeoises de Windsor fut écrite en quinze jours, sur un ordre de la reine Élisabeth, qui voulait rire aux dépens de Falstaff amoureux; elle est presque tout entière en prose, contrairement à l'usage de Shakespeare, et, par une dérogation plus grave aux habitudes du grand poète, le fond en est presque aussi prosaïque que le style. Jamais personnage de théâtre n'a subi une dégénération plus complète que Falstaff, en tombant du drame historique de Henry IV sur la nouvelle scène où Shakespeare le replaçait pour le divertissement d'une reine de peu de goût. Le brillant et vaillant humoriste est devenu un lourd coquin, sans esprit, sans invention, qui se laisse berner par deux femmes, s'avoue vaincu au dénouement et fait amende honorable. «Ce drôle, s'écrie un critique anglais, n'est qu'un vulgaire imposteur qui a volé au vrai Falstaff son gros ventre et son nom!»
Nous touchons ici à une distinction extrêmement importante: celle des comédies ou prétendues comédies de Shakespeare et de son génie comique en général; pour avoir de son génie comique une idée juste et complète, ce ne sont pas seulement les ouvrages qui portent, à tort ou à raison, le nom de comédies, c'est tout l'ensemble de l'œuvre shakespearienne qu'il conviendrait de considérer. En France, la tragédie et la comédie se sont rigoureusement séparées, celle-là vivant dans un monde idéal, celle-ci dans le monde réel: voilà pourquoi dans notre théâtre la comédie se détache avec un relief d'une incomparable netteté; mais ailleurs les choses se sont passées tout autrement. Les deux muses ne craignaient pas de faire ménage ensemble, et il y avait déjà tant de réalisme comique dans les œuvres de la tragédie, que, lorsqu'il a plu à la comédie d'habiter un domaine à part, elle a dû se construire dans les airs un palais de fantaisie.
M. Guizot a très clairement expliqué ce point dans une page de son étude sur Shakespeare qui a toujours beaucoup frappé par sa justesse les critiques étrangers, et qui jette en effet la plus vive lumière sur la question.
«A l'arrivée de Shakespeare, écrit M. Guizot, la nature et la destinée de l'homme, matière de la poésie dramatique, ne s'étaient point divisées ni classées entre les mains de l'art... Le comique, cette portion des réalités humaines, avait droit de prendre sa place partout où la vérité demandait ou souffrait sa présence... En un tel état du théâtre et des esprits, que pouvait être la comédie proprement dite? Comment lui était-il permis de prétendre à porter un nom particulier, à former un genre distinct? Elle y réussit en sortant hardiment des réalités ... elle ne s'astreignit point à peindre des mœurs déterminées ni des caractères conséquents; elle ne se proposa point de représenter les choses et les hommes sous un aspect ridicule, mais véritable; elle devint une œuvre fantastique et romanesque, le refuge de ces amusantes invraisemblances que, dans sa paresse ou sa folie, l'imagination se plaît à réunir par un fil léger, pour en former des combinaisons capables de divertir ou d'intéresser sans provoquer le jugement de la raison. Des tableaux gracieux, des surprises, la curiosité qui s'attache au mouvement d'une intrigue, les mécomptes, les quiproquos, les jeux d'esprit que peut amener un travestissement, tel était le fond de ce divertissement sans conséquence...»
Une comédie de Shakespeare en général est un roman d'aventures ou un conte de fées dont les héros sont deux amoureux. Une séparation arrive pour un motif ou pour un autre entre l'amant et sa maîtresse; celle-ci, sous un déguisement d'homme, suit ou rejoint son amant qui ne la reconnaît pas. Ce fait, sans cesse reproduit, donne la mesure de ce que le poète croit pouvoir oser dans l'ordre des choses invraisemblables et impossibles. Les personnages principaux de la pièce n'ont jamais d'autre folie que l'amour, qui chez eux n'a rien de ridicule, puisqu'ils sont deux jeunes gens; leur passion n'est donc point comique. Les jeunes premiers du théâtre de Molière ne sont pas comiques non plus; mais chez Molière ils n'occupent pas le premier plan du tableau; ce sont des figures autrement caractérisées, Harpagon, Chrysale, Orgon, Tartuffe, Argan, M. Jourdain, avec la diversité de leurs ridicules et de leurs vices, qui attirent surtout et retiennent l'attention du spectateur: chez Shakespeare ce sont toujours des amoureux et des amoureux jeunes.
De tels personnages n'ayant rien de plaisant par eux-mêmes, et leur situation étant souvent tragique, le poète, afin d'égayer leur rôle, a recours à la vivacité spirituelle du dialogue. L'esprit de mots, extrêmement rare et presque introuvable dans le théâtre de Molière, surabonde dans celui de Shakespeare. Les calembours, les concetti, les équivoques, les assauts brillants et les vives ripostes constituent certainement le plus clair de ses ressources comme auteur comique. Il n'est pas nécessaire que ces traits d'esprit soient en même temps des traits de caractère et de nature; il n'est pas même nécessaire qu'ils aient quelque rapport avec le sujet: il suffit qu'ils brillent. Comme ils ne tiennent aux personnages par aucun lien profond, on peut les transporter indifféremment d'une bouche à l'autre, ils sont également bons en toute circonstance; aussi peu variés qu'ils sont nombreux, ce sont le plus souvent des joyeusetés égrillardes sur le rapport des sexes, auxquelles des femmes modestes prêtent l'oreille et répondent dans le même style sans aucun embarras.
A côté de ces personnages spirituels, il y a généralement dans les comédies de Shakespeare un groupe d'idiots dont la bêtise est démesurée et idéale, je veux dire hors de toute proportion avec ce que la réalité offre communément en ce genre; leur stupidité consiste principalement à prendre les mots les uns pour les autres, et ces grosses balourdises constituent, après les traits d'esprit, la seconde source ordinaire du rire dans la comédie shakespearienne.
Le hasard, autrement dit le caprice et l'arbitraire, joue dans ces pièces un rôle suprême; c'est un heureux hasard qui délie subitement le nœud de Beaucoup de bruit pour rien, donnant ainsi un dénouement de comédie à cet imbroglio tragique. Les figures principales n'étant point des pères de famille vicieux ou ridicules, mais de jeunes et sympathiques amoureux, ces œuvres légères ont pour cadre non pas, comme chez Molière, le foyer domestique, mais l'espace illimité du monde réel et du monde idéal ouvert à l'imagination. Les titres sont vagues: Comme il vous plaira, le Soir des Rois ou Ce que vous voudrez, le Songe d'une nuit d'été, Peines d'amour perdues, parce qu'il n'y a jamais de caractère central qui puisse donner son nom à l'ouvrage.—Tels sont les traits généraux de la comédie shakespearienne.
Le docteur Johnson a prétendu que le génie de Shakespeare était instinctivement plus porté vers la comédie que vers la tragédie, qu'il était comique par nature, tragique par la volonté et l'art. L'assertion contraire serait évidemment moins fausse. Ce n'est certes pas dans ses comédies proprement dites que Shakespeare a donné toute sa mesure comme poète; et quant aux éléments comiques de ses tragédies, dont on fait tant de bruit, ils ne sont ni plus nombreux ni plus remarquables que les éléments tragiques de ses comédies. Il y a toujours dans celles-ci un côté pathétique; nous avons noté ailleurs cette part du sentiment dans la Comédie des méprises[3]; l'émotion ne fait pas défaut non plus à Ce qu'il vous plaira, au Soir des Rois, même au Songe d'une nuit d'été. Shakespeare a généralement besoin d'agrandir et de relever ses sujets comiques par quelque inspiration demandée aux pensées plus hautes de la tragédie; la pure farce n'est point de son goût, et les deux pièces de son théâtre qui appartiennent par exception à cette catégorie ne sont pas, comme nous l'avons remarqué tout à l'heure, des productions vraiment originales de sa muse.
On ne sait rien de certain sur le caractère du poète; mais une tradition très vraisemblable le présente comme un homme d'humeur gaie, bienveillante et sereine. Cette disposition optimiste est beaucoup moins favorable qu'on pourrait le croire d'abord au développement du véritable génie comique. «Je me figure, a dit Sainte-Beuve, que, dans la vie commune, Shakespeare, le poète des pleurs et de l'effroi, développait volontiers une nature plus riante et plus heureuse, et que Molière, le comique réjouissant, se laissait aller à plus de mélancolie et de silence.» Avec un peu de réflexion, on reconnaîtra que ce qui semble un paradoxe est la vérité même, et que la comédie est plus triste au fond que la tragédie.
Le poète tragique s'amuse à peindre les crimes et les grandes passions de l'homme; cela ne peut pas le toucher beaucoup, parce que l'objet de sa peinture est trop éloigné de lui et trop exceptionnel; mais le poète comique étudie des vices, des ridicules, des folies que le spectacle du monde met en abondance sous ses yeux: comment, pour peu qu'il ait de sérieux dans l'âme, conserverait-il une inaltérable gaieté naturelle au milieu de tant de misères intellectuelles et morales?
Shakespeare a pu garder toute sa gaieté, parce qu'il n'a fait qu'effleurer la comédie. Productions de sa jeunesse pour la plupart, ses œuvres comiques se distinguent toutes par un optimisme que rien ne déconcerte; les méchants s'y convertissent à la fin, et les malheureux y voient changer leur infortune en joie. Vive la gaieté, la jeunesse et l'amour! chante l'heureux poète, et à bas leurs ennemis! à bas les puritains, les philistins, les pédants, la raison morose, l'esprit de discipline et de morgue, les graves et lourds censeurs de la folie et du plaisir, tels qu'ils sont personnifiés dans Malvolio: ce sont les seules victimes de Shakespeare. Son esprit n'est jamais blessant ni cruel; il ne fond pas sur les ridicules pour les mettre en pièces et les dévorer à la façon d'un oiseau de proie; il rit, chante et prend son essor en plein ciel bleu, comme l'alouette. Sa gaieté est celle d'un enfant; de même que les enfants, elle s'amuse de rien. «Je supplie votre Grâce de me pardonner, dit Béatrice; je suis née pour ne dire que des folies sans conséquence:» voilà l'épigraphe qu'il faudrait mettre à tout le théâtre comique de Shakespeare.
Nulle amertume ne trouble l'innocence de ces aimables jeux. Le poète eût applaudi de bon cœur au sentiment de Sterne disant dans un de ses sermons: «Il y a bien de la différence entre ce qui est amer et ce qui est piquant, entre la malignité et la verves spirituelle. L'une est sans humanité, et c'est un talent du diable; l'autre descend du père des esprits, si pure, si inoffensive dans sa généralité, qu'elle ne fait individuellement de mal à personne; lorsqu'elle effleure un ridicule, c'est d'une touche délicate et légère; le seul coup qu'elle donne à la sottise, c'est, en passant, un coup de pinceau.»—Nulle amertume, avons-nous dit; mais prenons-y garde: ces mots ne sont-ils pas synonymes de superficiel et sans profondeur? l'arrière-goût de tout ce qui est profond, en fait de comédie, n'est-il pas toujours plus ou moins amer?
Henri Heine s'amusait beaucoup de la difficulté particulière qu'éprouvent les Français à goûter sincèrement les comédies de Shakespeare, à cause de leur prédilection marquée pour ce qui est raisonnable, clair, logique et substantiel en littérature:
«Ils regardent d'un air stupéfait à travers la grille dorée; ils voient se promener sous les grands arbres les chevaliers et les nobles dames, les bergers et les bergères, les fous et les sages; ils voient l'amant et sa maîtresse qui, couchés sous l'ombre fraîche, échangent de tendres propos; de temps en temps, ils aperçoivent quelque animal fabuleux: par exemple, un cerf à ramure d'argent, ou une licorne effarouchée qui sort en bondissant de dessous un bosquet et vient poser sa tête sur le sein de la belle jeune fille... Ils voient encore sortir des ruisseaux les ondines avec leur chevelure verte et leurs voiles brillants, et tout à coup la lune qui vient éclairer ce tableau... Ils entendent ensuite le chant du rossignol... Et ils secouent leurs petites têtes raisonneuses en présence de toutes ces folies incompréhensibles pour eux! C'est que les Français qui comprennent le soleil, sont incapables de comprendre la lune, et encore bien moins les sanglots délicieux et les trilles du rossignol dans son ravissement mélancolique... Ils entendent des mots connus, mais ces mots ont un tout autre sens. Ils prétendent alors que ces gens-là n'entendent rien à la passion ardente, à la grande passion, que c'est de l'esprit à la glace qu'ils se servent les uns aux autres, en guise de rafraîchissement, et non le breuvage brûlant de l'amour... Et ils ne s'aperçoivent pas que ces gens ne sont que des oiseaux déguisés qui conversent dans une langue à part, langue qu'on ne peut apprendre qu'en rêve.»
Cette page délicieuse est aussi une page profonde. Il est certain que les personnes (peuples ou individus) qui ne goûtent pas les comédies de Shakespeare, sont moins habiles et moins heureuses que celles qui les goûtent, puisqu'elles manquent d'un sens et d'un plaisir. Le but propre de l'éducation esthétique n'est point de fermer avec une sévérité chagrine, mais au contraire d'ouvrir et de multiplier les sources de jouissance pour l'esprit. D'une manière générale on peut dire que, plus un homme a d'instruction, plus il sait apprécier de fruits différents dans ce paradis terrestre des beaux-arts et de la poésie, où les gens d'un esprit étroit et contentieux prétendent que les seuls arbres bons sont ceux de leur petit verger, et du haut de leur ignorance regardent dédaigneusement tout le reste du jardin. L'homme dans l'esprit duquel le mot comédie n'éveille pas d'autre idée que celle du genre cultivé par Molière, est exclusif et borné; d'autant plus borné que ce genre n'est nullement, à tout prendre, le plus répandu. Bien des œuvres, dans notre littérature elle-même, peuvent nous préparer à l'intelligence de Shakespeare et nous acclimater en quelque sorte à l'air de sou théâtre comique. De ce nombre sont les six comédies de Corneille avant le Menteur; le théâtre de Marivaux, où les jeux de l'amour et du hasard constituent, comme dans celui de Shakespeare, le fond même et toute la substance des pièces; enfin le théâtre d'Alfred de Musset. La comédie selon Molière et la comédie selon Shakespeare se ressemblent comme le jour et la nuit, rien de plus juste que cette comparaison de Heine, mais elles ont chacune leur beauté: le jour a le soleil divin; la nuit a ses délicieux mystères et son ordre de splendeurs aussi, ses clairs de lune, son ciel étoilé et la musique des rossignols.
Cela dit, je me permettrai d'opposer à la jolie page d'Henri Heine, en style moins poétique que le sien, une remarque dont la portée me semble considérable: c'est que, si les Français ont besoin de tant d'éducation pour goûter les comédies de Shakespeare, la réciproque n'est pas vraie et que la même étude n'est point nécessaire aux étrangers pour goûter les comédies de Molière. On parle beaucoup du caractère étroitement national de cette forme de l'art dramatique: oui, cela est certain, la tragédie, vivant dans un monde plus ou moins idéal, vague et conventionnel, se fait aisément comprendre partout, au lieu que la comédie, puisant généralement ses sujets dans la réalité contemporaine et locale, devient vite inintelligible pour les autres âges et les autres peuples; mais prétend-on, par cette remarque banale, clore toute discussion et renvoyer en paix chacun chez soi? Je suis plus intolérant que cela, et je réclame formellement pour Molière le sceptre souverain de tout l'empire comique.
En l'année 1800, un célèbre acteur anglais, Kemble, vint à Paris. Ses confrères de la Comédie-Française lui offrirent un banquet. A table on causa d'abord des poètes tragiques des deux nations; la supériorité de Shakespeare sur Racine et sur Corneille était vivement soutenue par l'Anglais contre ses hôtes, qui, par politesse ou par conviction, commençaient à céder le terrain, quand tout à coup le comédien Michot s'écria: «D'accord, d'accord, Monsieur; mais que direz-vous de Molière?» Kemble répondit tranquillement: «Molière? c'est une autre question. Molière n'est pas un Français.—Bah! un Anglais peut-être?—Non, Molière est un homme. Le bon Dieu voulut un jour faire goûter au genre humain dans toute leur perfection, dans toute leur plénitude, les joies dont la comédie peut être la source. Il fit alors Molière et lui dit: «Va, dépeins les hommes tes frères et amuse-les; rends-les meilleurs, si tu peux.» Puis il le lança sur la terre. Sur quel point du globe allait-il tomber? au nord ou au midi? de ce côté-ci ou de l'autre côté de la Manche? Le hasard a fait qu'il est tombé chez vous, mais il nous appartient autant qu'à vous-mêmes. N'a-t-il peint que vos mœurs? n'amuse-t-il que vous? Non, il a peint tous les hommes, et nous jouissons tous également de ses œuvres et de son génie. Devant lui s'évanouissent les petites différences de temps et de lieux; aucun peuple, aucun siècle ne peut le revendiquer comme sien: il est à tous les âges et à toutes les nations.»
Un savant professeur de littérature étrangère, M. Karl Hillebrand, dans un article de la Revue critique[4] consacré à l'appréciation du livre de M. Humbert, fait cette réserve à ses éloges: «Le tort de M. Humbert, c'est d'établir dans les genres une hiérarchie que rien ne justifie. Pourquoi la comédie à caractères serait-elle supérieure à la comédie fantastique? Pourquoi l'Arioste serait-il inférieur à Cervantes, et Rembrandt au Corrège? Ce sont là affaires de goût... Le Songe d'une nuit d'été et le Petit Poucet me font rire ou me touchent, me plaisent en un mot autant que le Festin de Pierre ou le Malade imaginaire, et point n'est besoin, ce me semble, d'établir des comparaisons et de mesurer le degré de plaisir qu'on éprouve.»
Je ne saurais être de l'avis de M. Hillebrand, quel que soit le crédit de l'adage sur lequel il s'appuie: «Il ne faut pas disputer des goûts.» Il est vrai que les disputes littéraires sont sans fin, de même que les disputes politiques, de même que les disputes religieuses; pourquoi? parce que l'esthétique, la politique, la religion, ne sont pas des sciences, et qu'il n'y a point, dans cet ordre de questions, de principe assez évident ou assez démontré pour fermer la bouche à l'adversaire. Il y a longtemps que Socrate l'a dit:
«Si nous disputions ensemble sur deux nombres, Eutyphron, pour savoir lequel est le plus grand, ce différend nous rendrait-il ennemis et nous armerait-il l'un contre l'autre? et en nous mettant à compter, ne serions-nous pas bientôt d'accord?
—Cela est sûr.
—Et si nous disputions sur les différentes grandeurs des corps, ne nous mettrions-nous pas à mesurer, et cela ne finirait-il pas sur-le-champ notre dispute?
—Sur-le-champ
—Et si nous contestions sur la pesanteur, notre différend ne serait-il pas bientôt terminé par le moyen d'une balance?
—Sans difficulté.
—Qu'y a-t-il donc, Eutyphron, qui puisse nous rendre ennemis irréconciliables, si nous venions à en disputer sans avoir de règle fixe à laquelle nous puissions avoir recours?... Vois un peu si par hasard ce ne serait pas le juste et l'injuste, l'honnête et le déshonnête, le bien et le mal. Ne sont-ce pas là les choses sur lesquelles, faute d'une règle suffisante pour nous mettre d'accord dans nos différends, nous nous jetons dans des inimitiés déplorables? Et quand je dis nous, j'entends tous les hommes.»
Il en est de même dans l'ordre du beau. La différence des goûts peut exaspérer jusqu'à une «inimitié irréconciliable» les natures passionnées; et les haines littéraires, aussi bien que les haines politiques et les haines religieuses, ont une singulière amertume, provenant sans aucun doute du sentiment humiliant de l'impuissance où nous sommes de convaincre et de convertir notre adversaire. Voilà, semble-t-il, une bonne raison pour supprimer toute dispute de ce genre; et en effet les sages de ce siècle, professant en matière de goût une indifférence très philosophique, ont enseigné qu'il fallait désormais remplacer la critique des œuvres par l'analyse des talents; mais ils n'ont pas réussi à imposer silence, ni autour d'eux ni dans leurs propres ouvrages, aux libres manifestations du sentiment littéraire. C'est qu'il s'agit ici d'un instinct naturel et, par conséquent, indestructible.
La critique littéraire repose, il est vrai, sur une contradiction: la légitimité des disputes de goût et l'impossibilité d'y mettre un terme; mais cela ne l'empêche pas de vivre et de se bien porter, au contraire. Il y a autre chose, dans le monde de la pensée, que des faits de science et des vérités de l'ordre logique; Dieu merci, l'idéal du positivisme n'est pas encore réalisé. Parce que je ne puis pas vous prouver mathématiquement que j'ai raison, dois-je me taire? Non pas; j'aurai besoin seulement, pour communiquer mon sentiment à autrui, d'une éloquence plus persuasive, il n'y a point de mal à cela. La nature intime d'une conviction ne prouve pas que cette conviction soit vaine, et les vérités impossibles à démontrer ne sont pas celles qui s'emparent de nos âmes avec le moins de puissance.
La préférence de M. Humbert et de bien d'autres pour Molière et pour la comédie à caractères n'a point de fondement logique, c'est vrai; elle ne peut pas s'imposer victorieusement à l'adversaire rendu muet par un syllogisme péremptoire: mais est-ce à dire qu'elle ne soit pas fondée en raison et qu'elle ne puisse se justifier par des arguments très forts et des considérations excellentes? M. Hillebrand soutient que rien n'autorise à établir dans les genres une hiérarchie, que la comédie à caractères n'est point supérieure en soi à la comédie fantastique: est-ce bien sûr? A sa comparaison de Cervantes et de l'Arioste, de Rembrandt et du Corrège, j'en opposerai une autre, qui me paraît plus juste.
Les opéras du style italien ont leur charme: tant pis pour les personnes qui ne les goûtent pas: mais n'est-ce pas une chose reconnue par ceux même qui comprennent mal la musique allemande, qu'elle est d'un ordre supérieur? Les grandes compositions de Molière, où tout est vrai, profond, sérieux, où nul mot n'est inutile, où nul trait ne s'égare, me semblent être aux spirituelles extravagances de la comédie shakespearienne ce que la puissante harmonie d'un Beethoven est aux mélodies agréables, mais sans rapport avec le sujet, qui caractérisent le style italien. Les Mille et une Nuits sont des contes amusants; mais qui oserait les mettre en parallèle avec Don Quichotte? Il y a un comique d'homme et un comique d'enfant: Molière a choisi le premier. La haute raison, la profondeur morale, sont en littérature quelque chose de plus relevé que les caprices riants de l'imagination et de l'esprit; l'homme est un objet plus digne de l'étude d'un poète que le monde fantastique des lutins et des fées. Je ne puis pas prouver cela, mais je le sens, et je me crois parfaitement autorisé à le dire.
Répliquera-t-on que si Molière l'emporte sur l'auteur du Songe d'une nuit d'été comme penseur et comme moraliste, il lui est inférieur comme poète? Je ne demande pas mieux que de faire regagner à Shakespeare en poésie ce qu'il me paraît perdre du côté de l'étude des caractères et des passions; mais, d'autre part, je ne suis nullement disposé à faire bon marché de Molière comme poète. Il y a là sur la nature et sur l'objet de la poésie la matière d'une discussion sans fin, comme toutes celles du même genre, mais non point vaine pour cela; car si les gens éclairés se taisent, le vulgaire, que ces questions éternellement à l'ordre du jour ont le privilège d'intéresser, ne s'en mêlera pas moins de donner sur elles son avis et dira encore un peu plus de sottises.
Que les critiques consultent leurs forces et suivent la voie à laquelle lu nature et l'éducation les destinent. Parmi les hommes qui ne sont ni des créateurs ni des inventeurs et qui doivent, faute d'un génie original, se contenter du rôle utile et modeste d'interprètes de la pensée d'autrui, les uns mettent leur étude à constituer le texte exact des grands écrivains, à en commenter la lettre, à remonter aux sources des idées et des mots: ce sont les philologues. D'autres ont à cœur de réunir le plus grand nombre de faits positifs relativement à la personne des auteurs, au lieu et au temps où ils ont vécu, afin d'expliquer par les influences de la race, de la famille, de l'éducation, du moment et du milieu la nature particulière de leur talent: ce sont les historiens. D'autres enfin ne craignent pas d'exercer, en présence des œuvres du génie, une fonction de l'esprit vraiment bien délicate et bien aventureuse; elle consiste à traduire en jugements plus ou moins absolus et généraux les impressions diverses que la sensibilité a reçues: ce sont les critiques littéraires proprement dits, ou, pour employer un terme d'une parfaite exactitude, les esthéticiens. Le mot esthétique, tiré du grec αἰσθάνεσθαι, sentir, a été introduit au XVIIIe siècle par un philosophe allemand pour désigner ce qu'on appelle faussement la science du beau; néologisme excellent, parce que sa racine transparente empêche qu'on se fasse illusion sur le caractère foncièrement subjectif de cette prétendue science.
Il n'est pas impossible à un même individu de réunir en sa personne les aptitudes diverses du philologue, de l'historien et de l'esthéticien, et de remplir ainsi les conditions du critique complet; mais en tout la perfection est chose rare, et la différence naturelle des goûts, la division de plus en plus fine du travail intellectuel, sont cause que la plupart des critiques choisissent entre ces trois tendances et en suivent une avec une prédilection assez marquée pour qu'il soit permis de les classer par genres. Aujourd'hui, deux fonctions de la critique sont en honneur: ce sont la philologie et l'histoire; la troisième, l'esthétique, est méprisée. Ce mépris a sa source dans l'esprit positif du siècle, qui a besoin de certitude et de notions concrètes, et que les vaines discussions et les vaines théories ont abreuvé jusqu'au dégoût. Quelques-uns des adeptes les plus enthousiastes de la philologie sont des transfuges de l'esthétique, apportant comme d'usage dans leur foi nouvelle la passion et l'intolérance propre aux néophytes. Épouvantés un jour du néant, ou, pour rappeler une expression célèbre, du grand creux qui se trouve au fond de toutes les idées purement littéraires, ils se sont jetés tout à coup dans les bras de la science comme un sceptique se jette dans ceux de la religion.
Je comprends trop bien ce découragement, et je n'essaierai pas de défendre l'esthétique contre la philologie et l'histoire en revendiquant pour elle un caractère scientifique quelconque, car je n'y crois point. J'ai cherché, parmi les idées littéraires qui ont été mises en circulation depuis Aristote jusqu'à Hegel, des vérités à la fois assez sûres et assez riches en conséquences utiles pour servir de pierres d'assise à la critique: je n'en ai point trouvé; les propositions incontestables sont toutes plus ou moins insignifiantes, et les seules qui vaillent la peine d'être avancées sont sujettes à contestation.
Cependant, j'oserai dire quelque chose en faveur de l'esthétique. De même que l'homme ne vit pas seulement de pain, l'esprit ne saurait se nourrir uniquement de science et de faits. Le degré de culture intellectuelle d'un individu ne se mesure pas par la simple addition de ses connaissances exactes et positives. La politesse, l'esprit, le goût, le sentiment exquis des nuances, le doute prudent et l'ignorance modeste, sont aussi des fruits de l'éducation, et de l'éducation littéraire, non point scientifique. Les lettres sont l'agent civilisateur par excellence, humaniores litteræ, tandis que le triomphe exclusif des sciences et l'avènement d'un état purement positif du monde, rêvé par quelques philosophes modernes, ferait tomber l'humanité sous le joug de la plus féroce tyrannie. La douceur et le charme seront bannis de la société des hommes le jour où l'on n'aura plus le droit de se tromper librement sur aucun sujet, et où toute erreur se verra brutalement enregistrée au compte de l'ignorance.
Donnons-nous garde d'introduire dans les questions littéraires, qui relèvent avant tout du sentiment, c'est-à-dire de la liberté, un esprit de roideur scientifique, et continuons à les traiter, non avec l'âpreté de cuistres convaincus qu'ils ont seuls tout à fait raison contre leurs adversaires, mais avec le tact et la bonne grâce d'hommes éclairés qui savent que dans cet ordre de choses rien ne saurait être absolument vrai ni absolument faux. Si un jour je dois faire comme tant d'autres, et abandonner à mon tour le sol incertain des jugements de goût pour me reposer et m'affermir sur le terrain plus commode et plus sûr de la philologie ou de l'histoire, qu'au moins ce ne soit pas sans avoir donné â l'esthétique un banquet d'adieu et fait avec les pures idées littéraires une dernière orgie..
J'ai comparé, dans un autre ouvrage, Shakespeare et les Tragiques grecs. Il n'y a point lieu de faire la même comparaison entre Shakespeare et Aristophane, car ici les rapports deviennent extrêmement superficiels. La matière et l'inspiration des deux théâtres diffèrent autant qu'il est possible. Quand on a dit que l'un et l'autre sont pleins de fantaisie, quand on a nommé la féerie des Oiseaux, cette brillante exception dans l'œuvre toute politique d'Aristophane, on a complètement payé sa dette envers une comparaison des deux poètes. Au fond, quoi de moins semblable au doux et inoffensif Shakespeare que ce violent pamphlétaire athénien, animé de terribles haines littéraires, politiques, religieuses, poursuivant ses ennemis sur la scène et faisant du théâtre un pilori? Quel rapport sérieux peut-on établir entre des imaginations si pures, si éthérées, si détachées du monde réel, qu'elles donnent un démenti à la définition vulgaire de la comédie, et un théâtre cynique qui ne s'écarte pas moins de cette définition, mais dans l'autre sens, et qui, à force de réalisme au contraire et d'actualité, ressemble à une polémique de journal, ou, comme on l'a si vivement dit, à «une tribune dressée sur des tréteaux, où l'orateur improvisé venait faire de la politique à sa manière, gambadant à droite et à gauche et tirant la langue aux hommes d'État[5]»?
L'habitude de rapprocher les noms d'Aristophane et de Shakespeare est une tradition de la critique qui doit probablement son origine moins à des qualités communes aux deux poètes qu'à ce qui leur manque à l'un et à l'autre: peu ou point d'intrigue, encore moins de caractères, composition décousue et capricieuse. Plutarque a dit, non sans justesse, mais avec dureté et dans un esprit malveillant: «Chez Aristophane, le choix et l'arrangement des mots est tantôt tragique, tantôt comique, fastueux ou terre à terre, obscur et commun, enflé et prétentieux, mêlé de bavardage et de futilités qui donnent la nausée. Ce style qui a tant d'incohérence et d'inégalité ne prête pas à chaque personnage le ton qui lui convient et lui est propre. Un roi devrait parler avec majesté, un orateur avec adresse, les femmes avec naturel, les simples citoyens sans recherche, le marchand de l'agora sans façons; mais chez Aristophane, c'est le hasard qui met dans la bouche de chaque personnage les premières paroles venues, d on ne peut reconnaître si c'est un fils, un père, un paysan, un dieu, une vieille femme ou un héros qui parle.»
Pareillement, si l'idée venait à quelqu'un de rapprocher Plaute de Shakespeare, ce ne pourrait être que pour les bizarreries ou les faiblesses qui se mêlent à leur comique; parce que chez l'un et chez l'autre l'esprit est surtout dans les mots, et parce que le hasard joue dans la conduite de leurs pièces un rôle prépondérant. Il n'y aurait donc point de base solide pour une comparaison du poète anglais avec les grands comiques anciens.
Je me propose, dans ce volume, de traiter, à l'occasion des comédies de Shakespeare, quelques questions générales de critique littéraire plus instructives et même plus amusantes (je l'espère, du moins) que ne pourrait l'être la critique particulière de ces charmantes productions, insaisissables à l'analyse, musique aérienne faite pour être écoutée en rêvant, non pour être commentée.
Le point de départ de nos considérations sera l'examen des jugements que certains admirateurs trop exclusifs de Shakespeare et d'Aristophane en Allemagne ont portés sur Molière, et j'aime à penser que cette étude fortifiera en nous la double conviction que Molière et Shakespeare sont les deux plus grands noms du théâtre moderne, l'un dans la comédie, l'autre dans la tragédie. Je ne voudrais nullement abaisser Shakespeare; mais je prétends, contre la critique allemande, élever Molière à son niveau. Les qualités qu'on a toujours le plus admirées dans le théâtre tragique de Shakespeare, la profondeur psychologique et morale, la vie des caractères, la puissante objectivité dramatique, la poésie, oui, la poésie, nous les retrouvons toutes dans Molière. Il ne faut pas que les sottises des pédants qui voudraient brouiller ces deux grands hommes nous empêchent de reconnaître et de saluer en eux deux frères. Ils avaient, comme nous le verrons, les mêmes idées sur le théâtre, la même poétique.
La parenté de leurs génies a vivement frappé le plus excellent des critiques français:
«Molière, écrit Sainte-Beuve, est, avec Shakespeare, l'exemple le plus complet de la faculté dramatique et, à proprement parler, créatrice ... Corneille, Crébillon, Schiller, Ducis, le vieux Marlowe, sont sujets à des émotions directes et soudaines dans les accès de leur veine dramatique. Souvent sublimes et superbes, ils obéissent à je ne sais quel cri de l'instinct et à une noble chaleur du sang, comme tes animaux généreux, lions ou taureaux; ils ne savent pas bien ce qu'ils font. Molière, comme Shakespeare, le sait; comme ce grand devancier, il se meut, on peut le dire, dans une sphère plus librement étendue, et par cela supérieure, se gouvernant lui-même, dominant son feu, ardent à l'œuvre, mais lucide dans son ardeur. Et sa lucidité néanmoins, sa froideur habituelle de caractère au sein de l'œuvre si mouvante, n'aspirait en rien à l'impartialité calculée et glacée, comme on l'a vu de Gœthe, le Talleyrand de l'art: ces raffinements critiques au sein de la poésie n'étaient pas alors inventés. Molière et Shakespeare sont de la race primitive[6].»
Ajoutons qu'à eux seuls, parmi les grands génies dramatiques, il a été donné de ravir également le goût des délicats et celui du peuple.
Une touchante conformité de destinées achève la ressemblance et leur fait traverser l'histoire littéraire la main dans la main. Des légendes ont eu cours sur l'un et sur l'autre, honneur qui n'appartient qu'aux poètes populaires. La sotte envie les a tous deux accusés de plagiat; en effet ils ont pillé largement, sans prendre la peine de démarquer le linge, avec le sans façon de l'âge d'or où tout était en commun[7]: la belle affaire! dévoré par de tels princes, le menu fretin de la littérature meurt pour entrer dans une vie plus haute...
... Vous leur fîtes, seigneur,
En les croquant, beaucoup d'honneur.
D'infâmes calomnies ont tenté de noircir la réputation morale de Molière comme de Shakespeare. Ils ont l'un et l'autre connu de près la multitude et fréquenté la cour, subissant ainsi la double et salutaire influence, du peuple avec lequel leur profession les mettait en contact, et de la société élégante. Ils ont tous deux souffert des affronts attachés au métier de comédien. Tous deux ils étaient riches, ils aimaient le luxe, et n'affectaient nullement la gueuserie de la bohême littéraire. Shakespeare entendait fort bien ses affaires de directeur de théâtre; Molière avait trente mille livres de revenu et donnait d'excellents dîners.
Bref, ils ont pleinement joui des réalités de la vie présente; ils ont connu toutes les joies, toutes les douleurs de l'humanité, et ils ont usé rapidement leur existence dans le tourbillon dévorant d'une incessante activité dramatique. A la différence des hommes de cabinet et de tranquille étude, le théâtre, le monde était leur laboratoire. Tout entiers à l'œuvre du moment, leur modestie ne paraît pas avoir deviné quelle gloire immortelle et grandissante ils auraient dans l'avenir: les premières éditions complètes de leurs œuvres ne furent pas publiées de leur vivant ni préparées par leurs soins; elles parurent sept ans après la mort de Shakespeare, neuf ans après celle de Molière.