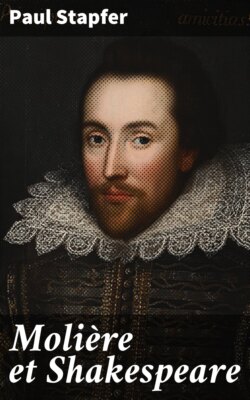Читать книгу Molière et Shakespeare - Paul Stapfer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER PARADOXES ALLEMANDS SUR MOLIÈRE
ОглавлениеGuillaume Schlegel.—Point de départ de son argumentation.—Sa théorie de la gaieté.—Prétendue incompatibilité du comique et du sérieux.—Perfection d'Aristophane, prosaïsme de Ménandre et de Molière selon Schlegel.—Le Roi de Cocagne de Legrand.—Étrange paradoxe de Hegel.—L'Avare—Le Médecin malgré lui.—Peines d'Amour perdues.
Il faut être juste envers tout le monde, même envers les Allemands. J'ai vu jouer à Munich quelques comédies de Molière: elles ont fait grand plaisir, et le succès du poète est le même, assure-t-on, sur tous les théâtres d'Allemagne. La nation allemande, les hommes de génie qui sont les représentants les plus éminents de l'esprit germanique, partagent sur Molière le sentiment de la France et de l'Europe. Ne nous lassons pas de citer les belles paroles de Gœthe: «Molière est si grand que chaque fois qu'on le relit on éprouve un nouvel étonnement ... Tous les ans je lis quelques pièces de Molière, de même que de temps en temps je contemple les gravures d'après les grands maîtres italiens, pour me maintenir toujours en commerce avec la perfection. Car de petits êtres comme nous ne sont pas capables de garder en eux la grandeur de pareilles œuvres; il faut que de temps en temps nous retournions vers elles pour rafraîchir nos impressions.»
Et néanmoins il est vrai de dire que la critique allemande en général est hostile à Molière. Chez les gens du métier, professeurs, historiens de la littérature, philosophes, critiques de profession, une tradition s'est établie de l'autre côté du Rhin, en vertu de laquelle Aristophane et Shakespeare sont les seuls poètes qui réalisent vraiment l'idée de la comédie, tandis que le genre inauguré en Grèce par Ménandre et porté par Molière au plus haut point de perfection est prosaïque, inférieur et vulgaire. Le nom d'Aristophane ou celui de Shakespeare ne se rencontre guère sous la plume d'un esthéticien allemand sans qu'il en prenne occasion de dire quelque chose de désobligeant pour Molière, et rien n'est plus agaçant que ce parti-pris de dénigrement systématique; ou bien encore, ces savants critiques construisent leur théorie de la comédie, multiplient les exemples tirés des théâtres d'Aristophane et de Shakespeare, et passent sous silence celui de Molière, absolument comme s'il n'existait pas[1].
D'où vient une si étrange dissidence? Il convient de l'attribuer d'abord, en grande partie, à une révolte bien légitime de l'esprit national. La littérature française, non contente de régner sur l'Europe comme une reine doublement glorieuse, doublement digne d'admiration et de respect, par l'ancienneté de sa naissance et par l'incomparable éclat de ses œuvres, l'avait trop longtemps gouvernée et régentée à la façon d'un maître d'école. Lessing commença la réaction, elle était juste et nécessaire alors; mais Guillaume Schlegel en fut l'instrument attardé et passionné sans motif littéraire sérieux. Quand on lit ces fameuses leçons sur la littérature dramatique faites à Vienne en 1808, pendant que Napoléon amassait la haine de l'Europe contre la France, l'intérêt esthétique que pourrait offrir la critique du professeur est gâté désagréablement par le souvenir d'une parole que Lord Byron raconte avoir entendu tomber de sa bouche: «Je médite une terrible vengeance contre les Français, je leur prouverai que Molière n'est pas un poète.»
Cependant, tout n'est pas fureur aveugle dans la critique de Schlegel; elle a un côté rationnel et philosophique qu'il serait injuste de méconnaître. Schlegel reste, après tout, un écrivain d'une valeur considérable, un éloquent vulgarisateur d'idées fécondes, comme Villemain l'a été en France, et de plus un érudit et un artiste; sa traduction de Shakespeare, faite en collaboration avec Tieck, est un ouvrage classique en Allemagne. Nous n'avons point le droit de traiter un tel homme de haut en bas, comme pouvait le faire Gœthe ou Henri Heine[2].
«Pour un être comme Schlegel, disait Gœthe, une nature solide comme Molière est une vraie épine dans l'œil; il sent qu'il n'a pas une seule goutte de son sang et il ne peut pas le souffrir. Il a de l'antipathie contre le Misanthrope, que moi, je relis sans cesse comme une des pièces du monde qui me sont les plus chères; il donne au Tartuffe, malgré lui, un petit bout d'éloge, mais il le rabat tout de suite autant qu'il lui est possible. Il ne peut pas pardonner à Molière d'avoir tourné en ridicule l'affectation des femmes savantes, et il est probable, comme un de ses amis la remarqué, qu'il sent que, s'il avait vécu de son temps, il aurait été un de ceux que Molière a voués à la moquerie... Sa critique est essentiellement étroite; dans presque toutes les pièces il ne voit que le squelette de la fable et la disposition; toujours il se borne à indiquer les petites ressemblances avec les grands maîtres du passé; quant à la vie et à l'attrait que le poète a répandus dans son œuvre, quant à la hauteur et à la maturité d'esprit qu'il a montrées, tout cela ne l'occupe absolument en rien... Dans la manière dont Schlegel traite le théâtre français, le trouve tout ce qui constitue le mauvais critique, à qui manque tout organe pour honorer la perfection, et qui méprise comme la poussière une nature solide et un grand caractère.»
Il est doux de répéter ces paroles de Gœthe; mais ce serait faire beaucoup trop bon marché de Schlegel que de nous en tenir à ce jugement, ou de nous contenter de dire avec Heine qu'«il prit Molière en aversion, comme Napoléon prit en aversion Tacite».
Un penseur bien autrement profond que Schlegel, un homme aussi exempt de sot patriotisme littéraire que fêlait Gœthe lui-même. Hegel, a prouvé par raisons démonstratives que Molière n'avait pas fait de bonnes comédies.
Il y a là un phénomène des plus curieux pour les personnes qu'intéresse l'histoire des singularités de la critique, et je voudrais m'y arrêter quelque temps. A quoi bon? m'a dit quelqu'un. Mais pourquoi serait-il permis au naturaliste, à l'antiquaire, d'examiner en détail dans l'ordre des faits certaines bizarreries de la nature ou de l'art, et défendrait-on au philosophe de faire la même chose dans l'ordre des idées? Un paradoxe est plus amusant qu'une vérité triviale, et j'estime d'ailleurs que les erreurs humaines ont toute espèce de droit à l'indulgente et sérieuse attention des personnes modestes, assez sages pour ne pas prétendre avoir seules la raison de leur côté. Craindrait-on par hasard de se fausser l'esprit en prenant connaissance des idées cornues de ces logiciens qui, par le raisonnement, sont arrivés à cette conclusion rare, que la lune (pour rappeler la jolie comparaison de Heine) est plus brillante que le soleil, et que les comédies de Shakespeare sont plus belles que celles de Molière?
J'ose promettre que les résultats de cette étude seront sains et réellement instructifs: nous en recueillerons l'utile enseignement de la vanité du dogmatisme en littérature. Je ne m'amuserai pas à réfuter les idées particulières des ennemis de Molière, mais j'attaquerai la méthode générale sur laquelle toute leur critique se fonde: je prouverai, contre ces raisonneurs, qu'il n'y a point d'idée, ni rationnelle, ni même empirique, du beau, du comique, de la poésie; que leurs prétentions doctrinales sont une chimère, et que tout jugement esthétique se réduit en dernière analyse à un sentiment libre, spontané, qui est susceptible de culture, mais qui se moque de la science. Je les renverrai au principe éternel, posé par Kant dans sa Critique du jugement de goût et d'abord par Molière dans sa Critique de l'École des femmes: «Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnements pour nous empêcher d'avoir du plaisir.»
Guillaume-Auguste Schlegel part de ce principe, que la comédie doit offrir avec la tragédie un contraste parfait. De tous les genres de poésie la tragédie est le plus sérieux: de tous les genres de poésie la comédie est donc le plus gai; le sérieux est l'essence de la tragédie: donc l'essence de la comédie, c'est la gaieté. Voilà la pierre de l'angle de tout le système. Pour donner à son assise une sorte de consécration, Schlegel cite un passage du Banquet de Platon, où Socrate déclare qu'«il appartient au même homme de savoir traiter la comédie et la tragédie, et que le vrai poète tragique, qui l'est avec art, est en même temps poète comique». Personne, assurément, ne se serait avisé que ces paroles de Socrate pussent être invoquées à l'appui de la théorie; mais admirons ici la subtilité allemande: selon Schlegel, le philosophe grec a voulu dire par là que la connaissance des contraires est une, ou (pour employer les termes mêmes dont Socrate s'est servi ailleurs et les comparaisons qui lui sont familières), qu'on ne peut connaître les choses opposées que l'une par l'autre, et qu'en conséquence il est impossible d'approfondir la nature de la santé sans savoir ce que c'est que la maladie; du contentement, sans savoir ce que c'est que la tristesse; du sérieux, sans savoir ce que c'est que la gaieté; de même il est impossible de pénétrer un peu profondément dans l'essence de la tragédie, sans découvrir du même coup l'idée de la comédie, qui est son contraire.
Je me suis profondément assimilé la pensée de Schlegel, et je me propose de la développer avec autant de soin que si c'était la mienne propre. Foin de ces résumés avares et iniques qui mutilent et qui défigurent la thèse de l'adversaire! Je préviens le lecteur que, dans l'exposé qui va suivre, il trouvera beaucoup de choses qui lui sembleront justes et qui le sont en effet. La vérité est l'alliage grâce auquel l'erreur a cours: il convient, si l'on veut comprendre le succès qu'ont eu dans la critique allemande les idées de Schlegel sur la comédie et sur Molière, de n'y point séparer le faux d'avec le vrai.
Le sérieux et la gaieté, dit Schlegel, ont assez souvent la même apparence pour qu'il puisse nous arriver presque à chaque pas, si nous n'y sommes pas très attentifs, de prendre l'une pour l'autre deux choses si profondément contraires. Qu'on veuille bien y réfléchir: ne sommes-nous pas enclins à croire qu'il n'y a pas de disposition vraiment sérieuse sans une ombre marquée de tristesse, et que le rire qui éclate sur les lèvres d'un homme ou dans les pages d'un livre est un signe non équivoque de gaieté? Eh bien, c'est justement là notre erreur; le sérieux n'est pas toujours triste, et le rire est si peu identique à la gaieté, qu'il peut être sérieux jusqu'à la tristesse. Que dis-je? il peut être tragique. C'est l'arme la plus terrible de l'indignation, du mépris, de la haine; c'est le coup de massue qui terrasse et achève l'ennemi. La gaieté, cette chose vive, ailée et légère, fuit bien loin devant un tel rire. Elle voltige au-dessus du monde réel et glisse, sans jamais s'y abattre, sur nos misères et nos passions. C'est l'hôte d'un monde aérien et fantastique, qui, de loin en loin, vient visiter notre vie lasse et désenchantée, traverse nos ténèbres d'un rayon de lumière et remonte au ciel avec la poésie. L'enfance est gaie; mais combien d'hommes, combien de poètes, ont su conserver ou rappeler les joyeux éclats de rire de l'enfance? Ne vous y trompez pas, nous avertit Schlegel: la plupart des inventions soi-disant comiques appartiennent au fond à la tragédie; car leur rire est sérieux ou même triste. La gaieté, voilà le signe, le seul signe auquel se reconnaît la bonne et franche comédie. Qu'est-ce donc que la gaieté, en langage précis et sans métaphores? Montrons d'abord tout ce qui lui ressemble sans être elle; nous dirons ensuite ce qu'elle est.
La gaieté comique n'a rien de commun avec le rire amer et moqueur ou l'ironie. Pour cesser d'être comique et gaie, il n'est pas nécessaire que l'ironie soit terrible; la plus fine, la plus légère, fût-ce celle de Voltaire, est toujours grave au fond, quelque enjouée qu'en soit la forme; elle trahit une disposition sérieuse, qui est contraire à l'essence de la comédie. Que la colère et le mépris lui inspirent une satire, ou la malice une épigramme, si elle ne tue pas, elle blesse toujours. La gaieté comique, au contraire, est inoffensive et douce: le jeu varié d'une intrigue, les accidents imprévus, les contrastes bizarres, voilà les matières où elle s'exerce, et, si quelquefois elle se moque des travers des hommes, c'est d'une manière si générale qu'elle fait rire tout le monde sans offenser personne.
Il existe, poursuit Schlegel, une autre espèce de gaieté triste et fausse qu'il ne faut pas confondre avec la gaieté comique. Dans le Légataire universel de Regnard, un pauvre vieillard, accablé d'infirmités, touche à sa fin; des scélérats le tourmentent pour son héritage et fabriquent en son nom un faux testament pendant qu'ils le croient à l'agonie. On rit, parce qu'il est impossible de ne pas rire en voyant Crispin s'envelopper dans la robe de chambre du moribond et contrefaire sa voix cassée: mais quel triste sujet de gaieté, grand Dieu! un malheureux qui se débat contre la mort entre les mains avides de ses héritiers!
Ce que Schlegel ajoute est fin et délicat. Je ne demande point, dit-il, au poète comique une morale positive; je ne lui demande même pas de s'interdire la représentation de la ruse, du mensonge, de l'égoïsme, des mauvaises passions, de l'immoralité en un mot; la comédie ferait mieux de ne rien peindre de pire que des ridicules, mais il lui est permis de produire sur la scène le vice lui-même, pourvu que le poète ait une assez grande intelligence de son art et assez de tact moral pour empêcher que ma conscience ne vienne élever sa voix au milieu de la fête qu'il donne à mon esprit. Il ne faut pas que j'aie compassion des victimes de la fourberie, il ne faut pas que je m'indigne contre les fourbes. Si le poète laisse la moindre place à l'indignation ou à la pitié, c'en est fait de toute franche gaieté comique, il ne me fait rire qu'à contre-cœur; je suis mécontent de moi-même, parce que je ris malgré moi; mécontent de sa société de coquins, parce qu'ils sont moins plaisants qu'odieux, mécontent de lui tout le premier, parce qu'il blesse ma conscience en m'amusant. Le théâtre de Regnard et celui de Lesage, ainsi que son plus illustre roman, n'excitent guère que cette gaieté fausse et triste, qui est aussi éloignée du vrai comique que l'ironie.
Enfin (et c'est ici un point capital dans la théorie de Schlegel) il ne faut pas confondre le comique avec le ridicule. Le ridicule n'est qu'un motif de la gaieté comique, le motif le plus ancien et le plus nouveau, la source la plus riche, j'y consens; mais il est si peu la gaieté elle-même, qu'il ne réussit pas toujours à la provoquer, et que celle-ci peut très bien prendre ses inspirations ailleurs.
Nous avons, dans la Métromanie de Piron, l'exemple d'un ridicule qui n'est point gai, en d'autres termes, qui n'est point comique. Que cette pièce manque absolument de gaieté, je ne prétends pas cela, dit notre auteur; il y a de la gaieté dans deux ou trois situations fort plaisantes: mais le comique n'égaie que les parties accessoires de l'œuvre; le ridicule qui en est l'objet principal, la manie de faire des vers, n'a produit qu'une peinture froide et incomparablement moins gaie que le reste.
Le Roi de Cocagne du poète Legrand nous offre l'exemple opposé: ici, point de ridicule, mais seulement du comique; car la folie du roi, tant qu'il a au doigt l'anneau magique, n'a rien qui ressemble à ces travers du caractère ou de l'esprit qu'on appelle proprement des ridicules. Et néanmoins «cette petite pièce est d'un comique achevé, la gaieté s'y élève jusqu'à une sorte de délire...» Qu'est-ce que cette pièce? Qu'est-ce que cet anneau? Qu'est-ce que le Roi de Cocagne? Nous le saurons tout à l'heure. L'analyse de la comédie de Legrand doit être le couronnement logique de notre petit exposé. L'admiration de Guillaume Schlegel pour cette farce inepte est célèbre et a voué son nom à un ridicule immortel.
Après avoir distingué la gaieté comique de tout ce qui a la même apparence, il ne reste plus à Schlegel, pour en trouver l'exacte définition, qu'à appliquer le grand principe de Socrate. N oppose à la gaieté son contraire et se demande en quoi consiste le tragique ou le sérieux.
Nous sommes sérieux toutes les fois que les facultés de notre âme sont dirigées vers quelque but. Quand ce but concentre tellement toutes nos forces intellectuelles et morales qu'en dehors de lui nous n'avons ni sentiment ni activité pour rien, alors le sérieux nous domine et nous possède exclusivement; et quand ce but est un objet infini, l'accomplissement d'un devoir sublime ou la satisfaction d'une passion profonde, alors l'état de notre âme est tragique. Ce qui constitue le sérieux, c'est donc la direction de notre activité vers un but; et ce qui élève le sérieux jusqu'au tragique, c'est le caractère infini du but proposé à notre activité.
La tragédie, en nous offrant le spectacle agrandi de nos devoirs, de nos passions, de notre destinée, nous invite à rentrer en nous-mêmes et à réfléchir profondément sur la vie; c'est là sa mission: mais que la comédie s'en garde bien! elle doit, au contraire, nous faire sortir de nous-mêmes, nous enlever à toute préoccupation sérieuse et nous inviter gaiement à l'oubli.
Le sérieux, qui est le fond de la tragédie, donne aussi à la forme du drame tragique un caractère spécial: cette forme est une, simple, grande, sévère; le poète marche rapidement et nous entraîne à sa suite vers un but qu'il ne perd pas de vue et qu'il nous fait entrevoir de moment en moment; il écarte les accessoires étrangers à l'action et tous ces incidents minutieux, importuns, qui entravent dans la vie réelle le cours des grands événements, afin de concentrer toute l'attention des spectateurs sur la catastrophe où il précipite le drame. Quelle doit être, par opposition, la forme de la comédie? La tragédie se plaît dans l'unité: la comédie aime donc le chaos; la variété, la bigarrure, les contrastes, les contradictions même, voilà son empire. Le poète comique doit éviter par-dessus tout de fixer sur un seul et même objet l'attention de ses spectateurs; car la direction de notre esprit vers un point unique, c'est le sérieux, et la gaieté ne peut s'épanouir librement que lorsque tout but sérieux est écarté et toute impression sérieuse dissipée. Elle ne supporte aucun travail, aucune gêne, aucun effort; la moindre attention suivie lui est un tourment et une fatigue. Elle rit de tout et ne s'intéresse à rien; elle touche à toutes les idées de la raison et n'en épouse aucune; elle joue avec toutes les passions de la nature humaine et demeure indépendante en face d'elles; elle voltige d'objet en objet, dans le monde réel et dans tous les mondes imaginaires, sans se poser plus d'un instant sur chaque fleur.
Qu'est-elle donc, en dernière analyse? Je la définirais volontiers, conclut notre philosophe, une sorte d'oubli de la vie, un état de bien-être et de vitalité plus haute, où nous nous sentons enlever non seulement à toute idée triste, mais à toute idée sérieuse; alors nous ne prenons rien qu'en jouant, tout passe sans laisser de trace et glisse légèrement sur la surface de notre âme. Le spectateur qui est dans cet état aime à promener ses regards vaguement, sans but et sans suite, sur une infinie diversité de choses, et si le poète ose lui faire violence en exigeant de lui la disposition sérieuse qui ne convient qu'au spectateur d'une tragédie, je veux dire en voulant arrêter jusqu'à la fin ses yeux sur un objet unique, sans incidents, sans interruptions et mélanges bizarres de toute nature pour le distraire, sans jeux d'esprit ou mots piquants pour l'éveiller à toute minute, sans inventions inattendues, amusantes, pour le tenir sans cesse en haleine, la gaieté tombe, le sérieux reste et le comique s'évanouit.
Telle est toute la théorie du comique ou de la gaieté, selon Schlegel.—Voyons maintenant l'application qu'il en fait à la critique des différents théâtres.
Méconnaissant pour les besoins de son système le côté sérieux, et sérieux jusqu'à la violence la plus âpre, du théâtre d'Aristophane, Schlegel ne veut y voir que la fantaisie poétique et la gaieté. C'est la réalisation la plus parfaite, selon lui, de l'idée de la comédie. Car, dit-il. l'imagination du poète est affranchie de toute contrainte de la raison. Tandis qu'une tragédie de Sophocle ou d'Eschyle rappelle, par sa structure grande et simple, la monarchie des temps héroïques, le théâtre d'Aristophane offre dans sa constitution intérieure une fidèle image de cette démocratie excessive contre laquelle le poète dirigeait ses coups. Il est plaisant de voir avec quelle ingénieuse subtilité Schlegel fait tourner à la louange d'Aristophane et à la confirmation de sa théorie du comique les choses qui y semblent le plus contraires.
Il n'y avait, dit-il, qu'une partie sérieuse en apparence dans les comédies d'Aristophane, c'était la parabase et les chœurs; et cela même, h bien prendre la chose, était au profit de la gaieté. En effet la parabase, ce morceau étranger à la pièce, avait beau être sérieux en lui-même, il montrait que le poète ne prenait pas au sérieux la forme dramatique; et les chœurs, tout sublimes qu'ils étaient, et précisément parce qu'ils étaient sublimes, faisaient voir avec quelle liberté il se jouait même de la comédie, en illuminant soudain de toutes les magnificences du lyrisme les bas-fonds de la plus grossière obscénité. Si Sophocle, s'adressant à l'assemblée par l'entremise du chœur, eût vanté son propre mérite et dénigré ses compétiteurs, ou si, en vertu de son droit de citoyen d'Athènes, il eût fait des propositions sérieuses pour le bien public, assurément toute impression tragique aurait été détruite par de semblables infractions aux règles de la scène. Mais les incidents épisodiques, les bizarreries de toute espèce reçoivent de la gaieté un favorable accueil, lors même que ces hors-d'œuvre sont plus sérieux que tout le reste du spectacle; car la gaieté est toujours bien aise d'échapper à la chose dont on l'occupe, et toute attention prolongée, quel qu'en soit l'objet, lui est pénible. C'était pour les spectateurs un plaisir de se soustraire un instant aux lois de la scène, à peu près comme dans un déguisement burlesque on s'amuse quelquefois à lever le masque.
Il était nécessaire, pour des raisons étrangères à l'art, que la forme de l'ancienne comédie fût abolie bientôt; mais son esprit, c'est-à-dire la fantaisie poétique et la gaieté, pouvait et devait lui survivre, et lui a survécu en effet dans les comédies de Shakespeare, dans le Roi de Cocagne de Legrand, dans le Désespoir de Jocrisse, «ouvrage classique» s'écrie Schlegel dans sa douzième leçon, «ouvrage qui a conquis la palme de l'immortalité»!
De Ménandre, Térence et Plaute, Schlegel fait peu de cas, parce que chez les auteurs comiques de cette école la forme de la composition est sérieuse; tout y est régulièrement ordonné et dirigé avec effort vers un but. L'unité d'impression est le grand souci de ces poètes: de peur de l'affaiblir ou de la troubler, ils évitent soigneusement tout ce qui pourrait distraire les spectateurs en les égayant hors de propos; ils n'admettent les saillies de la verve comique que dans la mesure où elles concourent à l'effet principal. Et le sérieux n'est pas seulement dans la contexture de leurs poèmes, où tout se lie, où tout se tient comme les scènes d'une tragédie: il est dans l'esprit de ces pièces, qui s'appellent pourtant des comédies et qui ne sont que des moralités lourdes ou des drames gonflés de pathétique. Quant au prosaïsme, il est partout: dans l'imitation de la vie réelle, dans le but instructif que se propose le poète, dans le dénouement de ces œuvres graves et raisonnables qui se terminent régulièrement par un mariage. En les lisant, on croit entendre Euripide s'écrier, dans les Grenouilles d'Aristophane:
Grâce à moi, grâce à la logique
De mes drames judicieux,
Et surtout à l'esprit pratique
De mes héros sentencieux,
Le bourgeois plus moral, plus sage,
Apprend à mener sa maison,
Car il rencontre à chaque page
Des maximes pour sa raison
Et des conseils pour son ménage!
Arrivons à Molière.—Il y a dans son théâtre des scènes pleines de folie poétique et de gaieté, et que Schlegel, conséquent avec ses doctrines, fait profession d'admirer beaucoup; telles sont: les ballets du Malade imaginaire; les coups de bâton que les archers donnent à Polichinelle; les coups de plats de sabre que les Turcs distribuent en cadence à M. Jourdain; la danse des dervis: Dara, dara bastonara ... «Mamamouchi, vous dis-je, je suis mamamouchi;» M. de Pourceaugnac poursuivi par des apothicaires armés des outils de leur profession; ou bien encore cette petite scène de la Princesse d'Élide où Moron caresse un ours:
«Ah! monsieur l'ours, je suis votre serviteur de tout mon cœur. De grâce, épargnez-moi. Je vous assure que je ne vaux rien du tout à manger, je n'ai que la peau et les os, et je vois de certaines gens là-bas qui seraient bien mieux votre affaire. Eh! eh! eh! monseigneur, tout doux, s'il vous plaît. Là, là, là, là. Ah! monseigneur, que votre altesse est bien faite! elle a tout à fait l'air galant et la taille la plus mignonne du monde. Ah! beau poil! belle tête! beaux yeux brillants et bien fendus! Ah! beau petit nez! belle petite bouche! petites quenottes jolies! Ah! belle gorge! belles petites menottes! petits ongles bien faits!...»
Voilà, selon Schlegel, les endroits magistraux de Molière. L'auteur des Plaisirs de l'île enchantée excelle, quand il veut, dans cette gaieté inoffensive, dans ces douces et poétiques folies qui ne font de mal à personne; il connaît le grand art des intermèdes, ces interruptions si éminemment comiques dans la suite naturelle des scènes et des actes, surtout quand elles n'ont aucun rapport avec le sujet de la pièce; il dit parfois de pures bêtises: par exemple, quand le docteur Pancrace prie Sganarelle de passer de l'autre côté, «car cette oreille-ci est destinée pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la vulgaire et la maternelle»; quand Clitandre, pour savoir si Lucinde est malade, tâte le pouls à son père, ce sont là, Dieu merci! de vraies gaietés comiques et nullement des traits de caractère.
J'ai entendu dire à M. Guizot que Schlegel, dans ses conversations, professait une admiration particulière pour les Fourberies de Scapin.
Malheureusement, Molière a écrit le Misanthrope et le Tartuffe, sans parler de l'Avare, des Femmes savantes et de tant d'autres erreurs d'un homme qui n'était pourtant pas sans génie comique. Le Tartuffe est une assez belle satire en forme de drame; mais, à quelques scènes près, ce n'est point une comédie. Sauf la gaieté obligée de la soubrette, tous les personnages sont sérieux, la mère et le fils par leur bigoterie, le reste de la famille par sa haine pour l'imposteur, et le beau-frère par ses sermons, où il prêche avec tant d'onction que les dévots de cœur ne doivent
Jamais contre un pécheur avoir d'acharnement,
Mais attacher leur haine au péché seulement.
Quant à Tartuffe lui-même, le théâtre tout entier n'a point de personnage moins gai que ce scélérat, qui fait passer le pauvre Orgon par «une alarme si chaude», que le dénouement de cette prétendue comédie allait être tragique, si Molière ne se fût avisé à temps que Louis XIV était «un prince ennemi de la fraude». Après le discours inopiné du messager royal, on conçoit l'allégresse de toute la famille, le soulagement du public et notre reconnaissance pour le poète qui, par un coup de son art, vient de nous délivrer de la terreur et de la pitié tragiques et de sauver la comédie; mais nous comptions sans le beau-frère, qui nous interdit toute joie profane et nous ramène à des sentiments sérieux par cette exhortation finale, tout à fait édifiante:
... Souhaitez que son cœur, en ce jour,
Au sein de la vertu fasse un heureux retour,
Qu'il corrige sa vie en détestant son vice
Et puisse du grand prince adoucir la justice.
Le crime puni, cela est tragique; mais le crime repentant, cela s'éloigne encore davantage de la gaieté et de la comédie. En sorte que le Tartuffe est une satire entremêlée de sermons et terminée comme un drame moral, à laquelle l'auteur a eu soin d'ajouter un personnage superflu, Dorine, pour avoir au moins un rôle gai et ne pas faire mentir tout à fait le titre de comédie qu'il a donné à son œuvre.
Et le Misanthrope? Soyons sérieux; on n'assiste pas à la représentation de cette pièce pour s'amuser:
Ah! ne plaisantez pas, il n'est pas temps de rire!
nous dit Alceste d'un ton courroucé, et s'il nous arrive de nous dérider à la scène comique de Dubois ou à la plaisante description du «grand flandrin de vicomte» qui, «trois quarts d'heure durant, crache dans un puits pour faire des ronds,» le drame étonné et indigné s'écrie, par l'organe de son principal personnage:
Par la sambleu, messieurs, je ne croyais pas être
Si plaisant que je suis!...
Tel est le jugement de Guillaume Schlegel sur Molière, ou, plus exactement (car je laisse de côté, pour l'heure, mainte critique de détail plus ou moins curieuse), la partie de ce jugement qui est en relation directe avec sa théorie du comique.
Il me reste à faire connaître aux lecteurs de ce fidèle exposé le Roi de Cocagne de Legrand, poète français (1673-1728), l'héritier d'Aristophane en France, comme Shakespeare est son héritier en Angleterre, le seul écrivain de notre prosaïque nation qui ait vraiment réalisé l'idéal de la comédie. Schlegel a malheureusement omis de donner à ses auditeurs de 1808 l'analyse du chef-d'œuvre; je comblerai cette lacune, mais le critique allemand fera lui-même le commentaire.
La pièce est précédée d'un prologue. Legrand en personne, sous le nom de Geniot, s'efforçant d'escalader le Parnasse, rencontre Thalie, qui cherche précisément un poète. Elle vient de rebuter Plaisantinet, parce qu'il aime la gaillardise et qu'il ne sait pas faire rire sans choquer l'honnêteté. Geniot lui propose son sujet, le Roi de Cocagne. Thalie en est charmée, et l'auteur, impatient du dieu qui l'agite: Allons, s'écrie-t-il,
Allons, Muse, il est temps! Se m'abandonne pas!
Déjà tous m'inspire! du badin, du folâtre,
Du bouffon.
Ce petit prologue est, sans doute, peu de chose; mais «il ne faut pas qu'un prologue ait trop d'importance». Shakespeare est tombé dans le défaut qu'a su éviter Legrand: «Dans la Méchante Femme mise à la raison, le prologue est plus remarquable que la pièce même.»
Philandre, chevalier errant, Zacorin, son valet, et Lucelle, infante de Trébizonde, sont transportés dans le pays de Cocagne par la puissance de l'enchanteur Alquif. Bombance, ministre du roi, les accueille avec bonté au nom de son maître et leur fait une description merveilleuse de l'empire:
Quand on veut s'habiller, on va dans les forêts,
Où l'on trouve à choisir des vêtements tout prêts.
Veut-on manger? Les mets sont épars dans nos plaines,
Les vins les plus exquis coulent de nos fontaines;
Les fruits naissent confits dans toutes tes saisons;
Les chevaux tout sellés entrent dans les maisons;
Le pigeonneau farci, l'alouette rôtie,
Nous tombent ici-bas du ciel, comme la pluie.
«Si les critiques français ne se montraient pas indifférents ou même contraires à tous les élans de la véritable imagination, ils ne dédaigneraient pas une petite pièce dont l'exécution est aussi soignée que celle d'une comédie régulière, par cette seule raison que le merveilleux y joue un grand rôle et y occupe la première place. L'esprit fantastique est rare en France, et Legrand n'a dû qu'à son génie l'idée d'un genre alors absolument neuf; car il est probable qu'il ne connaissait pas le théâtre comique des Grecs.»
Dès la seconde scène, le théâtre change, et l'on voit s'élever le palais du roi; les colonnes en sont de sucre d'orge et les ornements, de fruits confits.
«Les critiques français affectent de mépriser les changements de décoration. Au milieu d'un peuple léger, ils ont pris le poste d'honneur de la pédanterie; pour qu'un ouvrage leur inspire de l'estime, il faut qu'il porte l'empreinte d'une difficulté péniblement vaincue; ils confondent la légèreté aimable, qui n'a rien de contraire à la profondeur de l'art, avec cette autre espèce de légèreté qui est un défaut du caractère et de l'esprit.»
Au moment où les étrangers se disposent, en dépit du désespoir de Bombance, à manger le palais, le roi s'avance au bruit de la symphonie:
Que chacun se retire, et qu'aucun n'entre ici.
Bombance, demeurez, et tous, Ripaille, aussi.
Cet empire envié par le reste du monde,
Ce pouvoir qui s'étend une lieue à la ronde,
N'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit
Et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit.
Je ne suis pas heureux tant que vous pourriez croire;
Quel diable de plaisir! toujours manger et boire!
Dans la profusion le goût se ralentit;
Il n'est, mes chers amis, viande que d'appétit.
Je suis donc résolu, si vous le trouvez bon,
De laisser pour un temps le trône à l'abandon...
Le trône, cependant, est une belle place:
Qui la quitte, la perd. Que faut-il que je fasse?
Je m'en rapporte à vous, et par votre moyen
Je veux être empereur ou simple citoyen.
«Folie aimable et pleine de sens! La parodie des vers tragiques est un des meilleurs motifs de la comédie.»—Toute cette scène est excellente. Je regrette seulement que Bombance dise au roi:
Si le trop de santé vous cause des dédains,
Souffrez dans vos États deux ou trois médecins:
Ils vous la détruiront, je me le persuade.
L'influence de Molière est sensible ici; mais elle est rare partout ailleurs, et à part deux ou trois traits mordants de la même nature, une gaieté douce règne dans ce petit poème exempt de fiel et parfaitement inoffensif.
Cependant le roi tombe amoureux de Lucelle, et Philandre est mis en prison. Cet embarras du héros de la comédie n'est point pénible pour le spectateur, comme celui d'Orgon, victime des machinations de Tartuffe. Pourquoi? parce que le poète a eu bien soin de ne nous intéresser à aucun des personnages de sa pièce, et que dans le monde purement idéal où il les a placés nous savons qu'ils ne manqueront jamais d'expédients pour se tirer d'affaire. En effet, le sage Alquif possède une bague fée, qui a la propriété de rendre fou l'imprudent qui la met à son doigt. Zacorin, devenu échanson, cherche un moyen de la substituer à l'anneau royal. Il présente au roi un bassin avant son repas.
ZACORIN.
Sire...
LE ROI.
Que voulez-vous? tous ce apprêts sont vains.
ZACORIN.
Quoi?...
LE ROI.
Je viens là-dedans de me laver les mains.
ZACORIN.
Et ne voulez-vous pas les laver davantage?
LE ROI.
Et par quelle raison les laver, dis?
ZACORIN bas.
J'enrage.
Haut.
Sire, dans nos climats, la coutume des rois
Est de laver leurs mains toujours deux ou trois fois.
De guerre lasse, il imagine de répandre, comme par mégarde, un encrier sur la main du roi. Le roi quitte son diamant pour se laver, et quand il a fini, Zacorin lui présente à la place la bague enchantée. Mais l'infortuné prince ne l'a pas plutôt mise à son doigt que la tête lui tourne ... il ne sait plus ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Il chasse Lucelle de sa présence en l'accablant d'injures; il donne l'ordre d'élargir Philandre, et entre autres extravagances du meilleur comique il s'écrie:
Gardes!
UN GARDE.
Seigneur?
LE ROI.
Voyez là-dedans si j'y suis.
Telle est la comédie que Guillaume Schlegel met au-dessus de tout le théâtre de Molière: rien de plus logique, c'est la conséquence de ses principes,—et voilà ce qu'on appelle une réfutation par l'absurde.
On peut omettre sans inconvénient le côté métaphysique de la théorie de Hegel, en ce qui concerne la comédie. Si la métaphysique hegelienne de la tragédie, vraie ou non, je veux dire conforme ou non à la réalité historique et à la pratique des poètes, est en soi une construction de premier ordre, d'une grandeur et d'une beauté incontestables, la métaphysique hegelienne de la comédie est obscure et sans intérêt. Je la néglige, et je vais droit à la partie originale de la doctrine de Hegel—originale, dois-je dire? ou étrange, inconcevable, inouïe, renversant toutes nos idées et tous les faits!
S'il y a dans l'ordre esthétique une vérité qui nous semblait sûre et certaine, c'est que, pour qu'un individu soit comique, il faut qu'il se prenne lui-même au sérieux. A partir du moment où nous nous apercevons qu'il n'a plus en sa propre personne une foi naïve, il peut continuer à nous égayer par sa brillante humeur, à nous faire rire par son esprit, mais il a cessé d'être comique. Et cela est si bien senti par tout le monde, que le premier talent des pitres de société consiste à garder autant que possible l'apparence du sérieux et à être, comme on dit, des pince-sans-rire. La naïveté humaine, voilà incontestablement (nous le pensions du moins) la source du vrai comique. Dans le rire provoqué par l'esprit, nous rions avec le personnage; dans le rire provoqué par le comique, nous rions du personnage, qui lui-même ne rit pas.
Prenons un exemple bien simple. Quand Dogberry, fonctionnaire imbécile dans Beaucoup de bruit pour rien, vient faire des lapsus de cette force: «La dissemblée est-elle au complet?... Qui de vous est le plus indigne d'être constable?... Corbleu! je voudrais vous faire part d'une affaire qui vous décerne»; ou quand le paysan Thibaut, dans le Médecin malgré lui, consulte Sganarelle en ces termes: «Ma mère est malade d'hypocrisie, monsieur.—D'hypocrisie?—Oui. C'est-à-dire qu'allé est enflée partout ... alle a de deux jours l'un la fièvre quotiguenne avec des lassitudes et des douleurs dans les mufles des jambes,» cela est d'un comique assurément très vulgaire et très bas, mais enfin cela est comique, parce que Thibaut est naïf, parce que Dogberry est sérieux. Ce genre tout à fait inférieur de comique consistant en inconscientes bévues de langage abonde jusqu'à l'excès dans les comédies de Shakespeare; mais une chose y surabonde encore: ce sont des jeux de mots, pointes, concetti, calembours, qui, étant voulus et ayant l'intention d'être spirituels, n'ont absolument rien de comique à nos yeux.
Ducis, succédant à Voltaire comme membre de l'Académie française, faisait des comédies de son prédécesseur la critique suivante dans son discours de réception[3]: «Il y a quelquefois dans les comédies de M. de Voltaire un comique de mots et d'expressions, au lieu du comique de situations et de caractères. On dirait que le personnage qu'il fait parler veut se moquer de lui-même. Le poète paraît sourire à sa propre plaisanterie. Mais plus il montre le projet d'être comique, plus il diminue reflet... Rien n'est si différent que la plaisanterie et le comique.» Ces vérités-là sont élémentaires en France; on peut dire quelles traînent partout; le hasard ayant fait tomber entre mes mains une feuille perdue de l'Année littéraire, j'eus la curiosité d'y jeter les yeux, et voici ce que je lus: «Les personnages de la comédie des Plumes du paon ne sont ni de la bohême, ni du demi-monde, ni d'aucune fraction du monde: ce sont, en argot d'atelier, des bonshommes impossibles; ils ont plus de bizarrerie que d'originalité; pleins de contradictions dans leurs mœurs, leurs sentiments, leur langage, leur excentricité n'est pas prise assez au sérieux pour nous en faire rire.» La langue est incorrecte, mais la pensée est juste.
Eh bien, croirait-on que Hegel change tout cela, met le cœur à droite et le foie à gauche, et, sans avoir l'air de se douter que sa doctrine est un paradoxe contredisant le sens commun et l'évidence, enseigne tranquillement que le personnage comique ne doit point se prendre lui-même au sérieux!
«On doit bien distinguer, dit-il, si les personnages sont comiques pour eux-mêmes ou seulement pour les spectateurs. Le premier cas seul doit être regardé comme le vrai comique. Un personnage n'est comique qu'autant qu'il ne prend pas lui-même au sérieux le sérieux de son but et de sa volonté...
«Aristophane, le vrai comique, avait fait de ce dernier caractère seulement la base de ses représentations. Cependant, plus tard, déjà dans la comédie grecque, mais surtout chez Plaute et Térence, se développe la tendance opposée. Dans la comédie moderne celle-ci domine si généralement, qu'une foule de productions comiques tombent ainsi dans la simple plaisanterie prosaïque, et même prennent un ton âcre et repoussant... Il faut excepter Shakespeare, chez qui les personnages comiques conservent leur bonne humeur et leur gaieté insouciante malgré les mésaventures et les fautes commises... Mais Molière, dans celles de ses fines comédies qui ne sont nullement du genre purement plaisant, est dans ce cas.
«Le prosaïque, ici, consiste en ce que les personnages prennent leur but au sérieux avec une sorte d'âpreté. Ils le poursuivent avec toute l'ardeur de ce sérieux. Aussi, lorsqu'à la fin ils sont déçus ou déconfits par leur faute, ils ne peuvent rire comme les autres, libres et satisfaits. Ils sont simplement les objets d'un rire étranger. Ainsi, par exemple, le Tartuffe de Molière, ce faux dévot, véritable scélérat qu'il s'agit de démasquer, n'est nullement plaisant. L'illusion d'Orgon trompé va jusqu'à produire une situation si pénible, que pour la lever il faut un deus ex machina... De même, des caractères parfaitement soutenus, comme l'avare de Molière, par exemple, mais dont la naïveté absolument sérieuse dans sa passion bornée ne permet pas à l'âme de s'affranchir de ces limites, n'ont rien, à proprement parler, de comique. L'avarice, aussi bien quant à ce qui est son but que sous le rapport des petits moyens qu'elle emploie, apparaît naturellement comme nulle de soi; car elle prend l'abstraction morte de la richesse, l'argent comme tel, pour la fin suprême où elle s'arrête. Elle cherche à atteindre cette froide jouissance par la privation de toute autre satisfaction réelle, tandis que dans cette impuissance de son but comme de ses moyens, de la ruse, du mensonge, etc., elle ne peut arriver à ses fins. Mais maintenant, si le personnage s'absorbe tout entier dans ce but, en soi faux, et cela sérieusement, comme constituant le fond même de son existence, au point que, si celui-ci se dérobe sous lui, il s'y attache d'autant plus et se trouve d'autant plus malheureux, une pareille représentation manque de ce qui est l'essence du comique. Il en est de même partout où il n'y a, d'un côté, qu'une situation pénible, et de l'autre que la simple moquerie et une joie maligne[4].»
Je ne trouve guère dans tout le théâtre de Molière qu'un seul personnage principal qui soit comique selon la formule de Hegel: c'est Sganarelle, dans son rôle de médecin malgré lui. Comme il est fagoteur de son état et qu'on l'a fait médecin à son corps défendant, il est clair qu'il ne peut pas se prendre au sérieux dans sa nouvelle profession. Le bon, c'est qu'«il finit par prendre goût à son métier de médecin. Son esprit inventif y trouve beau jeu, et, par plaisir plus encore que par nécessité, il se lance, il brode, il argumente, il pérore, il extravague, il embrouille le cœur et les poumons; il va chercher au fond de sa mémoire quelque bribe rouillée de son latin d'autrefois, et la fait resservir à merveille, s'admirant lui-même de jouer si bien avec l'inconnu[5]».
Certes, Sganarelle est amusant; mais il n'y a pas en France un homme de goût qui ne trouve les deux Diafoirus, père et fils, plus comiques dans le vrai sens du mot, lorsqu'ils tâtent sérieusement le pouls d'Argan: «Quid dicis, Thomas?—Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien,»—plus comiques, dis-je, que Sganarelle, si plaisant qu'il soit d'ailleurs, lorsqu'il gesticule dans sa robe et déblatère en son latin: Cabricias arci thuram catalamus singulariter, nominativo, hæc musa la muse, bonus bona bonum, Deus sanctus, est ne oratio latinas? Etiam oui, quare pourquoi, quia substantivo et adjectivum concordat in generi, numerum et casus.
Il y a toute une grande comédie de Shakespeare conforme d'un bout à l'autre à la théorie de Hegel, et je ne lui en fais pas mon compliment: c'est Peines d'amour perdues.
Le roi de Navarre et trois seigneurs de sa suite font vœu, on ne sait pourquoi, de consacrer trois années à l'étude, de ne point voir de femme durant tout ce temps, de ne dormir que trois heures par nuit, de jeûner complètement un jour par semaine et de ne manger qu'un plat les autres jours. Il est manifeste que ce serment n'est pas sérieux, et dès le début de la comédie les quatre partenaires se trouvent placés dans des conditions telles, qu'ils sont obligés par la force des choses de le violer partiellement. A dater de cet instant, la situation a entièrement perdu le peu d'intérêt qu'elle pouvait avoir. Ils ne tardent pas à se parjurer tout à fait et à se moquer ouvertement de leurs vœux: «Considérons ce que nous avons juré: jeûner, étudier, et ne pas voir de femme! Autant d'attentats notoires contre la royauté de la jeunesse. Dites-moi, pouvons-nous jeûner? Nos estomacs sont trop jeunes, et l'abstinence engendre les maladies. En jurant d'étudier, chacun de nous a abjuré le vrai livre... Les femmes sont les livres et les académies... L'amour enseigné par les yeux d'une femme se répand, rapide comme la pensée, dans chacune de nos facultés; à toutes nos forces il donne une force double en surexcitant leur action et leur pouvoir, etc., etc.»
Cette tirade, quoique d'une longueur excessive, est juste et spirituelle; mais l'absence de tout sérieux, de toute naïveté dans les rôles, est évidemment la cause principale de l'insipidité de Peines d'amour perdues en tant que comédie.
Falstaff est un autre exemple, et le plus intéressant qu'on puisse produire, d'un personnage comique qui ne se prend pas au sérieux, s'associe au rire qu'il excite et se moque de lui-même. «Que voulez-vous? dit ce bon vivant, c'est ma vocation; et ce n'est pas péché pour un homme que de suivre sa vocation. Si, dans létal d'innocence, Adam a failli, que peut donc faire le pauvre John Falstaff dans ce siècle corrompu? Vous voyez bien qu'il y a plus de chair chez moi que dans un autre, partant, plus de fragilité.» «Me voici, moi, dit-il encore, le plus vieux et le plus gros des honnêtes gens qui en Angleterre aient échappé à la potence!»
Je me contente ici d'indiquer ce trait du caractère de Falstaff; pour peu que j'insistasse à présent sur ce point, je toucherais à une question réservée, et que je désire garder intacte à cause de son importance: la question du genre d'esprit nommé humour et de la littérature humoristique. Hegel, dans la page citée tout à l'heure, a confondu, je crois, deux choses très différentes: l'humour et le comique proprement dit.
La théorie hegelienne de la comédie ressemble beaucoup au fond à celle de Guillaume Schlegel. Elles aboutissent toutes de deux à cette même conclusion absurde, mais logique, que le prix de l'art appartient à des farces telles que le Roi de Cocagne, l'Œil crevé, etc., et que le théâtre des Folies-Dramatiques est plus vraiment comique que celui de la Comédie-Française! Qui se serait attendu à tant de légèreté de la part des doctes professeurs allemands? J'aime bien l'Œil crevé dans son genre, et je serais fâché que ce genre n'existât point; seulement je ne crois pas qu'il y ait des raisons logiques et scientifiques de penser que cette pièce réalise mieux que le Misanthrope l'idéal de la comédie: c'est ce que je me propose de montrer dans le chapitre qui va suivre.