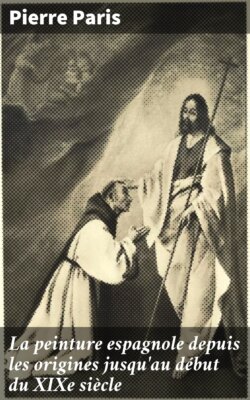Читать книгу La peinture espagnole depuis les origines jusqu'au début du XIXe siècle - Pierre Paris - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES PREMIERS TEMPS CHRÉTIENS ET L’ÉPOQUE ROMANE
ОглавлениеMais voici que le christianisme a révolutionné et rénové le monde. L’Espagne, province très romaine, emprunte, comme l’Italie, les premiers éléments de son art chrétien, art religieux des tombes, à l’art de ses colonisateurs, et cela jusqu’à l’édit de Milan et à la pacification de l’Église. Par malheur, rien absolument ne subsiste, que nous sachions, des monuments de cette première époque, qui rappelaient l’art des Catacombes, romain par essence, avec quelques contaminations orientales. La crypte en columbarium de Carmona, avec les fleurs et les oiseaux de ses voûtes, quoique païenne, en donne pourtant quelque idée.
Après le triomphe de l’Église, l’art byzantin se fait pour plusieurs siècles l’expression définitive de la religion nouvelle. Sous la domination des Visigoths, l’Espagne est une province byzantine, comme l’Italie même; l’Orient grec, au VIe siècle, envahit et domine l’Occident latin, qui se défend mal et ne garde, parmi les nouveautés, que quelques souvenirs de son passé. Mais ici encore, si l’architecture, la sculpture, l’orfèvrerie, la menue décoration se laissent étudier dans la péninsule en des monuments par malheur trop rares, la peinture fait défaut, ainsi que la mosaïque, qui en est la forme, pour ce qui est de ce temps, perfectionnée. Rien qui rappelle de près ou de loin Salonique ou Ravenne, ou même la Gaule et l’Afrique du Nord, où l’art nouveau, comme on sait, poussa loin ses ramifications. Il y a là une lacune bien difficile à combler. Cependant on peut affirmer que la peinture visigothique et byzantine n’a pas manqué en Espagne plus qu’en Italie, en Gaule et en Afrique; il serait étrange qu’elle y eût fait défaut alors que les autres arts y ont fleuri, non sans des caractères originaux qu’ont reconnus les historiens, alors que les manuscrits enluminés y ont fait fortune, apportant tous les symboles, tous les thèmes, toutes les images, tous les procédés et tous les styles de l’Orient hellénique mêlés à ceux de l’Occident latin, alors surtout que dans la Catalogne plus proche, de par ses communications maritimes et terrestres, du monde de Rome et de Byzance, tout l’art roman des vieilles églises pyrénéennes, à partir du XIe siècle, tout cet art dont l’exposition récente aux musées de Barcelone, Vich et Lérida, est une merveilleuse surprise, est une longue survivance et une véritable résurrection byzantine.
Nous voulons parler d’abord d’un assez grand nombre de devant d’autels ou antipendia, peints sur bois, provenant d’églises rurales ou de monastères plus ou moins perdus aux flancs des Pyrénées orientales. Le plus ancien, du Xe ou XIe siècle, serait, selon Émile Bertaux, au Musée de Vich, l’antipendium de Montgrony: on y voit, en quatre compartiments qui flanquent un Christ de majesté, quatre épisodes de la vie de saint Martin, dont le plus fameux, celui du manteau partagé. Le style en est très primitif, maigre et pauvre, et dénote sans doute la main d’un artiste local, mal inspiré par les modèles des enlumineurs (pl. IV). Il en est de plus barbares, quoique plus récents; mais déjà au XIe siècle il y en a d’un art plus expert, tel celui du Musée de Barcelone (pl. IV), gardant aux encadrements des figures et des scènes le souvenir des ornements au repoussé et des orfèvreries des primitifs antipendia de métal, et quelquefois même, par le stuc qui modèle les figures peintes, le souvenir des antipendia de marbre ou de bois sculpté. Mais la technique est, au fond, la même aussi bien que le dessin, cernant de traits noirs le coloris identique. Les œuvres de cette série ont subi des influences diverses: aux XIe et XIIe siècles il semble bien que ce soit la française qui domine, mêlée d’éléments orientaux; mais à la fin du XIIe, comme l’a remarqué Émile Bertaux, le meilleur des juges, «dessin et coloris changent complètement. Les peintre catalans s’appliquent alors, comme les miniaturistes et les verriers français, à imiter l’art byzantin». Ce n’est pas à dire que tout souvenir français soit exclu de ce style nouveau, mais il ne règne plus en maître, comme il fera derechef dans quelques œuvres capitales de la fin du XIIIe siècle.
La peinture murale évolua de même aux mêmes époques. Dans les églises et les monastères de la Catalogne pyrénéenne, le style catalan-français, qui domine d’abord, cède bientôt la place au byzantin. Les murs latéraux peut-être, les absides à coup sûr, reçurent généralement une décoration de fresques (car la mosaïque eût coûté trop cher) que le temps a souvent épargnées, et dont les plus importantes sont maintenant en sûreté à Barcelone. Si elles valent peu, d’ordinaire, par l’originalité des thèmes religieux, du moins l’éclat hardi, souvent brutal, des couleurs, qui accentue leur caractère indigène et aussi populaire, leur donne une force inattendue et marque entre elles une intéressante unité. Saint-Michel (Seu d’Urgel), Sainte-Marie et Saint-Clément de Tahull, Pedret, Mur, Sainte-Marie de Aneu, Saint-Michel de Angulasters, Saint-Pierre de Burgal, Estahon, Ginestarre, Esterri de Aneu, Sainte-Marie de Bohi, Sainte-Marie de Terrassa, et plusieurs autres églises encore, construites et décorées au XIIe et au XIIIe siècle, sans parler de celle de Saint-Martin-de-Fenouillar, qui, quoique appartenant à la Catalogne française, fait partie du même groupe, nous ont offert une magnifique et unique collection de Christs en majesté avec tout leur cortège de personnages bibliques ou évangéliques ou symboliques. Par malheur, ces images si longtemps négligées sont encore en assez grande partie inédites, et l’étude en est encore embryonnaire. Les gravures que nous donnons de trois d’entre elles (pl. V et VI) en marquent l’extrême intérêt, intérêt qui s’augmente si l’on ajoute qu’à côté des scènes et des personnages religieux on en voit d’autres plus suggestifs, empruntés à la vie sociale, où apparaît, comme toujours en Espagne, avec une imagination hardie, un souci naïf de la réalité vivante.
Si le groupe des peintures romanes de Catalogne est le plus compact et peut-être le plus instructif, on ne saurait passer sous silence quelques peintures, également très anciennes, éparses à travers l’Espagne. Les plus antiques sont sans doute celles de l’ermitage de San Bandelio — église si originale avec ses arcs arabes, et remontant probablement au IXe siècle, — où l’on voit dans l’abside une curieuse Adoration des Mages et sur la tribune, entre autres scènes, une chasse à courre sous une inscription coufique. Les figures du chœur du Cristo de la Luz, à Tolède, petite mosquée transformée en chapelle, sont plus récentes (XIIe siècle), mais non moins originales, étant plus orientales encore (pl. VI), tandis que les fresques presque contemporaines (fin du XIIe siècle) du narthex de Saint-Isidore à Léon, comprenant à côté des scènes évangéliques et apocalyptiques, avec le Christ sur son trône dans un nimbe, les travaux des douze mois, forment le plus important ensemble que l’on puisse mettre en parallèle avec ceux des églises françaises. «L’iconographie des scènes», a écrit Émile Bertaux, «le dessin très ferme des silhouettes, le coloris dur, les tons d’ocre jaune et rouge, le cerne noir, témoignent d’une imitation directe de l’art français.»
On n’ignore pas quelle fut, du VIIIe au XIe siècle, la résistance du Nord de l’Espagne, depuis les monts asturiens jusqu’aux Pyrénées orientales, contre laconquête et la domination arabes. Il était assez naturel que les monuments chrétiens de cette époque fussent plus nombreux en ces régions que dans le reste de la péninsule, et c’est une reconnaissance de plus que les Espagnols doivent avoir aux défenseurs de leur sol et de leur civilisation aux frontières du Nord, pour avoir permis à l’art chrétien de ne pas périr. Ce sont eux vraiment qui ont sauvé au moins, sinon créé, l’art roman d’Espagne et lui ont permis de se développer aux siècles suivants, lorsqu’à partir du début du XIe siècle jusqu’à la moitié du XIIIe les Arabes, affaiblis par leurs divisions et leurs luttes intestines, reculèrent peu à peu sous la poussée continue des comtes et des rois libérateurs. Il ne faut pas oublier cependant qu’à l’une comme à l’autre époque les Maures firent généralement montre d’une grande tolérance envers les indigènes soumis, envers leur religion comme envers leurs mœurs et coutumes, et n’étouffèrent pas leurs instincts et leurs aspirations artistiques. De là vient que dès le XIVe siècle, au sortir de l’âge roman, la peinture se développa dans toute la péninsule avec une rare abondance.
Jusque là, ce qui avait prédominé dans cet art, c’était, en somme, l’influence française et celle de Byzance, si bien qu’on a pu dire que la peinture espagnole, de même que la miniature au XIIIe siècle, avait été «un prolongement de l’art français». Et ce prolongement s’étendit jusqu’à l’Andalousie. Émile Bertaux a pu signaler à Séville, à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe, des Vierges, comme la Vierge de Rocamadour (église San Lorenzo) «visiblement imitées des modèles français». Mais bientôt commença à se faire sentir l’influence italienne, et cela, comme il était naturel, dans les Baléares, la Catalogne et le royaume d’Aragon, dont les peintres s’inspirèrent surtout de modèles siennois, et tels tableaux de Palma de Majorque ou du couvent de Pedralbas (près de Barcelone), ceux-ci dus au Catalan Ferrer Bassa (pl. XV ci-après), ont évoqué les noms de Simone et Lippo Martini. Si l’art en est charmant, délicat et brillant comme celui qui l’inspira, et fait un contraste heureux, révélateur d’un grand progrès esthétique, avec celui des Primitifs romans, il n’en est pas moins vrai qu’il n’est pas original autant qu’on le voudrait, et que le caractère du crû espagnol ne s’en marque que par le choix de quelques types, par quelques duretés de dessin et quelque outrance dans la tonalité plus sombre des couleurs. Du reste, l’esprit siennois se répandit aisément dans la plus grande partie de la péninsule, et particulièrement à Valence, où s’établirent des peintres toscans formant école. Émile Bertaux a montré dans ce sens toute l’importance d’un triptyque de la Chartreuse de Porta Coeli (Musée provincial de Valence), qui date de la seconde moitié du XIVe siècle, et qui pourrait bien être, sans qu’on ose l’affirmer, de Lorenzo Zaragoza.
On trouve un peu partout des peintures de la même école; l’une des plus importantes, car il s’y ajoute aux éléments siennois un cachet tout spécial de terroir, est le tableau d’autel (vers 1375) provenant de Tobed, en Aragon, et conservé actuellement dans une collection particulière de Saragosse, où l’on voit Henri II, roi de Castille, à genoux avec sa famille aux pieds de la Vierge (pl. VIII); on le rattache à l’œuvre de Pere Sera, l’un des peintres catalans les plus renommés de ce siècle, que l’on commence à bien connaître, et dont un grand retable dans la cathédrale de Manresa, en particulier, permet d’apprécier le talent délicat.
Les Florentins ont aussi leur part dans l’expansion italienne en Espagne. On sait par Vasari que Guerardo Starnina, «peintre giottesque», voyagea en Espagne de 1380 à 1387 et qu’il y subit lui-même l’influence des types et des costumes du pays, et par Ceán Bermúdez qu’il travailla en Catalogne pour le roi Jean I. Il est peut-être l’auteur des peintures giottesques de la chapelle de Saint-Blaise à Tolède. Il se peut aussi qu’il ait vécu à Séville et y ait fait école, et que le Sévillan Garci Fernández, dont un médiocre panneau a été identifié à Salamanque, ait été son élève.
Émile Bertaux retrouve la même inspiration florentine, avec maints souvenirs français, dans les trois peintures qui décorent les plafonds d’une salle de l’Alhambra de Grenade attenante à la cour des Lions. Il vaut la peine de citer la page que leur consacre le plus autorisé comme le plus fin des historiens français de l’art espagnol: «Ces peintures ont été exécutées, non point à fresque, mais a tempera, sur cuir. Le fond d’or est comme gaufré de dessins en relief, étoiles ou rinceaux.... Les sujets sont ceux qui composaient, au XIVe siècle, en France ou en Italie, la décoration ordinaire des objets ou des monuments profanes, boîtiers de miroirs ou salles de palais, et qui ont passé plus d’une fois en Espagne, comme en France, dans la décoration sculptée des monuments religieux: quelques-uns d’entre eux ont été seulement modifiés pour flatter la vanité des princes de Grenade. Chevaliers et dames de la cour de Séville paradent à côté des guerriers mores, dont les femmes restent hors du tableau, dans l’ombre du harem.... Ces peintures ont pour fond un décor très riche, dont les édifices roses et verts sont de goût italien. La vasque d’une fontaine est supportée par quatre statuettes de femmes nues. Tous les visages ont le type giottesque. Cependant le peintre n’était pas italien; il néglige complètement le modelé, pour procéder par taches vives et plates, finement cernées d’un contour noir.»
Mais cet apport florentin ne fut, en somme, qu’un épisode; l’Andalousie revint, au commencement du XVe siècle, à l’imitation siennoise, comme en témoignent par exemple les peintures du cloître de San Isidro del Campo, près de Séville.
A cette époque, c’est en Castille que s’exerce l’influence de Florence; on y a signalé plusieurs artistes venant de cette ville, dont le plus célèbre fut Nicolas le Florentin. Une hypothèse ingénieuse et fortement appuyée de M. Gómez Moreno veut identifier ce peintre avec Dello di Nicola, artiste mystérieux qui aurait séjourné en Espagne depuis 1432. Quoi qu’il en soit, c’est à Nicolas qu’est due, en particulier, l’importante décoration à fresque de l’abside de la vieille cathédrale de Salamanque, travail commandé par le chapitre en 1445.