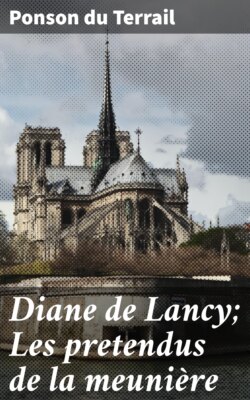Читать книгу Diane de Lancy; Les pretendus de la meunière - Ponson du Terrail - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
La route de Lyon à Nevers, qui passe par Villefranche et Charolles et longe les dernières montagnes de la haute Auvergne, côtoie, pendant quelques lieues, la lisière du Morvan.
Le Morvan est une province peu connue et dont le nom n’éveille de souvenirs que chez les chasseurs; c’est un coin montagneux, une petite Écosse, un canton sauvage et d’une âpre poésie, jeté comme par hasard entre les collines verdoyantes et les plaines fertiles du Nivernais et du Berri, et les coteaux chargés de vignobles de la basse Bourgogne.
Le Morvan est une contrée giboyeuse; par suite, elle est peuplée de braconniers.
Ses vallons boisés, ses sites abruptes rappellent les Alpes; çà et là, sur un roc, au coin d’un bois de châtaigniers, le voyageur attardé par les chemins de traverse découvre une ruine féodale dont une aile est encore habitée par des gentilshommes devenus paysans ou des paysans qui ont eu grand’peine à installer leur métairie et leurs greniers à foin dans la vieille demeure des gentilshommes.
Un étrange lien d’amitié, de parenté même, unit encore le paysan morvandiau à son ancien seigneur, qui généralement est aussi pauvre que lui. L’un et l’autre sont braconniers, le premier par nécessité, le second par orgueil de caste. Tous deux dédaignent le permis de chasse et sont en perpétuelle contravention avec la loi. De là une étroite amitié, un dévouement réciproque que resserrent et augmentent une certaine communauté d’idées, une singulière uniformité de mœurs. Le gentilhomme morvandiau ressemble fort à l’ancien seigneur breton. Il est vêtu comme un paysan; il porte souliers ferrés et guêtres de cuir; il se tient volontiers, pendant les soirées d’hiver, sous le manteau de la cheminée des cuisines, et écoute gravement les légendes des pâtres et les sornettes du bouvier.
Les traditions superstitieuses d’autrefois, de vieilles haines dont l’origine est douteuse, ont survécu, en Morvan, au passage des révolutions; il n’est pas rare de rencontrer à une lieue l’un de l’autre deux manoirs croulants, abritant deux races de Capulets et de Montaigus.
Au commencement d’octobre de l’année 1847, par une soirée pluvieuse et tellement embrumée qu’on n’y pouvait voir à dix pas devant soi, un cavalier suivait au petit pas, et se fiant entièrement à l’instinct de sa monture, un sentier étroit et rocailleux courant entre un précipice au fond duquel roulait un torrent et une bande de bruyères grises qui léchait les derniers escarpements d’une chaîne de collines.
C’était un jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans, d’une taille avantageuse, brun de visage et de cheveux, assez régulièrement beau, et possédant surtout cette mobilité de traits, cette physionomie intelligente qui séduit chez l’homme bien mieux qu’un type de beauté accompli, trop ordinairement dépourvu d’expression.
Son costume de voyage, bien que des plus simples, avait ce cachet d’élégance qui décèle le Parisien; l’insouciance avec laquelle il voyait arriver la nuit et bravait la pluie qui lui fouettait le visage trahissait cette bravoure singulière, cette gaieté sans nuages que l’habitant de la grande ville conserve dans ses plus lointaines pérégrinations.
Il pouvait être environ sept heures; le jour baissait rapidement, et le brouillard épaississant à mesure, en même temps que le sentier devenait plus difficile et plus roide, force devait être bientôt à notre voyageur de s’arrêter et de chercher un abri pour la nuit sous l’auvent de quelque rocher, s’il n’avait une connaissance parfaite du pays.
Il n’y songeait point cependant, car il fredonnait le plus joyeusement du monde un air d’opéra, il paraissait se peu soucier de la pluie qui pénétrait son manteau et ses vêtements.
Mais tout à coup le cheval broncha, puis, s’arrêtant court, refusa d’avancer. Le cavalier fut donc contraint de s’occuper un peu plus de son chemin et un peu moins de son motif musical. Il reconnut alors que le sentier qu’il suivait aboutissait à un pont de troncs d’arbres jeté sur un ravin, et que ce pont avait été emporté par les derniers orages, si bien qu’il était impossible d’aller plus loin.
«Morbleu! se dit-il, mes chers oncles les paysans gentilshommes auraient bien dû m’envoyer un guide à Nevers, pour me conduire sans encombre jusqu’à leur nid d’oiseaux de proie. Ces gens-là s’imaginent que j’ai le pied montagnard comme eux, et que j’y vois la nuit, ainsi qu’un chat de gouttière. Que vais-je donc devenir jusqu’à demain? Il doit bien y avoir un autre sentier quelque part; mais il faut le trouver, et je défierais Christophe Colomb lui-même d’en venir à bout par le brouillard qu’il fait. Brrr! cette pluie me glace les os. Cherchons un gîte; on dit qu’il y a une Providence pour les ivrognes, les voyageurs et les Parisiens; je sais me griser, j’habite Paris et je voyage, la Providence ne peut manquer de s’offrir à moi sous la forme la plus simple, fût-ce celle d’une grotte ou même d’un arbre assez touffu pour nous abriter mon cheval et moi.»
Le jeune homme mit aussitôt pied à terre, et, laissant le sentier, remonta à travers les bruyères jusqu’à une touffe d’arbres qui masquaient assez bien un bloc de roche creuse, sous laquelle il se plaça avec sa monture, qu’il laissa en liberté après s’être assis lui-même sur une couche de bruyère, préservée de l’humidité par ce toit naturel.
«Fort heureusement, continua-t-il en reprenant son aparté, lorsqu’il se fut installé le plus commodément possible, fort heureusement j’ai déjeuné tard à Nevers, et je me suis pourvu de cigares; car je crois que je ne dînerai pas ce soir, et que je serai contraint de passer la nuit ici, à mélanger de mon mieux la fumée de mon panatellas avec le brouillard du ciel.»
Le voyageur tira un cigare de son étui, l’alluma, puis s’étendit sur les bruyères et se mit à fumer avec la gravité d’un musulman.
«Il est, dit-il en lui-même lorsqu’il en fut à sa quatrième bouffée, il est de singulières phases dans l’existence d’un homme du monde qui a le malheur d’être endetté. Il y a quarante-huit heures à peine, j’étais chez moi, à Paris, rue du Helder, dînant gaiement avec Azurine et mes bons amis Restaud et d’Éparny; nous causions des courses dernières, et je songeais à acheter Blidah, la jument arabe du petit comte Persony. Le champagne était bien frappé, on avait suffisamment chauffé le bordeaux, et je me trouvais dans un tel état de béatitude que j’avais oublié mes dettes et une certaine lettre de change souscrite au bénéfice de Thomas Baptiste, mon carrossier, lequel me logera bien certainement rue de Clichy, si je n’arrange mes affaires au plus vite. Arrive une lettre...!
«Pardieu! cette lettre est trop curieuse pour que je ne la relise point à la lueur de mon cigare, car le jour me fait complétement défaut.»
Le voyageur prit dans la poche de son gilet un chiffon de papier grisâtre, plié grossièrement et qui avait dû être cacheté, à défaut de cire, avec de la mie de pain. Une grosse écriture et une orthographe de pure fantaisie en couvraient le recto et le verso sur les trois premières pages.
Le Parisien relut à mi-voix avec une inflexion de raillerie légère:
«Monsieur mon neveu,
«Mon frère Antoine me sert de secrétaire, car vous savez que je n’ai jamais appris à écrire, étant né pendant la révolution; mais c’est moi, votre oncle Joseph, qui dicte la présente. Bien que nous ne vous ayons jamais vu, Antoine et moi, car vous n’êtes point venu nous rendre visite en Morvan, j’ai tout lieu de croire que vous avez pour nous l’affection qu’un bon gentilhomme doit conserver aux frères de son père, et je suis persuadé que ma lettre vous fera un plaisir infini.
«Notre frère bien-aimé Louis, votre père, était notre aîné de près de dix ans. Aussi avions-nous pour lui une tendresse respectueuse, et avons-nous toujours regretté vivement qu’il nous eût quittés, en 1805, pour aller servir dans les armées de l’empereur. Il est vrai que ce départ fut pour lui une source de fortune, puisqu’il épousa votre mère, qui avait cinquante mille livres de rente.
«Mais il paraît qu’on dépense beaucoup à Paris, lorsqu’on est jeune et bien tourné comme vous, car il nous est revenu que vous aviez mené si grand train depuis la mort de notre frère Louis, que vous étiez aux trois quarts ruiné, ce qui nous a affligés plus que vous ne sauriez croire. Cependant, peut-être avons-nous trouvé un moyen de réparer en partie vos pertes, et ce moyen le voici:
«Vous savez que nous avions un quatrième frère qui s’appelait Pierre, et qui est mort il y a huit ans. Il nous est resté de lui une fille qui aura seize ans vienne la Toussaint, et nous sommes quasiment à la fin d’octobre.
«C’est la plus jolie fille qu’on ait jamais vue de Saint-Pierre à Saint-Landry en passant par notre manoir de la Châtaigneraie et en allant jusqu’au château de la Fauconnière, où nichent ces oiseaux de malheur qu’on appelle les Lancy.
«A propos des Lancy, je dois vous dire que le marquis est aux trois quarts mort et qu’il ne quitte plus son fauteuil. Quant à son fils, c’est un grand benêt qui se cache sitôt qu’il nous voit. Mais sa sœur est un vrai démon; nous n’osons plus mettre le pied dans le parc de la Fauconnière depuis qu’elle nous a envoyé une charge de sel dans les jambes à mon frère Antoine et à moi. Elle tient contre nous des propos à faire frémir, et nos laboureurs frissonnent des pieds à la tête quand ils la rencontrent.
«Je vous assure qu’elle est bien nommée, et son sobriquet de Dragonne lui va à ravir.
«Mais revenons à notre nièce. Je vous disais donc que c’était la plus jolie fille du pays; nous l’avons fait éduquer par le curé du village, et elle est tout à l’heure plus savante que lui. Elle est si petite, si frêle, si blonde, que nous l’avons appelée Mignonne. Elle a des mains roses et menues comme vos dames de Paris, et nous en sommes amoureux, mon frère et moi, à ce point, que nous l’épouserions, l’un ou l’autre, si nous n’avions passé la soixantaine. Du reste, si cela arrivait, nous nous brouillerions très-certainement, et c’est pour cela que nous avons songé à vous.
«Mignonne sera riche après nous. Nous avons un beau bien, et nous l’augmentons chaque année des trois quarts de nos revenus, ne dépensant rien pour nous. Depuis dix ans nous n’avons eu, mon frère Antoine et moi, qu’une seule fantaisie, et je vous assure que ce fut bien à tort. Nous achetâmes, l’an dernier, deux fusils Lefaucheux, des armes qui se chargent par la culasse. Nous n’avons jamais pu nous en servir, et nous en sommes revenus à nos vieux fusils de braconniers.
«Il faut vous dire que Mignonne aura bien cinq cent mille francs quand nous serons morts, et c’est un beau denier en tout pays. Nous avons donc pensé, mon frère Antoine et moi, qu’il vous conviendrait de l’épouser. C’est pourquoi je vous écris. Si notre proposition vous convient, venez; sinon, répondez-nous.
«Il faut vous dire que le fils Lancy est toujours fourré dans les environs; comme je suis persuadé que vous détestez les Lancy presque autant que nous, j’aime à croire que vous arriverez au plus vite, ne serait-ce que pour empêcher ce drôle d’en conter à notre Mignonne. Sur ce, mon cher neveu, nous vous embrassons de tout cœur, mon frère Antoine et moi.
«Baron Joseph de Vieux-Loup, seigneur
de La Châtaigneraie.»
«P. S.—Mon frère Antoine, qui est un savant, a lu dans les livres que les mariages d’amour étaient les meilleurs; aussi n’avons-nous parlé de rien à Mignonne, afin qu’elle vous aime; ce qui ne peut manquer, car on dit que vous êtes fort joli garçon.»
Le jeune voyageur termina la lecture de cette lettre par un nouveau sourire, et puis il se dit:
«Il est possible que cette petite fille qu’on appelle Mignonne, et dont mes chers oncles font un si grand éloge, soit en effet gentille; à coup sûr, une dot de cinq cent mille francs a bien son mérite, mais ces braves messieurs de Vieux-Loup se moquent de moi, très-certainement, s’ils supposent que je vais épouser leur querelle avec leur vieux voisin le marquis de Lancy. Ce serait au moins curieux, pour ne pas dire ridicule, qu’en l’an de grâce mil huit cent quarante-sept, moi Gaston de Vieux-Loup de la Châtaigneraie, membre du Jockey-Club et d’une foule de sociétés et d’institutions remarquables au point de vue du progrès de la reproduction et de l’amélioration des races chevalines, j’allasse continuer une petite guerre de clocher remontant à Charles IX! Me voyez-vous chaussant un éperon d’acier, montant un destrier gris de fer, et, la lance au poing, m’en aller clouer avec ma dague mon gant sur la porte de mes voisins les marquis de Lancy? Le tout dans le but unique de plaire à mon oncle Joseph, qui ne sait pas écrire, et à mon oncle Antoine qui a un style et une orthographe de si haute fantaisie! Il est vrai, reprit Gaston de Vieux-Loup (nous pouvons, dès à présent, lui donner ce nom), il est vrai que je débute en Morvan par le métier de chevalier errant, et que, l’éloquence de mes oncles aidant, je pourrais prendre jusqu’à un certain point mon rôle au sérieux.»