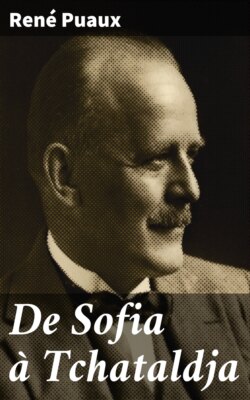Читать книгу De Sofia à Tchataldja - René Puaux - Страница 4
LA PÉRIODE DIPLOMATIQUE
Оглавление(Avant la déclaration de guerre: 3-17 octobre).
Au moment de mon départ pour Sofia (3 octobre), à Paris on ne croyait pas à la guerre, et ma mission en Bulgarie paraissait devoir se borner à une enquête politique et diplomatique. Il était nécessaire que le Temps envoyât quelqu’un sur place, notre correspondant habituel, M. Siméon Radef, nous ayant télégraphié qu’il lui était impossible de continuer sa tâche, ayant été appelé sous les drapeaux par suite de la mobilisation générale.
Je partais donc, persuadé qu’au bout d’une semaine ou deux je reprendrais l’Orient-Express. J’avais cependant pris quelques précautions, achetant hâtivement à Paris, dans l’après-midi du jeudi 3 — mon départ ayant été décidé dans la matinée seulement, — divers objets d’équipement que je supposais ne pouvoir trouver à Sofia, au cas où, malgré les prévisions optimistes, la guerre serait déclarée. Il y avait surtout une certaine jumelle prismatique, puissance 16, qui me donna quelque angoisse et qui fut pendant plusieurs jours un objet de plaisanterie entre mes camarades et moi.
«Si la guerre n’éclatait pas, cet instrument coûteux me resterait pour compte, mon journal ne le rembourserait pas.» Je dois dire que cette inquiétude se dissipa assez vite. Les premières impressions de Sofia furent concluantes. Le soir même de mon arrivée, le samedi 5 octobre, après une tournée hâtive de visites dans le monde diplomatique et politique de la capitale bulgare, je télégraphiai au Temps:
Sofia, 5 octobre.
Ce matin, debout et tête nue, ce qui a été très remarqué et a provoqué d’interminables acclamations, le roi a ouvert la session extraordinaire du Sobranié et demandé le vote d’un crédit extraordinaire de cinquante millions. La séance a été ensuite levée. On siégera demain dimanche à deux heures, et probablement lundi aura lieu le vote final, qui ne fait pas de doute, tous les partis étant absolument d’accord.
Dans ces conditions d’unanimité du pays bulgare, il reste à examiner la situation diplomatique, la situation envers la Turquie et la situation militaire.
L’accord entre les puissances balkaniques est parfait. Les tentatives de la Turquie pour détourner la Serbie ont échoué et n’ont aucune chance de réussir.
D’autre part on a l’assurance formelle, viâ Pétersbourg, de la neutralité de la Roumanie, et on sait que l’Autriche n’a aucune intention d’intervention.
Ceci étant établi, on attend ici le résultat du dernier essai d’action des puissances sur Constantinople, bien décidé à ne désarmer que si cette action obtient des résultats positifs et non de vagues promesses.
Ceux qui ont pu croire qu’une résurrection du programme de Muerzsteg suffirait à calmer les États balkaniques se trompent.
Les Bulgares estiment qu’ils ne peuvent accepter que la constitution en Turquie d’Europe d’autonomies à caractère national, c’est-à-dire de sphères respectivement bulgare, serbe et grecque.
Ces provinces autonomes auraient leurs Diètes nationales et des gouverneurs généraux chrétiens nommés avec l’assentiment des puissances.
Enfin il serait créé des milices locales, et comme garantie de l’exécution de ces réformes et preuve du bon vouloir turc, on demanderait le retrait immédiat des troupes turques.
On voit que ce programme est singulièrement plus radical que celui de Muerzsteg et le simple contrôle des finances.
Réussira-t-on à le faire accepter par la Porte? C’est non seulement improbable, mais même presque impossible.
Dans ces conditions, les États balkaniques alliés, après avoir laissé aux grandes puissances le temps strictement nécessaire pour obtenir une réponse de la Porte, feront à Constantinople une démarche collective pour obtenir, eux aussi, leur réponse directe sur la même proposition. On ne laissera pas à la Turquie de délais inutiles; ce sera oui ou non, et si, comme on le pense, c’est non, les hostilités commenceront immédiatement.
Toutes les dépêches qui parleront de déclaration de guerre avant la fin de la semaine seront fausses. Je suis en mesure de vous l’affirmer; car on veut, comme je l’ai dit plus haut, laisser aux puissances la possibilité d’agir, contre toute vraisemblance d’ailleurs.
Au point de vue militaire, la Bulgarie est prête; sa mobilisation, qui devait se faire en sept jours, a été terminée en six, avec une telle rapidité et un tel enthousiasme que les chiffres ont dépassé les prévisions.
La concentration des troupes se fera avec la même célérité. Tout a été ici préparé depuis si longtemps qu’il ne peut y avoir d’accroc.
L’instant est décisif, et je dois dire que je n’ai jamais vu un peuple aussi prêt, aussi certain de la victoire et aussi unanime à la certifier imminente.
Par un phénomène curieux, alors que cette décision belliqueuse de la Bulgarie et de ses alliés était évidente, criante, certains de mes confrères, envoyés comme moi spécialement de Paris, se refusèrent, pendant toute la semaine qui suivit et presque jusqu’à la veille des hostilités, à l’admettre. Ils avaient apporté avec eux un optimisme théorique qui leur faisait chercher des preuves de leurs idées au lieu de voir simplement les faits.
A combien de déjeuners et de dîners chez le père Klein n’avons-nous pas entendu certains d’entre eux développer la thèse du bluff balkanique, celle de l’impossibilité de l’effort militaire adéquat, et se baser sur les propos de certain diplomate fort distingué qui déclarait urbi et orbi au mois d’août qu’il manquait aux Bulgares 8,000 chevaux et que leurs canons n’avaient pas cent coups à tirer. Ma religion fut éclairée dès le soir de mon arrivée. Il ne me restait plus qu’à suivre la joute diplomatique des cabinets balkaniques avec les cabinets européens pour éviter que ceux-ci les privassent de «leur guerre» sans cesser de conserver leur sympathie.
Le 6 octobre, qui était un dimanche, le Sobranié tint séance à deux heures de l’après-midi. L’Assemblée avait à approuver l’oukase de mobilisation.
Le président du conseil, M. Guechof, prit la parole pour exposer les vues du gouvernement et défendre l’oukase.
Après avoir fait constater l’attitude pleine de correction du gouvernement bulgare qui était allé jusqu’à ordonner la clôture prématurée des grandes manœuvres, afin de prévenir tout motif d’inquiétude chez ses voisins de Turquie, le président du conseil ajouta:
«La Turquie a répondu par la mobilisation, menaçant ainsi directement notre sécurité. Après cet acte de provocation, que rien ne justifiait, la Bulgarie a dû modifier son attitude et mobiliser à son tour; le gouvernement a pleinement conscience de l’extrême gravité de sa résolution et de la lourde responsabilité qui en découle pour lui devant la nation, mais il trouve un réconfort suffisant dans la justice que le monde civilisé rend aux efforts infructueux qu’il a faits pour maintenir la paix, dans le sentiment d’union avec les autres États balkaniques chrétiens qui, comme la Bulgarie, ont épuisé toutes les ressources pacifiques et auxquels les mêmes décisions s’imposent, motivées par la même mobilisation turque; enfin et surtout dans l’appui unanime de la nation entière, qui manifeste par d’éclatantes et admirables démonstrations patriotiques son accord avec le gouvernement, dans l’espoir de voir se lever une aurore nouvelle pour les Bulgares de Turquie.»
En terminant, M. Guechof remercia l’Assemblée de son unanimité. Ce n’était pas, en effet, un spectacle banal que de voir défiler à la tribune, une sorte de petit enclos drapé de rouge, à la gauche du banc des ministres, les chefs de tous les partis, démocrates, stamboulovistes, libéraux, jeunes-radicaux, venant apporter au gouvernement, qu’ils déchiraient naguère à belles dents, le témoignage de leur confiance. Il n’y eut qu’une note discordante, l’inévitable socialiste pacifiste, qui commença un interminable discours contre la guerre, jetant l’anathème sur ceux qui en acceptaient la responsabilité. On l’écouta un certain temps, et puis on commença à l’interrompre véhémentement. Il continua. Alors certains quittèrent la salle pour ne pas l’entendre. On le traita de sans-patrie et d’autres qualificatifs peu flatteurs que mes connaissances insuffisantes du bulgare ne me permirent pas de comprendre, mais dont on devinait, aux gestes menaçants des interrupteurs, le manque d’urbanité. A la fin, la patience fit défaut, et un député barbu qui trépignait d’indignation près d’une porte s’élança, et attrapant le pacifiste par le bras, tenta de l’arracher de la tribune. Les autres socialistes vinrent défendre leur collègue et ce fut la mêlée générale. Le président, M. Danef, leva la séance au milieu du brouhaha pendant que le pacifiste, accroché à la barre de la tribune, secouait sa tête de petit professeur opiniâtre en manifestant sa volonté ferme de continuer.
A la reprise de la séance, il continua, sans dépasser cependant les limites de la plaisanterie permise. Un silence de mort accueillit la fin de son oraison et l’on se sépara.
Maintenant les jours vont se suivre, monotones, agaçants. Les correspondants, talonnés par le souci de l’information, le besoin de fournir quotidiennement quelque chose à leurs journaux, font la navette entre la demeure de M. Guechof, qui répond invariablement, mensonge que les convenances diplomatiques rendent nécessaire, que «toute chance de solution pacifique n’est pas perdue », et le télégraphe où ils torturent leur imagination. Ils se retrouvent sur le trottoir devant l’hôtel de Bulgarie, autour du billard du café de Bulgarie, ou dans la grande salle morne du Casino, sorte de brasserie à l’allemande où, avant la mobilisation, un orchestre distrayait les consommateurs. On se surveille les uns les autres du coin de l’œil. Si quelqu’un disparaît un instant, on le suppose nanti d’une importante nouvelle et l’on court aux informations. Il n’y a rien, on attend la démarche des puissances et on se prépare à lui répondre évasivement. Et voici, au jour le jour, mes télégrammes:
Sofia, 7 octobre.
Les dépêches de Paris annonçant que M. Sazonow, d’accord avec M. Poincaré, aurait envisagé une action austro-russe à Sofia, ont provoqué ici un certain malaise. On considère que la coopération de la Russie avec l’Autriche a, dans les questions balkaniques, de fâcheux précédents et que rien de bon pour la Bulgarie n’en peut sortir.
On dit, de source très autorisée, que tout d’abord cette intervention sera absolument nulle si elle espère empêcher la guerre, et que si elle se manifeste après la guerre, elle sera contraire aux aspirations des peuples balkaniques.
On comprend la situation délicate de la France, mais on déplore cette tendance de sa politique.
L’état d’esprit que vous indiquait ma dépêche d’hier a atteint, à Sofia, son diapason maximum. Ce matin, des bandes de Macédoniens défilaient en chantant. A deux heures, les régiments d’artillerie sont partis avec leurs canons enguirlandés de fleurs; la population a jeté des fleurs aux régiments d’infanterie partis également hier.
Une fois les bandes de Macédoniens lâchées — et ils sont partis par milliers — et étant donné l’esprit dans le peuple bulgare, on peut presque considérer la guerre comme fatale.
J’avais écrit déclarée et non fatale. On n’osa pas publier une telle affirmation. A Paris, on croyait toujours à la possibilité d’un arrangement.
Sans quoi, se serait-on donné la peine de peser avec tant de soin cette formule que Londres avait adoucie, malgré le sentiment si net qu’avait M. Poincaré qu’une intervention vigoureuse auprès de la Porte aurait seule une chance d’arrêter les alliés balkaniques? Ce fut le mardi 8 octobre que la note ci-dessous fut remise par M. de Nekludof, ministre de Russie, et le comte Tarnowski, ministre d’Autriche-Hongrie, à M. Guechof:
«Les gouvernements russe et austro-hongrois déclareront aux Etats balkaniques:
«1° Que les puissances réprouvent énergiquement toute mesure susceptible d’amener la rupture de la paix;
«2° Que s’appuyant sur l’article 23 du traité de Berlin, elles prendront en main, dans l’intérêt des populations, la réalisation des réformes dans l’administration de la Turquie d’Europe, étant entendu que ces réformes ne porteront aucune atteinte à la souveraineté de Sa Majesté impériale le sultan et à l’intégrité territoriale de l’empire ottoman; cette déclaration réserve d’ailleurs la liberté des puissances pour l’étude collective et ultérieure des réformes;
«3° Que si la guerre vient néanmoins à éclater entre les États balkaniques et l’empire ottoman, elles n’admettront, à l’issue du conflit, aucune modification au statu quo territorial dans la Turquie d’Europe.
«Les puissances feront collectivement auprès de la Sublime-Porte les démarches dérivant de la précédente déclaration.»
En recevant les ministres russe et autrichien et en prenant connaissance de la note qu’ils lui remettaient, le président du conseil bulgare se contenta de leur répondre: «Nous avons, hélas! mobilisé.»
C’étaient les propres paroles que Gortchakof adressait en 1877 à lord Loftus, ambassadeur d’Angleterre, qui venait lui parler d’accord possible avec la Turquie.
La similitude des situations s’affirmait jusque dans la similitude voulue des mots.
D’ailleurs il était impossible de s’y tromper: la Bulgarie ferait la guerre, malgré toutes les notes diplomatiques. Avant même de connaître le contenu de celle-là, la réponse était prête, et je pouvais télégraphier ce même mardi 8 octobre:
Sofia, 8 octobre, 1 heure.
Voici quel sera le sens de la réponse:
La Bulgarie remerciera les puissances de leur intérêt pour la cause des populations balkaniques et précisera son point de vue, demandant aux puissances d’obtenir de la Porte les mêmes précisions, ce qui paraît difficile.
Donc, la situation n’est pas modifiée malgré les apparences, la Bulgarie ne pouvant pas donner de délais qui compromettraient sa situation militaire.
Il fallait cependant gagner du temps pour permettre à la concentration des troupes de se terminer. On allait donc tenir une succession de conseils de cabinet, y préparer la réponse aux puissances, la retarder sous des prétextes variés jusqu’au jour où on serait prêt.
Le lendemain, mercredi 9 octobre, on distribuait à midi le communiqué suivant:
«Le conseil des ministres a discuté la communication remise hier à M. Guechof par les ministres de Russie et d’Autriche-Hongrie. Il n’a malheureusement pas trouvé dans cette communication les précisions qu’il attendait sur les réformes proposées à la Turquie, ni les garanties pour leur réalisation. Mais avant de prendre une décision, il a voulu échanger des vues sur ladite communication avec les cabinets de Belgrade et d’Athènes.»
Sous une forme discrète, le communiqué était catégorique. On ne trouvait dans la note des puissances ni les précisions attendues, ni les garanties demandées. Cela ne signifiait-il pas pour tout esprit averti que le conseil des ministres bulgares répondrait négativement à l’heure où il se déciderait à répondre?
Je télégraphiai le lendemain:
Sofia, 10 octobre.
Le gouvernement bulgare a reçu l’adhésion du cabinet de Belgrade au point de vue bulgare relatif à l’attitude à prendre vis-à-vis de la note des puissances. On attend aujourd’hui jeudi la réponse d’Athènes.
On ne se dissimule pas dans les milieux diplomatiques que la réponse bulgare sera une fin de non-recevoir et je peux dire qu’on s’y attendait. Le communiqué bulgare que je vous ai télégraphié était significatif et on ne s’y est pas trompé, pas plus à la légation d’Autriche qu’à celle de Russie.
Il restera alors au gouvernement bulgare à adresser à la Porte son mémorandum-ultimatum en donnant vingt-quatre heures pour la réponse, ce qui pourra être fait sans doute samedi.
Un diplomate admirablement au courant de la situation vient de me déclarer:
«On peut considérer la guerre comme certaine. Aussi la question de l’éviter ou de ne pas l’éviter n’offre-t-elle plus d’intérêt; mais ce n’est pas une raison parce que les puissances s’y sont prises trois semaines trop tard pour arrêter l’action diplomatique et l’échange de vues entre elles.
«Si on attend maintenant qu’il y ait eu une bataille à Andrinople pour s’inquiéter d’une intervention nécessaire, on sera de nouveau de trois semaines en retard, et Dieu sait où on ira! Il faut que dès maintenant les puissances qui n’ont pas su éviter la guerre se préoccupent des moyens de la faire cesser. L’article 3 du mémorandum affirme que les puissances n’admettront aucune modification du statu quo territorial en Turquie d’Europe à l’issue du conflit. Cela est très bien. mais il faut que les puissances prévoient aussi bien la victoire turque que la victoire bulgaro-serbe et aient des programmes complètement prêts, y compris les désignations nominatives de gouverneurs-généraux chrétiens des provinces autonomes et cætera pour la minute qui suivra la bataille décisive. L’expérience d’un retard dans les décisions et les conversations de chancelleries ne doit pas être renouvelée. On voit à quoi il a abouti!»
Je vous confirme que la concentration des troupes se poursuit sans à-coups et sera vraisemblablement terminée dans quatre ou cinq jours.
Solia, 10 octobre.
La réponse bulgare à la note austro-russe ne sera pas remise aujourd’hui, comme on l’avait pensé. M. Guechof vient de me dire lui-même qu’elle le sera sans doute demain vendredi.
Cet ajournement aurait pour raison, comme je vous l’ai télégraphié, non pas une hésitation de la dernière minute, mais le désir de ne pas entamer la conversation avec les puissances pour leur répondre par une fin de non-recevoir, au moment même où l’ultimatum sera envoyé à la Porte, ce qui coupera court à toute discussion ultérieure.
Sofia, 11 octobre.
Le conseil des ministres a examiné, à la fin do l’après-midi, la note des puissances. A l’issue du conseil, aucun communiqué n’a été fait.
Dans les cercles diplomatiques étrangers, on déclare croire encore à une légère chance de paix, si les puissances sont réellement décidées à agir immédiatement et énergiquement sur la Porte et si elles peuvent non seulement obtenir complète satisfaction, mais encore donner aux États balkaniques des assurances de l’exécution des réformes. On a l’impression qu’il faudrait, pour réussir à arrêter les Bulgares, plus que même la promesse des puissances d’exercer leur contrôle sur l’exécution des réformes en Macédoine, et on s’attend à une réponse évasive du cabinet de Sofia demain.
Evidemment, si les puissances réussissaient à intimider Belgrade et Athènes, la situation pourrait se trouver modifiée; mais il ne semble pas que cette tactique ait des chances de réussir. «D’ailleurs, me disait un diplomate étranger qui connaît depuis de longues années les Balkans, s’il est vrai que les bandes macédoniennes ont franchi la frontière avec leurs chefs, toutes les démarches que nous pourrons faire seront inutiles. Il serait trop tard.»
Le silence absolu du gouvernement bulgare ne permet que de formuler des hypothèses et je me borne à vous transmettre des impressions; mais elles demeurent que le cabinet de Sofia ne se prêtera pas à un dialogue diplomatique comportant un long ajournement de l’action décisive.
Quand ce télégramme arriva à Paris, on s’étonna qu’il n’y fût pas fait mention de la déclaration de guerre du Monténégro qui venait de commencer les hostilités. On fit des hypothèses, et celle à laquelle on s’arrêta fut que le gouvernement bulgare n’avait pas laissé pénétrer cette nouvelle dans le public pour se donner le temps de délibérer et de prendre position sans être influencé par un mouvement populaire.
Ainsi donc on croyait encore à Paris à une paix possible, aux hésitations du gouvernement de Sofia qui pouvait craindre de se laisser entraîner à la guerre par la foule qui lui crierait: «Imitez le Monténégro! Puisque nous sommes alliés, et que l’un a marché, faisons comme lui!»
Quelle chose extraordinaire que cette persistante illusion! Nous savions parfaitement la déclaration de guerre du Monténégro, mais nul n’y attachait d’importance. Les Monténégrins rendaient simplement officiel ce qui existait en fait depuis des mois. Ils s’étaient toujours battus avec les Turcs, cela ne changeait rien, et les Turcs eux-mêmes ne devaient pas autrement s’en émouvoir. Aussi continuait-on à Sofia, où les nouvelles du Montenegro avaient leur place dans les feuilles de l’agence officieuse, à préparer tranquillement l’action militaire en même temps que la réponse polie, mais négative, que l’on allait faire aux puissances.
Sofia, 11 octobre.
Le président du conseil, M. Guechof, vient de me prévenir que la réponse de la Bulgarie ne sera pas encore remise aujourd’hui aux représentants des puissances. C’est la continuation de la tactique que je vous indiquais hier: éviter d’engager la conversation avec l’Europe jusqu’au moment où la concentration sera terminée et l’ultimatum envoyé à la Porte.
On a prévenu les correspondants de guerre de se tenir prêts à partir.
M. Stanciof et les autres ministres bulgares à l’étranger ont reçu hier des instructions pour expliquer le point de vue de la Bulgarie aux gouvernements auprès desquels ils sont accrédités. Ils doivent dire que les efforts des puissances pour obtenir des réformes réelles en Macédoine ayant toujours échoué et le projet nouveau n’offrant pas de garanties d’un changement radical, la Bulgarie et les États alliés sont dans la nécessité de prendre en main le sort de leurs conationaux macédoniens.
Le gouvernement bulgare a donné des ordres sévères aux autorités provinciales pour que les musulmans de Bulgarie ne soient molestés en aucune façon, même si les Turcs se livraient à des massacres en Macédoine.
Sofia, 11 octobre.
Le roi Ferdinand a assumé le commandement en chef des troupes et s’est adjoint le général Savof. Le général Fitchef a été nommé chef de l’état-major général.
Maintenant la concentration est presque terminée. Les puissances ont remis leur note mardi, on a traîné tant qu’on a pu pour leur répondre, alors qu’on savait parfaitement dès le premier jour ce qu’on leur répondrait. Il faut se décider. On va démasquer les batteries.
Le Temps, dans son numéro du dimanche 13 octobre (daté du 14), a la primeur de la nouvelle:
Sofia, 13 octobre.
La réponse à la note des puissances présentée par les ministres d’Autriche et de Russie sera remise aujourd’hui dimanche au début de l’après-midi. De même la mise en demeure des États balkaniques sera présentée aujourd’hui également aux ministres turcs accrédités à Sofia, Belgrade et Athènes.
La note bulgare, comme les notes serbe et grecque, qui sont exactement semblables, commence par remercier les puissances de l’intérêt que leur démarche a manifesté pour le problème soulevé dans les Balkans. La note relève l’expression «prendre en main l’exécution des réformes» qui se trouve dans le mémorandum des puissances et dit en apprécier l’importance; mais, ajoute la note bulgare, «nous nous trouvons dans une situation qui nous fait un devoir de demander directement à la Porte de préciser ses intentions de réformes en Macédoine».
Cette réponse est bien, comme je vous l’avais fait prévoir, une fin de non-recevoir à l’égard de l’intervention médiatrice des puissances.
En même temps que cette réponse sera remise aux ministres Nekludof et Tarnowski, M. Guechof remettra à Moukbil bey, chargé d’affaires de Turquie, le mémorandum bulgare à la Porte. Cette procédure qui sera imitée également aujourd’hui dimanche, à la même heure, à Belgrade et à Athènes, a été adoptée parce qu’il est impossible de charger les ministres bulgare, serbe et grec à Constantinople de faire cette démarche auprès du ministre Noradounghian, les relations télégraphiques, surtout chiffrées, étant interrompues par ordre du gouvernement ottoman entre les capitales balkaniques et leurs représentants à Constantinople, et il est également impossible d’envoyer des courriers spéciaux.
Le mémorandum des États balkaniques au gouvernement ottoman commence par rappeler qu’ils ont attendu depuis nombre d’années les réformes promises en Macédoine, réformes qui furent inscrites dans des actes internationaux. Les États balkaniques se trouvent dans l’obligation de préciser eux-mêmes les conditions dans lesquelles l’ordre et la paix peuvent être rétablis. Le mémorandum énumère alors les conditions que je vous ai déjà télégraphiées: créations d’autonomies à caractère national; nominations de gouverneurs chrétiens à la tête de chacune de ces régions autonomes; assemblées nationales; langue de la population dans chaque région autonome reconnue comme officielle et administrative; créations de milices régionales .
Le mémorandum dit en terminant que pour assurer la réalisation d’un tel programme, le contrôle des grandes puissances et des États balkaniques eux-mêmes est indispensable. Enfin le mémorandum demande à la Turquie, comme preuve de sa sincérité au cas où elle accepterait ces conditions, d’ordonner immédiatement la démobilisation de son armée.
Il faut souligner dans ce qui précède la part de contrôle demandée par les États balkaniques et la condition de démobilisation. Ces deux conditions seront évidemment rejetées par la Porte qui ne saurait admettre que les États balkaniques jouent à l’égard de la Macédoine le rôle de l’Autriche vis-à-vis de la Bosnie, ce qui équivaudrait pour la Turquie à signer sa déchéance de grande puissance en Europe. Les gouvernements balkaniques avaient primitivement songé, comme je vous l’ai signalé, à demander dans le mémorandum le retrait des troupes ottomanes de la Turquie d’Europe, et on avait hésité entre cette exigence et celle du contrôle des États balkaniques sur les réformes en Macédoine. Après des échanges de vues entre Belgrade et Athènes la deuxième formule a prévalu.
Ce télégramme est daté du dimanche 13. Je l’ai en réalité envoyé dans la nuit du 12 et j’en avais la substance depuis le matin de ce même samedi 12. Il ne fallait pas songer à l’expédier immédiatement, la censure, une censure vigilante et impitoyable, m’en aurait empêché au nom des convenances diplomatiques qui ne permettent pas qu’un journal publie une information avant que les intéressés en aient eux-mêmes connaissance. C’était pourtant une information précieuse, attendue, que j’avais eu quelque peine à me procurer. Même le dimanche matin on me l’aurait arrêtée. Il restait une chance. Elle me fut favorable. Le bureau de la censure fermait à dix heures du soir, j’attendis sa fermeture. Or la censure bulgare avait des rouages que j’avais appris à connaître. Tous les télégrammes, après avoir passé par le bureau, faisaient un nouveau stage dans le cabinet du ministre des postes et chemins de fer, M. Franghia, qui les examinait, les relisait et leur donnait l’estampille définitive sous forme d’un petit paraphe au crayon bleu. M. Franghia, homme d’un commerce charmant, m’avait, dès les premiers jours, témoigné quelque amitié. Il se plaisait vers minuit à me donner un coup de téléphone: «Venez donc prendre une tasse de café et fumer des cigarettes.» Il soignait la presse, plaidait auprès d’elle, avec une faconde toute méridionale et chaleureuse, la cause bulgare. Je vins donc ce samedi soir, mon télégramme dans ma poche, fumer des cigarettes et deviser de la France, des alliances balkaniques, de la Triple-Entente, etc... Puis vers une heure du matin, nonchalamment, je sortis les feuillets bleus de ma poche.
— Mon cher ministre, puisque je suis là, pour gagner du temps, je vais vous soumettre ce télégramme qui devrait bien partir cette nuit où les lignes sont moins encombrées et que je voudrais voir à Paris d’assez bonne heure parce que, le dimanche, le Temps met sous presse deux heures plus tôt.
— Eh bien, lisez-moi ça!
— Ma diction, qui n’a jamais passé pour bonne, fut, en l’occurrence, effroyable, les phrases étaient coupées de façon biscornue, la ponctuation n’était plus qu’une chimère. D’ailleurs le ministre, éreinté par le travail formidable qu’il fournissait tout le long du jour, n’écoutait pas Son oreille n’avait évidemment plus qu’une faculté : celle de pouvoir saisir, s’ils s’étaient présentés, les mots: mobilisation, concentration, renforts serbes ou autres nouvelles militaires. Du moment qu’il n’était question dans mon histoire que de réformes en Macédoine, d’intervention médiatrice des puissances, d’actes internationaux,cela n’avait pas d’importance.
Et il mit à ma grande satisfaction le paraphe au crayon bleu. Je n’étais pas toutefois complètement rassuré. Si la fantaisie lui prenait de relire mon télégramme, j’étais perdu. J’insistai alors doucement pour qu’il appelât le chef de l’expédition télégraphique, et j’avoue que lorsque je vis mon papier bleu partir pour la salle des opérateurs je ne me tins pas de joie. Je restai avec M. Franghia encore pendant près de trois quarts d’heure, craignant toujours de voir revenir mon papier bleu que quelque télégraphiste, étonné de n’y voir que le paraphe ministériel sans le cachet de la censure, rapporterait par un scrupule de conscience.
Quand je fus sûr qu’il courait sur la ligne, je souhaitai le plus cordial bonsoir au ministre des chemins de fer et m’en fus dormir avec béatitude.
J’assistai, le lendemain,avec une sérénité joyeuse, aux courses affolées de mes confrères à la recherche de renseignements sur les fameuses notes qui, disait-on, allaient être remises. On leur interdit de télégraphier le peu qu’ils avaient pu apprendre avant le soir, car les notes ne furent portées au comte Tarnowski, à M. de Nekludof et à Moukbil bey qu’à sept heures du soir.
Le Temps avait paru à trois heures de l’après-midi avec leur contenu.
J’ai dit, en commençant ce chapitre de la période diplomatique qui précéda la déclaration de guerre, que certains se refusèrent à admettre jusqu’à la dernière minute l’évidence.
Ce même dimanche soir, comme nous allions dîner chez le père Klein, un de mes confrères, et des plus distingués, qui, après avoir parié un dîner merveilleux que la guerre n’éclaterait pas, avait passé par une crise pessimiste dans les trois derniers jours, reprit triomphalement sa thèse optimiste: «La note des alliés à la Turquie est la preuve la plus éclatante de ce que j’avance. Ce n’est pas un ultimatum, c’est un mémorandum. La distinction est capitale. Le bluff balkanique est maintenant prouvé. Ils hésitent à la dernière minute. La preuve est faite.»
Et comme je l’écoutais stupéfait d’une telle ténacité dans l’optimisme, je revoyais, la veille au soir, la gare de Sofia où je m’étais rendu avant de faire ma visite au ministre Franghia.
J’avais assisté au passage d’un des nombreux trains amenant les régiments serbes qui apportaient l’appoint de leurs forces à l’armée bulgare dans le choc imminent. Malgré l’heure tardive, plusieurs centaines de personnes étaient sur les quais avec des fleurs, des cigarettes, du tabac, des miches de pain pour les frères serbes.
Curieux retour des choses! Il y a vingt-sept ans presque jour pour jour, le 14 novembre 1885, l’armée serbe entrait en Bulgarie; sa droite écrasait les Bulgares à Banskidol; l’émotion gagnait les faubourgs de Sofia. On se portait en masse sur la route de Philippopoli, d’où on attendait le salut, l’arrivée des régiments de Roumélie. L’angoisse était terrible. Le lendemain les Serbes pouvaient envahir Sofia. Un jeune ministre de la guerre, le major Nikiforof, qui n’avait pas trente ans, relevait tous les courages: on tiendrait, on vaincrait! Aujourd’hui c’est un général Nikiforof, curieuse similitude de nom, qui, ministre de la guerre, reçoit en gare de Sofia les régiments serbes amis!
De l’autre côté de la voie un train de mobilisation bulgare est arrêté ; sa musique joue à l’arrivée du train serbe, et c’est dans cette nuit froide un grand frisson à entendre cette petite musique qui martèle l’hymne du pays voisin, hier ennemi, aujourd’hui ami. Les soldats, enfermés dans leurs fourgons depuis le matin, se pressent à l’ouverture des panneaux et demandent: «Où sommes-nous? » On leur répond: «Sofia.» Les acclamations dont on les a salués les ont réveillés; ils roulent depuis si longtemps qu’ils se croyaient au delà de la frontière turque.
Comment le bluff aurait-il pu être poussé jusque-là ? Comment le roi Ferdinand aurait-il osé cette chose décisive, l’entrée des troupes serbes en Bulgarie, si la résolution n’était pas, et depuis longtemps, prise?
Certes, comme je le télégraphiai le lendemain 14, cette note ne constituait pas à proprement parler un ultimatum: la Bulgarie se contentait d’y formuler ses exigences.
Mais comme il est évident que la Porte ne répondra pas, du moins immédiatement, je crois savoir que le cabinet bulgare, ne pouvant admettre un ajournement qui compromettrait l’avance incontestable de sa concentration militaire, demandera, dès lundi soir, ou au plus tard mardi matin, à la Porte, de le fixer sur ses intentions dans un délai de quarante-huit heures. Cette seconde démarche sera le véritable ultimatum, caractère que le mémorandum remis hier n’a pas, du moins dans sa forme et sa terminologie.
Je vous avais donné, dans mon télégramme d’hier, mardi soir comme la date et l’heure décisives; il faut reculer d’un jour; cela n’a d’ailleurs qu’une importance minime, puisque le résultat final est certain: c’est la guerre inévitable.
Ces derniers jours ne seront pas inutiles pour terminer la concentration serbo-bulgare. Dans l’interview publiée par le Temps du 10 octobre, M. Stanciof déclarait, d’après les officiers bulgares, que la concentration totale peut être opérée en dix jours; or elle a commencé le 5 octobre: concluez.
Je crois d’autre part savoir que le cabinet bulgare prépare pour les cabinets et l’opinion publique d’Europe un exposé général historique des relations bulgaro-turques démontrant l’impossibilité d’aboutir à aucun accord et expliquant par des faits les raisons qui ont poussé le ministère, qui avait tout tenté pour arriver à un arrangement avec la Turquie, à modifier complètement sa politique.
Pendant ce temps la Porte rédigeait de son côté une note en réponse à la communication collective des puissances. Cette communication, on se le rappelle, était faite au nom de la France, de l’Angleterre, de la Russie, de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie:
Le soussigné, ministre des affaires étrangères du sultan, a l’honneur de rappeler qu’ainsi que Leurs Éminences veulent bien le constater, le gouvernement impérial a déjà reconnu la nécessité d’introduire les réformes que comporte l’administration des vilayets de la Turquie d’Europe.
Il a envisagé ces réformes avec d’autant plus de conviction qu’il entend les appliquer en dehors de toute ingérence étrangère, et qu’il prévoit que dans ces conditions leur exécution ne manquera pas de contribuer à la prospérité et au développement économique du pays en assurant dans l’esprit libéral de la Constitution ottomane la concorde et la bonne harmonie entre les éléments hétérogènes qui composent la population de cette partie de l’empire.
Il est à relever que si, jusqu’à présent, les différents essais pour l’amélioration de la situation à l’intérieur de ces provinces ne produisent pas tous les fruits qu’on était en droit d’en attendre, une des principales causes de ce retard est incontestablement l’état de trouble et d’insécurité causé par les attentats de tous genres provenant des foyers d’agitation dont le but réel ne laisse aucun doute. Le gouvernement impérial n’en apprécie pas moins l’intention amicale de la communication que les grandes puissances ont jugé à propos de faire, en raison des circonstances présentes.
Il s’associe de tout cœur aux efforts déployés par elles pour conjurer le danger d’une collision dont les conséquences entraîneraient fatalement de grandes calamités, qu’il est du devoir du monde civilisé de prévenir par tous les moyens de conciliation. Sous ce rapport nous avons conscience d’avoir pris les devants pour faciliter la tâche humanitaire des grandes puissances en présence du redoutable problème dont elles cherchent la solution.
En effet, sans vouloir insister sur le fait que les vaines stipulations du traité de Berlin reçurent une exécution non conforme tant à la lettre qu’à l’esprit qui les avait dictées, et qu’ainsi les intérêts ottomans furent gravement lésés en plusieurs cas; sans vouloir en particulier examiner jusqu’à quel point l’article 23 du traité put conserver, plus que les autres articles, une valeur actuelle, le gouvernement déclare qu’il vient de prendre de son propre mouvement la résolution de présenter le projet de loi de 1880 dans tout son ensemble historique, dès l’ouverture prochaine de la session, à l’approbation du Parlement et à la sanction impériale, conformément à la charte fondamentale de l’empire.
Les grandes puissances peuvent être persuadées que les autorités impériales tiendront la main à la scrupuleuse application de la loi dès sa promulgation. Il serait souverainement injuste d’inférer d’anciennes négligences et de tergiversations plus ou moins systématiques, inhérentes à l’autre régime, que l’empire constitutionnel d’aujourd’hui ne renoncerait pas logiquement aux errements passés, et de prendre l’occasion de certains doutes à cet égard pour chercher une autre mesure que celle seule qui est compatible avec l’intérêt bien entendu du pays et des populations mêmes.
Noradounghian effendi faisait ainsi du style à l’adresse des grandes puissances. Quant aux États balkaniques, il les traitait avec dédain. Valait-il la peine de répondre à ces petites puissances, dont l’une était hier encore vassale de l’empire ottoman? On ne leur ferait pas l’honneur d’une contre-note.
Le mardi 15, la Porte rappelait ses ministres de Sofia, Belgrade et Athènes; ce rappel était motivé pour les deux premières capitales par la note des États balkaniques; quant à Athènes, elle était motivée par l’admission des députés crétois à la Chambre hellénique. A propos de la note il s’est produit l’incident suivant à Athènes. Le président du conseil, M. Venizelos, envoya dimanche, par son secrétaire, le mémorandum au ministre de Turquie; celui-ci, après l’avoir gardé trois heures, le renvoya. L’affaire en resta là.
Les événements se précipitent. Le lendemain mercredi, le chargé d’affaires de Turquie quitte Sofia à dix heures du soir, pour Budapest via Belgrade, avec son personnel. La légation de Turquie transmet ses archives à la légation allemande et les intérêts des sujets ottomans seront défendus par le ministre d’Allemagne.
Sofia, 15 octobre.
Le rappel par la Turquie de ses agents change un peu les données du problème. Les gouvernements serbe et bulgare feront état de l’attaque des postes serbes par les troupes turques à Ristovatz et des postes bulgares à Tchoukourkeuï, pour estimer que la Turquie a ouvert les hostilités et a voulu compléter l’état de guerre en rappelant ses ministres; ce qui en effet en droit international n’est pas en soi une déclaration de guerre. Il est donc probable qu’il n’y aura plus d’ultimatum demandant une réponse turque, mais notification que les États balkaniques considèrent l’attitude et les actes de la Turquie comme volonté de faire la guerre.
Le mercredi soir je me suis rendu à la gare pour assister au départ du chargé d’affaires de Turquie. Par le même train partait M. Bobtschef nommé ministre de Bulgarie à Saint-Pétersbourg et qui allait rejoindre son poste. Le train, garé un peu en dehors de la station, était entouré d’un petit groupe de personnes. A l’encontre de ce que l’on m’avait pompeusement annoncé, nul wagon-salon n’avait été mis à la disposition de Moukbil bey et du personnel de la légation de Turquie. Un simple compartiment de première classe leur avait été réservé. Par contre M. Bobtschef avait une couchette dans une voiture de la Compagnie internationale des wagons-lits. Le ministre bulgare était très entouré. Ses collègues l’embrassaient à la mode slave, des dames lui remettaient des fleurs, et le diplomate, dont les traits offraient quelque ressemblance avec ceux de M. Dujardin-Beaumetz, se répandait en poignées de main et en petites allocutions.
Devant le wagon des Turcs, c’était le silence. Quelques correspondants avaient l’élégance de venir tout de même, sous l’œil méfiant des Bulgares, dire adieu à Moukbil bey, un homme jeune, au regard fin, très gentilhomme de manières et d’allures, qui, d’un sourire un peu pincé, regardait les manifestations autour de M. Bobtschef. A un moment donné, M. Franghia, passant devant ce petit groupe solitaire, crut bon de corriger un peu cette impression d’abandon et de froideur. Il s’approcha, et avec sa rondeur toute méridionale tint au chargé d’affaires de Turquie un petit discours rempli d’aménité. «Vous nous reviendrez! Quand on a pris les eaux en Bulgarie on y revient toujours!» Moukbil bey s’inclina en souriant, amusé de ces paroles inattendues en un pareil moment et en de telles circonstances.
Et puis l’heure du départ sonna. Les Turcs montèrent dans leur compartiment, tirèrent les rideaux, et le train s’ébranla vers Belgrade et Budapest pendant que des acclamations saluaient l’homme d’État bulgare chargé de maintenir à Saint-Pétersbourg la cordialité de M. Sazonow pour la cause balkanique.
Le lendemain jeudi 17, il n’y a plus que la procédure de la déclaration de guerre qui soit en question.
Sofia, 17 octobre, 12 h. 10.
Les ministres de Bulgarie, de Serbie et de Grèce, qui n’ont pas encore quitté Constantinople, recevront aujourd’hui le document de déclaration de guerre des États balkaniques. Comme je vous l’avais fait prévoir dans mon télégramme du 15, ce texte énumère les actes d’hostilité de la Turquie contre les États alliés: saisie de bateaux grecs et de matériel serbe; agressions aux frontières bulgare et serbe, dont une nouvelle s’est produite à Mardare et à Prepolatz. La conclusion est celle-ci: «A leur grand regret les États balkaniques sont obligés d’avoir recours aux armes.»
La déclaration sera remise demain matin, vendredi, par les représentants balkaniques conjointement au ministre Noradounghian effendi, et les ministres des États alliés quitteront immédiatement Constantinople.
Tout est fini. Cette crise balkanique à laquelle il n’y a pas quinze jours on ne voyait pas d’issue belliqueuse va se dénouer par les armes.
Pour résumer les impressions de cette quinzaine, je ne puis mieux faire que de reproduire la lettre ci-dessous, écrite le 16 octobre, c’est-à-dire l’avant-veille de la déclaration de guerre.
«Sofia, 16 octobre.
«Ces jours d’attente par lesquels nous venons de passer auront été énervants par leur vide. Nous sentions tellement ici qu’il n’y avait aucun espoir de paix, qu’on s’était lassé de faire quotidiennement visite à des hommes politiques pour leur demander leurs impressions sur la situation, leurs prévisions sur le proche avenir. On n’y allait plus que par acquit de conscience, comme pour ne pas manquer la nouvelle du «miracle» si par un invraisemblable hasard il se produisait.
«Et c’est une sensation étrange, cette attente, qui a plus du malaise que de la fièvre, d’une chose dont nous sommes convaincus sans en être mathématiquement certains. C’est si poignant, si grand, malgré tout, que le cerveau anesthésié se refuse à réagir aux impressions minuscules, à tous ces riens qui sont le pittoresque de la vie. On erre sans comprendre, sans précisions, dans cette ville qui garde une apparence d’animation et qui est immensément silencieuse. On voit par petits groupes, lentement, normalement, des gens qui s’en vont à la promenade du soir vers le grand jardin encore fleuri de roses d’automne, et ils paraissent irréels. On voudrait presque les prévenir que quelque chose d’effroyable se prépare, car certainement ils ne savent pas...
«Et puis ce sont des escouades et des compagnies qui passent toujours sans bruit, les chaussures molles fourrées étouffant les pas sur ce merveilleux pavage de faïence dont Sofia a pris modèle sur certaines villes hongroises. De jour, les soldats ont des fleurs piquées dans le canon du fusil, des fleurs aux boutonnières de l’uniforme. Ils poussent quelques hourras, sur le ton triste des Slaves, renversent le buste en arrière, dans une sorte d’extase. Le soir, ce sont des masses lourdes, énergiques, fatalistes, qui gagnent le quai d’embarquement. Ils vont vers Philippopoli, vers Mustapha-Pacha, vers la plaine d’Andrinople, vers l’immense obstacle de Tchataldja avec un grand rêve dans le cœur.
«Maintenant, quand j’écris, je revois, le soir de mon arrivée ici, les salles d’attente, les couloirs de la gare au milieu de la nuit. Le ministre des chemins de fer m’avait conduit là dans son automobile à travers Sofia endormie, déserte, l’état de siège faisant tout fermer à dix heures. Un train de mobilisation venait de passer. On en attendait un autre; et des centaines de paysans, des retardataires, dormaient par terre. Il y en avait de très jeunes dont le sommeil n’avait pas disjoint les mains unies, sans doute deux frères, ou deux amis du même village, venus comme cela, à la mode orientale, en se tenant par la main jusqu’à Sofia, la capitale d’où l’on partirait pour venger les parents massacrés en Macédoine. Il y en avait des vieux, à barbe blanche, qui avaient accompagné leurs fils, qui avaient peut-être tenté de se faire enrôler et qui demeuraient là, roulés dans d’invraisemblables couvertures, jusqu’à l’aube prochaine, où ils regagneraient appuyés sur leur grand bâton, les hameaux de la montagne. Dans le bureau du chef de gare, le tictac du télégraphe annonçait l’arrivée d’un nouveau train chargé de soldats, et dans le grand silence de la nuit, ce petit bruit saccadé, ce langage mystérieux faisaient passer comme un frisson.
«Et puis dans le kaléidoscope du souvenir le spectacle change. C’est la grande salle du Sobranié avec ses larges tribunes qui regorgent de monde comme les galeries d’un théâtre populaire. M. Guechof vient de parler. Des applaudissements éclatent. Le gouvernement ne faiblira pas. Et là-haut, dans la tribune, une clarté blanche accroche mon regard. Ce sont les larges ailes de mouette d’un chapeau de jeune fille; elle est au premier rang, et rayonnante, elle bat des mains frénétiquement.
«La guerre, pour cette jeune patriote, c’est sans doute une chevauchée glorieuse, une chanson de victoire parmi les étendards déployés. Elle n’en sait pas les agonies et les horreurs.
«Et voici une autre image: un des amphithéâtres de l’Université. Sur le grand tableau noir est restée, inscrite à la craie, la dernière formule du professeur de chimie. Au pied de la chaire, la reine, en robe blanche, distribue leurs diplômes à une centaine d’infirmières. A l’appel de leur nom, elles descendent les gradins, font une révérence devant la souveraine, baisent sa main dégantée et s’en retournent avec leur parchemin et leur insigne. Et sur cette cérémonie pèse je ne sais qu’elle tristesse confuse. Toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles seront demain placées devant des spectacles d’épouvante, et on a pitié d’elles, car elles aussi ne savent pas.
«Alors en pensée l’esprit se reporte à quelques années en arrière, au soir du 13 septembre 1907. Le prince Ferdinand vient d’inaugurer avec le grand-duc et la grande-duchesse Wladimir le monument d’Alexandre II, le tsar libérateur. C’est une statue équestre qui se dresse, comme le Coleoni, sur un haut piédestal. Elle fait face au palais du Sobranié. Cinquante mille personnes ont acclamé le souverain et les membres de la famille impériale de Russie. Des ovations ont eu lieu devant le palais et la légation de Russie. Les manifestants ayant fait allusion à la Macédoine, le grand-duc Wladimir répond, du haut du balcon de la légation de Russie, ce simple mot: «Patience!»
«Aujourd’hui cette patience est à bout; les Bulgares, oubliant toutes leurs querelles avec les Grecs et surtout avec les Serbes vont au combat contre le Turc, l’ennemi héréditaire commun. Et ce sera une rencontre de démons!»