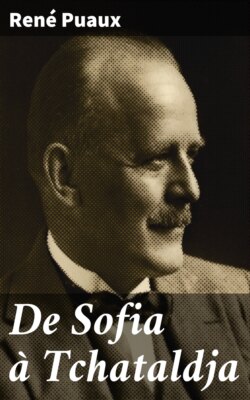Читать книгу De Sofia à Tchataldja - René Puaux - Страница 6
LES ALLIANCES BALKANIQUES
ОглавлениеComment l’Europe avait-elle pu à ce point demeurer dans l’ignorance des projets des États balkaniques et de leur décision? Comment les États balkaniques eux-mêmes, que l’on persistait à croire animés de sentiments hostiles les uns pour les autres, étaient-ils parvenus à conclure l’entente qui allait leur donner la force de vaincre le colosse turc?
Sur ces différents points, je crois qu’il y a quelque intérêt à lire les déclarations que me fit M. Spalaïkovitch, ministre de Serbie à Sofia. Des diplomates et des hommes d’État qu’il m’a été donné de rencontrer dans mes voyages à l’étranger, M. Spalaïkovitch est certainement l’un des plus remarquables. Une haute intelligence, mise au service d’une énergie enthousiaste, donne à l’expression de sa pensée le tour le plus captivant. Élève de l’Université de Paris où sa thèse de doctorat sur la Bosnie-Herzégovine fit sensation, secrétaire à Pétersbourg, secrétaire général au ministère des affaires étrangères de Belgrade, confident et pour ainsi dire exécuteur testamentaire au point de vue politique de Milovanovitch, c’est à lui et au roi Ferdinand de Bulgarie que l’on doit la conclusion de l’alliance serbo-bulgare du 13 mars 1912.
Les déclarations qu’il voulut bien me faire sont lumineuses:
«On se trompe, m’a-t-il dit, quand on attribue des intérêts égoïstes à la détermination des États balkaniques de régler définitivement la question macédonienne. Nous n’avons été poussés que par une grande idée humaine: mettre fin à une situation atroce qui pèse sur la vie nationale de la Bulgarie, de la Serbie, de la Grèce et du Montenegro. Depuis trop longtemps nous avons compris qu’après trente-cinq ans, les espoirs de réformes, venant de la Turquie elle-même ou favorisées par les puissances, étaient également vains. L’Europe ne l’a pas senti. Elle a commis une double erreur: la première de s’y prendre trop tard; la seconde de faire un faux diagnostic sur notre but et nos capacités d’action. Ce n’est pas, il y a trois semaines, quand la mobilisation turque a déclanché notre mobilisation générale; ce n’est pas, il y a trois, quatre ou cinq mois, quand les indiscrétions ont révélé d’abord l’accord serbo-bulgare, puis les résultats de la mission de M. Bochkovitch à Athènes, qu’elle aurait dû se préoccuper du problème balkanique; c’est il y a un an, au lendemain même de la déclaration de guerre italo-turque. Comment, à ce moment, la diplomatie européenne n’a-t-elle pas compris que les États balkaniques, trouvant enfin la situation politique inespérée qu’ils attendaient depuis longtemps, allaient chercher à en profiter pour régler le problème macédonien? Ce délai d’un an a permis à notre union de se réaliser. C’est en un an qu’un homme d’État aussi turcophile et aussi pacifique que M. Guechof a pu être amené à devenir l’un des partisans les plus résolus de l’action armée. Nous avons été longs à réaliser la profonde sagesse de la grande idée politique dont la mort devait empêcher mon regretté maître Milovan Milovanovitch de voir le triomphe: l’union politique de la Serbie et de la Bulgarie. N’était-ce pas lui qui avait écrit que nous devrions travailler pour l’union des Serbes et des Bulgares, si nous ne voulions pas être submergés par les flots de la poussée occidentale? Ne pas comprendre que l’occasion devait forcément réaliser cette union a été la première erreur de l’Europe.
«La seconde erreur a été de continuer à considérer les États balkaniques à travers les lunettes de Gladstone; de ne pas faire le simple calcul que nous étions capables de réunir 700,000 baïonnettes et de mettre 1,500 pièces en batterie. On s’est tellement habitué à l’idée que nous étions les petits enfants de la famille européenne qu’il suffisait de mettre au pain sec ou de réprimander pour les faire tenir tranquilles, que l’on ne s’est pas aperçu que nous avions l’âge d’homme, et jusqu’au dernier moment on n’a pas cru à la réalisation de nos affirmations. Nos mobilisations ont été traitées, très sincèrement d’ailleurs, je crois, de bluff coûteux. C’est une incompréhension totale de la situation. Les grandes puissances ont perdu le sens des politiques nationales que les intérêts matériels ne dominent et ne conduisent pas; elles ont cru qu’au fond de notre agitation il n’y avait qu’une question du partage éventuel de la Macédoine et d’appétits territoriaux. Cette façon d’envisager le problème est si manifestement restée la même jusqu’au dernier moment, qu’on trouve dans la note austro-russe le paragraphe 3 relatif à l’intégrité du territoire ottoman, paragraphe qui, dans l’esprit de ses rédacteurs, devait évidemment, en fauchant en herbe les espoirs qu’on nous attribue, nous forcer à désarmer. On se sera jusqu’au bout trompé. Nous allons faire la guerre, non pas pour le vilayet de Kossovo ou pour Uskub, mais simplement pour délivrer nos frères de Kossovo et d’Uskub d’un cauchemar séculaire, pour anéantir dans ce malheureux pays une autorité malfaisante et criminelle dont il n’est pas d’autre moyen de se débarrasser.
«Nous savons l’impuissance turque vis-à-vis des réformes, et si le ministère actuellement au pouvoir à Constantinople est peut-être bien intentionné, nous savons d’autre part que le comité Union et Progrès, la seule organisation politique de l’empire ottoman, est prêt à le renverser, que c’est le comité qui a dans la main cette gendarmerie macédonienne qui devait garantir la vie et les biens des citoyens, et qui est au contraire le vrai agent de pression électorale, d’exactions et de troubles; et c’est parce que nous savons cela que nous répondons aux puissances qui viennent nous proposer une amélioration du régime de Muerzsteg et une application surveillée de l’article 23 du traité de Berlin, qu’il est trop tard. Quelle que soit, en effet, la bonne volonté des puissances on ne peut pas, à Constantinople, nous donner ce que nous demandons, et nous ne pouvons pas perdre la seule occasion, qui ne nous sera peut-être jamais plus offerte, de venir à bout d’un régime exécré.
«Quel sera l’avenir? Que décideront les armes? Nul ne peut le dire, mais les soldats de nos armées se battront comme des lions, avec des haines et des vengeances dans le cœur. Quand la bataille aura donné son verdict, il sera temps de considérer l’organisation pacifique du pays délivré. Que les puissances, qui n’ont pas su voir avant, sachent comprendre alors les grands intérêts européens qui dicteront leurs actes. Il y va des ententes, car quelle que soit la valeur des accords de pacification dont la démarche conjointe austro-russe vient d’être la preuve, il est certain que les seuls intérêts politiques qui retiennent la Russie en Europe sont les intérêts balkaniques, et une communauté absolue d’action de l’Angleterre et de la France avec la Russie dans les affaires balkaniques est, après la guerre, la seule garantie de l’équilibre sur lequel vit actuellement l’Europe.»
A cet exposé si clair, si prophétique dans certaines de ses parties, je voudrais ajouter quelques détails complémentaires.
C’est bien au moment de la déclaration de guerre de l’Italie à la Turquie, en septembre 1911, que l’idée d’une entente serbo-bulgare s’imposa à Belgrade comme à Sofia.
Le ministre des affaires étrangères de Serbie, M. Milovan Milovanovitch, lança sans plus tarder une circulaire secrète aux puissances de la Triple-Entente: Russie, Angleterre et France, pour déclarer que la situation créée par la guerre italo-turque était de nature à avoir sa répercussion dans les Balkans et que la Serbie, «en cas de complications, était décidée à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts». Le ministre de Russie à Belgrade, M. de Hartwig, qui depuis 1909 travaillait dans cette capitale à l’union des Slaves du sud, attira l’attention de M. Sazonow sur l’importance des événements qui se préparaient. On fit à Saint-Pétersbourg la sourde oreille. On ne pouvait pas, on ne voulait pas croire. A Belgrade, on était cependant décidé à agir vite. Milovan Milovanovitch donna à son représentant à Sofia, alors en congé, M. Spalaïkovitch, les instructions les plus précises. Il devait immédiatement rentrer à son poste pour travailler à l’entente avec la Bulgarie.
L’instant était d’autant plus grave que la Turquie, craignant, elle aussi, une répercussion balkanique de la guerre avec l’Italie, venait de mobiliser en Macédoine; et la question se posait pour la Bulgarie de répondre à cette mobilisation. Il fallait, dans l’esprit de M. Milovanovitch, empêcher la Bulgarie de courir le risque du cavalier seul. Elle devait résister à la tentation de répondre à la mobilisation turque afin de réserver son effort pour plus tard, pour l’heure où, alliés, Serbes et Bulgares seraient de taille à vaincre l’ennemi commun.
Quand M. Spalaïkovitch arriva à Sofia, la situation était très tendue. Le roi était absent, faisant une cure en Autriche; M. Guechof, président du conseil, était également à l’étranger. M. Théodorof, ministre des finances, faisait l’intérim de la présidence. Le conseil des ministres hésitait sur le parti à prendre, quand arriva un télégramme de M. Guechof, demandant à ses collègues de surseoir à toute détermination. Il venait de causer très longuement avec le roi dans la ville d’eaux où il faisait sa cure et il revenait en toute hâte à Sofia.
L’arrivée de M. Guechof dans la capitale bulgare mit toutes choses au point. Le premier ministre était, d’accord avec le roi Ferdinand, décidé à temporiser et à ne pas répondre à la provocation turque. D’autre part, il avait fait route de Budapest à Belgrade avec M. Milovanovitch, et l’homme d’État serbe l’avait converti à ses idées. La négociation du traité d’alliance s’engagea aussitôt entre M. Guechof et M. Spalaïkovitch. Au cours des pourparlers, le président du conseil bulgare rappela à son interlocuteur les incidents qui avaient marqué la signature du traité de paix de Bucarest entre la Serbie et la Bulgarie, en 1884.
«Vous vous souvenez, disait M. Guechof, qu’à ce moment nous avions eu l’idée, car j’étais l’un des plénipotentiaires bulgares, d’intituler le traité : Traité de paix et d’amitié, mais que le roi Milan consulté s’opposa à cette adjonction. J’espère que cette fois-ci je pourrai signer le traité d’amitié.» Et il le signa le 13 mars 1912.
Le cabinet de Saint-Pétersbourg, protecteur naturel des Slaves du sud, connut immédiatement le grand événement politique qui venait de se produire. Londres et Paris en furent avisés. Serbes et Bulgares désormais unis allaient pouvoir maintenant envisager de façon sérieuse les risques et les chances d’une guerre avec la Turquie.
Du moment où les adversaires de la veille, ceux que d’aucuns jugeaient ne pouvoir jamais être autre chose qu’adversaires avaient signé un traité d’alliance offensive et défensive, il ne devait donc pas être impossible d’attirer dans cette union le troisième ennemi de la Turquie dans les Balkans: la Grèce.
Les démarches engagées avec Athènes dès le lendemain de la signature de l’accord serbo-bulgare eurent un succès rapide. Dès le mois d’avril la Grèce entrait dans la combinaison.
Il ne restait plus qu’à choisir le moment et l’heure.
Comme il appert des déclarations de M. Spalaïkovitch que j’ai reproduites plus haut, la guerre italo-turque avait été une des raisons déterminantes de l’accord. Si les États balkaniques devaient avoir quelque chance de vaincre les Turcs, c’était au moment où ceux-ci, engagés dans une lutte qui les occupait ailleurs, ne pourraient mettre en ligne contre des adversaires nouveaux qu’une partie de leurs forces.
On comprend dès lors avec quel intérêt on suivit à Belgrade, Sofia et Athènes les tentatives médiatrices des puissances et ultérieurement les négociations d’Ouchy. Turcs et Italiens allaient-ils s’entendre avant que les alliés balkaniques aient eu le temps d’organiser leur offensive, de préparer complètement l’action militaire qui déciderait de l’avenir des peuples balkaniques et de la libération de la Macédoine?
Les échecs successifs des tentatives de la diplomatie russe furent à ce point de vue rassurants; mais lorsque parut la proposition Berchtold, l’inquiétude gagna Sofia et Belgrade. Sous sa forme généreuse et un peu vague d’intervention auprès de la Porte en faveur de la décentralisation en Turquie d’Europe, le ministre des affaires étrangères de la monarchie dualiste n’avait-il pas le but secret d’intervenir uniquement en faveur de l’Albanie, colonie morale de l’Autriche? Les tendances du Ballplatz étaient connues, c’était la lente marche vers le sud, les projets sur le sandjak vers Salonique, le désir secret d’une Macédoine autrichienne dont l’Albanie, déjà autrichianisée, ne serait qu’un complément.
Comment pouvait-on ignorer l’extension prise par l’influence autrichienne jusque dans la sphère sud de l’Albanie, sur laquelle l’Italie estimait avoir des droits de par l’accord de 1897? Au su de tous, cette influence s’exerçait par l’intermédiaire du clergé, qui gagnait peu à peu tous les Albanais catholiques à la cause autrichienne.
Toute l’organisation catholique albanaise ressortit aux trois archevêchés de Scutari, Durazzo et Uskub. Ces archevêchés ont respectivement 30,000, 13,000 et 16,000 fidèles. Un grand rôle dans la vie catholique de l’Albanie et un plus grand rôle encore dans la propagande autrichienne parmi les Mirdites sont joués par l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Alexandre, à Oroschi, sécularisée depuis et érigée en 1888 en un siège de nullius diocesis, c’est-à-dire existant en dehors de l’organisation épiscopale. Elle étend son influence sur 16,000 catholiques albanais; le chef de cette puissante organisation de propagande autrichienne est Mgr Doczi, d’origine hongroise, très influent à Rome et à Vienne. Mgr Doczi, abbas nullius in Mirdita, qui est souvent à Scutari d’Albanie, où il possède une seigneuriale résidence, peut être considéré, avec les consuls autro-hongrois de Scutari et de Durazzo, comme le grand trait d’union entre les Albanais et le Ballplatz.
En dehors du clergé séculier, l’ordre des franciscains joue et a toujours joué, comme en Bosnie-Herzégovine, le rôle de grand conservatoire de la propagande de la foi catholique en Albanie; les couvents de Scutari, Troschani, Castrati, Rotti, Gruda, Triepchi, Selza, Vukati, Poulati, Schoschi, Plante, Nikaj, Aranza et Kiri, Douchmani et Schelja, pauvres, il est vrai, exposés à toutes les privations, occupés chacun par un seul moine, n’en sont pas moins autant d’agences de l’influence autrichienne. Il n’y a plus aujourd’hui beaucoup d’étrangers dans le clergé albanais; dans les temps passés les prêtres étaient envoyés directement de Rome par la Propaganda fide au grand bénéfice de l’influence italienne; mais aujourd’hui presque tous sont des Albanais qui reçoivent une première éducation au séminaire des jésuites autrichiens, à Scutari d’Albanie, d’où ils partent ensuite, pour parfaire leurs études, en Autriche: Innsbruck, Salzbourg, Villach, Klagenfurth. Le clergé régulier, qui se compose presque sans exception de franciscains, se recrute également parmi les Albanais; il est formé à la maison mère des franciscains, à Scutari d’Albanie.
L’Autriche, ayant d’office le protectorat des catholiques albanais, subvient à l’entretien de tout le clergé : chaque curé reçoit, viâ Scutari, du Ballplatz une subvention de six cents couronnes par an. Protecteurs officiels des catholiques albanais, les représentants de l’Autriche-Hongrie ont pu largement utiliser ce droit qui leur est conféré par les traités internationaux, et nombreux sont les millions qui ont passé du Ballplatz en Albanie, par les mains de Mgr Doczi et des consuls autrichiens de Durazzo et de Scutari.
Quant au caractère de la propagande autrichienne, et c’est là le secret de son succès, elle n’essaye point de déraciner les vieilles mœurs des peuples sur lesquels elle veut étendre le pouvoir impérial et royal. En Albanie comme ailleurs, elle ne parle pas aux Albanais de leur décadence morale, elle ne demande que l’amitié des intrépides
«Skipetars» qui ont combattu l’orthodoxie slave au sud comme elle a lutté de son côté contre le même ennemi au nord et à l’est.
C’est depuis 1857 environ que les consuls et envoyés spéciaux autrichiens parcourant l’Albanie font preuve d’un grand esprit de suite et d’infiniment de tact dans leur propagande. Aujourd’hui les missionnaires catholiques, bien choisis parmi les indigènes, sont devenus de très perspicaces propagateurs de l’influence autrichienne; ils ne parlent jamais aux Albanais de projets d’avenir, ni de monarchie: les livres qui se publient à Vienne sur l’Albanie sont, de même, muets à cet égard et ne quittent pas le style descriptif, mais les uns et les autres n’omettent jamais, un toute occasion, de faire le panégyrique de l’empereur François-Joseph, de ses constants soucis et de son affection désintéressée à l’égard des Albanais.
L’Europe allait-elle tomber dans le piège que lui tendait le comte Berchtold? Allait-elle travailler à cette décentralisation de l’Albanie pour le seul bénéfice de l’Autriche, dont elle encouragerait les espérances plus vastes en Macédoine au détriment des Slaves des Balkans?
Il y avait enfin pour les cabinets de Sofia et de Belgrade une troisième raison de précipiter les événements. Malgré les encouragements que M. Sazonow avait prodigués à ses agents dans ces deux capitales en faveur de l’union des Slaves du sud, on n’était pas sûr de l’assistance indéfinie de Saint-Pétersbourg. On craignait que le comte Berchtold ne pût reprendre à son compte les idées du comte d’Æhrenthal après l’annexion de la Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire dorer, d’une amitié reprise, la pilule que M. Isvolski avait dû avaler, et faire oublier à la Russie l’échec de sa diplomatie en lui tendant, après, une main cordiale et qu’il ne parvînt à séduire M. Sazonow et à le détourner de sa politique balkanique.
Il ne fallait donc ni laisser la paix italo-turque se conclure, ni permettre le succès de la politique albanaise du Ballplatz, ni surtout, enfin, donner le temps à Vienne de détourner Saint-Pétersbourg de ses devoirs panslaves.
Comme le disait M. Spalaïkovitch, les alliés balkaniques «ne pouvaient pas perdre la seule occasion, qui ne leur serait peut-être jamais plus offerte, de venir à bout du régime turc en Macédoine».
Quand on envisage la situation à la clarté de ces raisons majeures, on comprend que le roi Ferdinand, auquel un de ses confidents parlait dans la première semaine d’octobre de l’action pacificatrice des puissances, se soit contenté de lever la main en murmurant: «Trop tard!»