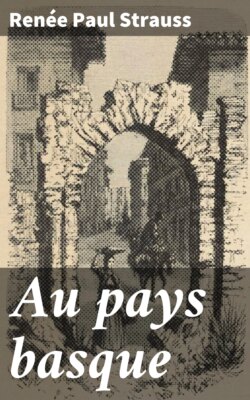Читать книгу Au pays basque - Renée Paul Strauss - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE DÉPART. — JOURNÉE EN CHEMIN DE FER MICHEL TROUVE UNE AMIE
ОглавлениеLE lendemain matin, de très bonne heure, Michel et ses parents étaient prêts à se rendre à l’hôpital. Mme Anaïs, justement libre ce matin-là, s’était proposée pour garder la boutique, la petite employée étant occupée à livrer les commandes. Pour tout bagage, Michel avait une boîte en bois blanc, fermant à clef, dans laquelle il avait mis les quelques bibelots dont il ne voulait pas se séparer: un couteau-canif en nacre qui lui avait été donné au jour de l’an, un jeu de jonchets, un jeu de cartes et quelques images. L’Assistance Publique se charge d’habiller les enfants au Sanatorium et ils ne peuvent rien emporter en fait de vêtements. Le rendez-vous était pour neuf heures, aux Enfants-Malades, et, à neuf heures moins dix, Michel, escorté de ses parents, franchissait la porte de l’hôpital. Un grand omnibus, destiné à conduire le convoi à la gare, stationnait devant cette porte. M. et Mme Lefort, après avoir attendu une demi-heure avec Michel, le quittèrent pour se rendre au chemin de fer afin de le revoir une dernière fois. Michel, lui, devait partir avec le chef du convoi, l’interne, deux infirmières et une quinzaine d’enfants. Le reste des petits voyageurs, envoyé par l’hôpital Trousseau, les retrouverait à la gare. A dix heures moins un quart, l’employé de l’Assistance Publique chargé de conduire les enfants à Hendaye et de les en ramener, arriva. Il se nommait M. Gervais. C’était un homme de quarante-cinq à cinquante ans, à l’œil bon et paternel, qui savait se faire aimer des enfants et les apprivoiser. Un vrai papa gâteau; il avait toujours quelques bonbons au fond de ses poches pour consoler son petit monde. Après avoir fait l’appel des enfants et constaté qu’il en manquait un, probablement un bébé malade au dernier moment et dans l’impossibilité de supporter la longueur de la route, on les fit monter en omnibus. A chaque voyage, c’est-à-dire chaque mois, M. Gervais était accompagné de deux infirmières et d’un interne. Ils partaient régulièrement le premier mardi du mois, à onze heures, pour arriver à Hendaye le lendemain matin, à cinq heures. Ils repartaient, en reprenant toujours une trentaine d’enfants, le jeudi soir, à onze heures, et ils étaient à Paris le lendemain, à cinq heures de l’après-midi. Bien que le déplacement fût extrêmement fatigant, c’était une joie pour les infirmières et l’interne de faire cette excursion et les demandes affluaient. En somme, s’ils avaient une surveillance continuelle à exercer sur les enfants, ils étaient libres pendant les deux jours qu’ils passaient à Hendaye et pouvaient visiter toute la- région. Les deux omnibus arrivèrent en même temps à la nouvelle gare du quai d’Orsay. On plaça les enfants en rang et la petite troupe fut conduite au train. L’Assistance Publique possède un wagon qui fait successivement tous les mois le service entre Paris et Berck et entre Paris et Hendaye. Dans l’intervalle, on le remise à Boulogne-sur-Mer. Cet énorme wagon se compose de deux compartiments communiquant entre eux par une porte placée au milieu, l’un de sept places, pour M. Gervais et l’interne, l’autre aménagé pour les trente enfants et les deux infirmières. Le soir, le wagon se transforme en sleeping et les enfants peuvent s’étendre; ils ont chacun un oreiller et une couverture. Les filles sont d’un côté, les garçons de l’autre, les plus grands au-dessus, les plus petits en bas. A l’extrémité de ce compartiment, se trouvent les water-closets et un office où un réchaud à gaz est installé et permet de chauffer quelque chose au besoin. Chaque hôpital envoie la nourriture des enfants pour la journée. Le menu comprend des œufs durs, de la viande froide, du fromage et des fruits suivant la saison.
L’installation des enfants prit une bonne demi-heure. On assigna à chacun sa place. Les banquettes pour deux enfants sont séparées par un grand couloir qui permet d’aller et venir. Au-dessus de chaque banquette se trouve un filet pour déposer les légers bagages. Michel était placé au centre du wagon, près de la vitre.
A côté de lui, trois enfants très jeunes et, derrière lui, une rangée de filles. M. et Mme Lefort, sur le quai de la gare, sollicitèrent de M. Gervais l’autorisation de rester avec leur fils jusqu’au moment du départ du train. M: Gervais, en voyant le chagrin de la mère, leur accorda par une faveur spéciale de monter avec leur fils jusqu’au coup de sifflet. Michel se blottit alors dans les bras de sa mère et retint à grand’peine ses larmes prêtes à couler. Son grand chagrin redoubla en voyant se mouiller les yeux maternels. Son père, lui, s’était promis d’être courageux, mais il avait. la gorge. sèche et ne pouvait prononcer une parole. Le temps passait vite; il fallut se séparer; M. Lefort arracha difficilement la mère des bras de son fils; ils descendirent et quittèrent le quai sans se retourner, ne voulant pas voir le train qui filait à toute vitesse, laissant derrière lui un panache de fumée. Michel ne pensait qu’à son chagrin, les mains devant ses yeux, il laissait couler ses larmes avec abondance, mais silencieusement. Il se sentait si seul et si malheureux! Une demi-heure se passa sans qu’il donnât aucune attention au paysage, sans qu’il s’occupât de ses compagnons de route. Après un instant, son mouchoir étant trempé, il se leva pour en prendre un autre dans sa boîte et il remarqua, à genoux sur la banquette placée derrière lui, une fillette tournée de son côté et qui fixait sur lui le feu de deux prunelles noires. Dans cette petite figure pâlotte entourée de cheveux coupés courts ainsi que l’ordonne l’Administration, on ne voyait, pour ainsi dire, que des yeux brillant d’un sombre éclat et largement fendus sous des sourcils qui avaient l’air d’être faits au charbon tant ils étaient noirs.
Les mains devant ses yeux, Michel laissait couler ses larmes.
«Pourquoi pleurez-vous?» demanda la petite fille, et les yeux noirs compatissaient déjà au chagrin de Michel.
Ce dernier ne put prononcer un mot tant ses sanglots redoublèrent.
«Vous avez donc un gros chagrin, continua la petite voix douce. Oh! dites-le-moi, cela soulage.» Et sans se fâcher du silence de Michel: «Moi, je confie toujours mes chagrins à Fatma. C’est vrai, vous ne connaissez pas Fatma? Fatma, c’est mon chien, là seule chose que je possède. Figurez-vous un petit chien tout noir avec deux petites taches jaunes sur les yeux et, avec cela, des pattes fines aux extrémités également jaunes. C’est Fatma que j’aime le mieux au monde et j’aurais été si contente de l’amener avec moi. Avez-vous laissé aussi un chien chez vous? C’est peut-être pour cela que vous pleurez.
— Je n’ai pas de chien, articula enfin Michel sanglotant toujours.
— Un chat alors?
— Non, pas de chat.
— Un perroquet? une perruche?»
Michel se contenta de secouer la tête.
«Alors, qu’avez-vous?
— Maman, maman.» Et les larmes de Michel coulèrent plus abondamment.
«C’est à cause de votre maman que vous pleurez, dit la fillette étonnée; c’est donc bien bon une maman?
— Vous n’en avez donc pas? dit Michel surpris à son tour.
— Non, fit-elle, un peu honteuse, ni maman, ni papa.
— Et avec qui demeurez-vous?
— Avec une cousine qui m’a prise chez elle à la mort de mes parents. J’avais un an à cette époque-là et je ne me rappelle plus de rien.
— Et cela ne vous fait rien d’avoir quitté votre cousine?
— Ma cousine? mais elle me bat comme plâtre et je ne suis jamais si contente que lorsque je la quitte. C’est la deuxième fois que je vais à Hendaye. J’y étais il y a deux ans et, si ce n’était pas Fatma, je serais ravie d’y retourner. Si vous saviez comme on s’amuse là-bas et à quelles bonnes parties l’on se livre! Puis, lorsque je suis revenue, j’étais complètement guérie, mais il paraît que ma tante (c’est ma cousine, elle exige que je l’appelle ainsi) ne me nourrit pas assez bien, c’est le docteur qui l’a dit et je suis vite retombée malade. Ma tante a fait alors les démarches nécessaires pour que je retourne au Sanatorium, c’était surtout pour se débarrasser de moi, mais il paraît que c’est très difficile d’y être envoyé une seconde fois et ma tante n’a pu l’obtenir qu’après trois mois et parce qu’elle connaissait notre conseiller municipal qui m’a recommandée chaudement à la commission. Je serais tout à fait contente si j’étais sûre que Fatma fût bien nourrie. Mais hélas! lorsque j’étais à Paris, j’étais obligée de lui donner sur ma nourriture. Alors, si elle mourait de faim!» Et les beaux yeux s’assombrirent. Michel, intéressé parce charmant babillage, commençait à oublier son chagrin et ses larmes cessaient de couler.
«Comment vous appelez-vous, dit-il?
— Mariette Tully.
— Quel âge avez-vous?
— Dix ans. Et vous, quel est votre nom?
— Michel Lefort et j’ai douze ans, dit-il avec un air de supériorité.
— Eh bien, Michel, si vous voulez, nous serons amis. Je vous parlerai de Fatma et vous me parlerez de votre maman. Elle est gentille pour vous, votre maman?
— Ma maman, dit Michel, avec de nouvelles larmes dans les yeux, c’est la meilleure maman du monde. Si vous saviez comme elle est bonne et comment elle m’embrasse,» continua Michel en éclatant en sanglots.
Mariette, comme une vraie petite femme, comprit qu’il ne fallait pas parler à Michel de sa mère en ce moment pour ne pas renouveler son chagrin, et changea immédiatement de sujet de conversation.
«C’est entendu, nous serons amis; n’est-ce pas?
— Convenu,» dit Michel gravement en lui tendant la main.
Mariette mit sa petite main aux doigts effilés dans celle de Michel et c’est ainsi que le pacte fut conclu. Michel se sentait moins seul maintenant qu’il savait que quelqu’un s’intéressait à lui et cela lui faisait du bien de contempler la petite mine éveillée et intelligente de sa nouvelle amie. Il s’intéressa alors aux endroits qu’ils parcouraient et tous deux regardèrent le paysage qui se déroulait très vite devant eux. Mariette, ayant déjà fait le voyage, connaissait la route et nommait chaque ville avec une mémoire surprenante.
«Oh! moi, dit-elle à Michel, à l’école, je n’ai jamais pu me mettre, la géographie dans la tête, il faut que je passe dans un pays pour le connaître. Alors, c’est fini, je ne l’oublie plus.»
Et les enfants s’amusèrent à regarder par la portière, essayant de lire les noms des stations devant lesquelles le train passait à toute vapeur; de jolis détails, à peine entrevus, frappaient leurs regards: le viaduc de l’Yvette, la tour de Montlhéry.
Le temps passait, les stations s’égrenaient le long de la voie. A midi quatre minutes, le train s’arrêta deux minutes à la gare d’Étampes, assez pour qu’on aperçût un étrange monument, la tour Guinette, dont la vue évoque tant dé souvenirs: le château des quatre tours, des batailles, des sièges fameux.
Le train se remit en marche et passa entre de jolies terrasses, traversa des viaducs, pour atteindre enfin, d’un vigoureux effort, le plateau de la Beauce, élevé de plus de 145 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Dès lors, changement à vue de paysage; le panorama n’est plus le même; les habitations, les jardins se font rares. Aussi loin que l’horizon s’étend, on ne voit, au début de l’été, que des forêts d’épis, d’interminables champs de blé, de seigle, d’avoine, de chanvre.
C’est la Beauce, le grenier de la France, la terre féconde en céréales.
Nos petits amis, fatigués de ne plus voir qu’une plaine immense où les arbres et les habitations étaient en petit nombre, abandonnèrent la vitre et s’assirent à leurs places. Du reste, l’heure du déjeuner avait sonné depuis longtemps et les infirmières distribuèrent, en commençant par les plus petits, les œufs durs et le pain. Michel n’avait pas très faim et, de plus, n’aimait pas beaucoup les œufs, mais Mariette trouvait tout délicieux et c’était un plaisir de la voir enfoncer ses petites quenottes dans le jaune de l’œuf. Sa bouche était toute barbouillée et Michel riait en la regardant. On leur donna ensuite à chacun une tranche de viande, du fromage, puis un abricot. Toute la bande commençait à s’apprivoiser, le déjeuner avait délié les langues et des groupes sympathiques se formaient. Mariette, moins timide que son nouveau petit ami, obtint de l’infirmière de changer de place et de se mettre à côté de Michel. Elle lui racontait d’une manière intarissable les prouesses de Fatma et Michel était charmé de son gentil babillage. En passant aux Aubrais, ils aperçurent de loin Orléans, ville illustrée par Jeanne d’Arc; ils eurent ensuite le spectacle des plaines de l’Orléanais, si différentes de. la Beauce, boisées, verdoyantes, embaumées. Et bientôt, leur distraction favorite fut de regarder la Loire qui à l’air de se cacher derrière un rideau de peupliers. Çà et là, des îles.
Vue de la Loire.
A Beaugency, Michel fit remarquer à Mariette qu’ils traversaient un magnifique viaduc en pierre et aussitôt après avoir quitté la gare, on franchit un autre viaduc. Un peu au delà, on sort du département du Loiret pour entrer dans celui du Loir-et-Cher. Ils passèrent à Blois où se trouve un château historique, célèbre dans les fastes de l’histoire de France, et à peu de distance, le beau château de Chambord. Le pittoresque ne les quittait pas; leur curiosité ne se lassait pas de voir la Loire, toujours la Loire, avec sa bordure d’arbres, de châteaux, calme et reposante, admirable et forte en son parcours fécond.
Lorsqu’ils arrivèrent à Amboise, où Mlle de La Vallière vit le jour, Michel s’empressa de montrer sa jeune science à sa nouvelle amie; il lui raconta, telle qu’il se la rappelait tant bien que mal, la fameuse conjuration d’Amboise sous le règne de François II. Mariette n’avait jamais entendu parler des Guises et elle était émerveillée des connaissances de son compagnon de route.
Le passage à la gare de Tours leur laissa le regret de ne pas visiter la ville dont Mariette avait entendu l’éloge fait par une amie de sa tante. En traversant le Cher, Michel était émerveillé et la vue du bassin du Cher et de la Loire les enchanta.
Bientôt, un autre coup d’œil les distrayait: à la sortie de tranchées monotones, le magnifique viaduc de l’Indre.
A quatre heures, chaque enfant eut un morceau de pain et une tablette de chocolat, et le goûter les fit tenir tranquilles pendant une petite demi-heure. Ce ne fut qu’un court arrêt et M. Gervais, qui, de temps en temps, entr’ouvrait la porte, ne put obtenir le silence. Ils parlaient tous à la fois et étaient ravis du voyage. Seuls, quelques marmots ne cessaient de réclamer leurs mamans et se faisaient entendre au milieu de ce tapage incessant. Michel et Mariette jetèrent un vague regard sur Poitiers et de suite après Angoulême, ils s’installèrent pour le dîner. Le menu était le même qu’au déjeuner et, comme ils étaient las, ils mangèrent de moins bon appétit. Michel, à mesure que le soir approchait, songeait à sa mère et Mariette ne parvenait pas à le distraire. Elle-même commençait à ressentir la fatigue du voyage et aussitôt le dîner terminé, elle s’assoupit dans son coin. Michel, bien que fatigué aussi, n’avait pas envie de dormir, il pensait à la vie qui l’attendait là-bas avec l’épouvante que vous donne toujours l’inconnu. Il aurait voulu dormir de longs mois et se réveiller à Paris, guéri. L’interne, en ce moment dans le dortoir, attiré par sa figure intelligente, s’approcha de lui et lui demanda s’il s’ennuyait.
Bordeaux.
«Oh! oui! monsieur, répondit-il, je voudrais bien être à Paris.
— Comment, un grand garçon comme toi, tu n’es pas plus courageux. Tu devrais être très content de voyager et de voir de beaux pays. Que feras-tu quand tu seras grand?
— Jusqu’à présent, je voulais être marin, mais aujourd’hui, je n’en ai plus envie; j’ai trop de chagrin d’avoir quitté ma mère.
— C’est un bien beau métier, mais connais-tu la mer?
— Non, monsieur, pas encore.
— Eh bien, tu devrais être content, tu vas la voir et en la contemplant, tu jugeras si tu persistes dans ta vocation de devenir marin. Voyons, il faut être raisonnable. Donne-moi ta main. Tu te fais du mauvais sang et tu as un peu de fièvre. Plus vite tu guériras, plus vite tu retourneras à Paris. Pense un peu au retour, quand ta maman te reverra si grand qu’elle aura de la peine à te reconnaître! Tu seras alors un vrai petit homme,» continua l’interne. Il se leva et passa à un autre.
A dix heures, le train arrivait à Bordeaux où il devait s’arrêter une heure un quart. Michel regretta que la nuit l’empêchât d’admirer la quatrième grande ville de France. Il savait que Bordeaux, situé sur la Gironde, possédait un port important. Il eut beau écarquiller les yeux dans l’obscurité, il n’aperçut qu’une quantité prodigieuse de petites lumières qui avaient l’air de danser, vues du train. Depuis plus d’une heure déjà, on avait transformé le compartiment en dortoir et Michel se trouvait placé en haut, à côté de Mariette qui, elle, dormait profondément. Il s’amusa à regarder l’extrême animation qui régnait dans la gare. Les employés se frayaient difficilement un passage à travers les nombreux voyageurs qui se tenaient debout sur le quai. Les camions à bagages manquaient de les heurter à chaque instant et c’est grâce à l’agilité des hommes d’équipe qui les poussaient avec tant d’adresse qu’aucun accident ne se produisait. Une petite voiture circulait continuellement, chargée d’oreillers et de couvertures, pendant qu’un garçon de café se montrait aux portières muni d’un plateau rempli de bocks. Un gamin courait aussi en criant les journaux du soir: La petite Gironde, La France du Sud-Ouest, les dernières nouvelles du monde entier. Tout ce vacarme plaisait à Michel et il ne songea à dormir qu’en quittant Bordeaux. De Paris à Bordeaux, on est sur le réseau de la compagnie d’Orléans; de Bordeaux à Hendaye, sur celui de la compagnie du Midi. Michel et Mariette se réveillèrent tous deux en entendant crier: «Bayonne, quinze minutes d’arrêt», avec un accent traînant très prononcé. Ils se regardèrent un peu ahuris de se trouver tous les deux dans ce wagon. Ils étaient encore sous l’impression du sommeil et ils eurent besoin de quelques minutes pour rassembler leurs souvenirs. Ce fut Mariette qui, la première, tendit la main à Michel en lui souhaitant le bonjour. Michel se rappela sa nouvelle amie et prit sa petite main. Presque tous les enfants ainsi que les infirmières dormaient encore et nos deux amis se mirent de nouveau à la vitre pour admirer le paysage. Les arbres étaient plus verts, l’eau était plus limpide sous le jour qui commençait à poindre. Le chemin de fer ne tarda pas à franchir l’Adour sur un pont métallique assez original avec sa voie ferrée et sa route de terre. La ville et ses remparts, l’Adour, frappent le regard par leur étrangeté. Un tunnel dissipe le charme et fait passer les voyageurs dans une région différente. Michel et Mariette aperçurent de loin le petit lac Marion, si tranquille, dont les arbres touffus qui le bordent se reflétaient dans son onde pure. Biarritz, ou plutôt la Négresse, la gare qui dessert Biarritz, ne se trouve qu’à un quart d’heure de Bayonne. Là, beaucoup de voyageurs descendirent et le train eut un léger retard par suite de l’affluence des bagages à décharger. On n’apercevait pas encore la mer, mais elle se faisait déjà sentir et Mariette fit remarquer à Michel que l’on avait du sel marin sur les lèvres. Le train se remit enfin en marche et après avoir traversé le tunnel de la Négresse, Michel jeta un cri d’admiration. A gauche, sur un coteau, les maisons éparses de Bidart, premier village basque, dominaient une grande nappe d’eau agitée, aux reflets changeants; c’était la mer. Mariette jouissait de la surprise de Michel et partageait son émerveillement. Puis ils passèrent à Guétary, avec ses maisons blanches aux volets rouges et verts. Le chemin de fer traversait d’exquises vallées et des sentiers délicieux semés d’aubépines. Au milieu de tranchées, par-dessus les ravins, la route se poursuit, avec des échappées sur la mer, la vue de petites baies étrangement découpées près desquelles on aimerait à se reposer. Le train stoppa à Saint-Jean-de-Luz, la dernière station avant Hendaye. On avertit les enfants de se préparer; dans un quart d’heure on arriverait. Michel et Mariette, déjà prêts, continuèrent à regarder la route et le splendide panorama qui se déroulait devant eux. Après la traversée de la Nivelle sur un pont de trois arches, le chemin de fer finit par longer la mer. Urugne apparaît; ensuite, un tunnel franchi, on entre dans la vallée de la Bidassoa. Mariette montra à Michel le Sanatorium, très gai avec ses toits rouges tranchant sur cette mer très bleue; puis, de l’autre côté, la Bidassoa et ses bancs de sable; on voit aussi la terre d’Espagne, le cap du Figuier qui s’allonge dans la mer. Michel fut tiré de ses ébahissements par l’arrêt du train qui arrivait en gare d’Hendaye, terme de son premier voyage.