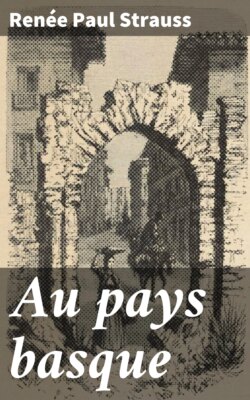Читать книгу Au pays basque - Renée Paul Strauss - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ARRIVÉE A HENDAYE.— PREMIÈRE LETTRE DE MICHEL. PREMIÈRE JOURNÉE AU LAZARET
ОглавлениеEN descendant du train, le convoi fut reçu par le Directeur du Sanatorium qui attendait tout ce petit monde sur le quai de la gare. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, à la physionomie douce; on devinait de suite qu’il aimait les enfants. Du reste, il était adoré de tout le Sanatorium, aussi-bien des petits que de son personnel. Il dirigeait l’établissement avec une maîtrise remarquable et l’administration de l’Assistance Publique l’appréciait à sa juste valeur. Il était à Hendaye depuis la fondation du Sanatorium et avait beaucoup contribué au succès de la nouvelle colonie. Connaissant admirablement, non seulement la langue espagnole grâce à des séjours prolongés en Espagne, mais aussi le basque qu’il parlait couramment, il était avantageusement connu dans le pays et était parvenu à s’y faire aimer. Nul mieux que lui n’achetait à meilleur compte les provisions nécessaires pour la nourriture de la maison. Le Sanatorium possède deux cents pensionnaires, plus le personnel, cela fait tous les jours deux cent cinquante personnes environ à nourrir. Tous les habitants de la région sont ravis du voisinage du Sanatorium, ce qui leur permet d’y écouler la plupart de leurs marchandises. Le boucher tue spécialement pour l’établissement, car il est obligé de lui livrer plus de cinquante livres de viande par jour.
Le Sanatorium, situé à l’extrémité de la plage, se trouve à quatre kilomètres de la gare. Un énorme omnibus attendait devant la station pour emmener les enfants et les infirmières. M. Gervais et l’interne montèrent avec le Directeur dans sa voiture, une petite charrette jaune traînée par une vieille jument. Les enfants, après ces dix-huit heures de voyage, étaient bien fatigués; malgré cela ils écarquillaient les yeux et se montraient ravis de respirer un peu d’air frais et pur. Le soleil s’était levé et faisait resplendir les montagnes environnantes. Aussitôt la première côte franchie, les plus grands jetèrent tous un cri d’admiration en voyant la large baie de la Bidassoa qui s’étendait très loin jusqu’à la pointe du Figuier. A gauche, Fontarabie se dressait majestueuse, surmontée de son léger clocher. La ville, coquettement campée au-dessus des flots bleus de la Bidassoa, avait de loin un aspect artistique. Mais ce n’était qu’une échappée et, après avoir traversé le pont du chemin de fer, l’omnibus entra dans le village d’Hendaye. Une longue rue étroite, dont l’extrémité s’en allait en pente très raide, laissait apercevoir Fontarabie dans le lointain. Avant le raidillon, les voitures prirent à gauche et, quelques pas plus loin, le même panorama apparut de nouveau. La Bidassoa forme là un véritable estuaire et la plage d’Hendaye, au loin, a l’air de rejoindre le cap du Figuier, tant cette étroite bande de terre entre deux mers paraît longue. Et pendant deux kilomètres, la route tourne et l’on a devant les yeux cet admirable et imposant spectacle. Après que l’omnibus eut fait un demi-tour à droite, le coup d’œil changea. D’abord, d’un côté des dunes de sable et de l’autre de riants vallons; puis enfin, la vue de la pleine mer et celle de la plage dominée par le Sanatorium et terminée par les Deux-Jumeaux ou rochers de Saint-Anna, qui ont l’air d’avoir été posés là tout exprès à la frontière de France. Baignés complètement lorsque la mer est haute, à marée basse on peut en faire le tour à pied sec. Sur le plateau qui se termine au cap Saint-Anna, au delà du Sanatorium, sont situés le château et la parc d’Arragory, ancienne résidence de Mme d’Abbadie, occupée actuellement par des astronomes, la propriété ayant été léguée à l’Institut. Sur ce plateau, au bord de la mer, des bouquets de sapins jettent une note gaie sur tout ce fond et les arbres se détachent très verts entre la mer et le ciel si bleu. L’omnibus, après avoir franchi une légère côte, entra dans la cour du Sanatorium par une grande porte de bois couverte d’un petit toit de briques rouges surmonté d’une longue flèche. Sur cette porte, cette inscription: Administration générale de l’Assistance Publique de Paris; puis au-dessous: Sanatorium d’Hendaye. Une petite entrée est réservée aux piétons. A droite, le pavillon du concierge; à gauche, le Lazaret. Le Sanatorium se compose de six pavillons. Tous les six, situés à gauche, ont vue d’un côté sur la mer, de l’autre sur la montagne. Le premier est le Lazaret. C’est là que les enfants, après leur arrivée, séjournent presque un mois. Ils n’ont aucune communication avec les autres de crainte de la contagion. Quelques jours avant l’arrivée du convoi mensuel, on les installe définitivement et le pavillon est alors nettoyé et désinfecté. Le second pavillon est l’infirmerie. Les quatre autres, qui comprennent réfectoires, dortoirs, salles de jeux et de classe, cuisine, lingerie, sont reliés ensemble par des galeries vitrées. Les filles sont séparées des garçons. Les deux sexes ne sont réunis qu’au Lazaret et à l’infirmerie. Les enfants descendirent de voiture et furent immédiatement confiés aux infirmières d’Hendaye. Celles de Paris avaient fini leur service et elles étaient libres jusqu’à leur départ; elles avaient donc deux jours de vacances. En partant, elles ramenaient les enfants guéris, désignés pour être rendus à leurs parents. Une tasse de chocolat fumant attendait chaque enfant; c’était la première fois qu’ils absorbaient un aliment chaud depuis vingt-quatre heures et cette collation fut accueillie avec enthousiasme. Bientôt après, les lits étant prêts, on assigna à chacun le sien. Les nouveaux pensionnaires devaient rester couchés jusqu’à l’arrivée du docteur. En dehors des deux internes, le service médical est assuré par le médecin du pays, qui vient tous les matins faire sa visite. Michel se coucha avec un bonheur extrême. Il était tellement fatigué qu’il ne pensait à rien et ne ressentait que des impressions physiques. Le chocolat lui sembla bon et son lit lui parut encore plus délicieux. Il éprouva un très vif plaisir à s’étirer et à sentir la fraîcheur des draps sur sa peau brûlante. La longueur du voyage lui avait donné un peu de fièvre et il éprouvait une grande lassitude. Mariette, elle, n’était pas plus tôt dans son petit lit, à l’autre extrémité de la grande pièce, qu’elle dormait à poings fermés. Elle rêva-que sa petite chienne Fatma, si malheureuse de son absence, venait toute seule la retrouver à Hendaye. Le Directeur, la voyant si fatiguée et voulant récompenser cet acte de fidélité, lui permettait de demeurer avec sa jeune maîtresse. Et Mariette s’imaginait la tenir dans ses bras. En se réveillant, elle fut toute surprise de ne pas trouver Fatma auprès d’elle et elle eut besoin de toute sa philosophie habituelle pour ne pas pleurer. Mais Mariette était une petite personne raisonnable, jusqu’à présent elle n’avait pas été heureuse et elle savait que l’on devait se résigner dans la vie. Sa cousine, qui l’avait prise chez elle par charité, avait l’habitude de la traiter sévèrement et, pourtant, cette femme, si dure pour Mariette, était une excellente mère, ce qui faisait que la pauvre petite s’apercevait encore plus de la différence. Elle avait continuellement devant les yeux ce que pouvait être la vie d’un enfant aimé et choyé et il fallait qu’elle eût une bien bonne nature pour ne pas devenir envieuse et méchante. D’autant plus que ses petites cousines étaient habituées à voir maltraiter Mariette, la considéraient comme une étrangère et ne se gênaient pas pour le lui faire sentir. Fatma était aussi leur victime, car elles devinaient qu’en taquinant la petite chienne elles atteignaient encore plus sa maîtresse. Bref, Mariette n’était heureuse qu’à l’école et elle aurait désiré que les heures de classe fussent plus longues. Ses maîtresses appréciaient son intelligence précoce et sa droiture. La petite sentait qu’elles étaient justes pour elle; cela lui donnait plus d’assurance et elle était tout autre avec elles qu’avec sa tante. Auprès de cette dernière, elle devenait cachottière, révoltée, boudeuse et se renfermait quelquefois des journées entières dans un profond silence.
Mariette, sauf le chagrin qu’elle avait d’avoir laissé Fatma entre les mains de ses ennemies, se réjouissait de jouir d’une tranquillité parfaite pendant plusieurs mois. Personne ne la tracasserait ici. Elle savait se faire aimer des infirmières et de ses petites camarades et prenait un plaisir très grand à tous les jeux de son âge. Que de bonnes parties elle avait faites, deux ans auparavant! Elle se réjouissait à la pensée de pouvoir recommencer avec son nouvel ami Michel.
Le docteur ne vint que très tard, vers onze heures et demie, et les examina tous l’un après l’autre. Ils passèrent sur une bascule et leur poids fut soigneusement inscrit. Ce n’est qu’à l’heure du déjeuner, après la visite du docteur, que Michel retrouva Mariette. Ils s’assirent l’un à côté de l’autre à table et purent causer à leur aise.
«Eh bien, dit Mariette la première, vous êtes-vous reposé ? Voulez-vous que nous nous tutoyions? Cela sera plus commode.
— Avec plaisir. Je veux bien te dire tu, répondit Michel après une hésitation.
— Je désirerais que le Directeur nous donnât la permission de sortir cet après-midi. Regarde, Michel, comme il fait beau et comme la mer est magnifique. Je voudrais déjà me baigner. Sais-tu nager?
— Non, je n’ai jamais pris de bain de mer ni de rivière et j’avoue que cela ne me tente pas.. Dieu que cela doit être froid! Brr... Brr....
— Mais non, au contraire, c’est très chaud. Si tu savais comme c’est amusant de barboter dans l’eau!
— Tu envies donc les canards?
— Non, parce qu’ils ne sont pas propres et choisissent toujours pour se baigner les mares les plus sales, mais j’aurais voulu être poisson ou plutôt être sirène. Être libre de m’en aller très loin, de plonger sous la mer. Et puis, j’aurais charmé un prince qui m’aurait épousée!
— Mademoiselle a des goûts aristocratiques, dit Michel d’un ton moqueur. Je vais m’informer s’il y a un prince dans la contrée. Peut-être le prince Charmant habite-t-il le château situé sur ce plateau, là-haut!
— Vilain moqueur, répondit Mariette un peu fâchée. Je sais très bien que l’histoire de Cendrillon n’arrive pas deux fois. Ce château appartenait à Mme d’Abbadie qui l’a légué à l’Institut. Il y a deux ans, lorsque j’étais ici, elle vivait encore et je me rappelle l’avoir vue. Elle ne nous aimait pas, paraît-il, et elle était furieuse de la fondation du Sanatorium. Pourtant, M. le Directeur nous a dit que c’était une dame très bonne et très charitable; elle était aimée dans le pays et elle faisait beaucoup de bien. Vois-tu toutes ces fermes aux alentours? Aussi loin que tu peux apercevoir, toutes ces terres lui appartenaient.
— Comme au marquis de Carabas.
— Aimes-tu les contes de fées? Moi, je les adore, demanda Mariette.
— Non, j’aime mieux Jules Verne et André Laurie. Ils parlent de voyages et cela me passionne.
— Oh! moi, je préfère faire des voyages que de les lire. Quand je serai grande, je voudrais voyager.
— Tu viendras avec moi, Mariette. Je veux être marin et découvrir des terres inconnues.
— Monsieur veut faire son Christophe Colomb, dit Mariette, contente de pouvoir prendre sa revanche.
— Tu n’accepterais pas de vivre avec moi dans une île déserte comme Robinson Crusoé ?
— Merci, je préfère le monde et je resterai à Paris qui est encore la plus belle ville d’Europe.»
Le déjeuner touchait à sa fin, Mariette proposa à Michel d’aller au jardin pour apercevoir la plage, mais ce dernier répondit qu’il lui fallait écrire à ses parents avant le départ du courrier.
«Mais toi, Mariette, tu n’écris pas à ta tante?
— Jamais de la vie, s’écria Mariette. Du reste, ajouta-t-elle plus bas et un peu honteuse, je n’ai pas de timbre et pas d’argent pour en acheter.
— Qu’à cela ne tienne, s’empressa de dire Michel, j’ai des timbres.» Et le petit garçon ouvrit un minuscule portefeuille qu’il portait toujours sur lui et que sa mère, prévoyante, avait garni de timbres.
«Non, décidément, je n’entends pas écrire à ma tante, elle me répondrait peut-être et, même par lettre, je ne veux pas être grondée.
— Mais tu n’as rien fait pour cela.
— Il n’est pas nécessaire d’avoir été méchante pour recevoir des réprimandes de ma tante. Elle ne fait que cela et j’y suis habituée, ajouta Mariette avec philosophie.
— C’est abominable, fit observer Michel outré et qui avait à un très haut degré le sentiment de la justice.
— Si tu veux, Michel, d’ici trois ou quatre jours, j’accepterai un timbre, ce qui me permettra d’écrire à la petite fille de notre concierge. Je l’ai chargée de veiller sur Fatma et elle pourra me donner de ses nouvelles.
— Mais certainement, avec joie, le veux-tu maintenant?
— Non, garde-le, je serais capable de le perdre.
— Alors c’est entendu, Mariette, je vais écrire et j’irai ensuite te retrouver au jardin.»
Mariette sortit et Michel resta avec plusieurs de ses compagnons qui désiraient aussi envoyer de leurs nouvelles à leurs parents. Il s’installa à une table et écrivit posément, d’une jolie écriture, la lettre suivante:
«Mes bons parents chéris,
«Notre voyage s’est bien passé et je m’empresse de vous en avertir afin que vous ne soyez pas inquiets sur ma santé. Le docteur, ce matin, m’a trouvé très anémié, mais il ne doute pas que le bon air d’Hendaye ne me remette complètement. Je voudrais bien être à ce jour-là, je serais auprès de vous et je pourrais embrasser tout à mon aise ma maman chérie. J’étais bien triste hier, avant de m’endormir en chemin de fer, parce que maman n’était pas là pour me donner mon baiser du soir. J’espère que papa ne sera pas fâché de ce que je trouve les baisers de maman plus doux que les siens. Nul ne sait m’embrasser comme elle et je suis très, très malheureux dé ne plus demeurer avec elle.
«Je dois vous avouer que ma peine a été adoucie par la connaissance que j’ai faite d’une gentille petite fille qui se trouvait parmi mes compagnons de voyage. Nous sommes devenus bien vite amis. Malheureusement, je ne suis que pour un mois avec elle, car aussitôt que nous aurons quitté le Lazaret, elle sera dans le quartier des filles et moi dans celui des garçons. Quel malheur qu’elle ne soit pas un garçon! moi, en effet, je ne voudrais pas être une fille. J’oublie de vous dire le nom de ma nouvelle amie: elle s’appelle Mariette Tully, elle a dix ans et elle est presque aussi grande que moi. Elle a des yeux noirs superbes que j’aime beaucoup parce qu’il sont aussi doux que ceux de maman. Il paraît qu’elle avait de très jolis cheveux noirs et frisés; on les lui a coupés avant son départ. Cela lui a fait beaucoup de peine et elle a conservé une de ses boucles qu’elle m’a montrée. Je n’ai jamais vu de cheveux si soyeux. Mariette est très malheureuse; elle n’a plus de parents et vit avec une vilaine cousine méchante qu’elle est obligée d’appeler: ma tante, et qui lui fait beaucoup de misères. Sa seule affection au monde est une petite chienne appelée Fatma qui est restée à Paris. Mariette est très inquiète sur son sort, car elle craint que la pauvre bête ne meure de faim. Si c’était possible, papa serait bien gentil de lui porter à manger de temps en temps, mais il ne faudrait pas que la tante de Mariette s’en doutât. Je ne veux pas en parler à Mariette avant de savoir si mon idée est réalisable. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme Mariette a été bonne pour moi pendant le trajet de Paris à Hendaye. Elle m’a consolé, car je dois vous dire que j’ai versé d’abondantes larmes après vous avoir quittés; j’ai même ressenti de la fièvre. Bref, je pense que grâce à Mariette, je finirai par m’habituer ici. Sous le rapport matériel, je suis très bien, mais il m’est pénible de vivre loin de ma famille.
«Nous sommes bien couchés et bien nourris. Comme je sais que le menu des repas intéresse maman, je vais lui dire ce que nous avons eu à déjeuner. Du rosbeef, des choux-fleurs gratinés; puis, comme dessert, du raisin. j’ai mangé de bon appétit et je me suis même forcé un peu pour engraisser et pour revenir plus vite auprès de vous. Je pèse exactement vingt-cinq kilos trois cents. Il paraît que je suis au-dessous du poids normal. Je ne pense pas que l’on nous permettra de faire une promenade aujourd’hui. Nous avons simplement l’autorisation de sortir devant le pavillon, dans un petit carré de terrain entouré de barrières. Nous sommes considérés comme contaminés et nous n’approchons pas les autres. Il paraît que nous pouvons avoir apporté de Paris le germe d’une maladie et on prend des précautions pour que nous ne la communiquions pas aux habitants du Sanatorium. Il me tarde d’avoir de vos nouvelles. Je voudrais que vous connussiez Mariette, elle vous plairait beaucoup. Quel dommage que vous ne l’ayez pas vue à la gare de Paris. Elle est si gentille avec moi et elle a déjà été si malheureuse! Elle est partie de Paris sans un sou et n’a pas de quoi acheter un timbre-poste. Je vais lui en donner un pour qu’elle puisse avoir des nouvelles de sa chère Fatma. Mais le temps passe à bavarder ainsi et Mariette est là qui m’attend devant le pavillon pour me montrer les montagnes qui sont superbes. Nous sommes entourés de riantes collines très vertes et la route est ornée de bouquets de sapins. Il me tarde de faire de grandes promenades; Mariette pense que nous commencerons à sortir demain.
«Au revoir, mes chers parents, j’embrasse papa bien fort et je mets ma tête sur l’épaule de maman pour qu’elle me dépose sur les yeux de bons baisers.
«Votre petit garçon qui vous aime.
«MICHEL.»
«P. S. — Embrassez pour moi grand’mère et dites le bonjour de ma part à tous les voisins sans oublier Mme Anaïs et Pierre.»
Michel écrivit l’adresse très lisiblement, ferma l’enveloppe, colla un timbre et remit la lettre à l’infirmière qui devait la déposer dans la boîte placée devant le pavillon du concierge, puis il courut rejoindre Mariette. Cette dernière, entourée de tous les nouveaux arrivés, sauf les petits, était occupée à donner des indications sur le pays. C’était la seule qui le connût.
«Oh! disait-elle, si j’avais une carte, je m’expliquerais bien mieux.» Apercevant Michel, elle se tourna vers lui et lui dit: «Vois-tu cette montagne en face qui présente trois plateaux au sommet, ce sont les Trois-Couronnes. Sais-tu dans quel pays elle est située?
— En France, parbleu, répondit Michel avec assurance.
— Non, dit Mariette, ravie de sa science. Elle est en Espagne.
— Je ne comprends pas, avoua Michel.
— Quel ennui de n’avoir pas de carte, mais je vais tâcher de te démontrer qu’il en est bien tout de même ainsi. Suis-moi bien. Regarde dans la direction de la pointe du Figuier, tu sais que c’est l’Espagne. Là se trouve l’embouchure de la Bidassoa. La Bidassoa, après Fontarabie, dont tu vois le clocher, tourne en faisant un demi-cercle et a l’air de rentrer en France. Ces montagnes que tu aperçois sont sur l’autre rive de la rivière et elles sont donc en Espagne. As-tu compris?
— Oh oui! s’écria Michel, je saisis; mais il me fallait une explication. Mais quelle est donc cette montagne pointue devant nous, un peu à notre gauche?
— La Rhune, répondit Mariette sans hésitation. Cette montagne s’élève au-dessus de Saint-Jean-de-Luz. C’est la dernière de la chaîne des Pyrénées.
— Tu parles comme une géographie, dit Michel.
— Et je pourrais encore te dire que la Rhune a neuf cents mètres de hauteur. Je t’étonne?
— Je l’avoue. Comment sais-tu tout cela?
— La première fois que je suis venue, on nous avait fait faire une copie et je l’ai toujours conservée. Tous ces détails y étaient et je les ai appris par cœur.
— Je voudrais bien aller sur la plage, mademoiselle, dit Michel à une infirmière qui s’approchait, irons-nous bientôt à la mer?
— Pas-avant quelques jours, mon enfant, l’air de la mer est très vif et il faut vous habituer d’abord au pays avant d’affronter la plage. Demain, vous commencerez par une petite promenade dans la campagne; après-demain, vous irez plus loin et tous les jours, graduellement, l’on vous fera marcher davantage. Je ne pense pas que vous alliez jouer sur le sable avant quinze jours ou trois semaines.
— C’est bien long, dit Mariette, c’est si amusante!
— Vous connaissez donc la mer? dit l’infirmière surprise.
— Oui, mademoiselle, je suis venue ici, il y a deux ans.
— Je n’y étais pas alors. J’ai été malade et j’ai dû prendre un congé d’un an.»
Les autres enfants familiarisés se rapprochèrent et Mariette, toujours la moins timide, posa cette question à l’infirmière:
«Vous êtes du pays, mademoiselle?
— Oui, mes enfants, je suis de Béhobie, à deux kilomètres d’Hendaye. Mon père est douanier et il vient tous les matins faire son service sur cette petite bande de terre que vous apercevez entre-la mer et la Bidassoa. Vous pouvez voir sa cabane d’ici.
— Béhobie est en France? demanda Michel qui aimait à se renseigner.
— Oui, en France, sur la Bidassoa et de l’autre côté, relié à la France par un pont, se trouve Béhobia qui est espagnol. Plusieurs membres de ma famille habitent Béhobia et sont Espagnols. Mais moi, je suis Française, s’empressa-t-elle d’ajouter avec une certaine fierté.
— Votre père a-t-il déjà arrêté des contrebandiers? dit Michel.
— Pas depuis qu’il est de service sur la pointe, mais auparavant, lorsqu’il était dans la montagne, il en a capturé plusieurs. Le service était alors très dur, il était obligé de faire des vingt kilomètres dans la montagne, sans pouvoir s’abriter contre le mauvais temps et ayant l’œil toujours en éveil. C’est par la montagne que les contrebandiers passent ordinairement.
— Et qu’est-ce qu’ils transportant? questionna Mariette.
— Du tabac, du blé, de tout. Ils forment des bandes admirablement organisées et ont des chiens très bien dressés qui aboient aussitôt qu’ils sentent le douanier.
— Je voudrais bien voir un contrebandier, dit Michel.
— Moi, dit Mariette, quand je suis venue ici la première fois, je croyais que les contrebandiers avaient des costumes spéciaux: des bottes, des culottes courtes et de grands chapeaux garnis d’énormes plumes. J’ai été bien étonnée quand j’ai vu qu’ils étaient habillés comme tout le monde, sauf qu’ils paraissent toujours misérables.
— On ne doit pas s’enrichir dans la contrebande, remarqua Michel philosophiquement.
— Et de plus, ajouta l’infirmière, Mlle Marie, ils exposent leur vie tous les jours.
— Oh, mademoiselle, vous seriez gentille, lui dit Michel, de me montrer un contrebandier,
— C’est bien facile, repondit Mlle Marie. Trois fois par semaine, le poisson du Sanatorium est apporté par le camionneur de la gare. Vous verrez un contrebandier.
— Comment? dit Michel, je ne comprends pas.
— Je vais vous donner la clef de l’énigme. Le camionneur est chef de contrebandiers; il est aussi chantre à l’église.
— Et les douaniers ne l’arrêtent pas? dit Michel surpris.
— Mais pour l’arrêter, il faudrait le surprendre faisant de la contrebande et il est difficile à saisir. On l’a pourtant arrêté plusieurs fois; il a fait de la prison, sa voiture et son cheval ont été vendus. Mais il n’est pas plus tôt libre, qu’il recommence de plus belle et il pratiquera la contrebande toute sa vie. Du reste, en dehors de cela, c’est un très brave homme qui ne serait pas capable de faire du mal à une mouche. Il a la contrebande dans le sang, comme presque tous les Basques.»
Mariette et Michel surtout restaient abasourdis. Ils n’arrivaient pas à comprendre que l’on pût être contrebandier et honnête homme en même temps. Les Basques sont généralement d’une grande probité et il se produit peu de vols dans le pays. Les habitants couchent les portes ouvertes et l’on ne découvre jamais de crime dans la région. Pour eux, se livrer à la contrebande, ce n’est que voler l’État et voler l’État, à leur avis, n’est pas un vol. Ils font presque tous de la contrebande plus ou moins, depuis le plus riche jusqu’au plus pauvre. On ne s’habitue à leurs mœurs qu’en vivant au pays basque et plus on les fréquente, plus on apprécie leur nature honnête.
Michel et Mariette restèrent dehors jusqu’au dîner qui a lieu à six heures précises. Une soupe, un plat de viande, un plat de légumes et un dessert. Tout cela très bien cuit et appétissant. Aussitôt le repas fini, la cloche du coucher sonna et tous les enfants ne furent pas fâchés de retrouver leur lit. Ils ne tardèrent pas à s’endormir profondément du sommeil du juste et de l’innocence.