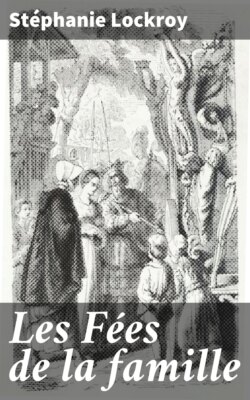Читать книгу Les Fées de la famille - Stéphanie Lockroy - Страница 7
BELLE ET LAIDE
ОглавлениеRien n’était plus beau que la belle princesse Roselmida. Son regard avait l’éclat du soleil, sa taille la souplesse et la majesté du palmier, ses joues étaient des roses, ses dents des perles et ses yeux du velours. Quand elle déroulait sa chevelure blonde, lisse et brillante, cette chevelure tombait jusqu’à ses talons et l’enveloppait tout entière. Le soir, lorsqu’elle paraissait aux fêtes que donnait le roi son père, ce n’était pas son diadème de pierreries qui relevait la beauté de sa figure, c’était sa figure qui semblait rehausser l’éclat de son diadème de pierreries.
Aussi tous l’admiraient, tous l’encensaient, tous l’adoraient, et tout s’inclinait devant elle, presque reine par la naissance et reine par la beauté.
Mais Roselmida était vaine, fière, orgueilleuse et hautaine, autant que belle.
Parmi les nombreuses filles d’honneur qui formaient sa cour, s’en trouvait une aussi disgraciée de la nature que Roselmida en avait été favorisée. Le roi avait recueilli la pauvre Amythe, dont le père était mort à la tête de ses armées, en combattant pour lui, et l’orpheline vivait auprès de la princesse, qui daignait à peine lui accorder un regard.
Amythe était laide; rien en elle ne pouvait plaire aux yeux. C’était en vain que la jeunesse elle-même avait jeté son voile riant sur cette disgracieuse enveloppe. Le seul charme qu’elle pût avoir consistait dans sa voix douce, harmonieuse et pénétrante; le rossignol n’eût pu trouver, dans ses notes cadencées, des accords plus suaves que ceux de la voix d’Amythe; mais la pauvre enfant ne tirait aucun parti de ce don enchanteur. Elle avait si bien la conscience de sa laideur qu’elle redoutait tout ce qui pouvait attirer l’attention sur elle, et que sa seule préoccupation était de s’effacer et de se faire oublier autant que possible.
Le roi exigeait qu’elle parût à toutes les fêtes qu’il donnait: reconnaissant, plus que les rois n’ont coutume de l’être, du dévouement montré par le père d’Amythe, et reportant sa gratitude sur la fille, il désirait la faire aussi heureuse qu’il le pouvait.
Amythe apportait à ces fêtes ses tristes souvenirs, le sentiment de son isolement et celui du peu de plaisir qu’elle pouvait causer aux autres. Elle revêtait ordinairement des habits de couleurs sombres; puis, se choisissant une place aussi écartée que possible derrière ses heureuses compagnes, la pauvre Amythe se dissimulait à tous les regards. Elle assistait silencieuse à ces plaisirs, qui lui étaient étrangers: aucun seigneur ne songeait à lui offrir sa main pour les danses; le front baissé, le cœur serré, elle voyait passer et repasser devant elle la séduisante Roselmida, couverte de fleurs et de diamants, rayonnant dans ses parures de reine, éblouissante de bonheur et de beauté et tout environnée d’hommages.
Le contraste de son sort avec cette destinée brillante l’oppressait douloureusement; peu à peu l’envie, cet odieux sentiment, pénétra dans son âme et finit par l’envahir tout entière. Un mot d’affection ou même de pitié de la princesse eût pu combattre cette funeste disposition; mais celle-ci n’avait que dédains et duretés pour la fille pauvre, laide et abandonnée, que les bontés seules du roi pouvaient soutenir à la cour, où elle faisait tache au milieu de tant de jeunes et éclatantes beautés.
Amythe se prit à haïr la princesse, et, à force de souffrance, cette haine en vint à lui paraître si naturelle qu’elle lui eût fait du mal ou lui eût causé du tort, tout en croyant n’exercer qu’une vengeance légitime. Son cœur, pourtant, n’était point méchant; mais elle était malheureuse, et la vue continuelle de tous les bonheurs dont elle se trouvait déshéritée avait fini par ulcérer ce cœur et par y jeter les instincts les plus pernicieux.
Un jour, le roi ordonna une grande chasse dans les bois qui avoisinaient son palais. Amythe, comme de coutume, fut conviée à cette fête.
La matinée, fraîche et charmante, promettait une journée favorable. La princesse Roselmida parut avec un magnifique costume de cheval, en velours vert, boutonné avec des diamants; ses petits souliers étaient attachés par des nœuds de pierreries; un rubis retenait la longue plume qui flottait à son chapeau; son superbe cheval blanc portait une housse enrichie de perles.
L’air du matin, le plaisir, le sentiment de sa beauté toute puissante rehaussaient l’éclat du teint et des yeux de Roselmida; sa bouche vermeille souriait; une rose, qu’elle avait attachée à son corsage, paraissait moins fraîche et moins brillante qu’elle. Le roi la considérait avec amour et orgueil; tous les seigneurs de la cour se disputaient l’honneur de l’escorter.
Elle était au milieu de son triomphe lorsque parut la triste Amythe. Celle-ci avait revêtu, comme à son ordinaire, un costume sombre et sévère, sans aucun ornement; elle montait un cheval noir, et un voile tombait sur son front, plutôt pour le cacher que pour le parer.
La foule joyeuse des chasseurs partit aux sons du cor, et s’élança dans les allées verdoyantes de la forêt. On échangeait de gais propos; les rires se croisaient; le hennissement des chevaux se mêlait aux bruyantes fanfares.
Amythe s’écarta peu à peu de tous ces groupes animés, et s’enfonça dans les profondeurs des bois, perdue dans ses rêveries accoutumées. Le silence se fit autour d’elle; son cheval marchait sans bruit sur la mousse épaisse: après une longue course, elle releva la tête et regarda autour d’elle.
Elle aperçut alors avec effroi un horrible sanglier, qui se tenait immobile à l’entrée de l’allée qu’elle suivait; il paraissait attendre quelque chose ou quelqu’un, l’œil fixe et le poil hérissé, et ne se préoccupant en aucune façon de la chasse, dont on entendait les bruits lointains.
Cette singulière rencontre frappa la jeune fille de surprise et de terreur, et elle tourna bride à l’instant, en mettant son cheval au galop. Au détour du chemin elle rencontra la princesse, qui suivait de loin la chasse avec une de ses dames.
— Voyez donc, dit Roselmida en la désignant et assez haut pour être entendue d’elle, voyez donc, Ethel, quel sombre et vilain costume, bien digne de celle qui le porte! Je ne sais, en vérité, pourquoi mon père s’obstine à attrister toutes ses fêtes par l’aspect continuel de ce maussade laideron.
Amythe devint pourpre, puis une pâleur de mort couvrit son visage à cet affront; son sang reflua vers son cœur.
— Princesse, dit-elle, la voix tremblante et sans se rendre compte à elle-même de ce qu’elle faisait, princesse, le roi est là qui vous attend. Il m’a chargée de vous envoyer auprès de lui.
Et son doigt désignait l’allée fatale.
Roselmida s’y élança, bondissante et joyeuse, sans faire attention au trouble d’Amythe ou l’attribuant au dépit causé par l’insolent propos qu’elle venait de tenir. La jeune suivante alla rejoindre la chasse.
Amythe resta un moment immobile, pétrifiée, le remords la saisissant déjà au cœur; puis, éperdue, elle se précipita à la suite de la princesse, sans bien savoir au juste si elle allait pour la sauver, pour mourir avec elle ou pour jouir de ses angoisses.
Quand elle arriva auprès d’elle, Roselmida était pâle, renversée en arrière sur son cheval, la bouche béante, les yeux sortis de leurs orbites, les cheveux hérissés.
Le sanglier paraissait prêt à se jeter sur elle.
Amythe s’élança.
Tout à coup la bête féroce perdit ses formes hideuses; un brouillard l’enveloppa, puis ce brouillard s’étendit, s’éleva comme une fumée, et, se dissipant à demi, laissa apparaître une femme d’une grande taille, vaporeuse comme les nuages qui l’environnaient et belle dans ses contours indécis.
— Je suis la fée Brouillard, dit-elle aux deux jeunes filles stupéfaites; il y a longtemps que je vous connais et que je vous observe. Vous êtes méchantes toutes deux, et toutes deux vous serez punies.
En même temps elles se sentirent enlevées par les cheveux, et traversèrent les espaces avec une rapidité vertigineuse.
Quelques instants après, elles s’abattaient dans une grande plaine, dépouillée d’arbres et de verdure, aride, pierreuse, et où il n’y avait aucune trace d’habitation. Aussi loin que la vue pouvait s’étendre, on n’apercevait rien qu’un horizon monotone qui bordait cette immensité.
La fée était encore là.
— Vous voici, belle princesse, dit-elle à Roselmida interdite, à trois cent cinquante mille neuf cent deux lieues et demie du royaume de votre père. Vous allez le regagner à pied.
Et elle indiquait de la main un des points de l’horizon.
— Vous apprendrez peut-être par les souffrances et les privations à compatir aux peines des autres.
Et toi, ajouta-t-elle en se tournant vers Amythe, envieuse et cruelle, puisque tu as voulu la mort de la princesse, tu expieras ta méchanceté ; plus forte et hardie que ta compagne, tu lui serviras de guide et de soutien pendant son douloureux voyage. Tiens, prends cet anneau, il pourra satisfaire à vos besoins les plus urgents; mais garde-toi d’y recourir trop souvent, car il est avare de ses dons, et pour qu’il se montrât généreux, il faudrait que vos cœurs revinssent à de bien meilleurs sentiments. Adieu.
Les formes de la fée se perdirent dans le brouillard; un rire moqueur traversa l’espace; les jeunes filles étaient seules.
Elles n’avaient plus leurs habits de chasse; elles étaient vêtues comme des paysannes; leurs pieds étaient chaussés de lourds souliers, et des coiffes grossières couvraient leurs têtes.
Elles restèrent quelque temps immobiles, saisies de surprise et d’effroi. Enfin Roselmida, éclatant en sanglots, se tourna vers sa compagne.
— C’est toi, méchante, lui cria-t-elle, qui es cause de mon malheur. C’est ta lâche envie qui m’a conduite ici. Tu as voulu me faire mourir; tu m’as envoyée vers cet affreux sanglier. Grâce à toi, à ton infernale méchanceté, je ne reverrai plus mon père, mon pauvre père qui m’aime tant et qui mourra de ma perte; je ne reverrai plus mon palais, mes compagnes; je suis privée de ma fortune, de mes parures, de mes fêtes; j’ai tout perdu. Et que t’avais-je fait? C’est ta repoussante laideur qui t’excitait contre moi; tu m’en voulais de ma beauté, de mes attraits, de l’amour qu’on me portait, odieuse et jalouse créature!
— Et qu’as-tu fait, dure et égoïste princesse, pour adoucir mon sort, pour éteindre les douloureux sentiments qui s’allumaient en mon cœur? lui répondit Amythe. As-tu jamais eu un mot consolant pour l’orpheline abandonnée et repoussée de tous? Ne l’as-tu pas continuellement écrasée de tes triompes, de tes succès, de ton insolent bonheur? Parce que rien ne manquait à tes joies, tu méprisais celle qui souffrait en silence. Mais tu es punie; te voici loin de ton père, de ton royaume, de tes admirateurs, de ta cour empressée; te voici réduite à souffrir comme la dernière des femmes, et ce qui me console ici de mon exil et de ma pauvreté, c’est l’aspect de ta misère et de tes larmes. Je te verrai donc enfin réduite au même état que moi, souffrante et humiliée comme moi.
Elle s’arrêta, la colère la suffoquait. La princesse ne lui répondit rien; elle fondit en larmes.
Cependant la nuit arrivait; la faim se faisait sentir. Amythe pressa le chaton de sa bague. Mais rien ne se présenta à elle. Elle se souvint des conseils de la fée et comprit qu’elle n’avait pas mérité ses secours. Elle roula autour d’elle sa grande mante de paysanne et se coucha sur la terre dure et froide. La princesse pleura et se plaignit longtemps, puis elle finit par l’imiter.
Leur sommeil fut agité ; la peur, le froid, la faim, le remords et le chagrin les tourmentaient à l’envi.
La nuit fut longue et triste.
Vers le matin, Amythe, épuisée, recourait de nouveau à sa bague. Cette fois, un pain vint s’offrir à elle: un pain, moins que rien pour celui qui vit dans l’aisance et ne manque de rien, trésor plus précieux que tous les diamants de l’univers pour celui qui souffre la faim!
Amythe s’en saisit avec avidité ; mais bientôt, réfléchissant que les bienfaits de la fée ne s’adressaient pas à elle seule, elle rompit le pain, après quelque hésitation, et en jeta brusquement la moitié à sa compagne, qui s’en empara non moins avidement qu’Amythe l’avait fait.
Au même instant, elles entendirent le murmure d’une petite source où elles coururent se désaltérer. Elles y rafraîchirent aussi leurs visages et leurs mains.
Toutefois Roselmida, que ses instincts de coquetterie n’abandonnaient jamais, ne put s’empêcher de lisser ses longs cheveux en se mirant avec complaisance dans l’eau. Son nouveau costume, avec toute sa simplicité, semblait faire ressortir encore sa merveilleuse beauté.
— Il est bien temps de se mirer, lui cria Amythe, qui était déjà prête. Même ici, dans ce désert, tu songes à ta figure; tu veux sans doute plaire aux pierres du chemin. Allons, coquette acharnée; moi, qui n’ai pas de temps à perdre, je m’en vais; comme c’est moi qui tiens l’anneau, je n’ai aucun besoin de t’attendre.
— Méchante! répondit la princesse. Pourquoi la fée te l’a-t-elle donné plutôt qu’à moi? Si tu n’en étais pas maîtresse, je saurais bien me passer et de ta protection et de ta maussade compagnie.
Amythe, sans répondre, prit les devants, et toutes deux commencèrent leur long voyage. Elles marchèrent tout le jour; la route était dure, le soleil les brûlait, les pierres blessaient les pieds délicats de la princesse, et nulle part elles n’apercevaient d’habitation, rien qui pût reposer les yeux. Toujours cette immensité sans fin! Toujours cet horizon qui semblait s’étendre et s’allonger à mesure qu’elles avançaient!
Le soir revint. Elles eurent, après cette rude journée, encore un pain pour se restaurer, avec un peu d’eau. Elles mangèrent et burent sans se parler, et se couchèrent comme la veille.
Elles allèrent ainsi pendant quinze jours. Les souffrances, les privations, ne pouvaient les décider à se rapprocher, ni diminuer la haine qu’elles se portaient. Au contraire, les maux qu’elles s’étaient attirés mutuellement venaient encore les aigrir et les éloigner l’une de l’autre. Aussi la bague ne leur donnait-elle que le strict nécessaire, et la route ne s’adoucissait en aucune façon pour elles.
La princesse, plus délicate que sa compagne et plus habituée à une vie douce et facile, se fatiguait bien plus qu’elle. Le froid et la faim la torturaient, et, ce qui n’était pas sa moindre douleur, sa beauté s’altérait; elle maigrissait; les roses pâlissaient sur ses joues qui se creusaient; son beau teint se hâlait; ses yeux fatigués avaient perdu leur éclat.
Le matin du quinzième jour, elle dormait encore lorsque Amythe se réveilla et s’approcha d’elle.
A la vue de cette belle tête pâle et souffrante, de ces grands yeux qui, tout fermés qu’ils étaient, laissaient échapper des larmes, elle sentit, pour la première fois, un mouvement de compassion. Son cœur s’attendrit, ses yeux s’humectèrent, et, pressant sa bague, presque sans s’en apercevoir, elle murmura:
— Pour soulager Roselmida!
A l’instant s’allongea devant elle une table splendide, couverte des mets les plus recherchés et des vins les plus exquis.
Amythe n’était pas gourmande, mais il y avait quinze jours qu’elle était au pain et à l’eau; aussi, à cette vue, ne put-elle retenir un cri de plaisir qui réveilla sa compagne.
Roselmida ressentit aussi une grande joie à l’aspect de cette table appétissante.
— C’est toi, Amythe, s’écria-t-elle, qui m’as préparé cette charmante surprise. Oh! merci! merci!
Elles s’assirent toutes deux, et se réconfortèrent à l’envi l’une de l’autre. C’était le meilleur repas qu’elles eussent fait de leur vie, repas assaisonné par la faim et par les privations des jours précédents.
Quand elles se furent bien rassasiées, Amythe aperçut auprès d’elle un panier, et, se souvenant des avis de la fée, elle ramassa avec soin tous les restes du festin, qu’elle emporta avec elle.
Ce jour-là, la route fut moins dure et moins pierreuse; le soleil avait moins d’ardeur; les jeunes filles, le cœur plus satisfait, se parlèrent un peu sans aigreur et sans rancune. Le soir, elles virent deux amas d’herbes sèches, qui semblaient avoir été placés là pour elles, et elles y trouvèrent un repos délicieux.
Leur voyage devint moins pénible; le besoin qu’elles avaient l’une de l’autre, les petits secours qu’elles étaient forcées de se donner mutuellement, l’isolement dans lequel elles se trouvaient, tout contribuait à les rapprocher, et une douce amitié se glissait dans leurs cœurs, presque à leur insu. Roselmida sentait enfin le besoin de s’appuyer sur Amythe, plus énergique et plus courageuse qu’elle. Quant à celle-ci, en voyant tout ce qu’avait à souffrir la princesse, si molle et si délicate, elle éprouvait une tendre compassion qui, pénétrant peu à peu dans son cœur, y prenait la place de la haine et de l’envie. Elle s’attachait à sa compagne par l’appui qu’elle lui prêtait continuellement, comme une nourrice s’attache à son nourrisson par les soins qu’elle lui prodigue.
Elles eurent bientôt à traverser un riant vallon, au pied de roches noires et abruptes; un ruisseau y courait en murmurant sur des cailloux qui en faisaient rejaillir l’eau en petites cascades. De grosses touffes de digitales sortaient des fentes des rochers. Roselmida, lasse, s’assit sur le gazon, au bord de l’eau, pour y rafraîchir ses pieds brûlants.
Amythe considéra tristement les gros bas de coton bleu de la princesse, qui, tout usés, laissaient voir la peau blanche et délicate de ses jambes.
Leurs habillements étaient déchirés par les ronces, leurs souliers usés par leurs longues marches; ces vêtements, déjà si simples, abîmés et défraîchis, n’auraient jamais pu laisser soupçonner le nom et le rang de celles qu’ils recouvraient.
La princesse soupira aussi en défaisant ses chaussures.
Tandis qu’elle se reposait, Amythe alla errer aux environs; tout à coup il lui sembla entendre auprès d’elle de petites voix argentines; elle prêta l’oreille attentivement et elle vit alors une grande digitale, dont toutes les clochettes s’agitaient, balancées par le vent, et murmuraient avec un son doux comme celui du cristal que l’on touche légèrement:
— Ouvre-moi! ouvre-moi!
Amythe s’empressa d’ouvrir une de ces jolies clochettes, et il en sortit une paire de souliers si petite et si mignonne, qu’il aurait presque fallu un microscope pour la regarder. Elle éclata de rire à cet aspect.
Mais les petits souliers grandissaient, grandissaient, et devinrent bientôt de la taille de ceux d’Amythe. La jeune fille, tout émerveillée, n’en pouvait croire ses yeux.
Elle ouvrit une seconde clochette, et elle en tira une petite robe de laine fine et rayée qui s’agrandit comme les souliers.
Chaque clochette pourprée apporta à son tour son présent, et Amythe eut bientôt devant elle un costume complet, qui, bien qu’il ne fût encore convenable que pour une paysanne, était si frais et si joli, qu’elle sautait de joie en le regardant et brûlait de l’essayer.
Elle s’apprêtait à quitter sa vieille robe, lorsque tout à coup elle se souvint du soupir de Roselmida, du chagrin qu’elle avait, elle si élégante et si coquette, à porter ses haillons.
Elle hésita. Son ancienne rancune lui revenait au cœur, son amitié naissante la combattait; enfin, le bon sentiment l’emportant, elle courut à la princesse, et, l’amenant devant les frais hommages de la fleur merveilleuse, elle les lui offrit avec un doux sourire.
— Mais toi, Amythe, lui dit la princesse confuse, que mettras-tu? N’y a-t-il donc plus rien pour toi?
— Oh! ne vous mettez point en souci. Je n’y tiens guère, moi. Et puis, vous serez si gentille avec cela. Allons! allons! dépêchez-vous de revêtir cette toilette. Je suis sûre que jamais robe lamée d’or ou d’argent et couronne de perles ne vous ont fait autant de plaisir que cette jupe de laine, ce corset de drap et cette coiffe de mousseline.
Roselmida se trouva bientôt habillée; elle était toute joyeuse et cependant se reprochait de profiter ainsi de la complaisance de sa compagne.
Mais elles n’étaient pas sorties de la vallée qu’une seconde fleur leur parla encore, et Roselmida, à son tour, en tira un habillement pour Amythe.
Elles traversaient maintenant de fraîches campagnes; des arbres leur prêtaient de doux ombrages; les pierres avaient fait place à une mousse veloutée; tout s’adoucissait pour elles, à mesure que leurs cœurs apprenaient l’affection et le dévouement.
Un jour, en passant dans un bois ombreux, Amythe, le cœur léger, se mit à chanter. Les oiseaux jaloux se turent à ses accents mélodieux.
Roselmida, surprise et enivrée, l’écouta longtemps, puis enfin elle s’écria:
— Amythe, chère Amythe, quelle divine harmonie! Eh quoi! vous nous avez caché jusqu’ici ce don surnaturel. Et vous vous plaignez! vous vous dites déshéritée de la nature! Eh! quelle beauté peut valoir cette voix enchanteresse, ce charme incomparable? Oh! répétez encore, Amythe, recommencez; je passerais ma vie à vous entendre!
La jeune chanteuse flattée sourit: c’était la première fois qu’on trouvait à louer quelque chose en elle; et, voyant que, malgré sa laideur, elle pouvait cependant encore être agréable et plaire aux autres, elle reprit quelque confiance en elle-même, et l’amertume de son âme s’adoucit. Depuis ce moment, elle se plut à charmer les ennuis du chemin, car la princesse l’écoutait toujours avec un nouveau ravissement.
Cependant, cette pauvre princesse s’épuisait. Elle ne pouvait supporter la fatigue et les privations comme Amythe, qui avait été plus habituée qu’elle à une vie rude et pénible.
Un soir, la fièvre s’empara de Roselmida; ses pieds gonflés ne pouvaient plus la porter. Amythe la soutenait en vain, en l’encourageant, et ne savait plus que faire, lorsqu’elle aperçut une petite maison isolée et, sur le seuil, une femme assez pauvrement vêtue, qui faisait une dentelle fine comme la plus fine toile d’araignée.
— Pouvez-vous nous recevoir pour cette nuit? lui demanda Amythe. Voyez, ma compagne est fatiguée, et il nous faudrait un lit et quelque nourriture.
— Oh! oh! répondit brusquement la dentellière en quittant son ouvrage, qui êtes-vous, mes belles coureuses? Me croyez-vous donc assez riche pour héberger ainsi tous les paysans? Et que me donnerez-vous pour me payer mon hospitalité ?
— Hélas! je n’ai rien, lui répondit Amythe, et je coucherais sur la dure plutôt que de vous importuner; mais, je vous le répète, cette jeune fille est malade, et elle ne peut marcher davantage. Ne nous refusez pas, ma bonne mère.
— Voyons, voyons; il faut arranger cela. Faisons un marché. Saurez-vous travailler à ma dentelle? Je n’ai que cet ouvrage pour vivre, et, si vous m’y aidez, je pourrai vous recevoir, vous et votre belle affligée. Je m’y connais; elle n’a que de la fatigue, et elle travaillera avec nous jusqu’à ce qu’elle soit assez reposée pour reprendre sa route.
— Je ne sais ce que pourra faire ma compagne, mais moi, je ne serai point embarrassée pour continuer votre dentelle. Je ferai tout ce que vous voudrez; mais, par grâce, laissez-nous entrer. Ma pauvre amie va défaillir dans mes bras. Demain je serai à vos ordres.
— Allons, entrez, dit la femme.
Et, les introduisant dans sa pauvre habitation, elle alla leur chercher deux jattes de lait, qu’elle venait de traire, deux galettes toutes chaudes, un peu de miel et quelques fruits.
Puis elle les conduisit dans une chambrette, où se trouvait un lit grossier, dans lequel Roselmida s’étendit avec délices.
Amythe descendit dans le jardinet qui attenait à la maison, et y cueillit quelques simples dont elle composa une tisane; comme elle avait souvent soigné des malades, elle savait bien s’y prendre pour les soulager.
Le lendemain, au point du jour, elle alla trouver son hôtesse et lui demanda à se mettre au travail.
— Vous avez raison de vous hâter, lui dit celle-ci, car si vous tenez à ce que je vous garde chez moi, il faut que vous me fassiez, avant la nuit, trois aunes de dentelle, et aussi fine que celle à laquelle vous m’avez vue travailler.
— Trois aunes, ma bonne mère! s’écria Amythe effrayée. Quelle tâche! Et comment voulez-vous que j’en puisse venir à bout dans ma journée?
— Vous n’êtes pas seule. Et votre belle compagne, si fatiguée qu’elle soit, peut bien faire jouer mes fuseaux sans se rendre pour cela plus malade. D’ailleurs, telles sont mes conditions. Il faut vous y conformer ou sortir de chez moi.
Amythe alla auprès du lit de Roselmida; mais elle la trouva encore si épuisée qu’elle n’osa lui communiquer les propositions de la dentellière. Elle prit courageusement ses fuseaux et se mit à l’ouvrage avec ardeur.
Le soir, ses trois aunes de dentelle étaient terminées, et cette dentelle était si belle et si fine, que son hôtesse, malgré tout son mauvais vouloir, n’y put rien trouver à redire.
Amythe continua ainsi pendant sept jours. La princesse reprenait ses forces et sa santé ; mais Amythe pâlissait de fatigue et s’épuisait à son tour, sans proférer une plainte. Elle chantait même tout en travaillant, et Roselmida tombait dans son extase habituelle en entendant cette voix céleste. La dentellière elle-même prenait plaisir à l’écouter et semblait perdre de sa dureté à ses suaves accents.
Le huitième jour, comme Roselmida, reposée et rafraîchie, assise sur son lit, prêtait l’oreille aux chants d’Amythe, dont les doigts agiles faisaient pendant ce temps toujours mouvoir ses fuseaux, leur hôtesse entra tout à coup dans leur chambrette: elle paraissait avoir repris toute sa mauvaise humeur.
— Que faisons-nous donc là, la belle? dit-elle rudement à Roselmida. Il faut être bien lâche pour laisser ainsi votre compagne finir à elle seule toute sa besogne. Vous êtes assez forte maintenant pour l’aider, et je m’ennuie à vous voir toujours désœuvrée.
— Hélas! ma bonne mère, répondit la princesse en rougissant, je ne pourrais tenir vos fuseaux, et je puis dire que je suis émerveillée des talents d’Amythe. Jamais je n’ai su faire de dentelles.
— Ah! ah! fort bien... Mais, alors, que savez-vous? Car il n’est pas juste que l’une s’épuise au travail pendant que l’autre se prélasse à l’écouter chanter. Voyons, vous allez traire ma vache.
— Je ne le saurais, dit la princesse avec dédain.
— Eh bien! rangez la maison et apprêtez le repas pendant que je me mettrai à mon métier.
— J’en suis tout à fait incapable.
— Bon. J’ai de jeunes arbres à tailler. Descendez au jardin, ma mie.
— Me prendriez-vous pour une jardinière?
— Non. Eh bien! voici une quenouille et du beau lin pour filer.
— Je ne file point.
—- Prenez alors cette blanche laine et travaillez à mes jupes.
— Je n’ai jamais fait les jupes de personne.
— Ah ça! vous n’êtes donc absolument bonne à rien! s’écria enfin la dentellière impatientée. A quoi donc, ma mie, employez - vous ces jolis doigts si effilés et si blancs? Que faites-vous de ces beaux yeux qui pourraient servir à tant de choses?... Que savez-vous faire enfin?
— Mais je sais... je sais... danser, murmura Roselmida confuse; je sais me coiffer.
— Vous coiffer!... danser!... Eh! quel parti puis-je tirer de ces beaux talents? Allons, la belle, il vous faut retourner à l’école!
— A l’école! répéta Roselmida outrée de dépit, moi, une grande princesse comme moi!
— Princesse! s’écria la dentellière en riant à se tenir les côtes. Oh! la belle princesse, avec sa jupe de laine et ses sabots! Où sont donc vos États, votre palais, vos courtisans, ma mie? Quelle grande princesse, qui court les chemins et tombe de fatigue à la porte des maisons! Il faut rabattre de vos prétentions, ma chère, et tâcher de vous rendre utile, si vous voulez qu’on vous garde. Voyez votre compagne; je suis sûre qu’elle n’est pas princesse, elle; elle a fait au moins une demi-aune de dentelle depuis que nous perdons le temps à jaser; aussi je l’aime bien mieux que vous avec vos airs languissants et toutes vos beautés.
Amythe souffrait d’entendre ainsi mortifier sa chère princesse. Aussi, la voyant rétablie, elle l’engagea à partir, et n’eut pas grand’peine à l’y décider.
Elles prirent donc congé de leur rude hôtelière.
Roselmida ne savait comment remercier Amythe de toute la peine qu’elle s’était donnée pour la faire rester si longtemps à se reposer. Elle s’apercevait de la supériorité de sa compagne et ne l’en aimait pas moins. Seulement, il se mêlait maintenant un peu de respect et beaucoup de reconnaissance à son affection. Elle oubliait l’élévation de sa naissance et de son rang; d’ailleurs, elle savait si peu quand et comment elle pourrait retrouver son palais et son royaume, qu’elle s’estimait trop heureuse, en attendant, d’avoir la protection et l’amitié d’Amythe, forte, adroite, prévenante et dévouée.
Quelle fut donc sa douloureuse surprise, un soir, en la voyant tomber presque pâmée dans ses bras, au moment où elles traversaient ensemble un fourré d’épines!
— Qu’as-tu, chère Amythe? s’écria-t-elle. Te serais-tu blessée? que puis-je faire pour toi?
Mais Amythe, pâle et presque évanouie, ne répondait point. Roselmida entendit un frôlement sous les feuilles, et elle vit s’enfuir un serpent qui venait de piquer sa compagne.
— O ciel! où es-tu blessée, mon amie, ma bien-aimée? où souffres-tu? Où t’a mordue cette affreuse bête?
Amythe désigna son pied. La princesse la déposa à terre sur la mousse, et, se jetant à genoux devant elle, se hâta de délacer sa bottine; puis, voyant sur son pied, vers la naissance de la jambe, une plaie bleuâtre et livide, elle y appliqua ses lèvres et en aspira le venin sans hésiter et avec rapidité.
Puis, enfin, se souvenant de l’anneau magique qu’elle avait oublié dans son trouble, elle prit la main glacée de sa compagne et pressa sa bague sur son doigt en s’écriant:
— Pour soulager Amythe!
A l’instant, des bandages d’une toile fine et blanche vinrent s’enrouler d’eux-mêmes autour du pied de la blessée. Des coussins moelleux sortirent de terre. Roselmida y plaça Amythe avec précaution, puis s’y étendit à ses côtés. Alors de chauds et soyeux rideaux enveloppèrent la couche improvisée, et les deux amies s’y endormirent dans les bras l’une de l’autre.
Au lever du jour, Amythe était guérie.
— C’est à toi que je dois la vie, dit-elle à Roselmida en l’embrassant avec tendresse; c’est ton généreux empressement qui m’a sauvée; je ne l’oublierai pas. Continuons notre route: en nous appuyant ainsi l’une sur l’autre, nous finirons sans doute par arriver au but de notre voyage, par retrouver ton père, ma Roselmida, ton royaume et tout ce qui te faisait si heureuse.
Comme elles allaient prendre leur repas, elles virent venir à elles, sortant d’un bois, un vieillard, dont la barbe, blanche comme de l’argent, tombait jusque sur sa poitrine. Il paraissait bien vieux et bien épuisé. Sur son dos étaient quelques fagots, qu’il semblait n’avoir pas la force de porter plus longtemps.
Les jeunes filles s’approchèrent de lui et lui offrirent leur secours. Elles le débarrassèrent de son fardeau; puis Amythe tira de son panier quelques réconfortants; ensuite, s’asseyant sur le gazon, elles l’invitèrent à partager leurs provisions.
Le vieux bûcheron se ranima peu à peu, et, devenant aussi loquace qu’il avait été jusque-là triste et silencieux, il se mit à causer en riant.
— Où allez-vous donc ainsi, les belles filles, qui courez les chemins seulettes? Vos souliers sont tout blancs de poussière, et vous paraissez venir de bien loin.
Je devine, ajouta-t-il d’un air malin, le but de votre voyage: vous allez à la Caverne-Noire. Je conçois qu’on marche longtemps pour y arriver.
Et se tournant vers Roselmida:
— Voilà, en effet, un teint qui mérite d’être conservé.
— Que voulez-vous dire, bon vieillard? répondit la princesse en rougissant. Quelle est cette Caverne-Noire? et comment, en m’y rendant, pourrai-je conserver mon teint?
— Eh quoi! vous ne connaissez pas cette caverne fameuse dans tout le pays, et si connue surtout des jeunes filles, cette caverne où l’on trouve l’eau qui empêche de vieillir.
— Que dites-vous? s’écria la princesse transportée; où est cette eau miraculeuse? Oh! j’en aurai, j’en aurai, dussé-je en mourir!
— J’en étais bien sûr, reprit le vieillard en souriant: toutes ces enfants sont de même; elles veulent rester jeunes; aucune ne se soucie d’avoir un jour mes cheveux blancs et mon dos voûté.
Vous m’avez secouru, vous m’avez restauré, mes belles, et, pour prix de vos peines, je vous dirai où est l’eau merveilleuse et comment on peut se la procurer. Écoutez-moi bien.
Amythe, distraite, effeuillait des fleurs; mais Roselmida était suspendue aux lèvres du bûcheron et retenait sa respiration pour ne pas perdre un mot de ce qu’il allait dire.
— Vous voyez là-bas, continua le vieillard, ce sentier qui se perd dans le bois, et où il y a tant d’aubépines en fleurs. Il mène à la Caverne-Noire. Cette caverne est creusée sous de grands rochers, et; a l’entrée se trouve un dragon ailé qui garde jour et nuit son trésor.
— Comment faire alors? s’écria la princesse haletante. Comment adoucir ce dragon? comment pénétrer dans cette caverne extraordinaire? Oh! dites, dites, bon vieillard; aidez-moi à conquérir ce bien inestimable.
— L’or et l’argent ne peuvent rien, mon enfant, sur cet impitoyable dragon: il n’est sensible qu’à l’harmonie. Si vous pouviez le charmer par quelque musique merveilleuse, il deviendrait inerte, insensible, et il vous serait alors possible de pénétrer dans sa caverne, où vous trouveriez une fiole qui contient l’eau que vous désirez si ardemment. Mais bien d’autres que vous ont déjà tenté l’aventure et n’ont pas réussi. Le dragon les a dévorées, et leurs ossements blanchis jonchent l’entrée de sa formidable demeure. Croyez-moi donc, renoncez à un bien si dangereux à acquérir, et contentez-vous des charmes dont la jeunesse vous a douée et qu’elle doit emporter avec elle, ainsi qu’elle l’a fait pour vos mères. Allons, me voici tout reposé. Aidez-moi, je vous prie, à recharger ces fagots sur mon dos; il faut que je retourne à mon travail.
Roselmida aurait bien voulu en savoir davantage; mais le vieux bûcheron se leva, et, saluant les jeunes filles d’un sourire narquois, il s’enfonça dans le bois en chantant.
Les voyageuses se remirent à marcher; la princesse était rêveuse: elle n’osait communiquer ses pensées à sa compagne qu’elle voyait si indifférente.
Pourtant, quand elle fut arrivée à l’entrée du sentier indiqué par le vieillard, elle hésita; elle ne pouvait se résoudre à passer outre, et elle craignait d’entraîner Amythe dans une aventure périlleuse et qui, pour elle, ne pouvait avoir que bien peu d’attrait.
Celle-ci s’aperçut du combat intérieur que se livrait son amie. Elle ne se souciait guère de s’engager dans le sentier qui menait à un but si redoutable, et dont personnellement elle avait si peu d’envie. Mais que n’eût-elle point tenté pour être agréable à Roselmida, qu’elle aimait tant aujourd’hui, et qui venait encore tout dernièrement de lui prouver son affection d’une manière si convaincante?
Elle s’arrêta donc, et, se tournant vers elle:
— Allons, Roselmida, lui dit-elle, prenons cette route, et voyons si nous ne pourrons pas faire quelque chose pour conserver à tout jamais cette beauté si charmante et qui a tant de prix pour vous.
— Mais toi, Amythe, ne crains-tu pas cet affreux dragon et les dangers de cette terrible caverne?
— Reculeriez-vous, princesse? Si vous êtes trop effrayée, retirons-nous.
— Oh! non; je risquerais ma vie tout de suite pour pouvoir rester belle. Je n’ai peur que pour toi, qui tiens si peu à tout cela.
— S’il n’y a que moi qui vous retienne, chère Roselmida, allons! Ne savez-vous donc pas bien tout ce que je ferais pour vous et pour assurer votre bonheur? Je vous aiderai à conquérir votre trésor, ou je mourrai avec vous.
Et elles entrèrent toutes deux résolûment dans le sentier.
Il était tout rempli des douces senteurs de l’aubépine fleurie: la mousse était verte et veloutée au pied des grands chênes; on entendait au loin la plainte monotone du coucou; mais tous les charmes de cette belle journée de printemps étaient perdus pour les jeunes aventurières, toutes préoccupées du but de leur course.
— Comment ferons-nous, Amythe, disait la princesse, pour adoucir le dragon? Si j’avais ici mon luth, j’essaierais d’en jouer; mais j’y suis si peu habile; à peine si je sais en tirer quelques sons. Il faut vraiment tout mon désir de posséder cette eau extraordinaire, pour m’engager dans une aventure si terrible et dont je prévois si peu le résultat.
— Vous avez trouvé ma voix agréable, objecta timidement Amythe, voulez-vous que j’essaye de m’en servir? Peut-être aura-t-elle quelque pouvoir sur ce dragon, si sensible à l’harmonie.
— Oh! oui, oui, chère Amythe. Je n’osais vous le demander; mais qui pourrait résister à votre voix touchante, aux doux accents que vous savez en tirer? Essayez, mon amie; rendez-moi encore ce nouveau service.
— Je ferai tout ce que vous voudrez, reprit la triste Amythe. Votre beauté pourra devenir éternelle, ajouta-t-elle avec un faible soupir: les années ne sauraient plus l’altérer. Mais moi, moi, je serai toujours laide, toujours repoussante; je n’ai rien à perdre et rien à conserver.
— Laide! repoussante! Amythe; mais je ne te trouve plus laide; tu es devenue si bonne, ta voix est si douce. Je te trouve maintenant plus de charme qu’à aucune des jeunes filles qui m’entouraient jadis chez mon père.
— C’est que tu m’aimes, bonne Roselmida, dit la pauvre fille. On peut donc s’habituer à moi; on peut donc oublier ma laideur. Oh! je tâcherai d’être bonne, et alors les autres m’aimeront peut-être aussi.
Elles arrivèrent vers le soir auprès de la Caverne-Noire. Le dragon leur fit grand’peur; il était d’une taille monstrueuse et avait deux grandes ailes noires sur le dos. Il se mit à rugir en voyant les jeunes aventurières. La princesse tremblait de tous ses membres.
Amythe, tout en tremblant aussi, commença à chanter, faiblement d’abord et d’une voix entrecoupée; puis, voyant s’adoucir les yeux étincelants du dragon, elle reprit quelque assurance et donna à sa voix tout le charme irrésistible dont elle était douée. Le dragon cessa de rugir; peu à peu il tomba dans une espèce de somnolence. Roselmida guettait ce moment: elle se précipita dans la caverne et en ressortit bientôt triomphante, avec un flacon de cristal de roche tout rempli d’une eau claire et transparente.
Elle se mit à courir de toutes ses forces; Amythe la suivit en chantant toujours, jusqu’à ce qu’elles fussent à une grande distance de la caverne du dragon. La princesse ne se possédait pas de joie.
— Je l’ai! je l’ai, chère Amythe! Oh! quel trésor à rapporter chez mon père! Mon voyage, si pénible qu’il ait pu être, n’aura pas été inutile; je le recommencerais tout de suite pour un pareil bonheur. Tu ne seras plus jalouse de ma beauté maintenant, mon Amythe: c’est à toi que je la devrai.
Comme elle parlait ainsi, elle aperçut tout à coup auprès d’elle le vieux bûcheron, sans pouvoir se rendre compte de la manière dont il y était venu. Il paraissait tout ragaillardi; sa taille s’était redressée, et il considérait la princesse d’un air malin.
— Eh bien! ma belle, avons-nous cette eau sans pareille? Avons-nous pu charmer cet effrayant dragon?
— Oui, oui, bon vieillard! s’écria la princesse ravie; c’est à vous aussi, aux renseignements que vous m’avez donnés que je suis redevable de cette joie! Oh! croyez que je ne l’oublierai pas. Ma beauté ne pourra plus s’effacer désormais, et mon bonheur sera éternel.
— Vous ne connaissez pourtant pas encore toutes les miraculeuses propriétés de cette eau, mon enfant. Non-seulement elle peut conserver la beauté de celle qui est douée de ce précieux avantage, mais elle pourrait aussi le procurer à celle qui en est privée.
Et son regard se dirigeait malicieux vers Amythe.
Celle-ci avait tressailli. Une vive rougeur couvrait son visage, sa respiration était haletante et entrecoupée, ses membres tremblaient.
La princesse aussi paraissait troublée: elle s’éloigna un peu de son amie et pressa plus étroitement son trésor contre son sein.
A partir de cet instant, une certaine mésintelligence recommença à régner entre les deux jeunes filles. Le souvenir des services mutuellement rendus s’effaça presque tout à fait. Roselmida se méfiait instinctivement de sa compagne. La nuit, elle se réveillait avec anxiété pour s’assurer qu’elle avait bien toujours son cher flacon; le jour, elle le tenait pressé contre elle.
Amythe, de son côté, s’apercevait de la défiance de la princesse, et elle s’en trouvait blessée, tout en éprouvant un irrésistible désir de posséder l’eau merveilleuse.
— Oh! pourquoi, se disait-elle, ce maudit vieillard n’a-t-il pas tout dit dès l’abord? C’est moi qui serais entrée dans la caverne! c’est moi qui me serais emparée de ce bien sans prix! N’est-ce pas à moi qu’il était dû ? C’est ma voix qui a engourdi ce formidable dragon. Qu’aurait pu faire Roselmida sans mon secours? De quel droit garde-t-elle pour elle seule le trésor que nous nous sommes réunies pour acquérir?
Et elle brûlait de s’en rendre maîtresse; puis, songeant au prix qu’y attachait la princesse, elle hésitait. Oh! si elle avait pu presser à son tour dans ses mains ce flacon, qui valait plus que la vie, et pour lequel toutes deux l’avaient risquée!
Il était là, et, grâce à lui, elle pourrait aussi devenir belle, belle comme Roselmida, et belle pour toute son existence. Le vertige s’emparait d’elle. Le bonheur, qu’elle avait toujours regardé comme impossible, elle le tenait presque, elle pouvait le saisir: elle aussi serait enviée, admirée, aimée, recherchée. A son tour, elle pourrait charmer, plaire, jouir de tous les enivrements de la jeunesse, dont elle avait toujours été si cruellement frustrée. N’avait-elle donc pas montré à la princesse un dévouement assez complet, assez constant? Pourquoi renoncer encore pour elle à ce bien précieux, qui semblait venir s’offrir de lui-même?
Un violent combat s’élevait dans son cœur, qu’une sourde amertume recommençait à gonfler.
Cependant la route, si unie et si douce, que les jeunes voyageuses se croyaient au bout de leurs peines, reprenait quelques aspérités; les ronces y remplaçaient les fleurs; les ombrages devenaient plus rares; des cailloux meurtrissaient de nouveau leurs pieds.
Un soir enfin, elles arrivèrent, brisées de fatigue, sur les bords d’un torrent presque tari. Elles s’y préparèrent chacune une couche avec des feuilles sèches et quelques herbes qu’elles arrangèrent dans le creux des rochers qui bordaient le torrent. Elles s’y étendirent, un peu éloignées l’une de l’autre et sans se parler, après un maigre repas. Elles sentaient bien que la fée n’était pas contente d’elles, mais chacune avait son motif pour se tenir à l’écart.
Au milieu de la nuit, la princesse s’éveilla, comme à son ordinaire, pour s’assurer qu’elle tenait toujours sur elle sa fiole enchantée. Elle sentit ses pieds tout mouillés et se dressa brusquement. La lune éclairait la campagne, et, à sa pâle lueur, Roselmida s’aperçut avec effroi que le torrent s’était gonflé pendant la nuit et qu’il était tout débordé. L’eau montait avec rapidité. Encore quelques instants et il ne serait plus possible de s’enfuir!
Elle se leva précipitamment, et, courant à sa compagne, elle l’appela avec terreur.
— Réveille-toi, Amythe; fuyons! Ce torrent augmente à vue d’œil: l’eau est descendue de la montagne pendant que nous reposions, et, si nous ne nous hâtons, elle va nous engloutir.
Amythe, éveillée en sursaut, promena autour d’elle des yeux hagards; puis, entendant les flots mugir, elle bondit sur ses pieds, et, saisissant le bras de Roselmida, elle s’enfuit avec elle.
Toutes deux couraient aussi fort qu’elles le pouvaient, mais l’eau les gagnait de vitesse. Elles se heurtaient à chaque pas contre les rochers et seraient infailliblement tombées, si elles ne se fussent soutenues mutuellement. Le sentiment du danger commun leur fit oublier leurs derniers dissentiments; elles ne songèrent plus au trésor qui les avait tant troublées, et, toute leur affection leur revenant au cœur, elles n’eurent plus qu’un désir, celui de se préserver l’une l’autre et d’échapper à l’eau menaçante.
Elles ne sortirent qu’à grand’peine des flots qui semblaient les poursuivre. Le jour parut, pâle et blafard, mais ne vint les éclairer que pour mieux leur montrer toute l’étendue des périls qu’elles couraient, car leur fuite se trouva tout à coup arrêtée par un affreux précipice dont on ne pouvait voir le fond: des ronces, des herbes sauvages en tapissaient l’entrée. Elles y jetèrent des pierres pour s’assurer de sa profondeur, et ces pierres retentissaient longtemps en rebondissant d’un rocher à l’autre. Un arbre, brisé par l’orage, était tombé en travers du gouffre et offrait aux fugitives un pont étroit et mouvant, suspendu sur l’abîme.
Roselmida, éperdue, saisie de vertige à cet horrible aspect, s’écria:
— C’en est fait! c’est ici que je dois mourir! Je ne reverrai jamais mon père et ma patrie; jamais je ne pourrai franchir cet étroit espace. Laisse-moi, Amythe; va, continue ta route, tu es forte et hardie, tu pourras surmonter cet affreux obstacle; mais moi, il n’y a plus aucun espoir pour moi! L’eau va m’atteindre et je n’ai plus de forces pour l’éviter; après cette nuit terrible, ce dernier danger anéantit tout mon courage. Va, sauve-toi sans moi, mon amie.
Elle retomba au bord de l’abîme, pâle, épuisée et presque sans connaissance.
— Sans toi, sans toi, ma bien-aimée! s’écria Amythe; sans toi, ma fidèle, mon inséparable compagne, à qui ces nouveaux malheurs, affrontés ensemble, viennent de me rattacher plus que jamais! Oh! non. Reprends courage! Allons! franchissons ce périlleux passage! De l’autre côté sont le retour, le bonheur, le salut, la liberté, ton père qui t’attend, Roselmida. Courage! nous arriverons au but de nos efforts; nous retrouverons ton palais, ton royaume; mais ne te laisse point abattre; rassemble toutes tes forces, mon amie, ma sœur!
Celle-ci ne l’entendait plus; ce dernier coup l’avait anéantie. Les yeux fermés, la tête renversée sur une pierre, elle semblait n’avoir plus qu’un souffle de vie.
Amythe hésita quelques instants; elle consulta ses forces, mesura de l’œil le gouffre effrayant, regarda derrière elle la campagne métamorphosée en lac et l’eau qui allait atteindre sa compagne expirante; puis, animée d’un généreux courage, elle la saisit dans ses bras et s’élança sur le pont vacillant, sans regarder au fond de l’abîme, et les yeux fixés sur l’autre bord.
Elle y arriva heureusement; mais là, épuisée de son effort surhumain, elle tomba à son tour sur un rocher, sans force et sans couleur.
Roselmida, pendant ce temps, reprenait peu à peu ses esprits et ne pouvait croire à son bonheur en se voyant de l’autre côté du précipice et hors des atteintes de l’eau déchaînée.
— Oh! ma brave Amythe, c’est toi qui m’as amenée ici! Mais ton effort t’a brisée; ranime-toi, mon amie, ma bonne, ma vaillante libératrice, toi qui viens de risquer ta vie pour sauver la mienne!
Et elle frappait dans les mains de sa compagne, en tâchant de la faire revenir à elle; puis, la voyant entr’ouvrir les yeux, mais trop faible encore pour pouvoir parler, elle se précipita à ses genoux, et, tirant de son sein le flacon merveilleux arraché au dragon de la Caverne-Noire, elle le lui présenta en tremblant.
— Tiens, lui dit-elle, il est pour toi; tu as sauvé ma vie; prends ce que j’estimais encore plus, et je serai quitte envers toi. Deviens belle, mon Amythe, et, avec toutes les qualités que j’ai découvertes en toi, rien ne te manquera plus désormais. Tu seras parfaite. Pour moi, je me trouverai heureuse de ton bonheur.
Des larmes s’échappaient de ses yeux en parlant ainsi; sa voix brisée, son sein haletant, sa pâleur mortelle, tout trahissait le violent effort qu’elle faisait et tout ce qu’il lui coûtait.
Amythe n’hésita pas. Elle se jeta sur la fiole précieuse, qu’elle saisit avidement.
En ce moment, le précipice disparut, les rochers arides s’évanouirent; un riant jardin s’étendait devant Roselmida, avec ses longues allées sablées, ses corbeilles de fleurs et ses massifs d’arbres.
— Mais ce sont les jardins de mon père, s’écria-t-elle transportée de joie; voilà son palais! Je suis de retour, je suis dans mes États; mon voyage est fini!
Et elle se leva en battant des mains.
Cependant on l’avait reconnue. Sa toilette s’était transformée sans qu’elle s’en aperçût, et elle se trouvait revêtue d’habillements convenables à son rang et à la position qu’elle reconquérait.
On courut prévenir le roi du retour de sa fille. Il était inconsolable de sa perte. Tout le monde l’avait crue morte, ainsi qu’Amythe. On avait retrouvé, dans le bois où la chasse avait eu lieu, sa longue plume blanche sur le gazon et le voile d’Amythe accroché à des ronces. La jeune Ethel s’était souvenue de les avoir laissées ensemble auprès de cet endroit, et personne n’espérait plus les revoir jamais, car on pensait qu’elles avaient été dévorées par des bêtes féroces.
Le roi se précipita au-devant de sa fille bien-aimée, et il la tint bien longtemps embrassée en pleurant de plaisir.
Cependant des cris de joie retentissaient de tous côtés. C’était à qui s’approcherait de la princesse; chacun cherchait à baiser ses mains et jusqu’aux plis de sa robe. Elle souriait en voyant l’amour et l’adoration qui éclataient autour d’elle.
Quelque chose pourtant manquait encore à l’ivresse de son bonheur. Elle regardait autour d’elle et n’apercevait point la compagne inséparable de son pénible voyage, celle qui avait partagé toutes ses douloureuses épreuves, celle qui lui avait sauvé la vie, et à laquelle son cœur avait voué une éternelle amitié.
Parmi toutes les beautés qui l’environnaient, quelle pouvait être la gracieuse figure qu’Amythe avait revêtue? Elle devait être la plus belle, comme elle était la meilleure et la plus aimée de toutes.
— Oh! mon père, s’écria la princesse, il faut que je vous présente ma libératrice, mon amie, plus aimée qu’une sœur, celle à qui je dois le bonheur de vous revoir encore.
Amythe, où donc es-tu?
— Me voici! dit une douce voix auprès d’elle.
Et Amythe sortit du groupe de ses compagnes, non point transformée, mais toujours avec sa même figure et son modeste costume d’autrefois.
— Eh quoi! toujours la même! Qu’attends-tu donc? Qu’as-tu fait de mon présent? Pourquoi n’es-tu pas encore belle?
— Parce que j’ai réfléchi, ma princesse. Que deviendrais-tu toi-même, privée de ces charmes qui font ton bonheur et ta vie, et dont tu es si fière et si heureuse? Je suis habituée à m’en passer, moi.
La Fée nous a fait faire un rude voyage, mais je me figure qu’il ne nous a pas été tout à fait inutile, et depuis que je l’ai entrepris, j’ai cru m’apercevoir que la beauté n’était pas la première des qualités ni même le premier des biens.
As-tu réfléchi, ma Roselmida, au peu de durée de ces attraits si enchanteurs et si passagers? Ne vois-tu pas déjà arriver la vieillesse, l’inévitable vieillesse, avec son cortége de rides et de glaçons? Attendras-tu qu’elle vienne ternir l’éclat si pur de tes yeux, argenter ton opulente chevelure, épaissir et voûter ta taille si gracieuse et si souple? Oh! non.
Et, pour que la tentation ne te revienne pas de te dessaisir encore de ton trésor, pour qu’elle ne me revienne pas à moi-même d’en profiter, ajouta-t-elle avec un triste sourire, faisons-en usage tout de suite.
Et, débouchant le flacon avant que Roselmida eût le temps de s’opposer à son rapide mouvement, elle en vida le contenu, à plusieurs reprises, dans le creux de sa main, et en aspergea le visage de la princesse, dont la beauté sembla revêtir un nouvel éclat sous cette magique influence.
Tout le monde applaudit avec transport à ce généreux dévouement d’une amitié sans bornes.
En ce moment on entendit un grand bruit, et l’on vit arriver un char merveilleux, fait d’une seule opale, et traîné par deux animaux étranges et inconnus, à l’air fier et doux, ayant une seule corne au milieu de la tête, avec une grosse escarboucle sur le front, et une épaisse fourrure qui traînait jusqu’à terre, semblable à de longues soies.
Dans le char se trouvait une femme d’une beauté étrange, et qui semblait revêtue de vapeurs argentées.
Les jeunes filles reconnurent la fée Brouillard, et coururent se prosterner devant elle.
Le roi vint lui offrir sa main pour l’aider à descendre de sa voiture.
— O roi, lui dit-elle, je vous rends votre fille aussi belle qu’autrefois, et belle maintenant pour toute sa vie; je vous la rends améliorée et purifiée par le malheur. J’ai arraché de son cœur l’égoïsme et la dureté ; elle est à présent bonne et compatissante autant que belle, et elle fera le charme et le bonheur de vos vieux jours.
Me reconnaissez-vous bien, mes enfants? ajouta-t-elle en se tournant vers les jeunes filles. C’est moi qui, sous les traits de votre hôtesse, me suis permis de donner une leçon à ma belle princesse; c’est moi qui, déguisée en bûcheron, vous ai indiqué cette eau que vous avez trouvée si précieuse; c’est moi qui ai cherché à faire pressentir à Roselmida le meilleur moyen de s’en servir, en l’employant à récompenser le dévouement et l’affection d’Amythe. Voyant que ma petite ruse, au lieu du bon résultat que j’en attendais, n’avait fait que ranimer en vos cœurs de mauvais sentiments que j’y croyais éteints à tout jamais, j’ai été forcée de recourir à une dernière épreuve, plus douloureuse qu’aucune de celles que je vous avais fait subir. J’espère que vous me la pardonnerez, mes chères enfants, maintenant que vous en êtes sorties si heureusement.
Généreuse Amythe, tu as sacrifié ce bien, que tu désirais avec tant d’ardeur. Je tâcherai, fille aimante et dévouée, de te rendre en bonheur et en contentement intérieur les joies qu’eût pu te donner cette beauté à laquelle tu as si courageusement renoncé.
J’avais connu et aimé autrefois vos deux mères, et je leur avais promis de veiller sur vous. J’ai tenu ma promesse. Amythe ne connaîtra plus jamais l’envie, n’est-ce pas? Et Roselmida ne dédaignera plus personne. Si je vous ai fait souffrir, vous avez, je crois, tiré un bon et fructueux parti de vos souffrances, et vous n’aurez pas à regretter de les avoir subies.
Tenez, mes enfants, voici les cadeaux que je vous destine.
Et ouvrant un grand coffre en bois de sandal, qui sortit de terre à ses côtés, elle en tira: pour Roselmida, un écrin tout ruisselant de pierreries; pour Amythe, une harpe d’or avec son chiffre incrusté en diamants, et dont les cordes rendaient les sons les plus doux aussitôt qu’on y posait les doigts.
Pour la première, une robe si légère et si transparente, qu’elle semblait tissue avec ces vapeurs qu’on voit flotter sur les prairies au lever du jour.
Pour la seconde, les livres les plus merveilleux et les plus variés, où l’on pouvait tout étudier et tout apprendre.
Puis encore pour la princesse, un diadème qui paraissait fait d’étoiles, tant les pierres qui le coin-posaient étaient d’une matière inconnue et brillante.
Pour sa compagne, un métier à broderie, d’un bois de senteur extraordinaire, et couvert d’une foule d’ouvrages commencés, avec les dessins les plus beaux et les plus fantastiques.
— A chacune votre lot!
Et le tien, mon enfant, dit la fée en se tournant vers Amythe avec un sourire affectueux, n’est peut-être pas le plus mauvais.
Et maintenant adieu, soyez heureuses.
Puis, les embrassant chacune sur le front, elle salua la foule émerveillée avec une grâce et une dignité incomparables, et, acceptant la main du roi, elle remonta dans son char.
Les animaux qui la conduisaient bondirent légèrement et partirent avec rapidité ; le char s’éloigna et se perdit dans une brume légère, qui laissa après elle une vague odeur d’ambroisie.
Amythe ne reparut plus aux fêtes de la cour, pour lesquelles elle sentit qu’elle n’était point faite. Elle consacra désormais sa vie à la retraite, à la prière, à l’étude, à la méditation; elle aima le travail, cet austère consolateur.
Elle avait compris que, toute disgraciée qu’elle parût, elle était mieux douée peut-être pour accomplir sa tâche terrestre que la princesse Roselmida elle-même, avec toute sa délicate beauté. N’avait-elle pas en effet la force, le courage, la patience, la santé, l’énergie, l’intelligence et l’amour du bien?
Elle étudia l’histoire des peuples; elle aima la lecture et la poésie, qui charmèrent ses loisirs. Elle mariait les sons de sa harpe aux accords de sa voix enchanteresse. De magnifiques broderies, des tapisseries aux couleurs éclatantes s’allongèrent sous ses doigts agiles; sa nature mélancolique et son peu d’attraits la portaient à fuir les heureux de la terre, mais elle aimait à aller s’asseoir au chevet des malades, qu’elle soulageait par ses soins ou tout au moins par ses paroles consolantes. Nul malheur ne l’implora jamais en vain. Elle eut quelques amis en petit nombre, mais sincères et dévoués, en tête desquels furent toujours la princesse Roselmida et le roi, qui l’aima comme une seconde fille. Elle avait gardé de ses voyages le goût des longues courses dans la campagne, où elle se plaisait à étudier les insectes et les fleurs, surtout les plantes qui avaient quelques propriétés pour adoucir les souffrances humaines, et dont elle apprenait à faire usage.
Elle amassa sans rien dire un trésor impérissable de connaissances précieuses et de pensées morales qu’elle résuma dans un livre qui eût pu immortaliser son nom, et que toutes les mères de son temps mirent entre les mains de leurs enfants; — mais modeste autant que bonne, — elle ne voulut pas le signer, et c’est à lui que tous les écrivains qui ont depuis travaillé pour la jeunesse ont emprunté leurs meilleures inspirations.
Avec tant d’occupations et de distractions variées, ses jours passaient comme des éclairs, et elle n’avait plus le temps de songer à sa laideur. Du reste, que lui importait à présent? N’était-elle pas aimée et estimée de tout le monde? La fée, tout en ne lui accordant pas la beauté, ne l’en avait-elle pas richement dédommagée? D’ailleurs la sérénité de son âme se reflétait sur ses traits et leur prêtait une douceur et un charme qui manquaient à bien des femmes belles et brillantes.
Pendant ce temps, la belle princesse Roselmida continuait à faire l’ornement et la joie des fêtes de son père. Seulement, quand elle y voyait paraître quelque femme laide, vieille, infirme ou souffrante, elle redoublait de soins et d’attentions pour elle. Sa beauté ne se flétrit jamais, grâce à son eau merveilleuse.
Elles ne revirent plus la fée Brouillard, mais elles lui conservèrent toujours un souvenir reconnaissant. En les soumettant à de difficiles épreuves, cette bonne fée ne les avait-elle pas en effet rendues meilleures, et par conséquent plus heureuses?