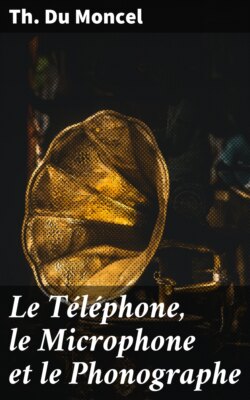Читать книгу Le Téléphone, le Microphone et le Phonographe - Th. Du Moncel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TÉLÉPHONES MUSICAUX.
ОглавлениеTable des matières
Téléphone de M. Reiss.—Le téléphone de M. Reiss est fondé, quant à la reproduction des sons, sur les effets découverts par M. Page en 1837 et, pour leur transmission électrique, sur le système à membrane vibrante utilisé dès 1855 par M. L. Scott dans son phonautographe. Cet appareil se compose donc, comme les systèmes télégraphiques, de deux parties distinctes, d'un transmetteur et d'un récepteur, et nous les représentons fig. 1.
Fig. 1.
Le transmetteur était essentiellement constitué par une boîte sonore K, qui portait à sa partie supérieure une large ouverture circulaire à travers laquelle était tendue une membrane, et au centre de celle-ci était adapté un léger disque de platine o, au-dessus duquel était fixée une pointe métallique b, qui constituait avec le disque l'interrupteur. Sur une des faces de cette boîte sonore K, se trouvait une sorte de porte-voix T qui était destiné à recueillir les sons et à les diriger à l'intérieur de la boîte pour les faire réagir ensuite sur la membrane. Une partie de la boîte K est brisée sur la figure pour qu'on puisse distinguer les différentes parties qui la composent.
Les tiges a, c, qui portent la pointe de platine b, sont réunies métalliquement avec une clef Morse t, placée sur le côté de la boîte K, et avec un électro-aimant A, qui appartient à un système télégraphique destiné à échanger les signaux nécessaires à la mise en action des deux appareils aux deux stations.
Le récepteur est constitué par une caisse sonore B, portant deux chevalets d, d, sur lesquels est soutenu un fil de fer d d de la grosseur d'une aiguille à tricoter. Une bobine électro-magnétique g enveloppe ce fil et se trouve enfermée par un couvercle D, qui concentre les sons déjà amplifiés par la caisse sonore; cette caisse est même munie, à cet effet, de deux ouvertures pratiquées au-dessous de la bobine.
Le circuit de ligne est mis en rapport avec le fil de cette bobine par les deux bornes d'attache 3 et 4, et une clef Morse t se trouve placée sur le côté de la caisse B pour l'échange des correspondances.
Pour faire fonctionner ce système, il suffit de faire parler l'instrument dont on veut transmettre les sons devant l'ouverture T, et cet instrument peut être une flûte, un violon ou même la voix humaine. Les vibrations de l'air déterminées par ces instruments font vibrer à l'unisson la membrane téléphonique, et celle-ci, en approchant et éloignant rapidement le disque de platine o de la pointe b, fournit une série d'interruptions de courant qui se trouvent répercutées par le fil de fer d d et transformées en vibrations métalliques, dont le nombre est égal à celui des sons successivement produits.
D'après ce mode d'action, on comprend donc qu'il soit possible de transmettre les sons avec leur valeur relative; mais l'on conçoit également que ces sons ainsi transmis n'auront pas le timbre de ceux qui leur donnent naissance, car le timbre est indépendant du nombre des vibrations, et, il faut même le dire ici, les sons produits par l'appareil de M. Reiss avaient un timbre de flûte à l'oignon qui n'avait rien de séduisant; toutefois le problème de la transmission électrique des sons musicaux était bien réellement résolu, et l'on pouvait dire en toute vérité qu'un air ou une mélodie pouvait être entendu à une distance aussi grande qu'on pouvait le désirer.
L'invention de ce téléphone date, comme on l'a déjà vu, de l'année 1860, et le professeur Heisler en parle dans son traité de physique technique, publié à Vienne en 1866; il prétend même dans l'article qu'il lui a consacré, que, quoique dans son enfance, cet appareil était susceptible de transmettre non-seulement des sons musicaux, mais encore des mélodies chantées. Ce système fut ensuite perfectionné par M. Vander-Weyde, qui, après avoir lu la description publiée par M. Heisler, chercha à rendre la boîte de transmission de l'appareil plus sonore et les sons produits par le récepteur plus forts. Voici ce qu'il dit à ce sujet dans le Scientific american Journal:
«Ayant fait construire en 1868 deux téléphones du genre de celui décrit précédemment, je les montrai à la réunion du club polytechnique de l'Institut américain. Les sons transmis étaient produits à l'extrémité la plus éloignée du Cooper Institut, et tout à fait en dehors de la salle où se trouvaient les auditeurs de l'association; l'appareil récepteur était placé sur une table, dans la salle même des séances. Il reproduisait fidèlement les airs chantés, mais les sons étaient un peu faibles et un peu nasillards. Je songeai alors à perfectionner cet appareil, et je cherchai d'abord à obtenir dans la boîte K des vibrations plus puissantes en les faisant répercuter par les côtés de cette boîte au moyen de parois creuses. Je renforçai ensuite les sons produits par le récepteur, en introduisant dans la bobine plusieurs fils de fer, au lieu d'un seul. Ces perfectionnements ayant été soumis à la réunion de l'Association américaine pour l'avancement des sciences qui eut lieu en 1869, on exprima l'opinion que cette invention renfermait en elle le germe d'une nouvelle méthode de transmission télégraphique qui pourrait conduire à des résultats importants. Cette appréciation devait être bientôt justifiée par la découverte de Bell et d'Elisha Gray.
Téléphone de MM. Cécil et Léonard Wray.—Ce système, que nous représentons fig. 2 et 3, n'est qu'un simple perfectionnement de celui de M. Reiss, imaginé en vue de rendre les effets produits plus énergiques. Ainsi le transmetteur est muni de deux membranes au lieu d'une, et son récepteur, au lieu d'être constitué par un simple fil de fer recouvert d'une bobine magnétisante, se compose de deux bobines distinctes, H, H', fig. 2, placées dans le prolongement l'une de l'autre, et à l'intérieur desquelles se trouvent deux tiges de fer. Ces tiges sont fixées par une de leurs extrémités à deux lames de cuivre A, B, maintenues elles-mêmes dans une position fixe au moyen de deux piliers à écrous I, I', et les deux autres extrémités de ces tiges, entre les bobines, sont disposées à une très-petite distance l'une devant l'autre, mais sans cependant se toucher. Le système est d'ailleurs monté sur une caisse sonore, munie d'un trou T dans l'espace correspondant à l'intervalle séparant les bobines, et celles-ci communiquent avec quatre boutons d'attache qui sont mis en rapport avec le circuit de ligne de telle manière que les polarités opposées des deux tiges soient de signes contraires, et ne forment qu'un seul et même aimant coupé par le milieu. Il paraît qu'avec cette disposition les sons produits sont beaucoup plus accentués.
Fig. 2.
La forme du transmetteur est aussi un peu différente de celle que nous avons décrite précédemment; la partie supérieure, au lieu d'être horizontale, est un peu inclinée, comme on le voit fig. 3, et l'ouverture E par laquelle les sons doivent se communiquer à la membrane vibrante, occupe une grande partie du côté le plus élevé de la caisse, qui, à cet effet, se présente sous une certaine obliquité. La seconde membrane G, qui est en caoutchouc, forme une sorte de cloison qui divise en deux la caisse, à partir du bord supérieur de l'ouverture, et, d'après l'inventeur, elle aurait pour effet, tout en augmentant l'amplitude des vibrations produites par la membrane extérieure D, comme dans un tambour, de protéger celle-ci contre les effets de la respiration et plusieurs autres causes nuisibles. L'interrupteur lui-même diffère aussi de celui de l'appareil de M. Reiss. Ainsi le disque de platine b, appelé à fournir les contacts, n'est mis en rapport métallique avec le circuit que par l'intermédiaire de deux petits fils de platine ou d'acier qui plongent dans deux petits godets a, c remplis de mercure et reliés à ce circuit. Par ce moyen, la membrane D se trouve libre dans ses mouvements et peut vibrer plus facilement.
Fig. 3.
L'interruption est d'ailleurs effectuée par une petite pointe de platine portée par un levier à ressort articulé KH qui se trouve au-dessus du disque, et dont l'extrémité, étant fixée au-dessous d'une sorte de clef Morse MI, permet d'effectuer à la main les fermetures de courant nécessaires à l'échange des correspondances pour la mise en train des appareils.
Harmonica électrique.—Longtemps avant M. Reiss et à plus forte raison longtemps avant M. Elisha Gray qui a imaginé un téléphone du même genre, j'avais fait mention d'une sorte d'harmonica électrique qui a été décrit de la manière suivante dans le tome I, p. 167, de la première édition de mon Exposé des applications de l'électricité publié en 1853[4].
«La faculté que possède l'électricité de mettre en mouvement des lames métalliques et de les faire vibrer, a pu être utilisée à la production de sons distincts, susceptibles d'être combinés et harmonisés; mais, en outre de cette application toute physique, l'électro-magnétisme a pu venir en auxiliaire à certains instruments, tels que pianos, orgues, etc., pour leur donner la facilité d'être joués à distance. Ainsi jusque dans les arts en apparence les moins susceptibles de recevoir de l'électricité quelque application, cet élément si extraordinaire a pu être d'un secours utile.
«Nous avons déjà parlé de l'interrupteur de M. de la Rive. C'est, comme on le sait, une lame de fer soudée à un ressort d'acier et maintenue dans une position fixe vis-à-vis un électro-aimant, par un autre ressort ou un butoir métallique en connexion avec l'une des branches du courant. Comme l'autre branche, après avoir passé dans le fil de l'électro-aimant aboutit à la lame de fer elle-même, l'électro-aimant n'est actif qu'au moment où cette lame touche le butoir ou le ressort d'arrêt; mais aussitôt qu'elle l'abandonne, l'aimantation cesse, et la lame de fer revient en son point d'arrêt, puis l'abandonne ensuite. Il se détermine donc une vibration d'autant plus rapide que la longueur de la lame vibrante est plus courte, et que la force est plus grande par suite du rapprochement de la lame de l'électro-aimant.
«Pour rendre les sons de plus en plus aigus, il ne s'agit donc que d'employer l'un ou l'autre des deux moyens. Le plus simple est d'avoir une vis que l'on serre ou que l'on desserre à volonté, et qui par cela même éloigne plus ou moins la lame vibrante de l'électro-aimant. Tel est l'appareil de M. Froment au moyen duquel il a obtenu des sons d'une acuité extraordinaire, bien qu'étant fort doux à l'oreille.
«M. Froment n'a pas fait de cet appareil un instrument de musique; mais on conçoit que rien ne serait plus facile que d'en constituer un; il ne s'agirait pour cela que de faire agir les touches d'un clavier sur des leviers métalliques, dont la longueur des bras serait en rapport avec le rapprochement de la lame nécessité pour la vibration des différentes notes. Ces différents leviers, en appuyant sur la lame, joueraient le rôle du butoir d'arrêt, mais ce butoir varierait de position suivant la touche.
«Si le courant était constant, un pareil instrument aurait certainement beaucoup d'avantages sur les instruments à anches dont on se sert, en ce sens qu'on aurait une vibration aussi prolongée qu'on le voudrait pour chaque note, et que les sons seraient plus veloutés; malheureusement l'inégalité d'action de la pile en rend l'usage bien difficile. Aussi ne s'est-on guère servi de ce genre d'appareils que comme régulateurs auditifs pour l'intensité des piles, régulateurs infiniment plus commodes que les rhéomètres, puisqu'ils peuvent faire apprécier les différentes variations d'une pile pendant une expérience, sans qu'on soit obligé d'en détourner son attention.»
En 1856, M. Pétrina, de Prague, imagina un dispositif analogue auquel il donna le nom d'harmonica électrique, bien qu'à proprement parler il ne constituât pas dans sa pensée un instrument de musique.
Voici ce que j'en disais dans le tome IV de la seconde édition de mon exposé des applications de l'électricité publié en 1859.
«Le principe de cet appareil est le même que celui du rhéotome de Neef, au marteau duquel on a substitué une baguette dont les vibrations transversales produisent un son. Quatre de ces baguettes, différentes en longueur, sont placées l'une à côté de l'autre, et étant mises en mouvement au moyen de touches, puis arrêtées par des leviers, produisent des sons de combinaison dont il devient facile de démontrer l'origine.»
Dans ce qui précède je ne dis pas, il est vrai, que ces appareils pouvaient être joués à distance; mais cette idée était toute naturelle, et les journaux allemands prétendent que M. Pétrina l'avait réalisée même avant 1856. Elle était la conséquence de ce que je disais en débutant: «que l'électro-magnétisme pouvait venir en auxiliaire à certains instruments tels que pianos, orgues, etc., pour leur donner la facilité d'être joués à distance», et j'indiquais plus loin les moyens employés pour cela et même pour les faire fonctionner sous l'influence d'une petite boîte à musique. Je n'y avais du reste pas attaché d'importance, et ce n'est que comme document historique que je parle de ces systèmes.
Téléphone de M. Elisha Gray, de Chicago.—Ce système, imaginé en 1874, n'est en réalité qu'un appareil du genre de ceux qui précèdent, mais avec des combinaisons importantes qui ont permis de l'appliquer utilement à la télégraphie. Dans un premier modèle il mettait à contribution une bobine d'induction à deux hélices superposées, dont l'interrupteur, qui était à trembleur, était multiple et disposé de manière à produire des vibrations assez nombreuses pour émettre des sons. Ces sons, comme on l'a vu, peuvent avec cette disposition être modifiés suivant la manière dont l'appareil est réglé, et s'il existe à côté les uns des autres un certain nombre d'interrupteurs de ce genre, dont les lames vibrantes soient réglées de manière à fournir les différentes notes de la gamme sur plusieurs octaves, on pourra, en mettant en action tels ou tels d'entre eux, exécuter sur cet instrument d'un nouveau genre un morceau de musique dont les sons se rapprocheront de ceux produits par les instruments à anches, tels que harmoniums, accordéons, etc. La mise en action de ces interrupteurs pourra d'ailleurs être effectuée au moyen du courant primaire de la bobine d'induction qui circulera à travers l'un ou l'autre des électro-aimants de ces interrupteurs, sous l'influence de l'abaissement de l'une ou l'autre des touches d'un clavier commutateur, et les courants secondaires qui naîtront dans la bobine sous l'influence de ces courants primaires interrompus, pourront transmettre des vibrations correspondantes à distance sur un récepteur. Celui-ci pourrait être analogue à ceux dont nous avons parlé précédemment pour les téléphones de Reiss, de Wray, etc., mais M. Gray a dû le modifier pour obtenir des effets plus amplifiés.
Nous représentons (fig. 4) la disposition de ce premier système. Les vibrateurs sont en A et A', les touches du clavier en M et M', la bobine d'induction en B, et le récepteur en C. Ce récepteur se compose, comme on le voit, d'un simple électro-aimant NN' au-dessus des pôles duquel est adaptée une caisse cylindrique en métal C dont le fond est en fer et sert d'armature. Cette boîte étant percée comme les violons de deux trous en S, joue le rôle de caisse sonore, et M. Elisha Gray a reconnu que les mouvements moléculaires déterminés au sein du noyau magnétique et de son armature, sous l'influence des alternatives d'aimantation et de désaimantation, étaient suffisants pour engendrer des vibrations en rapport avec la rapidité de ces alternatives, et fournir des sons qui devenaient perceptibles par suite de leur amplification par la boîte sonore.
Fig. 4.
S'il faut en croire M. Elisha Gray, les vibrations transmises par des courants secondaires seraient capables de faire résonner à distance, par l'intermédiaire du corps humain, des lames conductrices susceptibles d'entrer facilement en vibration et disposées sur des caisses sonores. Ainsi l'on pourrait faire produire des sons musicaux à des cylindres de cuivre placés sur une table, à une plaque métallique appliquée sur une sorte de violon, à une feuille de clinquant tendue sur un tambour ou à toute autre substance résonnante, en touchant d'une main ces différents corps et en prenant de l'autre le bout du fil du circuit. Ces sons qui pourraient avoir un timbre différent, suivant la nature de la substance touchée, reproduiraient la note transmise avec le nombre exact de vibrations qui lui correspond[5].
On comprend aisément que les effets obtenus dans le système représenté (fig. 4) pourraient être reproduits, si au lieu d'interrupteurs ou de rhéotomes électriques, on employait à la station de transmission des interrupteurs mécaniques disposés de manière à fournir le nombre d'interruptions de courants en rapport avec les vibrations des différentes notes de la gamme. On pourrait encore, par ce moyen, se dispenser de la bobine d'induction et faire réagir directement sur le récepteur le courant ainsi interrompu par l'interrupteur mécanique. M. Elisha Gray a du reste combiné une autre disposition de ce système téléphonique qu'il a appliquée à la télégraphie pour les transmissions électriques simultanées, et dont nous parlerons plus tard.
Téléphone de M. Varley.—Ce téléphone n'est à proprement parler qu'un téléphone musical dans le genre de celui de M. Gray, mais dont le récepteur présente une disposition originale vraiment intéressante.
Cette partie de l'appareil est essentiellement constituée par un véritable tambour de grandes dimensions (3 ou 4 pieds de diamètre), dans l'intérieur duquel est placé un condensateur formé de quatre feuilles de papier d'étain séparées par des feuilles en matière parfaitement isolante, et dont la surface représente à peu près la moitié de celle du tambour. Les lames de ce condensateur sont disposées parallèlement aux membranes du tambour et à une très-petite distance de leur surface.
Si une charge électrique est communiquée à l'une des séries de plaques conductrices de ce condensateur, celles qui leur correspondront se trouveront attirées, et si elles peuvent se mouvoir, elles pourront communiquer aux couches d'air interposées un mouvement qui, en se communiquant aux membranes du tambour, pourront, pour une série de charges très-rapprochées les unes des autres, faire vibrer ces membranes et engendrer des sons; or ces sons seront en rapport avec le nombre des charges et décharges qui seront produites. Comme ces charges et décharges peuvent être déterminées par la réunion des deux armatures du condensateur aux extrémités du circuit secondaire d'une bobine d'induction dont le circuit primaire sera interrompu convenablement, on voit immédiatement que, pour faire émettre par le tambour un son donné, il suffira de faire fonctionner l'interrupteur de la bobine d'induction de manière à produire le nombre de vibrations que comporte ce son.
Le moyen employé par M. Varley pour produire ces interruptions est celui qui a été déjà mis en usage dans plusieurs applications électriques et notamment pour les chronographes; c'est un diapason électro-magnétique réglé de manière à émettre le son qu'il s'agit de transmettre. Ce diapason peut, en formant lui-même interrupteur, réagir sur le courant primaire de la bobine d'induction, et s'il y a autant de ces diapasons que de notes musicales à transmettre, et que les électro-aimants qui les animent soient reliés à un clavier de piano, il sera possible de transmettre de cette manière une mélodie à distance comme dans le système de M. Elisha Gray.
La seule chose particulière dans ce système est le fait de la reproduction des sons par l'action d'un condensateur, et nous verrons plus loin que cette idée, reprise par MM. Pollard et Garnier, a conduit à des résultats vraiment intéressants.[Table des Matières]