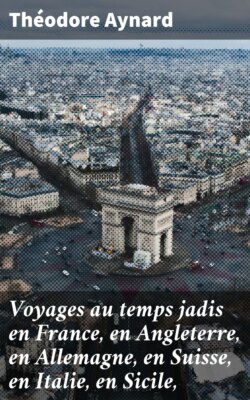Читать книгу Voyages au temps jadis en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Sicile, - Théodore Aynard - Страница 9
CHAPITRE PREMIER
ОглавлениеOù l'on voit le roi Louis XI, la poste et les postillons.
ans un de mes derniers voyages de Genève, une jeune dame assez jolie, autant qu'il m'en souvient, occupait avec moi le même compartiment d'un train express; le hasard seul avait fait notre rencontre, comme celle de la petite Sonia avec Tartarin sur les Alpes.
Il me fut facile de reconnaître que ce n'était pas le moins du monde une nihiliste russe, mais tout spirituellement une parisienne pur sang, dont la société ne m'exposait pas à faire connaissance avec les gendarmes, comme cela m'était une autre fois arrivé; j'aurai peut-être l'occasion de vous le dire.
En traversant le tunnel du Credo, elle s'étonnait que partie de Genève à onze heures du matin, elle ne pouvait arriver à Paris... le même jour, qu'à onze heures du soir.
Elle n'avait aucune idée de l'état de chose antérieur aux chemins de fer; elle les avait trouvés en venant au monde, elle les supposait aussi vieux que lui. Je l'aurais étonnée, je crois, en lui disant que ce n'était pas dans un wagon de première qu'Adam et Ève avaient déménagé de l'Éden.
Plus je pense à cette rencontre, plus je pense aussi que notre génération disparue, bien des gens seront comme ma parisienne, et ne pourront se faire aucune idée des voyages au temps jadis.
Il y a donc un certain intérêt à revenir sur ce passé, dont quelques-uns encore se souviennent et pourront me contrôler, et qui pour tous sera bientôt lettre close.
Mon titre a déjà besoin d'explication: qui sait aujourd'hui ce qu'était un voyage en poste?
Pour vous, jeune lecteur, la poste se résume dans l'uniforme, assez laid et souvent crotté, d'un facteur apportant lettres et journaux, et qui jamais, au premier de l'an, n'oublie de réclamer ses étrennes; qu'entre nous soit dit, il mérite généralement mieux que beaucoup d'autres; puis encore, dans une vilaine petite boîte, chez le marchand de tabac, où vous déposez vous-même votre correspondance, quand vous voulez être sûr qu'elle ne sera pas oubliée dans la poche d'un commissionnaire; comme le faisait toujours le comte J..., ministre des travaux publics sous Louis-Philippe, tant sa confiance dans son personnel était grande. On est bien loin d'être assuré, cependant, qu'elle arrive à sa destination, car on peut la dérober en route; je le sais par une expérience ennuyeuse et récente, que je tacherai d'oublier avant le 1er janvier, en pensant que c'est mon voleur qui a été volé.
Enfin, vous connaissez peut-être aussi le bureau de la poste restante, si vous n'en connaissez pas les mystères, et le guichet, où vous êtes obligé de faire queue pour payer vos dettes lointaines et transmettre aussi quelquefois vos cadeaux à distance, comme je l'espère pour vous, et surtout pour les destinataires.
Mais qu'il y a loin de cette poste, qui n'est plus qu'un service de distribution, à la poste ancienne, qui faisait elle-même le transport des lettres et des personnes.
La poste dont je vais parler datait de l'édit de Doullens, en 1464. Elle a disparu au milieu de notre siècle; elle a donc vécu quatre cents ans. Combien voyons-nous de choses qui ne durent pas si longtemps? Sans compter celles qui n'ont que dix-huit ans et qui durent déjà beaucoup trop pour l'intérêt de la chose publique et de bien des choses particulières.
Au dire de ses contemporains, le roi Louis XI était fort curieux de nouvelles et voulait, en outre, transmettre rapidement ses ordres dans tout le royaume.
Le premier, il fit établir dans les principales directions, des relais de chevaux de selle; en 1483, l'Angleterre suivit son exemple.
Le chef de chaque dépôt où les chevaux étaient postés, c'est de là que vient le nom, s'appelait d'abord maître coureur; ce n'est que plus tard qu'il prit le nom de maître du poste, et enfin, celui de maître de poste.
Ce n'était pas alors une institution précisément démocratique, car il était formellement défendu de monter sur ces chevaux sans mandement du Roi, sous peine de la vie.
Ce grand roi n'y allait pas de main morte. Comme M. Thiers, interrompu par les clameurs de l'extrême gauche, disait à la Chambre: «J'ai l'habitude d'appeler Monseigneur les princes dont les familles ont régné sur la France.» De même, j'ai l'habitude d'appeler grands les rois qui l'ont agrandie.
Le règne de Louis XI nous a donné le Maine, l'Anjou, la Bourgogne et la Provence!
Ce grand prince donc, n'y allait pas de main morte; aussi les mauvaises langues de son temps, et même du nôtre, lui reprochent, à tort ou à raison (adhuc sub judice lis est), d'avoir fait pendre haut et court, sans autre forme de procès, ceux qu'il soupçonnait de tramer complots contre l'État et contre lui surtout.
Ce fait paraît certain, cependant, non seulement par les peintures un peu chargées de Walter Scott, dans Quantin Durward (à qui dirait-on la vérité si ce n'est à ses amis!) mais par l'ensemble des traditions historiques qui prouvent qu'il gouvernait plus par la crainte que par tout autre moyen; que, fils sans cœur, il fut aussi roi sans pitié, et que s'il abaissait les grands, il ne ménageait pas les petits; car il accablait, dit-on, le peuple d'impôts, beaucoup moins qu'aujourd'hui cependant.
Bien des gens sont portés, non pas à l'absoudre, mais à lui pardonner un peu, à cause de son amour pour le principe d'autorité, dont le besoin se fait plus que jamais sentir; il est bien entendu que je parle de celle qui mérite ce nom.
Si l'on n'avait pas alors la liberté de la tribune et de la presse, il paraît que les moines ne se gênaient guère pour dire dans leurs sermons ce qu'ils pensaient de sa justice sommaire, de son prévôt Tristan et de ses exécuteurs, qui supprimaient la prison préventive autrement que voulait le faire Napoléon III, quand il envoyait en Angleterre M. Valentin-Smith, pour étudier cette question.
Le roi ayant appris que le cordelier Maillard s'était permis de l'attaquer indirectement en chaire, il l'envoya prévenir que s'il recommençait, il le ferait jeter à la rivière.
Sans s'intimider, le disciple de Saint-François répondit à l'envoyé: «Va dire à ton maître que je ne crains rien; malgré la protection de Notre-Dame d'Embrun, dont il porte la médaille à son bonnet, je suis plus sûr d'arriver au paradis par la voie d'eau, que lui avec tous ses chevaux de poste.»
Louis XI se le tint pour dit, eut le bon esprit d'en rire, et laissa les moines tranquilles.
De notre temps, on s'empresserait de laïciser le couvent, après un siège en règle en cas de résistance; puis quelque agence interlope de Limoges et de Tours proposerait aux Cordeliers de changer leur corde contre le cordon de la Légion d'honneur, moyennant finances bien entendu.
C'est deux cents ans plus tard, sous Louis XIV, en 1664, que le marquis de Crénan, chargé de ce service, fit construire les premières chaises roulantes dans lesquelles il fut défendu, par arrêt de 1680, de courre la poste à deux personnes dans la même chaise.
L'invention se perfectionna plus tard. À la fin du siècle dernier la chaise de poste à deux roues pouvait contenir deux personnes et même trois. Le public fut autorisé à faire traîner ses voitures par les chevaux du roi.
En même temps, les lettres n'étaient plus transportées dans la sacoche ou le porte-manteau d'un courrier à cheval; on les mettait dans une malle chargée sur les voitures du gouvernement, qui partaient régulièrement et à heure fixe dans les principales directions.
C'est de là qu'est venu le nom de Malle de poste donné à l'ensemble du système qui sert au transport de la correspondance.
S'il n'y a plus aujourd'hui de malles de poste proprement dites, on appelle encore malle des Indes, le train rapide qui porte les dépêches d'Angleterre aux Indes, ainsi que les navires à vapeur qui se trouvent sur leur parcours.
La première malle de poste que j'ai vue, consistait en un briska, voiture à quatre roues, d'origine russe, ne contenant que deux places: une pour le courrier, responsable des dépêches et l'autre pour un voyageur payant sa place.
Plus tard, de 1825 à 1850, sur les principales directions, le briska fut remplacé par un grand et confortable coupé à trois places; un quatrième voyageur pouvait encore se placer dans le cabriolet de devant avec le courrier; ce qui l'obligeait à l'aider dans la distribution sur la route des paquets de correspondance, et à supporter pendant tout le voyage l'odeur de la marée dont ces agents faisaient un petit commerce à leur profit, toléré dans l'intérêt de quelques gourmets de province; car les turbots, les soles et les homards n'avaient aucun autre moyen rapide d'arriver sur les tables de l'intérieur de la France.
Le service des malles étant régulier et obligatoire, les chevaux étaient toujours prêts et choisis; elles allaient donc plus vite que les chaises particulières.
Dans toutes les plus petites villes, et souvent dans des hameaux situés sur les routes impériales, royales ou nationales suivant le temps, il y avait des maîtres de poste; ils n'étaient pas fonctionnaires publics, mais souvent ils étaient subventionnés par l'État et jouissaient de certains privilèges; en compensation, ils étaient obligés d'entretenir un certain nombre de chevaux déterminé par l'importance de la circulation et au moins une voiture légère, qui devaient toujours être à la disposition du public, d'un relai à l'autre dans les deux sens.
Quand arrivés au relai, les chevaux n'avaient pas la chance de trouver une voiture de retour, ils revenaient haut le pied à leur résidence.
Lorsque deux chaises marchant en sens inverse se rencontraient vers le milieu d'un relai, on faisait un échange de chevaux et de postillons.
Le tarif de la poste était fixé par cheval et par postillon pour la distance d'une poste, qui correspondait à deux lieues soit 8 kilomètres. Les relais étaient espacés de 16 à 20 kilomètres, soit deux postes à deux postes et demie.
Tous ceux qui voyageaient de cette manière avaient chez eux le livre de poste, comme nous avons le livret Chaix. Le livre de poste était bien moins répandu; car de tous les livres de notre littérature moderne et même de l'ancienne, le livret Chaix est certainement celui qui, chaque année, a le plus fort tirage; beaucoup de gens ne lisent pas d'autre livre que celui-là!
Dans le livre de poste, on trouvait toutes les routes de France, avec l'indication des relais et des prix, dans les circonstances diverses qui pouvaient se présenter. Il en était de même dans tous les pays d'Europe, où le service de la poste aux chevaux était établi.
Une chaise de poste était une espèce de cabriolet à deux grandes roues, avec de forts brancards, dont la caisse était très bien suspendue et qui demandait deux chevaux.
Le cheval placé entre les brancards ou limons, se nommait le limonier, l'autre sur lequel montait le postillon, se plaçait à gauche et se nommait le porteur; on l'attelait avec un palonnier. Tous les harnais étaient à bricole.
Le cheval de droite portait aussi le nom de sous-verge, parce qu'il se trouvait sous le fouet (ou verge), placé dans la main droite du postillon.
Il y a encore de vieux cochers, qui distinguent les deux chevaux d'une voiture à timon, par les noms de porteur et sous-verge.
Les anciennes traditions ont quelquefois la vie si dure, qu'après plusieurs siècles il y a des mariniers qui distinguent encore les rives du Rhône et de la Saône, par ces dénominations: côté de l'Empire, rive gauche; côté du Royaume, rive droite. Autre exemple:
À Rome, le Ier janvier 1888, les Italiens qui se pressaient pour assister dans l'église de Saint-Pierre, à la messe jubilaire du pape Léon XIII, pour exprimer leur impatience, criaient encore: per Bacco! (par Bacchus.)
Les voitures à quatre roues exigeaient un plus grand nombre de chevaux; quatre chevaux obligeaient à deux postillons.
Le nombre de personnes dans une voiture, au-dessus de deux, influait sur le nombre de chevaux obligatoires.
Le prix était I fr. 50 par poste et par cheval, et 75 centimes par postillon. On pouvait quelquefois éviter les chevaux supplémentaires en les payant I franc par poste, bien qu'on ne les mît pas.
C'est ce qui faisait dire à Balzac, dans un de ses romans, à propos d'une certaine dame: «Son mari était un personnage tout à fait fantastique; il ressemblait au troisième cheval qu'on paie toujours quand on court la poste et qu'on ne voit jamais.» De nos jours c'est encore de même, il en est plus d'un et plus d'une que je pourrais citer: et vous?
On appelait poste royale, une poste qui se payait double, à l'entrée et à la sortie de quelques grandes villes, et de celles où résidait la Cour.
Quand on voulait être bien mené, il suffisait de dire aux postillons ces mots magiques: En avant et doubles guides. Cela voulait dire que si l'on était content, on payerait I fr. 50 au lieu de 75 centimes par poste et par postillon; alors les chevaux ne quittaient pas le galop de tout le relai.
Lorsqu'on était pressé, et qu'on ne regardait pas à la dépense pour voyager en prince, on envoyait un courrier en avant. Un postillon à cheval partait à franc-étrier, arrivait au premier relai avant vous, et faisait préparer le nombre de chevaux dont vous aviez besoin; cela se répétait à chaque changement de chevaux. De cette manière on ne perdait point de temps aux relais.
Il paraît que dans tout pays la poste était chère, il y a un proverbe italien qui dit: La posta e spesa di principe ed un mestière di facchino. La poste dépense de prince est métier d'homme de peine.
On peut se rendre compte de ce que coûtait un voyage de Lyon à Paris et réciproquement, pour une ou deux personnes.
Quand on avait sa chaise, la traction seule s'élevait à 400 francs environ, plus ou moins, suivant l'état des chemins et la saison.
Si l'on n'avait pas de chaise il fallait en louer une, ce qui coûtait une centaine de francs en moyenne, ce prix était variable suivant les circonstances. C'était donc une dépense d'environ 500 francs, sans compter les frais des hôtels qui l'augmentaient beaucoup, si l'on ne marchait pas jour et nuit.
Ce chiffre peut être considéré comme exact. Au moment de la première invasion du choléra à Paris en 1832, qui débuta d'une manière foudroyante, emportant Casimir Périer, alors président du conseil des ministres, mes parents furent très inquiets, et se décidèrent à venir me chercher. On était si terrifié qu'ils arrivèrent seuls à Paris dans une grande diligence à vingt places; celles qu'ils rencontraient en sens inverse étaient au contraire toutes pleines de fuyards.
M'ayant trouvé bien portant et pas effrayé du tout, ils durent repartir tout de suite, par l'ordre des médecins; mais toutes les voitures publiques, malles et diligences étant encombrées, ils ne purent partir qu'en poste, en louant une calèche à Paris.
Ils me laissèrent 500 francs pour prendre aussi la poste et revenir à Lyon au galop, si le choléra arrivait à l'Ecole polytechnique.
Quoique fortement menacée au milieu du quartier Mouffetard, où les habitants étaient décimés, grâce à Dieu l'Ecole fut préservée, fort heureusement pour moi, pour mes 500 francs et pour beaucoup d'autres.
Le prix du voyage par la malle était beaucoup moins cher, 92 francs par personne; mais il était fort difficile d'avoir des places sans les retenir longtemps d'avance.
Pour ceux qui n'en avaient pas l'habitude, le règlement avec les postillons était ennuyeux et souvent compliqué. Mon père, fort expert dans cette manière de voyager, m'y avait initié de bonne heure.
Nous allions souvent à Sury, près de Montbrison; pour faire la course en une journée, il n'y avait que la poste. Longtemps avant que j'eusse barbe au menton, on m'avait confié ce service, qui n'était pas toujours commode.
Un jour nous partîmes de Lyon dans une petite calèche avec un seul cheval, le nôtre; à la poste de Brignais, naturellement, on en mit deux; à Rive-de-Gier on en mit encore deux, mais on en fit payer trois; à Saint-Chamond on voulait en mettre trois et nous en faire payer quatre.
Exaspéré de cette progression croissante, je fis mettre les quatre chevaux et deux postillons. C'est ainsi que nous fîmes une entrée triomphante à Saint-Etienne, sur la place Chavannel, dans la cour de la manufacture d'armes, qu'habitait mon oncle.
Les officiers d'artillerie se mettaient aux fenêtres, croyant à une inspection imprévue du ministre de la guerre; ce n'était qu'un écolier en vacances qui avait voulu faire claquer son fouet tout comme un autre.
Lorsque mon grand-père conduisait sa famille à Sury, avec sa voiture et ses chevaux, il couchait toujours en route.
Les chemins étaient si mauvais avant 1820, qu'il était tout à fait extraordinaire si, pendant le trajet, on ne versait qu'une fois.
Fâcheuses conséquences des guerres de Napoléon Ier, qui avait supprimé l'entretien des routes pour mieux assurer l'entretien de ses armées.
C'était une belle institution, la poste aux chevaux, surtout dans le moment de sa grande activité. Rien n'était plus vivant, et ne donnait plus envie de voyager, que de voir une grande berline avec siège devant et derrière, attelée de quatre beaux chevaux conduits par des postillons alertes, en habits bleus, bordés de rouge et galonnés, avec leurs grosses bottes, assez dures pour les préserver du contact des brancards et des timons.
De loin on entendait le claquement des fouets se mêlant au bruit joyeux des grelots, pour faire écarter les autres voitures; car c'était un privilège de la poste royale. On devait lui laisser le haut du pavé, ou le milieu de la chaussée.
C'était ordinairement de cette manière que faisaient leurs voyages de noces les jeunes mariés de bonne maison.
Mais quelques-uns partant à la nuit tombante, n'allaient que jusqu'au premier relai, revenaient en ville à la nuit close, et rentraient discrètement à pied dans leur maison, où personne ne venait les voir pendant quinze jours.
Sur les lettres d'invitation au mariage, on imprimait régulièrement en post-scriptum: On part pour la campagne, cela voulait dire: nous n'avons pas besoin de vous, ce n'est donc pas la peine de vous déranger. Ce n'était point un mensonge; on partait bien, en effet, pour le pays de Tendre; car alors, si l'on ne lisait déjà plus l'Astrée d'Honoré d'Urfé et les romans de Mlle de Scudéri, on en conservait encore les traditions.
Comme beaucoup de choses de ce monde, hélas! le postillon a disparu; ce n'est plus sur son cheval, mais seulement sur la scène, qu'on pourra voir encore le Postillon de Lonjumeau, quand l'Opéra-Comique sera reconstruit, car lui aussi vient de disparaître dans un affreux désastre, sans emporter cependant nos anciens souvenirs.
Les maîtres de poste ont fait comme le postillon; j'ai connu les deux derniers de Paris et de Lyon, MM. Dailly et Mottard; tous deux aimaient tant leurs chevaux qu'ils n'ont pas voulu s'en séparer.
C'est une affection que je comprends; car, si quelquefois ces rudes serviteurs ont des caprices, et qui n'en a pas! souvent ils montrent leur reconnaissance, en léchant la main qui les nourrit; et surtout jamais ils ne disent du mal de vous. Il y a cependant des savants qui ne connaissent ces nobles bêtes que sous le nom de moteurs animés.
Avez-vous jamais, lecteur, conduit à grandes guides un quadrige de superbes normands ou de vigoureux Percherons?
Je pourrais, je crois, parier cent contre un, que cela ne vous est jamais arrivé.
Avez-vous jamais dirigé une véritable locomotive?
Il y a encore moins de chances pour que vous me donniez une réponse affirmative.
Eh bien! par extraordinaire et volontairement, je me suis trouvé dans des circonstances qui m'ont permis de me livrer à ces deux exercices.
De 1841 à 1845, avant l'ouverture du chemin de fer du Nord, pour le service de la navigation, j'allais plusieurs fois la semaine à Pontoise, par la berline qui, en partant de Paris, traversait les Champs-Elysées.
Du conducteur je m'étais fait un ami, pour que cette liaison me mît en rapport direct avec ses magnifiques gris-pommelés.
J'avais obtenu la faveur de me placer à côté de lui sur son siège, et tout naturellement ses guides passaient souvent de ses mains dans les miennes; car les hommes de travail perdent rarement une bonne occasion qui se présente de se reposer.
Quelques années plus tard, en 1848, allant tous les jours de Paris à Versailles, pour le chemin de fer de Rennes, je montais très souvent sur la locomotive à côté du mécanicien, alors sans aucun abri, afin de m'initier aux détails pratiques de son métier (car dans cette année d'effervescence générale, les ingénieurs furent obligés plusieurs fois d'assurer eux-mêmes le service). Souvent ma main novice maniait sous ses yeux le régulateur, et la machine docile m'obéissait comme à son véritable maître.
Vous me croirez sans peine si je vous dis que j'avais infiniment plus de plaisir et d'émotions à contenir, exciter, entendre hennir et voir piaffer les coursiers de mon Four in hand, qu'à entendre souffler, siffler et grincer sous ma main la locomotive de Versailles R. G.
Pour conserver ce qu'ils appelaient leur cavalerie, en échange de leurs brevets aristocratiques de Maîtres de Poste, MM. Dailly et Mottard, ont obtenu à Paris et à Lyon des concessions d'omnibus qui sont remplacés déjà par les tramways plus démocratiques encore.
Sic transit gloria mundi, qu'on peut traduire ainsi en s'inspirant de Lamartine:
Ainsi tout change, ainsi tout passe,
Ainsi nous-mêmes nous passons
Sur le railway qui prend la place
De la poste et des postillons.
Tout ce que je viens de dire pourrait s'intituler: Exposé théorique de la poste aux chevaux; la pratique souvent n'était pas aussi brillante.
Le mauvais état général des routes, surtout en hiver, leurs lacunes nombreuses et le manque de ponts sur le plus grand nombre des rivières, rendaient les voyages très difficiles.
Pour vous donner une idée vraie sur ce point des mœurs et usages du vieux temps, je me propose de faire passer sous vos yeux, si mon livre y est encore, quelques épisodes de mes voyages et de ceux de ma famille, que j'ai retrouvés, partie dans mes souvenirs, partie dans des manuscrits authentiques que j'ai eu la chance heureuse de rencontrer.
Cela fera l'objet des chapitres suivants.