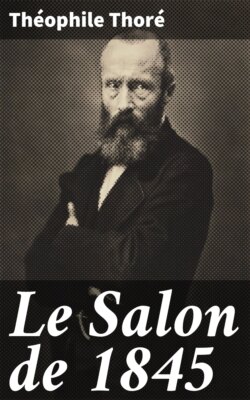Читать книгу Le Salon de 1845 - Théophile Thoré - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A BÉRANGER.
ОглавлениеTable des matières
Votre nom, Monsieur, représente mieux qu’aucun autre le sens direct de notre tradition nationale dans les lettres et dans les arts. Vous êtes de la grande famille française de Rabelais, de Molière et de La Fontaine. Tandis que la poésie du XIXe siècle s’aventurait dans des routes obscures et étrangères, vous, Monsieur, au lieu d’être cosmopolite par la forme du style, vous vous êtes contenté d’être humain par le fond même du sentiment et de la pensée. C’est une synthèse qui vaut bien l’autre. C’est la qualité des artistes immortels; car ils se Continuent ainsi dans l’âme de l’humanité dont ils ont réfléchi quelque vertu permanente. Au contraire, l’art qui s’attache imprudemment à la forme seule, passe de mode et se renouvelle sans cesse, quel que soit le charme du style extérieur.
L’art des vrais grands maîtres dissimule naturellement les procédés de l’exécution; il vous frappe par un caractère plus essentiel et plus profond que l’enveloppe plastique. Telle est la sculpture grecque de la belle époque, quoique l’art antique, en général, puisse être accusé de sensualisme relativement à l’art chrétien. La Minerve du Parthénon était sortie vivante et chaste du cerveau de Phidias, suivant le symbole mythologique. En contemplant la Vénus de Milo, vous avez d’abord un sentiment qui précède l’analyse de sa beauté. Tel est encore l’art de Raphaël, où l’habileté n’est considérable qu’après l’invention. Tel est Molière, supérieur peut-être à tous les grands hommes de toutes les littératures par le naturel et la simplicité de son style. Le beau style est comme une flèche dont on sent la piqûre sans avoir vu le trait dans l’air. Ainsi, le génie de Molière est un arc si bien tendu, qu’il vous envoie au cœur une atteinte inévitable, avant que vous ayez saisi le mouvement de la main qui prépare le coup. Mais, arrachez la flèche, et vous admirerez comme elle est aiguë, fine et souple, et vigoureuse, et ciselée à plaisir.
Votre talent a de l’analogie avec celui de Molière: la grandeur dans la naïveté, la clarté et la raison; dessin ferme, couleur franche; toutes qualités particulièrement propres au génie français. Vous avez comme Molière une sensibilité mélancolique qui donne souvent à vos vers une teinte douce et harmonieuse. Vous avez comme lui cette rare faculté de mettre dans le premier sujet venu une signification profondément humaine. Une comédie de Molière, tirée au hasard, vaut sans doute un poëme épique. Je ne par e pas du Misanthrope et de Tartufe, qui sont deux chefs-d’œuvre travaillés et qui annoncent, par leur conception même, devoir toucher à la philosophie, à la morale, à la politique, aux vices et aux vertus du cœur, et aux conditions de la société. Ce sont des tableaux d’histoire, comportant la méditation du sujet et le soin de la forme. Mais prenons cet autre chef-d’œuvre sans prétention, ce délicieux tableau de genre qui a nom l’École des Femmes: un homme coiffé d’une idée ridicule, un ami bavard, une fille niaise et rusée et un jeune fou. Le comique superficiel est assurément dans la situation de confident où Horace tient sans cesse Arnolphe; il est aussi dans le caractère d’Agnès, dans l’entêtement de son tuteur, dans l’impassibilité railleuse de Chrysalde. Cela suffit à en faire une pièce charmante et la plus amusante du monde. Mais pénétrez plus avant dans le caractère d’Arnolphe. Cet Arnolphe, avec son esprit borné et opiniâtre, ne vous inspirerait qu’un médiocre intérêt, s’il n’avait pas en même temps de la passion:
Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse,
Et cependant je l’aime, après ce lâche tour,
Jusqu’à ne me pouvoir passer de cet amour.
Voilà un trait de grand maître, et qui touche subitement. De la plus légère des fantaisies de Molière, comme de cette sublime comédie de l’École des Femmes, jaillit toujours un sentiment vrai, naturel, impérissable dans l’humanité.
Vous aussi, Monsieur, comme Molière dans ses improvisations, que vous touchiez un sujet quelconque, les Gueux ou les Deux Sœurs de Charité, le Petit Homme gris ou la Frétillon, vous êtes l’interprète si juste du sentiment commun, que tout le monde vous sait aussitôt par cœur, rien qu’à vous entendre; car vous exprimez simplement ce qui est la vie, et vous découvrez la vie où elle est, — partout.
C’est ici que j’en voulais venir, par application à l’art des peintres et des sculpteurs. Vous vous rappelez, Monsieur, ces luttes de la critique depuis quinze ans, les uns soutenant que l’art ne signifie rien du tout, que c’est un caprice bizarre ét individuel, inintelligible pour le vulgaire; les autres, ayant l’instinct de la divinité de l’art, exigeant que le style et la forme fussent toujours le vêtement d’une pensée significative. Ceux-là répondaient qu’il suffisait que la statue fût belle, oubliant que Pygmalion voulait encore l’animer d’un rayon volé dans les cieux. Mais nous, plus ambitieux que ces matérialistes modernes, nous aspirions toujours, comme l’artiste antique, à voir descendre la vie divine et humaine dans la forme créée spontanément. Nous appellions l’art une création vivante, ou l’expression de la vie. On nous passait volontiers cette manie dans les sujets historiques ou dans les grandes compositions. Mais, disait-on, que vient faire votre art humanitaire dans une fantaisie improvisée par un peintre? Vous n’avez pas besoin d’être un grand philosophe pour représenter quelque Bohémien en haillons, couché au soleil, ou une bergère cueillant des fleurettes.
Si bien que cette théorie frivole aboutissait à supprimer l’homme sous le haillon, la femme sous l’étoffe de soie. Il ne restait plus de l’art qu’une défroque vide. Mais ces apôtres de l’indifférence oubliaient même l’art hollandais et l’art flamand, dont les maîtres ont su faire naïvement des hommes et des femmes sous la plus humble apparence. Les buveurs débraillés d’Adrien Brauwer ou de Crasbeecke sont des personnages vivants au même titre que les nobles personnages de Raphaël, quoique dans une condition différente. Les Sganarelles de Molière ne céderaient pas leur âme à Hamlet, ce fils de roi, ou à Agamemnon, le roi des hommes.
Nos adversaires s’imaginaient triompher bien plus facilement encore à l’endroit du paysage et de la nature inanimée. Quelle signification donner à un intérieur de forêt, à une vue de campagne baignée de lumière, à une cour de ferme, à une mare où les canards barbotent entre les joncs? Mais ils oubliaient aussi, sans parler des grands paysagistes comme Le Poussin et Claude, que les petits maîtres hollandais ont empreint leurs paysages d’un sentiment immatériel et profondément poétique. Nous avons cité souvent la Vache philosophe, de Paul Potter, et le Buisson mélancolique, de Ruysdaël, qui sont au Louvre. Il y a encore au Musée un autre paysage de Ruysdaël, une sombre marine, appelée la Tempête, où l’artiste a jeté une partie de son âme. La mer furieuse occupe toute la toile et s’insurge partout contre un ciel lépreux, taché de plaques noires. A droite, dans un petit coin, on voit cependant une maisonnette en chaume, plantée comme sur une motte de terre que protège une grossière palissade de pieux enfoncés dans l’eau. Le vent, la pluie, l’orage, battent par en haut cette frêle retraite, tandis que les vagues en font le siège tout autour et se précipitent avec grand bruit contre le talus, comme des guerriers grimpant à l’assaut. La masure accroupie sur un sol mobile résistera-t-elle à cette attaque implacable? Cela ne me paraît point insignifiant du tout, et ce drame vaut, à mon avis, tous les drames castillans, moyen-âge et autres, où s’agitent de belles loques avec un cliquetis de ferraille; car la vie humaine se trouve intéressée dans ce grand chaos naturel. A propos, cette maisonnette n’est-elle point habitée? Puisque voici le fourreau, comme dirait un romantique, où donc est la lame? Hélas! il y a peut-être sous ce chaume, une famille de paysans qui se recommandent au bon Dieu; ou, peut-être, ces hardis enfants de la côte ont-ils abandonné leur nid à la tempête, pour aller dans quelque barque secourir de leurs bras, les navires égarés et balottés contre le rivage.
Mais parmi les contemporains, les véritables peintres, les véritables poètes, n’ont-ils pas toujours transporté l’homme, ou plutôt le sentiment humain, même dans la nature déserte. Rousseau, qui nous revient sans cesse quand il s’agit de poésie dans la peinture, a trouvé, un jour, une allée de châtaigniers dans un coin retiré de la Vendée, ce pays si original et si sauvage, dont la végétation vigoureuse a une couleur particulière, dont les arbres sans souci ont des tournures merveilleuses. Il a copié tout bonnement son allée de face. On y entre au bord de la toile comme dans la grande gueule d’un entonnoir, et l’on n’en sort pas; mais tout au fond, bien loin, on aperçoit le jour à l’orifice extrême de cette caverne de branches entrelacées et d’épais feuillages. Vous n’avez point de ciel au-dessus de vous, ni à droite, ni à gauche; car les arbres plantés tronc à troue s’emmêlent comme des lianes dans une forêt vierge, ou comme des arabesques le long des lambris et de la voûte d’un édifice. Seulement à quelques points de cette voûte verdoyante, de petits rayons tremblotants de lumière éclatent entre les feuilles agitées, comme des étoiles scintillantes au firmament du soir.
En considérant cette belle peinture, on éprouve la même impression que lorsqu’on entre seul dans une vaste cathédrale gothique, aux colonnes élancées, aux décorations capricieuses. La percée de ciel, à l’extrémité de l’allée mystérieuse, est comme l’autel radieux au fond du monument sombre.
Un pareil tableau est assurément de l’ART POUR L’HOMME et non point de l’art pour l’art. Je ne dis pas que cette poésie ne soit pas dans la nature; mais encore il faut l’y sentir et l’exprimer. L’artiste n’est pas seulement un œil comme le daguerréotype, un miroir fatal et passif, qui reproduit physiquement l’image qu’on lui présente; cest une àme mouvante et créatrice qui féconde à son tour la création extérieure. La nature est la mère voluptueuse qui provoque la passion de son amant, et l’art est le fruit de cette divine union.
L’allégorie est tellement inhérente à l’art véritable, que les peintres les plus spontanés, dévoués seulement à l’image, sans préoccupation de la pensée qui est dessous, font quelquefois des tableaux où la réflexion découvre des poëmes symboliques et des analogies que l’auteur n’a pas soupçonnés. J’ai vu souvent des artistes bien surpris des explications que la critique donnait de leurs ouvrages. Ils disent à cela qu’ils se moquent du symbole, et que l’art est un entraînement irréfléchi qui n’est pas forcé d’avoir conscience de sa raison. Raphaël et le poussin n’en disaient pas autant. Mais prenons les peintres comme ils sont aujourd’hui. Ce n’est pas leur faute si la philosophie et la pensée ont été proscrites de la société bourgeoise; et, après tout, qu’importe le procédé, si le résultat satisfait aux conditions de l’art?
M. Decamps, qui est un homme de vive impression, mais très indifférent aux théories, s’est inspiré souvent du Don Quichotte de Cervantes, ce poëme si humain dans le fond, si espagnol par la forme; car le procédé de l’art espagnol est invariablement le contraste, dans la peinture comme dans la littérature; contraste de la lumière et de l’ombre dans les tableaux; lutte de deux principes opposés dans les drames et les romans. C’est là tout Cervantes, avec une forme inimitable: d’un côté, l’élan héroïque de l’âme à la recherche des aventures périlleuses; de l’autre la résistance du corps sensuel et prudent. Don Quichotte ressemble plus qu’on ne le pense aux moines ascétiques de Zurbaran, et Sancho aux joyeux compagnons que Vélasquez et Murillo ont enflammés de leurs belles couleurs.
Je suppose que M. Decamps ne s’est jamais tourmenté du sens de Don Quichotte, et quelquefois, en effet, il a peint l’austère chevalier avec une grave irrévérence, bien voisine de la caricature. Mais cependant, un certain jour, il a vu les deux aventuriers entrant solennellement dans la montagne Noire, sous un aspect qui est une interprétation parfaite du roman espagnol. Le petit chef-d’œuvre de M. Decamps, exécuté légèrement à l’aquarelle, a été gravé à l’aquatinte par M. Prévost, et publié autrefois par l’Artiste. Il représente Don Quichotte et Sancho, arrivant de face sur un grand chemin, au milieu d’une campagne brûlée par le soleil et sillonnée de roches arides. Ce chemin de la vie est un théâtre sinistre qui dispose bien au drame. Le chevalier errant, armé de pied en cap et serrant sa lance, se tient droit et ferme sur ses étriers, toujours disposé au combat. Il regarde devant lui ce que la Providence daignera lui envoyer. Il est effilé verticalement, long et haut comme un peuplier qui monte au ciel, tandis qu’à son côté, Sancho, qui l’accompagne, s’étale horizontalement sur son âne, la panse en avant, sa grosse main reposée mollement sur sa cuisse arrondie. Le corps insouciant prend ses aises en suivant l’âme inquiète. Taudis que Don Quichotte est casqué jusqu’aux sourcils, et comprimé dans son armure de fer, Sancho a rejeté en arrière son souple chapeau, pour s’éventer un peu le crâne, et il a lâché quelques boutons de sa casaque pour ne pas gêner sa digestion. Sa tête rubiconde est tournée vers le maître, qui n’y prend garde, et qui contemple sans doute quelque grande chose dans sa pensée, sans écouter les propos et les sages conseils de son écuyer.
Ne connaissez-vous pas tout Cervantes, après ce croquis spirituel, où la vie humaine est symbolisée dans ses deux types les plus différents!
Il s’agit donc, quels que soient le sujet et la forme d’une œuvre d’art, tableau ou statue, que l’artiste y fasse intervenir un sentiment intime, naturel, irrécusable, qui se communique aux autres hommes, qui les éclaire ou les moralise. Le vieux proverbe du théâtre est applicable à tous les arts, ainsi que le vers du poète latin: corriger en amusant, mêler l’utile à l’agréable. Hélas! l’art contemporain est si éloigné de cette tendance élémentaire, qu’on ne sait même comment s’y prendre pour le ramener à une signification quelconque, et que les vérités les plus simples semblent de hardis paradoxes aux yeux éblouis de notre génération.
Là, Monsieur, est votre supériorité glorieuse et incontestable, et vous êtes un exemple vivant qu’on peut citer à nos peintres, sans grande espérance de le voir imiter. Vous avez bien prouvé qu’il n’y a point de petits sujets ni de petites formes, qu’il n’y a que de petits artistes; car le génie change les proportions de toutes choses. Vous avez pris la chanson et vous l’avez élevée à l’ode et au poëme. Vous avez pris des gueux, et vous en avez fait de grands philosophes. Vous avez pris des fous, et vous en avez fait des révélateurs. A propos de bouteilles et de vivandières, ou de n’importe quoi, vous avez ravivé l’esprit français et évoqué tous les sentiments généreux du patriotisme et de l’Égalité. Vous êtes, comme l’a dit Pierre Leroux, le fils de cette grande génération de la fin du XVIIIe siècle, qui fit la Révolution. Vous êtes peuple et philosophe, comme Diderot et Voltaire, et comme eux, vous avez mis votre poésie au service de l’Humanité.